© Éditions Charles Léopold Mayer, 2022.
Essai n° 248
ISBN : 978-2-84377-231-3
© 2019, David Bollier et Silke Helfrich pour la version anglaise.
Ce livre est sous licence Creative Commons Attribution – Pas d’utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions.
Lis le
- Préface À L’édition Française
- Introduction
- Première Partie : Les Communs : Une Perspective Transformatrice
- I. Communs Et Commoning
- II. Un Changement De Perspective Ontologique
- III. Le Langage Et La Créativité Des Communs
- Deuxième Partie : La Triade Des Communs
- Introduction
- IV. La Vie Sociale Des Communs
- V. La Gouvernance Par Les Pairs Dans Les Communs
- VI. L’approvisionnement Par Les Communs
- Troisième Partie : Étendre Le Communivers
- Introduction
- VII. Repenser La Propriété
- VIII. Relationaliser La Propriété
- IX. Pouvoir D’état Et Pratique Des Communs
- X. Faire Passer La Pratique Des Communs À Une Nouvelle Échelle
- Conclusion
- Remerciements
- Annexe A. Notes Sur La Méthodologie D’identification Des Patterns Du Commoning
- Annexe B. Communs Et Outils De Commoning Mentionnés Dans Ce Livre
- Annexe C. Les Huit Principes De Conception D’elinor Ostrom Pour Des Communs Viables
- Notes
Préface À L’édition Française
« L’objet de ce livre est de surmonter une épidémie de peur à travers un élan d’espoir concret. » Lorsque nous avons écrit ces mots dans la version anglaise de ce livre parue en 2019, nous n’avions aucune idée de l’arrivée prochaine d’une pandémie qui allait changer le monde. Quelques mois plus tard, avec la propagation du Covid-19 aux quatre coins de la planète, notre foi dans la pratique des communs comme vecteur d’« espoir concret » n’a pas été démentie. L’essor spontané de réseaux de solidarité et de soutien mutuel, comme des milliers d’autres initiatives relevant de ce que nous appelons le commoning, a confirmé qu’il était tout à fait possible – et souhaitable – de répondre à nos besoins à travers une éthique sociale de coopération et de réciprocité.
Alors que la peur et les crises incitent de nombreuses personnes à chercher des réponses du côté de démagogues autoritaires, un univers de communs en pleine croissance propose des voies de changement positives, vivantes, qui renforcent notre liberté. Les communs offrent des moyens socialement constructifs de satisfaire nos besoins, de cultiver une éthique de sobriété et de favoriser un sentiment d’utilité et d’appartenance. Ils montrent que le changement n’est pas quelque chose qui pourrait être simplement imposé d’en haut, mais qu’il doit être mis en œuvre aux niveaux cellulaires de la société avant de s’étendre à plus grande échelle.
Dans un contexte où les institutions hypertrophiées de la modernité capitaliste vacillent et s’effritent – avec une gouvernance du marché/État de plus en plus inefficace, des chaînes d’approvisionnement mondiales fragilisées, des bureaucraties impuissantes et notre échec général à nous adapter aux systèmes terrestres vivants –, les communs montrent qu’un autre monde est non seulement possible, mais qu’il est déjà en train, tranquillement, de mûrir. Un Communivers émergent est en train de mettre en place, dès maintenant, des formes d’approvisionnement plus humaines et plus écologiques, sans attendre l’autorisation des dirigeants politiques, des juges ou de la finance mondiale. Les commoneurs ne se fient ni à la bienveillance de l’État, ni à l’illusion de la main invisible du marché – ils savent que les gens ordinaires ont toute la créativité, tout l’engagement et tout le savoir-faire nécessaires pour construire leurs propres alternatives au système du marché/État qui les déresponsabilise et les maintient dans une position de subordonnés. La pratique des communs permet aux gens de sortir du monde moderne « normal » de l’hyperindividualisme, du consumérisme, de la concurrence et de la croissance économique. En nous invitant à ralentir et à prendre soin des besoins des autres et de la Terre, les communs donnent au mot « valeur » un sens plus large et plus riche, quasi sacré. La valeur n’est plus définie par le prix commercial ni restreinte aux seules marchandises. Nous réapprenons à voir que la valeur s’épanouit à travers nos relations sociales – ainsi qu’à travers nos relations avec les forêts et l’atmosphère, les océans et la Terre. La valeur est la vie elle-même.
Face à l’inexorable réchauffement de l’atmosphère terrestre, cette reconnaissance arrive à point nommé. Le penseur français de la modernité Bruno Latour a noté que le changement climatique remettait en question les rêves capitalistes de « développement » et de mondialisation. Les limites finies de la Terre s’imposent à nous et les fantasmes capitalistes s’estompent et vacillent, laissant un vide énorme dans nos consciences. Nous, les modernes, en l’absence d’un grand récit partagé du progrès de la civilisation par la croissance économique infinie et la conquête de la « nature », nous retrouvons profondément désorientés.
Latour soutient de manière convaincante que nous avons besoin d’un nouvel « attracteur » pour nous aider à formuler une vision postcapitaliste innovante de l’humanité, soucieuse de l’écologie. Il en appelle à une nouvelle histoire pour l’humanité tournant autour du « terrestre », c’est-à-dire la Terre comme « un endroit où atterrir – un paradigme qui rejette les fantasmes de la modernité et nous reconnecte aux réalités biophysiques de la vie ». Bien que Latour ne mentionne pas explicitement les communs, ils incarnent certainement ce qu’il vise à travers la notion de « terrestre » : un lieu pour réimaginer la vie, la politique, l’économie, la culture et la conscience en les intégrant dans les systèmes planétaires. Le langage des communs nous aide à évoluer vers un nouveau paradigme du « terrestre » en développant des relations de réciprocité et de respect en synergie avec Gaïa – la Terre comme système planétaire dynamique et vivant. C’est d’ailleurs l’un des objectifs de ce livre: montrer comment les divers « patterns » de Gouvernance par les pairs et d’approvisionnement par les communs peuvent nous aider à nous réveiller de nos prétentions modernistes et à redécouvrir Gaïa. Les cosmologies développées par d’innombrables peuples au cours des millénaires ont beaucoup à nous apprendre.
Je suis ravi que cette édition française de notre livre vienne rendre la dynamique profonde des communs encore plus accessible aux lecteurs francophones. Les commoneurs de France, d’Afrique francophone et du Canada ont toujours été parmi les plus créatifs et les plus engagés au sein du réseau transnational des commoneurs. J’espère que ce livre permettra non seulement d’honorer et de faire connaître leur travail, mais aussi d’inciter d’autres à étendre encore le territoire des communs dans les années à venir – car c’est très certainement nécessaire. Pour avoir rendu ce livre possible, je souhaite remercier mes collègues Frédéric Sultan de Remix the Commons, Heike Löschmann du bureau tunisien de la Fondation HeinrichBöll, le coordinateur de la traduction Olivier Petitjean et l’équipe de traducteurs Benjamin et Connie Chow-Petit, Léa Eynaud, Sylvia Fredriksson et Nicolas Sauret, les relecteurs Bernard Brunet et Camille Laurent.
Dans l’heureuse occasion qu’est la publication de ce livre, mon seul regret est que ma coautrice et amie Silke Helfrich ne puisse se joindre à moi pour écrire cette préface. Silke est décédée tragiquement à l’âge de 54 ans, en novembre 2021, dans un accident de randonnée au Liechtenstein. Pendant quinze ans, nous avons travaillé ensemble en tant qu’activistes-stratèges-théoriciens- collaborateurs-réseauteurs-vulgarisateurs des communs – elle depuis l’Allemagne, et moi depuis le Massachusetts aux États-Unis. Silke a été une partenaire irremplaçable dans mes nombreuses entreprises. Elle connaissait cinq langues, avait visité d’innombrables projets relatifs aux communs dans le monde entier, entretenu un vaste réseau de collègues et assisté à des dizaines de conférences et d’ateliers. Ce livre aura été notre collaboration la plus mémorable, une ambitieuse tentative de synthétiser et de distiller nos quinze années de travail sur le terrain, de voyages, de partage, de débats, de lectures et de réflexions sur la pratique des communs. Les recherches, les discussions et l’écriture de ce livre ont duré trois longues années – mais en un sens, celui-ci est aussi le produit d’une odyssée de quinze ans.
Il est triste que Silke ne soit pas là pour se réjouir de l’intérêt international croissant pour les communs. Elle a vu la publication des éditions allemande et espagnole de ce livre, mais pas celle en 2022 de l’édition grecque, de cette traduction française ou de la version portugaise à venir. Pendant ce temps, les communs, en tant que paradigme à la fois ancien et nouveau d’organisation et de gouvernance sociales, connaissent une renaissance. Alors que les lacunes du système marché/État deviennent douloureusement évidentes, notamment en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique, une nouvelle génération de chercheurs, d’activistes et de gens ordinaires adopte les communs comme moyen d’imaginer et de mettre en œuvre un avenir postcapitaliste. Les communs sont à la fois un cadre intellectuel versatile, un récit convaincant et un ensemble puissant de pratiques et d’expériences sociales permettant de dépasser les identités limitées de l’Homo economicus et du citoyen. Être un commoneur, c’est s’ouvrir à une vie plus vaste : aux mystères de nos vies intérieures, à de nouvelles pratiques sociales et éthiques, à des structures institutionnelles innovantes et à une Gouvernance par les pairs horizontale – tout cela est interconnecté !
Avec cette toile de fond en tête, j’espère que les lecteurs trouveront cette merveilleuse édition française de Free, Fair and Alive. The Insurgent Power of the Commons instructive et inspirante. La meilleure mesure de son succès sera d’inciter les lecteurs à inventer leurs propres innovations dans le domaine des communs, à les enraciner dans leurs environnements locaux et à développer leurs propres styles de commoning. L’avenir des communs réside dans notre capacité à faire preuve d’initiative et de créativité par nous-mêmes, puis à émuler et fédérer nos projets. C’est ainsi que nous pourrons développer des communs plus vastes, plus influents, plus résilients et plus profonds. Puisse ce livre contribuer à une meilleure compréhension des communs et à ce qu’ils poursuivent leur dynamique d’expansion et réalisent tout leur potentiel !
David Bollier, Amherst, Massachusetts, 8 juillet 2022
Introduction
Tant que nous nous laisserons emprisonner par nos craintes, nous ne trouverons jamais les solutions dont nous avons besoin pour construire un monde nouveau. Bien sûr, nous avons beaucoup de bonnes raisons d’avoir peur : le chômage, l’essor des régimes autoritaires, les abus des grandes entreprises, la haine raciale et ethnique. Sans oublier, par-dessus tout, le réchauffement du climat planétaire qui constitue une menace existentielle pour la civilisation elle-même. Nous voyons, émerveillés, des sondes spatiales détecter de l’eau sur Mars, tandis que les gouvernements ne parviennent pas à assurer l’accès à l’eau potable pour tous les habitants de la Terre. Les technologies permettront peut-être bientôt à certains de modifier les gènes de leurs enfants à naître comme du texte sur un ordinateur, mais nous ne savons pas trouver les moyens de prendre soin des malades, des personnes âgées et des sans-abri.
La peur et le désespoir sont alimentés par notre sentiment d’impuissance, l’impression que nous ne pouvons pas, en tant qu’individus, peser sur la trajectoire actuelle de l’histoire. Or cette impuissance a beaucoup à voir avec la façon même dont nous concevons notre sort – comme individus seuls et séparés. La peur et notre quête bien compréhensible de sécurité individuelle paralysent la recherche de solutions collectives et systémiques, les seules qui seraient véritablement efficaces. Il faut donc reformuler notre dilemme : que pouvons-nous faire ensemble ? Comment pouvons-nous le faire en dehors des institutions en place, qui ne sont pas à la hauteur ?
La bonne nouvelle est que d’innombrables graines de transformation collective sont déjà en train de germer. Il y a des pousses vertes d’espoir dans les fermes agroécologiques de Cuba et les forêts communautaires d’Inde, dans les systèmes Wi-Fi citoyens de Catalogne et les équipes de soins infirmiers de proximité aux Pays-Bas. Elles éclosent sous la forme de dizaines de monnaies locales alternatives, de nouveaux types de plateformes coopératives en ligne et de campagnes citoyennes de reconquête des villes au bénéfice des gens ordinaires. La beauté de ces initiatives est qu’elles satisfont de vrais besoins de manière directe et tout en favorisant l’autonomie. Les gens savent répondre présent pour inventer de nouveaux systèmes, libérés de la mentalité capitaliste, pour leur bénéfice mutuel, dans le respect de la Terre et dans une perspective de long terme.
En 2009, à Helsinki, un groupe d’amis assistait avec frustration à l’énième échec d’un sommet international sur le changement climatique. Ils se sont demandé ce qu’ils pouvaient faire eux-mêmes pour changer l’économie. Après beaucoup de discussions préparatoires, leur questionnement a donné naissance à une « Bourse de crédit » de quartier, à travers laquelle les participants acceptaient d’échanger entre eux des services allant de la traduction à des leçons de natation en passant par du jardinage et de l’édition de textes. Donnez une heure de votre expertise à un voisin et recevez une heure de talent d’un autre. La banque de temps d’Helsinki, comme elle a fini par s’appeler, est désormais une robuste économie parallèle à elle seule, comptant plus de 3 000 membres. À travers l’échange de dizaines de milliers d’heures de services, elle est devenue une alternative conviviale à l’économie de marché, partie prenante d’un vaste réseau international de banques de temps.
À Bologne, en Italie, une femme âgée voulait simplement qu’il y ait un banc dans l’un de ses lieux de rencontre favoris de son quartier. Lorsque les habitants ont demandé à l’administration municipale s’ils pouvaient installer eux-mêmes ce banc, les bureaucrates locaux ont répondu, perplexes, qu’il n’existait aucune procédure pour cela. Ce fut l’origine d’un long processus qui a débouché sur la création d’un système formel de coordination des collaborations entre les citoyens et la municipalité de Bologne. La ville a finalement adopté le règlement de Bologne pour l’entretien et la régénération des communs urbains afin d’organiser des centaines de « pactes de collaboration » entre les citoyens et l’administration – pour réhabiliter des bâtiments abandonnés, gérer des jardins d’enfants, prendre soin des espaces verts urbains. Cette initiative a depuis donné naissance au mouvement Co-city, qui orchestre des collaborations similaires dans des dizaines de villes en Italie.
Face au changement climatique et aux inégalités économiques, ces efforts ne restent-ils pas cependant douloureusement trop petits et trop locaux ? C’est précisément là l’erreur que commettent les traditionalistes. Ils se focalisent tellement sur les institutions de pouvoir, qui ne cessent de nous décevoir, et font une telle fixation sur l’échelle mondiale des problèmes qu’ils ne voient pas que les véritables forces de changement structurel prennent naissance à petite échelle, dans de petits groupes de personnes, loin des regards du pouvoir. Les sceptiques du « petit » sont les mêmes qui se moquent des agriculteurs qui sèment des grains de riz, de maïs et de haricots : « Vous allez nourrir l’humanité avec… des graines ?! » En réalité, les petites initiatives dotées de capacités d’adaptation peuvent s’avérer de puissants vecteurs de changement systémique. Il existe aujourd’hui un immense univers d’initiatives sociales à la base – familières ou nouvelles, dans tous les domaines de la vie, dans des territoires industrialisés ou ruraux – qui satisfont avec succès des besoins auxquels l’économie de marché et le pouvoir d’État sont incapables de répondre. La plupart de ces initiatives restent invisibles ou ne sont pas identifiées comme relevant d’un mouvement plus large. Dans l’esprit du public, elles sont souvent traitées avec condescendance, ignorées ou considérées comme des aberrations marginales. De fait, elles existent en dehors des systèmes de pouvoir dominants – l’État, le capital, les marchés. Les esprits conventionnels s’appuient toujours sur des solutions éprouvées et n’ont pas le courage d’expérimenter, même si les formules prétendument gagnantes de la croissance économique, du fondamentalisme de marché et de la bureaucratie ne peuvent plus cacher leurs profonds dysfonctionnements. La question n’est pas de savoir si une idée ou une initiative est petite ou grande, mais si ses prémisses contiennent un germe de changement global.
Évitons tout malentendu : les communs ne se résument pas à des projets à petite échelle visant à améliorer la vie quotidienne. Ils sont une vision séminale pour réimaginer ensemble notre avenir et réinventer notre organisation sociale, notre économie, nos infrastructures, notre politique et le pouvoir d’État lui-même. Les communs sont une forme sociale qui permet aux gens d’être libres sans opprimer les autres, d’assurer l’équité sans contrôle bureaucratique, de favoriser l’être-ensemble sans contrainte et d’affirmer une souveraineté sans nationalisme. Le chroniqueur George Monbiot a bien résumé les vertus des communs : « Un commun […] donne à la vie collective une orientation claire. Il repose sur la démocratie dans sa forme la plus authentique. Il détruit l’inégalité. Il incite à protéger le monde vivant. Il crée, en somme, une politique de l’appartenance1. »
C’est ce que reflète le titre anglais de notre livre consacré aux fondements, à la structure et à la vision des communs : Free, Fair and Alive [« Libres, équitables et vivants »]. S’émanciper du système en place implique d’honorer la liberté au sens humain le plus large et non seulement au sens de la liberté économique libertarienne de l’individu isolé. Cela exige de placer l’équité, mutuellement acceptée, au centre de tout système d’approvisionnement et de gouvernance. Et cela implique de reconnaître notre existence en tant qu’êtres vivants sur une Terre elle-même vivante. La transformation ne peut avoir lieu sans que tous ces objectifs soient atteints simultanément. C’est précisément ce que les communs rendent possible : combiner les grandes priorités de notre culture politique, régulièrement opposées les unes aux autres – la liberté, l’équité et la vie elle-même.
Les communs sont bien davantage qu’un message positif à promouvoir : ils sont une vision du monde intrinsèquement insurrectionnelle, au sens de l’affirmation d’un nouveau pouvoir contre les pouvoirs établis et en dehors d’eux. Lorsque des gens se rassemblent pour poursuivre des objectifs partagés et se constituent en tant que commun, c’est une nouvelle onde de pouvoir social cristallisé qui se soulève. Lorsque ces poches d’énergie ascendante convergent en nombre suffisant, c’est un nouveau pouvoir politique qui se manifeste. En outre, dès lors que les commoneurs adhèrent globalement à un ensemble de valeurs philosophiquement intégrées, ce pouvoir est moins vulnérable à la cooptation. Le couple marché/État a inventé un riche répertoire de stratégies de division et d’appropriation pour neutraliser les mouvements sociaux en quête de changement. Il satisfait partiellement une partie de leurs revendications, par exemple, mais uniquement en imposant de nouveaux coûts à quelqu’un d’autre. Oui à une plus grande égalité raciale et de genre au niveau du droit, mais seulement dans le cadre du système profondément inéquitable qu’est le capitalisme et sans véritable volonté d’appliquer ce droit. Oui à une plus grande protection de l’environnement, mais uniquement en imposant des prix plus élevés ou en pillant le Sud pour ses ressources naturelles. Ou encore, oui à de meilleurs soins de santé et à des conditions de travail favorables à la vie familiale, mais uniquement dans le cadre de systèmes rigides protégeant les profits des entreprises. La liberté est jouée contre l’équité, ou vice versa, et chacune des deux est jouée contre les besoins de la Terre Mère. C’est ainsi que les demandes de changement systémique viennent échouer encore et toujours contre les remparts de la forteresse capitaliste.
La grande ambition des communs est de rompre avec cette histoire sans fin de cooptations et de manipulations consistant à se défausser des problèmes sur un autre. Leur but est de développer une économie sociale parallèle et indépendante, en dehors du système marché/État, opérant selon une logique et une éthique différentes. Le Communivers ne poursuit pas la liberté, l’équité et la satisfaction des besoins dans les limites écologiques comme des objectifs distincts nécessitant que l’on trouve le bon compromis entre eux. Le Communivers cherche à intégrer et à unifier ces objectifs comme des priorités intrinsèquement liées. Ils sont un programme indivisible. De plus, ce programme n’est pas simplement aspirationnel ; il est au cœur de la pratique concrète des communs en tant que pratique sociale.
Sans surprise, la vision des communs que nous exposons ici est très différente de l’image qu’en donnent (en la tournant en dérision) la science économique moderne et la droite de l’échiquier politique. Selon eux, les communs sont des ressources sans propriétaires mises à la disposition de n’importe qui, et donc un mode de gestion conduisant inévitablement à une impasse. C’est l’idée popularisée par le célèbre article de Garrett Hardin sur la « tragédie des communs », sur lequel nous reviendrons plus loin. Mais nous ne sommes pas d’accord. Pour nous, les communs sont une catégorie bien déterminée de pratiques sociales auto-organisées permettant de répondre aux besoins de manière équitable et inclusive. Ils sont une forme de vie. Ils sont une perspective qui ouvre sur une manière différente d’être dans le monde et des manières différentes de connaître et d’agir.
Le système marché/État met souvent en avant tout ce qu’il fait pour les gens – ou, si la participation est autorisée, avec les gens. Mais les communs parviennent à faire beaucoup de choses utiles et importantes à travers les gens. C’est-à-dire que les gens ordinaires fournissent eux-mêmes l’énergie, l’imagination et les efforts nécessaires. Ils assurent eux-mêmes leur propre approvisionnement et leur propre gouvernance. Ce sont les commoneurs qui imaginent les systèmes, conçoivent les règles, apportent l’expertise, effectuent le travail difficile, contrôlent le respect des règles et sanctionnent ceux qui les enfreignent.
On le comprend donc, les communs impliquent aussi une transformation des identités. Ils exigent que les gens évoluent vers de nouveaux rôles et de nouvelles perspectives. Ils requièrent de nouveaux modes de relation avec les autres. Ils nécessitent que nous réévaluions ce qui compte vraiment dans notre économie et notre société, et comment le travail essentiel est accompli. Vus de l’intérieur, les communs démontrent que nous pouvons créer de la valeur par de nouveaux moyens, et créer du même coup du sens pour nousmêmes. Nous pouvons échapper aux chaînes de valeur capitalistes en élaborant des réseaux de valeur fondés sur l’engagement mutuel. C’est en changeant les microstructures de la vie sociale, sur le terrain, les uns avec les autres, que nous pouvons commencer à nous décoloniser nous-mêmes de l’histoire et de la culture dans lesquelles nous sommes nés. Nous pouvons échapper au sentiment d’isolement impuissant qui résume une grande partie de la vie moderne. Nous pouvons développer des alternatives plus saines et plus justes.
Bien évidemment, les gardiens de l’ordre dominant – qu’ils soient au sein du gouvernement, des entreprises, des médias, de l’enseignement supérieur ou des institutions philanthropiques – préfèrent travailler dans les cadres institutionnels en place. Ils se contentent d’opérer à travers des schémas de pensée bornés et une conception risible de la dignité humaine, choisissant, par exemple, de promouvoir le grand récit du progrès par la croissance économique. Ils préfèrent que le pouvoir politique soit consolidé dans des structures centralisées comme l’État-nation, la grande entreprise, la bureaucratie. L’objectif de ce livre est de faire voler en éclats ces préjugés et d’ouvrir de nouvelles perspectives sur les choix très réalistes que nous pouvons faire.
Ce livre n’est pas cependant une énième critique du capitalisme néolibéral. Bien que souvent précieuses, les critiques, même pénétrantes, ne nous aident pas nécessairement à imaginer comment reconstruire nos institutions et créer un monde nouveau. Ce dont nous avons réellement besoin aujourd’hui, c’est d’expérimentation créative et du courage d’initier de nouvelles formes d’action. Nous devons apprendre à identifier les motifs récurrents de la vie culturelle qui sont susceptibles de provoquer des changements concrets en dépit de l’immense pouvoir du capital.
Aux militants qui se préoccupent de partis et d’élections, de réformes législatives et de politiques publiques nous conseillons de s’intéresser à un niveau plus profond et plus signifiant de la vie politique – le monde des pratiques culturelles et sociales. Les modes d’action politiques conventionnels qui fonctionnent dans le cadre d’institutions politiques conventionnelles sont tout simplement incapables de nous apporter les changements dont nous avons besoin. Greta Thunberg, la jeune militante suédoise pour le climat, l’a souligné avec perspicacité : « Nous ne pouvons pas sauver le monde en respectant les règles du jeu. » Nous devons concevoir de nouvelles règles. Certes, l’ancien système ne peut être ignoré, et de fait, il peut souvent nous apporter certains bienfaits indispensables. Mais nous devons être honnêtes avec nous-mêmes : les systèmes existants ne produiront pas de changement transformationnel. C’est pourquoi nous devons nous ouvrir aux vents de changement plus vivifiants qui viennent de la périphérie, d’endroits inattendus, négligés, de zones marginales sans titre de noblesse, des gens eux-mêmes.
En conséquence, nous refusons le postulat selon lequel l’Étatnation serait le seul système de pouvoir réaliste capable de s’opposer à nos peurs et de proposer des solutions. Ce n’est pas le cas. L’État-nation est bien plutôt l’expression d’une époque révolue. Seulement, les élites et les bien-pensants refusent d’envisager les alternatives venant de la marge, par peur d’être considérés comme des extravagants ou des fous. Pourtant, les déficiences structurelles de l’État-nation et son alliance avec les marchés capitalistes sont d’une évidence éclatante, impossible à nier. Nous n’avons pas d’autre choix que d’oublier nos craintes – et d’embrasser les idées nouvelles qui nous viennent du dehors.
Précisons, pour rassurer au besoin le lecteur, que « dépasser » l’État-nation ne signifie pas sans État-nation. Cela veut dire que nous devons profondément changer la nature du pouvoir d’État en y introduisant de nouvelles logiques opérationnelles et de nouveaux acteurs institutionnels. Une bonne partie de ce livre est précisément consacrée à cette nécessité. Nous considérons, de manière peut-être immodeste, la pratique des communs – ce que nous appelons en anglais le commoning – comme un moyen d’incuber de nouvelles pratiques sociales et de nouvelles logiques culturelles, fermement ancrées dans l’expérience quotidienne et pourtant capables de se fédérer pour gagner en force, de se féconder mutuellement pour faire émerger une nouvelle culture et pénétrer au cœur même du pouvoir d’État. Lorsque nous décrivons les communs et le commoning, nous parlons de pratiques qui dépassent les manières habituelles de penser, de parler et de se comporter. Ce livre pourrait donc être considéré comme un manuel d’apprentissage. Nous espérons élargir votre compréhension de l’économie en allant, par exemple, au-delà de l’économie monétaire qui oppose mes intérêts et nos intérêts, et en ne considérant plus l’État comme la seule alternative au marché. Ce n’est pas une mince ambition, car le couple marché/État a imprimé ses cadres de pensée au plus profond de notre conscience et de notre culture. Mais si nous voulons vraiment échapper à la logique étouffante du capitalisme, nous devons la sonder en profondeur. Comment échapper à l’étrange logique qui veut que nous nous épuisions nous-mêmes et appauvrissions l’environnement en produisant des choses, et que nous devions ensuite produire des efforts héroïques pour nous réparer nousmêmes ainsi que l’environnement, et ce, uniquement pour que la roue de hamster de l’éternel aujourd’hui continue de tourner ? Comment les hommes politiques et les citoyens peuvent-ils prendre des initiatives véritablement indépendantes si tout dépend de l’emploi, de la Bourse et de la concurrence ? Comment emprunter de nouveaux chemins lorsque les motifs fondamentaux du capitalisme imprègnent constamment nos vies et nos consciences, érodant ce que nous avons en commun ? Avec ce livre, notre objectif n’est pas seulement de mettre en lumière de nouvelles formes de pensée et de sentiment, mais aussi de proposer un guide pour l’action.
Mais comment aborder un changement aussi profond ? Notre réponse est que nous devons d’abord déconstruire notre compréhension du monde : notre image de ce que signifie être un être humain, notre conception de la propriété, les idées dominantes sur l’être et le savoir (chapitre 2). Lorsque nous apprenons à voir le monde à travers de nouvelles lunettes et à le décrire avec de nouveaux mots, une vision convaincante émerge. Nous y gagnons une nouvelle compréhension de la vie bonne, de notre être-ensemble, de l’économie et de la politique. Une révolution sémantique avec de nouveaux vocabulaires (et l’abandon des anciens) est indispensable pour communiquer cette nouvelle vision. C’est pourquoi, dans le chapitre 3, nous proposons une variété de termes pour échapper au piège de nombreux binômes trompeurs (individuel/collectif, public/privé, civilisé/prémoderne) et nommer les expériences de pratique des communs qui n’ont pas encore de nom (Rationalité Ubuntu, liberté dans l’interconnexion, souveraineté sur la valeur, Gouvernance par les pairs).
Les idées sont une chose, l’action rigoureuse en est une autre. Comment procéder ? Nous considérons la partie II, composée des chapitres 4, 5 et 6 – comme le cœur de ce livre. La « triade des communs », comme nous l’appelons, décrit le système qui fait que le monde des communs « respire » – comment il vit, à quoi ressemble sa culture. Cette triade est un nouveau cadre pour comprendre et analyser les communs. Ce cadre est né de la méthodologie associée aux « langages de patterns », où l’on utilise un processus d’« exploration des motifs récurrents » pour identifier ce qui se répète dans les pratiques sociales à travers les cultures et l’histoire.
Suit la partie III, qui examine les présupposés implicites liés à la propriété (chapitre 7) et la manière dont une nouvelle forme de Propriété relationalisée pourrait être développée (chapitre 8) afin de soutenir la pratique des communs. Nous nous sommes rapidement rendu compte qu’une telle vision – tout comme d’autres motifs récurrents ou patterns du commoning –, lorsqu’elle commence à « prendre », finit souvent par se heurter au pouvoir d’État. Les États n’hésitent pas à recourir à la loi, aux droits de propriété, aux politiques publiques, aux alliances avec le capital et aux pratiques coercitives pour imposer leur vision du monde – généralement défavorable aux communs. À la lumière de cette réalité, nous ébauchons plusieurs stratégies générales pour construire malgré tout le Communivers (chapitre 9). Puis nous concluons par l’examen de plusieurs approches – chartes des communs, technologies de registres distribués, partenariats public-communs – susceptibles de développer les communs tout en les protégeant contre le système marché/État (chapitre 10). Avec ce livre qui cherche à reconceptualiser notre compréhension des communs, nous sommes conscients d’indiquer de nombreuses pistes de recherche que nous ne pouvons pas complètement explorer. Plus le rivage de nos connaissances est étendu, plus vastes sont les océans de notre ignorance. Nous aurions aimé détailler une nouvelle théorie de la valeur qui aille à l’encontre des notions insatisfaisantes de valeur et du système des prix utilisés par l’économie standard. La longue histoire du droit de la propriété recèle de nombreuses doctrines juridiques fascinantes qui mériteraient d’être davantage fouillées. De même pour les notions non occidentales d’« intendance » (stewardship en anglais) et de contrôle. Les dimensions psychologiques et sociologiques de la coopération pourraient donner à nos idées sur la pratique des communs une profondeur nouvelle. Les spécialistes de la modernité, les historiens des communs médiévaux et les anthropologues pourraient nous aider à mieux comprendre la dynamique sociale des communs contemporains. Bref, il reste beaucoup à dire sur les thèmes que nous abordons.
Parmi les questions les plus saillantes et les moins étudiées figure la manière dont les communs pourraient apporter des réponses aux défis géopolitiques, écologiques et humanitaires avec lesquels nous ne sommes que trop familiers. Les migrations, les conflits militaires, le changement climatique et les inégalités sont tous affectés par la prévalence des enclosures et la force relative des communs. Des commoneurs disposant de moyens de subsistance stables et ancrés dans leur territoire sont naturellement moins exposés à la nécessité de fuir vers des régions plus riches du monde. Lorsque des chalutiers industriels ont détruit les communs de pêche somaliens, cela a certainement contribué à alimenter la piraterie et le terrorisme en Afrique. La protection des communs par l’État pourrait-elle faire la différence ? Si ce modèle d’approvisionnement pouvait supplanter les chaînes d’approvisionnement du marché mondial, cela pourrait réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre dues aux transports et aux produits chimiques agricoles. Ces sujets, et bien d’autres, mériteraient davantage de recherche, d’analyse et d’élaboration théorique.
Nous souhaitons enfin attirer l’attention sur l’intérêt des annexes. L’annexe A explique la méthodologie utilisée pour identifier les patterns des communs exposés dans la deuxième partie du livre. L’annexe B dresse la liste des soixante-neuf communs et outils de commoning mentionnés dans ce livre. Enfin, l’annexe C énumère les célèbres huit principes de conception pour des communs efficaces d’Elinor Ostrom.
Première Partie : Les Communs : Une Perspective Transformatrice
I. Communs Et Commoning
Les êtres humains peuvent-ils vraiment apprendre à coopérer les uns avec les autres, au quotidien et à grande échelle ? De nombreux indices suggèrent que c’est bien le cas. Il n’y a pas d’obstacle génétique inné à la coopération. Bien au contraire même. Une expérience célèbre conçue par Michael Tomasello, chercheur en psychologie comparative et en psychologie du développement, met en scène un bambin frais et innocent qui observe un homme portant un tas de livres et ne cessant de se cogner sur la porte d’une armoire. L’adulte ne semble pas capable d’ouvrir l’armoire, et le bambin se sent concerné. Spontanément, il se déplace pour ouvrir la porte, invitant l’adulte maladroit à mettre les livres dans l’armoire. Dans une autre expérience, un adulte échoue systématiquement à placer une pilule bleue au sommet d’un tas de pilules. Un bambin assis en face de lui attrape les pilules éparses et les place toutes soigneusement au-dessus du tas. Dans un autre test encore, un adulte qui vient d’agrafer des papiers quitte la pièce et, quand il revient avec une nouvelle pile de papiers, il découvre que quelqu’un a déplacé son agrafeuse. Un enfant âgé d’1 an, dans la même pièce, comprend immédiatement le problème de cet adulte et lui indique obligeamment l’agrafeuse sur une étagère.
Pour Tomasello, ces expériences, et d’autres similaires, mettent en lumière une idée fondamentale : les êtres humains veulent instinctivement s’aider les uns les autres. Dans leurs efforts obstinés pour comprendre les origines de la coopération humaine, Tomasello et son équipe ont cherché à isoler le fonctionnement de cette pulsion humaine et à la différencier des comportements d’autres espèces, et particulièrement des primates. Tirant les leçons d’années de recherches, Tomasello conclut : « À partir approximativement de leur premier anniversaire – lorsqu’ils commencent à marcher et à parler et deviennent véritablement des êtres de culture –, les enfants humains sont déjà coopératifs et serviables dans un grand nombre de situations, mais bien entendu pas toutes. Et ils ne l’apprennent pas des adultes ; cela leur vient naturellement1. » Même des bébés âgés de 14 et 18 mois montrent une capacité à chercher des objets hors de portée, à enlever des obstacles auxquels se heurtent d’autres, à corriger l’erreur d’un adulte et à choisir le comportement correct en vue d’une tâche donnée.
Évidemment, les complications surviennent et se multiplient lorsque les enfants grandissent. Ils comprennent que certaines personnes ne sont pas dignes de confiance et que d’autres ne répondent pas de manière réciproque aux actes bienveillants. Ils apprennent à intérioriser les normes sociales et les attentes éthiques, en particulier celles des institutions. En prenant de l’âge, ils associent l’éducation avec le succès social, apprennent à faire de leur réputation personnelle une marque à promouvoir sur le marché, et à trouver leur satisfaction à travers l’acte d’acheter ou de vendre.
Tandis que ce drame de l’acculturation se joue de manières très différentes au niveau des individus, l’histoire de l’espèce humaine dans son ensemble est caractérisée par sa capacité versatile à la coopération. Nous sommes dotés d’un potentiel unique : celui d’exprimer et d’agir selon une intentionnalité partagée. « Ce qui nous rend différents, nous êtres humains, c’est notre capacité à associer nos efforts et nos réflexions pour faire des choses qu’aucun d’entre nous n’aurait pu créer seul, explique Tomasello. Il s’agit fondamentalement de communication, de collaboration et de travail conjoint. » Si nous en sommes capables, c’est parce que nous pouvons appréhender le fait que les autres êtres humains ont des vies intérieures avec des émotions et des intentions. Nous prenons conscience d’une condition partagée qui va au-delà d’une identité étroite et auto- référentielle. Toute identité individuelle fait aussi partie d’identités collectives qui guident la manière dont une personne pense, se comporte et résout ses problèmes. Nous sommes tous indélébilement façonnés par nos relations avec nos pairs et avec la société, et par les langages, les rituels et les traditions qui constituent nos cultures. En d’autres termes, la prétention individuelle à s’être « fait soi-même » est une illusion. Il n’y a pas de « moi » isolé. Comme nous y reviendrons plus tard, nous sommes tous en réalité des Moiimbriqués. Nous ne sommes pas seulement pris dans des relations ; nos identités elles-mêmes sont créées par ces relations. Le concept du Moi-imbriqué nous aide à aborder de manière plus honnête la réalité de l’identité et du développement humains. Nous, humains, sommes véritablement une « espèce coopérative », comme l’ont formulé les économistes Samuel Bowles et Herbert Gintis2. La question est de savoir dans quelle mesure cet instinct profond sera incité à s’épanouir. Et si la coopération est encouragée, sera-t-elle mise au service de tous ou au contraire d’objectifs individualistes et bornés ?
DES COMMUNS OMNIPRÉSENTS, MAIS SOUVENT MAL COMPRIS
Dans nos précédents livres The Wealth of the Commons (Levellers Press, 2012) et Patterns of Commoning (Levellers Press, 2015), nous avons documenté des dizaines d’exemples remarquables suggérant que la portée et l’impact réels des communs dans le monde d’aujourd’hui sont plus importants qu’il n’y paraît. Notre capacité à nous auto-organiser pour répondre à nos besoins indépendamment de l’État ou du marché se manifeste à travers des forêts gérées de manière communautaire, des fermes et des pêcheries coopératives, des communautés de conception et de fabrication en open source d’envergure mondiale, des monnaies locales et régionales, et une myriade d’autres exemples dans tous les domaines de la vie. L’impulsion humaine élémentaire qui est innée en nous – aider les autres, améliorer les pratiques existantes – se cristallise en des formes sociales stables infiniment variées : les communs. L’impulsion à « faire commun » émerge dans les circonstances les plus diverses – des quartiers urbains déshérités, des paysages frappés par des catastrophes naturelles, des fermes consacrées à l’agriculture de subsistance au cœur de l’Afrique, des réseaux sociaux dans le cyberespace. Et pourtant, étrangement, l’omniprésence des communs est rarement perçue comme telle, peut-être parce qu’ils vivent dans l’ombre du pouvoir d’État ou du marché. Ils ne sont pas reconnus comme une force sociale puissante, ni comme une forme institutionnelle à part entière. Pour nous, parler des communs, c’est parler de liberté-dans-l’interconnexion – un espace social dans lequel nous pouvons nous redécouvrir et nous reconstruire en tant qu’êtres humains entiers et jouir d’un degré élevé d’autonomie. Le langage des communs et du commoning nous aide à comprendre que des individus œuvrant ensemble peuvent donner naissance à des sociétés plus humaines, plus éthiques et plus écologiquement responsables. Il est possible et même plausible d’imaginer un ordre post-capitaliste stable et solidaire. La pratique même des communs, lorsqu’elle s’étend et fait sentir ses effets plus largement dans notre vie culturelle, catalyse de nouvelles possibilités politiques et économiques.
Soyons clairs : les communs ne sont pas une vue de l’esprit utopique. Ils existent ici et maintenant, dans d’innombrables villages et villes, dans le Sud et le Nord de la planète, dans les communautés du logiciel libre et les cyber-réseaux mondiaux. Notre premier défi est de nommer les nombreux communs qui ont lieu parmi nous et de les rendre culturellement lisibles. Ils doivent être perçus et compris afin de pouvoir être nourris, protégés et développés. Telle est la tâche qui nous attend dans les prochains chapitres et la raison pour laquelle nous avons besoin de poser un nouveau cadre général pour comprendre les communs et le commoning.
Les communs ne consistent pas simplement à « partager », comme on le fait dans d’innombrables domaines. Il s’agit de partager et de mettre en place des systèmes sociaux durables pour produire des choses et des activités partageables. Les communs n’ont pas grand- chose à voir non plus avec l’idée trompeuse de la « tragédie des communs ».
L’expression a été popularisée par un article célèbre du biologiste Garrett Hardin sur la« tragédie des communs », paru dans l’influente revue Science en 19683. Paul Ehrlich venait de publier The Population Bomb (La Bombe « P » en français), récit malthusien d’un monde submergé par une croissance démographique hors de contrôle. C’est dans ce contexte que Hardin a inventé la parabole fictive d’un pré partagé sur lequel aucun berger n’a d’incitation rationnelle à limiter le pâturage de son bétail. Le résultat inévitable, selon Hardin, est que chaque gardien de troupeau utilisera égoïstement la plus grande portion possible de la ressource commune, ce qui entraînera inévitablement sa surexploitation et sa ruine – d’où la fameuse « tragédie » des communs. Les solutions possibles, selon Hardin, consistent à attribuer des droits de propriété privée sur la ressource en question ou à demander au gouvernement de l’administrer comme un bien public, ou bien selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».
L’article de Hardin est devenu le plus cité de l’histoire de la revue Science, et l’expression « tragédie des communs » un lieu commun de notre culture. Son récit fantaisiste, ressassé par des économistes, des spécialistes des sciences sociales et des hommes politiques, a persuadé la plupart des gens que les communs étaient un mode de gestion voué à l’échec. Pourtant, l’analyse de Hardin présente plusieurs failles majeures. La plus importante est qu’il ne décrit pas un véritable commun ! Il raconte une mêlée générale dans laquelle rien n’est possédé et tout est gratuit – une « ressource commune non gérée », diraient certains. Comme l’a suggéré avec humour Lewis Hyde, spécialiste des communs, la thèse de la « tragédie » de Hardin devrait être rebaptisée « La tragédie des ressources communes non gérées, laisser-fairistes et facilement accessibles à des individus égoïstes ne communiquant pas entre eux4 ».
Dans un véritable commun, les choses se passent différemment. Une communauté définie régit une ressource partagée et son utilisation. Les utilisateurs négocient leurs propres règles, attribuent des responsabilités et des droits, et mettent en place des systèmes de contrôle pour identifier et pénaliser les resquilleurs. Certes, des ressources limitées peuvent se trouver surexploitées, mais c’est un risque bien davantage associé aux marchés libres qu’aux communs. Ce n’est pas une coïncidence si l’époque actuelle, où les marchés capitalistes et les droits de propriété privée prévalent à peu près partout, a produit la sixième extinction de masse de l’histoire de la Terre, une destruction sans précédent de sols fertiles, des perturbations du cycle hydrologique et un réchauffement extrêmement dangereux de l’atmosphère.
Comme nous le verrons, les communs sont si riches en facettes qu’ils ne peuvent être facilement contenus en une seule définition. Mais il est utile de préciser dès le début que certains termes souvent associés aux communs ne désignent pas, en fait, la même chose.
CE QUI EST UN COMMUN ET CE QUI NE L’EST PAS : QUELQUES CLARIFICATIONS
Les communs sont des systèmes sociaux vivants grâce auxquels les gens résolvent leurs problèmes partagés de manière auto-organisée. Malheureusement, certaines personnes utilisent ce terme à tort pour décrire des choses non possédées, comme les océans, l’espace et la Lune, ou bien des ressources qui font l’objet d’une propriété collective, comme l’eau, les forêts et la terre. En conséquence, le terme « communs » est souvent confondu avec des concepts économiques qui reflètent une vision du monde très différente. Des termes tels que « biens communs », « ressources communes » et « propriété commune » donnent une fausse image des communs, car ils mettent l’accent sur les objets et les individus, et non sur les relations et les systèmes. Voici quelques-uns de ces termes trompeurs.
Biens communs : terme utilisé en économie néoclassique pour distinguer les types de biens – biens communs, biens de club, biens publics et biens privés. Les biens communs sont réputés difficiles à clôturer (dans le jargon économique, ils sont « non exclusifs ») et susceptibles de s’épuiser (« rivaux »). En d’autres termes, les biens communs ont tendance à s’épuiser lorsque nous les partageons. L’économie conventionnelle présume que le caractère non exclusif et épuisable d’un bien commun est inhérent à ce bien lui-même, mais c’est une erreur. Ce n’est pas le bien qui est exclusif ou non ; ce sont les gens qui en sont exclus ou pas. Cela résulte d’un choix social. De même, l’épuisement d’un bien commun a peu à voir avec le bien lui-même et tout à voir avec la façon dont nous choisissons d’utiliser l’eau, la terre, l’espace ou les forêts. En qualifiant la terre, l’eau ou la forêt de « biens », les économistes portent en fait un jugement social : ils présument que quelque chose est une ressource à laquelle le marché peut attribuer un prix et qui peut être échangée – présomption qui pourrait être rejetée par une culture différente.
Ressources communes : terme employé par les spécialistes des communs, principalement dans la tradition inaugurée par Elinor Ostrom, pour analyser la manière dont les ressources partagées telles que les pêcheries, les aquifères ou les zones de pâturage peuvent être gérées. Les ressources communes sont considérées comme des communs, et en pratique ces deux termes sont très similaires. Toutefois, le terme « ressources communes » sert généralement à étudier comment les gens peuvent utiliser une ressource partagée sans en abuser.
Propriété commune : alors que les ressources communes font référence à une ressource en tant que telle, la propriété commune renvoie à un système juridique qui accorde des droits formels pour accéder à cette ressource ou l’utiliser. Ainsi, les termes « ressource commune » et « bien commun » désignent la ressource en tant que telle, tandis que la propriété commune désigne le système juridique qui réglemente la manière dont les gens peuvent l’utiliser. Parler de régime de propriété n’est pas la même chose que se référer directement à l’eau, à la terre, aux zones de pêche ou au code informatique. Chacun de ces objets peut être géré à travers un grand nombre de régimes juridiques différents ; la ressource et le régime juridique sont distincts. Certains commoneurs peuvent choisir d’utiliser un régime de propriété commune, mais ce régime ne constitue pas le commun.
Commun (nom singulier) : alors que certains traditionalistes utilisent le terme « le commun » au lieu des « communs » pour désigner la terre ou l’eau partagées, les théoriciens Antonio Negri et Michael Hardt ont donné une nouvelle tournure au terme « commun » dans leur livre Commonwealth, publié en 2009. Ils parlent du commun pour souligner les processus sociaux dans lesquels les gens s’engagent lorsqu’ils coopèrent et pour distinguer cette idée des communs en tant que ressources physiques. Hardt et Negri notent que ce sont « les langages que nous créons, les pratiques sociales que nous établissons, les modes de socialité qui définissent nos relations » qui constituent le commun. Pour eux, le commun est une forme de « production biopolitique » qui renvoie à un domaine audelà de la propriété, qui existe à côté du privé et du public, mais qui se déploie en engageant notre moi affectif. Bien qu’il soit similaire à notre utilisation du terme “commoning” – les communs comme pratique –, le terme « commun » dans l’acception de Hardt et Negri semble comprendre toutes les formes de coopération, sans considération de but, et pourrait donc inclure les gangs et la mafia.
Le bien commun : terme utilisé depuis les Grecs anciens pour désigner la recherche du bien de tous dans une société. Il s’agit d’une généralité brillante sans signification claire : pratiquement tous les systèmes politiques et économiques affirment produire le plus de bénéfices pour tout le monde.
LES COMMUNS DANS LA VIE RÉELLE
La meilleure façon de se familiariser avec les communs est de prendre connaissance de quelques exemples concrets. C’est pourquoi nous présentons ci-dessous cinq brefs exemples qui donneront une meilleure idée de la pratique des communs, de leurs contextes, de leurs réalités spécifiques et de leur grande diversité. Ces exemples nous aideront à comprendre les communs à la fois comme un paradigme général de gouvernance, d’approvisionnement et de pratique sociale – une vision du monde et une éthique, pourrait-on dire – et comme des phénomènes toujours éminemment singuliers. Chaque commun est unique en son genre. Il n’existe pas de modèle universel ni de « bonnes pratiques » qui définissent les communs et le commoning, mais seulement des expériences révélatrices et des motifs récurrents instructifs.
Camp de réfugiés de Zaatari
Le camp de réfugiés de Zaatari en Jordanie regroupe environ 78 000 Syriens déplacés, qui ont commencé à arriver en 2012. Il pourrait paraître improbable qu’il serve à illustrer les idées de ce livre. Et pourtant, dans un contexte de désolation, ces réfugiés ont conçu un vaste système très élaboré d’abris, de quartiers, de routes, et même d’adresses. Selon Kilian Kleinschmidt, fonctionnaire des Nations unies autrefois en charge du camp, le camp de Zaatari comptait en 2015 « 14 000 ménages, 10 000 pots d’égout et toilettes privées, 3 000 machines à laver, 150 jardins privés, 3 500 nouvelles entreprises et boutiques ». Un journaliste visitant le camp a noté que certaines des maisons les plus sophistiquées étaient « bricolées à partir d’abris, de tentes, de parpaings et de conteneurs d’expédition, avec des cours intérieures, des toilettes privées et des égouts de fortune ». La colonie dispose d’un salon de coiffure, d’une animalerie, d’un magasin de fleurs et d’un commerce de glaces artisanales. Il existe un service de livraison de pizzas et une agence de voyages proposant un service de prise en charge à l’aéroport. L’artère principale de Zaatari est appelée « les Champs-Élysées5 ».
Bien entendu, Zaatari reste un endroit difficile qui connaît de nombreux problèmes. L’État jordanien et les Nations unies sont aux commandes. Mais ce qui le rend si remarquable en tant que camp de réfugiés, c’est le rôle significatif que la participation auto- organisée depuis la base a joué pour construire une ville improvisée, mais stable. Il ne s’agit pas simplement d’un camp d’urgence de fortune où des populations misérables font la queue pour obtenir de la nourriture, où les administrateurs fournissent des services et où les gens sont traités comme des victimes sans défense. C’est un endroit où les réfugiés ont pu consacrer leur énergie et leur imagination à se construire un lieu de vie. Ils ont pu assumer une certaine responsabilité en matière d’autogestion et se réapproprier leur existence, regagnant au passage une bonne part de dignité. Il semblerait que les administrateurs et les résidents de Zaatari, même si c’est de manière partielle, aient reconnu les vertus de la pratique des communs. L’expérience de Zaatari en dit beaucoup sur le pouvoir de l’auto-organisation, un concept central des communs.
Buurtzorg Nederland
Dans la ville néerlandaise d’Almelo, un infirmier, Jos de Blok, s’inquiétait du déclin constant de la qualité des soins à domicile : « La qualité se détériorait de plus en plus, la satisfaction des clients diminuait et les dépenses augmentaient », se rappelle-t-il. De Blok et une petite équipe d’infirmières professionnelles ont décidé de créer une nouvelle organisation de soins à domicile, Buurtzorg Nederland6. Plutôt que de structurer les soins aux patients sur le modèle du travail à la chaîne en usine, en fournissant des unités mesurables de services marchands sur la base d’une division stricte du travail, Buurtzorg Nederland s’appuie sur de petites équipes auto-organisées d’infirmières hautement qualifiées qui s’occupent de cinquante à soixante personnes dans le même quartier. (Le nom de l’organisation, Buurtzorg, signifie « soins de quartier » en néerlandais.) Les soins sont holistiques et se concentrent sur les nombreux besoins personnels des patients, leur situation sociale et leur état de santé à long terme.
La première chose qu’une infirmière fait lorsqu’elle rend visite à un nouveau patient est de s’asseoir pour discuter et prendre une tasse de café. Comme le dit de Blok, « les gens ne sont pas des bicyclettes que l’on peut organiser selon un organigramme ». À cet égard, les infirmières de Buurtzorg appliquent une logique consistant à « passer du temps » (dans le commun) plutôt qu’à « gagner du temps » pour être des compétiteurs plus efficaces. Il est intéressant de noter que l’accent mis sur le temps passé avec les patients fait que ceux-ci ont besoin de moins de temps de soins professionnels. Si l’on y réfléchit, ce n’est pas vraiment une surprise : les soignants essaient principalement de se rendre inutiles dans la vie des patients aussi rapidement que possible, ce qui encourage les patients à devenir plus indépendants. Une étude réalisée en 2009 a montré que les patients de Buurtzorg guérissaient deux fois plus vite que les clients des concurrents et qu’ils ne demandaient finalement que 50 % des heures de soins prescrites7.
Les infirmières fournissent une gamme complète de services aux patients, depuis les soins médicaux jusqu’à une assistance comme les aider à se laver. Elles identifient également les réseaux informels de soutien dans le voisinage d’une personne, favorisent la vie sociale et encouragent l’autonomie en matière de soin et l’indépendance8. Buurtzorg est une organisation autogérée par les infirmières elles-mêmes. Cette autogestion est facilitée par une structure organisationnelle simple et horizontale et par les technologies de l’information, y compris l’utilisation de billets de blog mobilisateurs écrits par de Blok. Buurtzorg fonctionne efficacement à grande échelle sans avoir besoin ni de hiérarchie ni de consensus. En 2017, Buurtzorg employait environ 9 000 infirmières, qui s’occupaient de 100 000 patients dans l’ensemble des Pays-Bas, avec de nouvelles initiatives transnationales en développement aux États-Unis et en Europe9.
La reconceptualisation des soins à domicile par Buurtzorg a permis de créer un traitement humain de haute qualité pour un coût relativement faible. En 2015, les soins de Buurtzorg ont permis, selon une étude de KPMG, de réduire de 30 % les visites aux urgences et de diminuer les dépenses des contribuables pour les soins à domicile10. Les employés de Buurtzorg sont également les plus satisfaits de toutes les entreprises néerlandaises de plus de 1 000 salariés, selon une étude d’Ernst & Young11.
WikiHouse
En 2011, deux jeunes diplômés en architecture, Alastair Parvin et Nicholas Ierodiaconou, ont rejoint le cabinet de design londonien Zero Zero Architecture, où ils ont pu expérimenter leurs idées sur la conception ouverte. Ils se sont posé la question suivante : et si les architectes, au lieu de créer des bâtiments pour ceux qui ont les moyens de les commissionner, aidaient les citoyens ordinaires à concevoir et à construire leurs propres maisons ? Cette idée simple est à l’origine d’un étonnant kit de construction de logements en open source. Parvin et Ierodiaconou ont appris que, grâce à une technologie familière connue sous le nom de « production par commande numérique », ils pourraient réaliser des dessins numériques permettant de fabriquer de grandes pièces plates en contreplaqué ou autre matériau. Cela les a menés à l’idée de publier des fichiers open source pour les maisons afin que de nombreuses personnes puissent modifier et améliorer leurs designs selon les circonstances. Cela aiderait également une main-d’œuvre non qualifiée à ériger rapidement et à moindre coût l’enveloppe structurelle d’une maison. Ils ont appelé ce nouveau système de conception et de construction WikiHouse12.
Depuis ces modestes débuts, WikiHouse s’est épanoui pour devenir une communauté mondiale de design. En 2017, il comptait onze chapitres (collectifs aux périmètres et statuts adaptés au contexte local) dans le monde entier, chacun d’entre eux opérant indépendamment du WikiHouse original, devenu une fondation à but non lucratif qui conserve la même mission. Pour résumer, les participants à WikiHouse ont pour objectif de « mettre des solutions de conception pour construire des maisons à faible coût, à faible consommation d’énergie et à haute performance entre les mains de chaque citoyen et entreprise de la planète ». Ils veulent encourager les gens à produire cosmo-localement, un pattern décrit au chapitre 6. Et ils entendent « développer une nouvelle industrie du logement distribué, composée de nombreux citoyens, communautés et petites entreprises développant des maisons et des quartiers pour eux-mêmes, réduisant ainsi notre dépendance à l’égard des systèmes de logement de masse hiérarchiques et fondés sur l’endettement ».
La charte WikiHouse, qui énumère quinze principes, énonce les éléments de base de la construction de maisons open source du point de vue technologique, économique et des processus. Cette charte est l’un des nombreux exemples de la façon dont les commoneurs cultivent des buts et des valeurs partagés dans le cadre de la Gouvernance par les pairs (voir chapitre 5). Elle inclut des idées essentielles telles que privilégier des normes de conception minimisant le temps, les dépenses, les compétences et l’énergie nécessaires à la construction d’une maison, des normes ouvertes et des licences ouvertes « Partage à l’identique » pour les éléments de conception, ainsi que l’habilitation des utilisateurs à réparer et à modifier les caractéristiques de leurs maisons. En invitant les utilisateurs à adapter les designs et les outils pour répondre à leurs propres besoins, WikiHouse cherche à fournir un riche ensemble d’« outils conviviaux », tels que les décrit le critique social Ivan Illich. Les outils ne devraient pas tenter de contrôler les humains en prescrivant des façons étroites de faire les choses. Les logiciels ne devraient pas être encombrés de cryptage et d’obstacles à la réparation. Les outils conviviaux sont conçus pour libérer la créativité et l’autonomie personnelles13.
L’agriculture soutenue par la communauté
N’importe quel samedi matin dans la paisible ville de Hadley, dans le Massachusetts, vous verrez des familles arrivant à la ferme Next Barn Over pour cueillir des haricots et des fraises dans les champs, couper des herbes et des fleurs fraîches, et récupérer leur lot hebdomadaire de pommes de terre, de chou frisé, d’oignons, de radis, de tomates et autres denrées. Next Barn Over est une ferme fonctionnant sur le principe de l’agriculture soutenue par la communauté [comme les AMAP en France ou les GASAP en Belgique, NdT], ce qui signifie que les gens achètent à l’avance une part de la récolte saisonnière de la ferme et viennent ensuite chercher leurs produits frais chaque semaine d’avril à novembre. En d’autres termes, les participants mettent leur argent en commun avant la production et répartissent la récolte entre tous les membres. Cette pratique, utilisée par des milliers de fermes à travers le monde, nous a incités à identifier le fait de mettre en commun, plafonner et répartir comme une caractéristique importante de l’économie des communs (voir chapitre 6).
Une part pour deux personnes dans Next Barn Over coûte 415 dollars américains, soit environ 400 euros, tandis qu’une grande part, suffisante pour six personnes, coûte 725 dollars américains, soit environ 710 euros. En achetant des parts de la récolte au début de la saison, les membres fournissent aux agriculteurs les fonds de roulement dont ils ont besoin et partagent les risques de production – mauvais temps, maladies des cultures, problèmes d’équipement. On pourrait dire qu’ils se financent en harmonie avec les communs.
L’agriculture soutenue par la communauté n’est toutefois pas un modèle commercial, l’objectif n’étant pas de faire des bénéfices. Il s’agit pour les familles et les agriculteurs de se soutenir mutuellement dans le but de cultiver des aliments sains de manière écologiquement responsable. L’ensemble des 14 hectares de Next Barn Over est en agriculture biologique. La fertilité du sol est améliorée par l’utilisation de couvert végétal, d’engrais organiques, de compost et de fumier, avec une rotation régulière des cultures pour réduire les parasites et les maladies. La ferme utilise des panneaux solaires installés sur le toit de la grange. Des systèmes d’irrigation goutte à goutte minimisent la consommation d’eau. Next Barn Over organise régulièrement des dîners au cours desquels les familles peuvent se rencontrer, danser sur la musique de groupes locaux et en apprendre davantage sur les réalités de l’agriculture dans l’écosystème local.
Depuis le lancement de la première initiative d’agriculture soutenue par la communauté en 1986, celle-ci est devenue un mouvement international, avec plus de 1 700 structures rien qu’aux États-Unis (2018) et des centaines d’autres dans le monde entier. Si certaines structures américaines sont gérées dans une logique quasi commerciale, la philosophie initiale reste forte : tenter de développer de nouvelles formes de coopération entre les agriculteurs, les travailleurs et les membres, qui sont essentiellement des consommateurs. Certains s’inspirent du teikei, un modèle similaire très répandu au Japon depuis les années 1970 (le mot signifie « coopération » ou « entreprise commune »). Dans ce cas aussi, l’accent est mis sur l’agriculture biologique à petite échelle et sur les partenariats directs entre agriculteurs et consommateurs. L’un des acteurs centraux du teikei, l’Association japonaise pour l’agriculture biologique, a déclaré vouloir « développer un système de distribution alternatif qui ne dépende pas des marchés conventionnels14 ». Ces expériences inspirent aujourd’hui une variété de projets régionaux d’agriculture et de distribution alimentaire dans le monde entier, avec les mêmes objectifs : donner du pouvoir aux agriculteurs et aux gens ordinaires, renforcer les économies locales et éviter les problèmes causés par l’agriculture industrielle (pesticides, OGM, additifs, aliments transformés, coûts de transport). Le modèle socio-économique de l’agriculture soutenue par la communauté est si solide que le Schumacher Center for a New Economics, qui a contribué à l’incubation de la première initiative de ce type, développe actuellement l’idée d’une « industrie soutenue par la communauté » pour la production locale. L’idée est d’utiliser les principes de la mutualisation communautaire pour lancer et soutenir des entreprises locales – une usine de meubles, une conserverie de compote de pommes, un abattoir sans cruauté – afin d’accroître l’autonomie et la résilience économiques des territoires.
La plupart des gens imaginent que seule une grande entreprise de télécommunications ou un câblo-opérateur ayant ses entrées politiques et beaucoup de capitaux peut construire l’infrastructure nécessaire pour des réseaux Wi-Fi. En Catalogne, une modeste coopérative, Guifi.net, a prouvé le contraire, à savoir qu’il est tout à fait possible pour des gens ordinaires de construire et d’entretenir des connexions Internet de haute qualité abordables pour tous. En s’engageant à respecter les principes de propriété mutuelle, de neutralité du réseau et de contrôle citoyen, Guifi.net est passé d’un seul nœud Wi-Fi en 2004 à plus de 35 000 nœuds et à 63 000 kilomètres de connectivité sans fil en juillet 2018, particulièrement dans les zones rurales de Catalogne.
Guifi.net a vu le jour lorsque Ramon Roca, un ingénieur espagnol employé par Oracle, a piraté des routeurs standards pour les faire fonctionner comme des nœuds dans un système de type réseau maillé connecté à une seule ligne DSL appartenant à Telefónica et desservant les administrations municipales. Cette opération a permis à beaucoup de gens d’envoyer et de recevoir des données sur l’Internet en utilisant d’autres routeurs piratés de la même manière. Par l’effet du bouche-à-oreille, cette innovation de Roca pour faire face à la rareté de l’accès à l’Internet s’est rapidement répandue. Comme l’a raconté le magazine Wired, Guifi.net a développé son système grâce à une sorte de système improvisé de financement participatif, ou crowdfunding : « Il s’agissait d’annoncer un projet, d’en décrire le coût et de demander des contributions, explique M. Roca. Les fonds n’allaient pas à Guifi.net, mais aux fournisseurs de matériel et d’accès à l’Internet. Toutes ces initiatives ont jeté les bases non seulement de la construction du réseau global, mais aussi de l’émergence de nombreux fournisseurs d’accès. » Ce que Guifi.net a fait, c’est tout simplement mettre en commun et mutualiser (il a mis en commun les ressources et partagé l’Internet ; voir chapitre 6).
En 2008, Guifi.net a créé une fondation, qui a ensuite été enregistrée en tant qu’opérateur auprès de la Commission du marché des télécommunications (CMT) en avril 2009, pour aider à superviser les bénévoles, les opérations du réseau et la gouvernance de l’ensemble du système. Comme l’explique Wired, la fondation « a géré un trafic réseau vers et entre les fournisseurs internationaux, s’est connectée à CATNIX, l’un des principaux nœuds des réseaux, permettant ainsi d’accéder à d’énormes quantités de bande passante, a planifié le déploiement de la fibre et, surtout, a développé des systèmes pour s’assurer que les fournisseurs d’accès payaient leur juste part des coûts globaux de gestion des données et du réseau15 ».
L’ensemble du projet est guidé par le « Pacte pour un réseau libre, ouvert et neutre », une charte qui énonce les principes clés du commun qu’est Guifi.net et les droits et libertés de ses utilisateurs :
-
- Vous avez la liberté d’utiliser le réseau à n’importe quelle fin, tant que vous ne nuisez pas au fonctionnement du réseau lui-même, aux droits des autres utilisateurs ou aux principes de neutralité qui permettent aux contenus et aux services de circuler librement.
- Vous avez le droit de comprendre le réseau et ses compo-sants, et de partager la connaissance de ses mécanismes et de son fonctionnement.
- Vous avez le droit d’offrir des services et des contenus au réseau par vos propres moyens.
- Vous avez le droit d’adhérer au réseau et l’obligation d’étendre cet ensemble de droits à toute personne selon ces mêmes principes.
Tous ceux qui utilisent l’infrastructure de Guifi.net en Catalogne – internautes individuels, petites entreprises, administration, dizaines de petits fournisseurs d’accès Internet – sont engagés dans le « développement d’un réseau de télécommunications fondé sur les communs, libre, ouvert et neutre ». Cela a permis à Guifi.net de fournir un bien meilleur service haut débit à des prix moins élevés que celui demandé par les opérateurs dominant le marché espagnol (Telefónica, Orange et Vodafone). Les fournisseurs d’accès utilisant Guifi.net facturaient de 18 à 35 euros par mois en 2016 (environ 20 à 37 dollars) pour des connexions en fibre optique d’un gigabit, avec des prix beaucoup plus bas pour le Wi-Fi, alors que le prix moyen en Espagne était de 41 dollars (en 2017). Comme l’a souligné Wolfgang Sachs, les communs sont très efficients sur le plan financier. Ils nous permettent de devenir moins dépendants de l’argent et nous libèrent, ce faisant, de la coercition structurelle des marchés.
L’expérience de Guifi.net montre en outre qu’il est tout à fait possible de construire une « infrastructure haut débit à grande échelle, détenue localement, avec une meilleure couverture géographique que les opérateurs historiques », selon les termes du défenseur des technologies ouvertes Sascha Meinrath16. Ce succès tient pour une grande part à la mutualisation des coûts et des avantages que permet un régime fondé sur les communs.
COMPRENDRE LES COMMUNS « À L’ÉTAT SAUVAGE » DE MANIÈRE HOLISTIQUE
Comment donner du sens à ces communs si différents entre eux ? Ceux qui découvrent le sujet lèvent souvent les bras au ciel en signe de confusion, faute de percevoir les caractéristiques structurelles qui font d’un commun un commun. Ils sont perplexes à l’idée qu’un seul terme puisse être utilisé pour caractériser tant de phénomènes aussi divers. Il s’agit en fait d’un problème d’éducation de sa propre perception. Tout le monde connaît le « marché libre », même si ses manifestations – Bourses, épiceries, cinéma, mines, services personnels, travail – sont au moins aussi éclectiques que les communs. Culturellement, nous considérons la diversité des marchés comme normale, alors que les communs restent presque invisibles.
La vérité est que nous manquons presque totalement d’un langage ordinaire permettant de comprendre les communs contemporains. Les études en sciences sociales sur le sujet sont souvent obscures et très spécialisées, et la littérature économique a tendance à traiter les communs comme des ressources physiques et non comme des systèmes sociaux. Or, plutôt que de se focaliser sur la ressource singulière dont chaque commun dépend, il est plus judicieux de se concentrer sur leurs similitudes. Chaque commun dépend de ressources physiques, du partage des connaissances et de processus sociaux. Chacun d’entre eux connaît les mêmes difficultés à articuler le social, le politique (gouvernance) et l’économique (approvisionnement) en un tout intégré.
Tous les communs sont fondés sur des ressources naturelles.
Tout commun est un commun de savoirs.
Tout commun dépend d’un processus social.
Notre tâche est ainsi, pour une grande part, de nous réapproprier l’histoire sociale négligée des communs et d’en tirer des enseignements pour notre contexte contemporain. Pour cela, nous avons besoin d’un cadre conceptuel, d’un nouveau langage et d’histoires que tout le monde peut comprendre. On ne peut pas expliquer les communs avec le vocabulaire du capital, du « business » et de l’économie conventionnelle. Ce serait comme recourir à la métaphore d’une horloge ou d’une machine pour décrire des systèmes vivants complexes. Pour comprendre comment les communs fonctionnent effectivement, nous devons nous libérer d’habitudes de pensée profondément ancrées et cultiver de nouvelles perspectives.
La tâche devient plus facile dès lors que l’on reconnaît qu’il n’existe pas de modèle unique et universel pour apprécier un commun. Chaque commun porte les marques distinctives de ses origines particulières, d’une culture, de gens, d’un contexte. Pour autant, il y a aussi, dans la pratique des communs, des motifs récurrents profonds qui permettent de faire quelques généralisations prudentes. Des communs qui superficiellement paraissent très différents présentent en réalité souvent des similitudes remarquables dans la manière dont ils se gouvernent, se répartissent les ressources, se protègent contre les enclosures et cultivent des objectifs partagés.
En d’autres termes, les communs ne sont pas des machines standardisées qui peuvent être construites à partir d’un même plan. Ce sont des systèmes vivants qui évoluent, s’adaptent au fil du temps et nous surprennent toujours par leur créativité et leur ampleur.
Le terme de « pattern », ou motif récurrent, tel que nous l’utilisons ici mérite quelques explications. Nous nous inspirons ici des idées développées par l’architecte et philosophe Christopher Alexander dans son célèbre ouvrage publié en 1977, A Pattern Language [« Un langage de patterns »].Ces idées sont approfondies dans son chefd’œuvre en quatre volumes, The Nature of Order [« La nature de l’ordre »], résultat de vingt-sept années de recherches et de réflexion originales. Alexander et ses coauteurs ont brillamment mêlé une perspective scientifique empirique à une analyse du rôle formateur de la beauté et de la grâce dans la vie quotidienne et le design pour aboutir à ce que nous pourrions appeler l’« épanouissement17 ».
Pour Alexander, un pattern est un « problème qui se répète sans cesse dans notre environnement, puis décrit le cœur de la solution à ce problème, de telle sorte que vous pouvez utiliser cette solution un million de fois, sans jamais le faire deux fois de la même manière18 ». En d’autres termes, la pensée par patterns et les solutions qui en découlent ne sont jamais décontextualisées ni déconnectées de ce que nous pensons et ressentons. Il faut étudier de près les patterns sous-jacents aux communs florissants pour s’en inspirer, tout en gardant à l’esprit qu’il ne sera jamais possible de simplement « copier-coller » le fonctionnement de ce commun. Chacun doit développer ses propres solutions, localisées et adaptées à leur contexte. Chacun doit satisfaire à la fois des besoins pratiques et des aspirations et intérêts humains plus profonds.
Dans cet ouvrage, nous tentons d’identifier les patterns, ou motifs récurrents, qui sous-tendent une constellation de communs en pleine expansion – le Communivers. Notre récit se veut à la fois descriptif et ambitieux : descriptif lorsque nous examinons le fonctionnement de divers communs ; ambitieux lorsque nous essayons d’imaginer comment la dynamique actuelle des communs pourrait plausiblement se développer et devenir un secteur distinct de l’économie politique et de la culture. Nous nous appuyons sur les sciences sociales pour étudier certains aspects cruciaux des communs. Mais nous avons recours également à notre propre expérience de première main : nos discussions avec des commoneurs et nos écouvertes sur leurs remarquables communautés. Nous voulons faire la lumière sur un domaine richement texturé de créativité humaine et d’organisation sociale qui a été trop longtemps négligé, tout en rassurant le lecteur sur le fait que les communs ne sont pas si compliqués et si obscurs que seuls des experts pourraient les comprendre. En réalité, les communs prennent naissance dans l’action de gens ordinaires qui font des choses assez banales, lesquelles ne semblent inhabituelles que dans des sociétés focalisées sur le marché.
Au cours de nos voyages, nous avons été étonnés par la variété de circonstances à l’origine des communs. Cela nous a amenés à nous demander pourquoi tant de discussions sur les communs se fondaient sur des catégories économiques d’analyse (« types de biens », « allocation des ressources », « productivité », « coûts de transaction »), alors que les communs sont avant tout des systèmes sociaux permettant de répondre à des besoins partagés. Cette question nous a incités à entamer un processus de reconceptualisation de ce que signifie, dans son sens le plus large, s’engager dans la pratique des communs.
Nous pensons que cette perspective s’inscrit dans un changement de paradigme plus large. Elle contribue à redéfinir l’idée même d’économie et à élargir le champ fonctionnel de l’action démocratique. Les communs répondent à des besoins bien réels tout en provoquant un changement dans la culture et les identités. Ils influencent nos pratiques sociales, notre éthique et notre vision du monde et, ce faisant, modifient le caractère même de la politique. Pour comprendre ces courants plus profonds, nous avons besoin d’un cadre de pensée plus riche, donnant tout leur sens aux communs. Nous en avons besoin pour mieux expliquer la dynamique interne de la gouvernance et de l’approvisionnement par les pairs, ainsi que la manière dont la pratique des communs articule l’économie politique au sens large avec nos vies intérieures. Bref, nous devons reconnaître que les communs requièrent une nouvelle vision du monde.
I. Communs Et Commoning
Les êtres humains peuvent-ils vraiment apprendre à coopérer les uns avec les autres, au quotidien et à grande échelle ? De nombreux indices suggèrent que c’est bien le cas. Il n’y a pas d’obstacle génétique inné à la coopération. Bien au contraire même. Une expérience célèbre conçue par Michael Tomasello, chercheur en psychologie comparative et en psychologie du développement, met en scène un bambin frais et innocent qui observe un homme portant un tas de livres et ne cessant de se cogner sur la porte d’une armoire. L’adulte ne semble pas capable d’ouvrir l’armoire, et le bambin se sent concerné. Spontanément, il se déplace pour ouvrir la porte, invitant l’adulte maladroit à mettre les livres dans l’armoire. Dans une autre expérience, un adulte échoue systématiquement à placer une pilule bleue au sommet d’un tas de pilules. Un bambin assis en face de lui attrape les pilules éparses et les place toutes soigneusement au-dessus du tas. Dans un autre test encore, un adulte qui vient d’agrafer des papiers quitte la pièce et, quand il revient avec une nouvelle pile de papiers, il découvre que quelqu’un a déplacé son agrafeuse. Un enfant âgé d’1 an, dans la même pièce, comprend immédiatement le problème de cet adulte et lui indique obligeamment l’agrafeuse sur une étagère.
Pour Tomasello, ces expériences, et d’autres similaires, mettent en lumière une idée fondamentale : les êtres humains veulent instinctivement s’aider les uns les autres. Dans leurs efforts obstinés pour comprendre les origines de la coopération humaine, Tomasello et son équipe ont cherché à isoler le fonctionnement de cette pulsion humaine et à la différencier des comportements d’autres espèces, et particulièrement des primates. Tirant les leçons d’années de recherches, Tomasello conclut : « À partir approximativement de leur premier anniversaire – lorsqu’ils commencent à marcher et à parler et deviennent véritablement des êtres de culture –, les enfants humains sont déjà coopératifs et serviables dans un grand nombre de situations, mais bien entendu pas toutes. Et ils ne l’apprennent pas des adultes ; cela leur vient naturellement1. » Même des bébés âgés de 14 et 18 mois montrent une capacité à chercher des objets hors de portée, à enlever des obstacles auxquels se heurtent d’autres, à corriger l’erreur d’un adulte et à choisir le comportement correct en vue d’une tâche donnée.
Évidemment, les complications surviennent et se multiplient lorsque les enfants grandissent. Ils comprennent que certaines personnes ne sont pas dignes de confiance et que d’autres ne répondent pas de manière réciproque aux actes bienveillants. Ils apprennent à intérioriser les normes sociales et les attentes éthiques, en particulier celles des institutions. En prenant de l’âge, ils associent l’éducation avec le succès social, apprennent à faire de leur réputation personnelle une marque à promouvoir sur le marché, et à trouver leur satisfaction à travers l’acte d’acheter ou de vendre.
Tandis que ce drame de l’acculturation se joue de manières très différentes au niveau des individus, l’histoire de l’espèce humaine dans son ensemble est caractérisée par sa capacité versatile à la coopération. Nous sommes dotés d’un potentiel unique : celui d’exprimer et d’agir selon une intentionnalité partagée. « Ce qui nous rend différents, nous êtres humains, c’est notre capacité à associer nos efforts et nos réflexions pour faire des choses qu’aucun d’entre nous n’aurait pu créer seul, explique Tomasello. Il s’agit fondamentalement de communication, de collaboration et de travail conjoint. » Si nous en sommes capables, c’est parce que nous pouvons appréhender le fait que les autres êtres humains ont des vies intérieures avec des émotions et des intentions. Nous prenons conscience d’une condition partagée qui va au-delà d’une identité étroite et auto- référentielle. Toute identité individuelle fait aussi partie d’identités collectives qui guident la manière dont une personne pense, se comporte et résout ses problèmes. Nous sommes tous indélébilement façonnés par nos relations avec nos pairs et avec la société, et par les langages, les rituels et les traditions qui constituent nos cultures. En d’autres termes, la prétention individuelle à s’être « fait soi-même » est une illusion. Il n’y a pas de « moi » isolé. Comme nous y reviendrons plus tard, nous sommes tous en réalité des Moiimbriqués. Nous ne sommes pas seulement pris dans des relations ; nos identités elles-mêmes sont créées par ces relations. Le concept du Moi-imbriqué nous aide à aborder de manière plus honnête la réalité de l’identité et du développement humains. Nous, humains, sommes véritablement une « espèce coopérative », comme l’ont formulé les économistes Samuel Bowles et Herbert Gintis2. La question est de savoir dans quelle mesure cet instinct profond sera incité à s’épanouir. Et si la coopération est encouragée, sera-t-elle mise au service de tous ou au contraire d’objectifs individualistes et bornés ?
DES COMMUNS OMNIPRÉSENTS, MAIS SOUVENT MAL COMPRIS
Dans nos précédents livres The Wealth of the Commons (Levellers Press, 2012) et Patterns of Commoning (Levellers Press, 2015), nous avons documenté des dizaines d’exemples remarquables suggérant que la portée et l’impact réels des communs dans le monde d’aujourd’hui sont plus importants qu’il n’y paraît. Notre capacité à nous auto-organiser pour répondre à nos besoins indépendamment de l’État ou du marché se manifeste à travers des forêts gérées de manière communautaire, des fermes et des pêcheries coopératives, des communautés de conception et de fabrication en open source d’envergure mondiale, des monnaies locales et régionales, et une myriade d’autres exemples dans tous les domaines de la vie. L’impulsion humaine élémentaire qui est innée en nous – aider les autres, améliorer les pratiques existantes – se cristallise en des formes sociales stables infiniment variées : les communs. L’impulsion à « faire commun » émerge dans les circonstances les plus diverses – des quartiers urbains déshérités, des paysages frappés par des catastrophes naturelles, des fermes consacrées à l’agriculture de subsistance au cœur de l’Afrique, des réseaux sociaux dans le cyberespace. Et pourtant, étrangement, l’omniprésence des communs est rarement perçue comme telle, peut-être parce qu’ils vivent dans l’ombre du pouvoir d’État ou du marché. Ils ne sont pas reconnus comme une force sociale puissante, ni comme une forme institutionnelle à part entière. Pour nous, parler des communs, c’est parler de liberté-dans-l’interconnexion – un espace social dans lequel nous pouvons nous redécouvrir et nous reconstruire en tant qu’êtres humains entiers et jouir d’un degré élevé d’autonomie. Le langage des communs et du commoning nous aide à comprendre que des individus œuvrant ensemble peuvent donner naissance à des sociétés plus humaines, plus éthiques et plus écologiquement responsables. Il est possible et même plausible d’imaginer un ordre post-capitaliste stable et solidaire. La pratique même des communs, lorsqu’elle s’étend et fait sentir ses effets plus largement dans notre vie culturelle, catalyse de nouvelles possibilités politiques et économiques.
Soyons clairs : les communs ne sont pas une vue de l’esprit utopique. Ils existent ici et maintenant, dans d’innombrables villages et villes, dans le Sud et le Nord de la planète, dans les communautés du logiciel libre et les cyber-réseaux mondiaux. Notre premier défi est de nommer les nombreux communs qui ont lieu parmi nous et de les rendre culturellement lisibles. Ils doivent être perçus et compris afin de pouvoir être nourris, protégés et développés. Telle est la tâche qui nous attend dans les prochains chapitres et la raison pour laquelle nous avons besoin de poser un nouveau cadre général pour comprendre les communs et le commoning.
Les communs ne consistent pas simplement à « partager », comme on le fait dans d’innombrables domaines. Il s’agit de partager et de mettre en place des systèmes sociaux durables pour produire des choses et des activités partageables. Les communs n’ont pas grand- chose à voir non plus avec l’idée trompeuse de la « tragédie des communs ».
L’expression a été popularisée par un article célèbre du biologiste Garrett Hardin sur la« tragédie des communs », paru dans l’influente revue Science en 19683. Paul Ehrlich venait de publier The Population Bomb (La Bombe « P » en français), récit malthusien d’un monde submergé par une croissance démographique hors de contrôle. C’est dans ce contexte que Hardin a inventé la parabole fictive d’un pré partagé sur lequel aucun berger n’a d’incitation rationnelle à limiter le pâturage de son bétail. Le résultat inévitable, selon Hardin, est que chaque gardien de troupeau utilisera égoïstement la plus grande portion possible de la ressource commune, ce qui entraînera inévitablement sa surexploitation et sa ruine – d’où la fameuse « tragédie » des communs. Les solutions possibles, selon Hardin, consistent à attribuer des droits de propriété privée sur la ressource en question ou à demander au gouvernement de l’administrer comme un bien public, ou bien selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».
L’article de Hardin est devenu le plus cité de l’histoire de la revue Science, et l’expression « tragédie des communs » un lieu commun de notre culture. Son récit fantaisiste, ressassé par des économistes, des spécialistes des sciences sociales et des hommes politiques, a persuadé la plupart des gens que les communs étaient un mode de gestion voué à l’échec. Pourtant, l’analyse de Hardin présente plusieurs failles majeures. La plus importante est qu’il ne décrit pas un véritable commun ! Il raconte une mêlée générale dans laquelle rien n’est possédé et tout est gratuit – une « ressource commune non gérée », diraient certains. Comme l’a suggéré avec humour Lewis Hyde, spécialiste des communs, la thèse de la « tragédie » de Hardin devrait être rebaptisée « La tragédie des ressources communes non gérées, laisser-fairistes et facilement accessibles à des individus égoïstes ne communiquant pas entre eux4 ».
Dans un véritable commun, les choses se passent différemment. Une communauté définie régit une ressource partagée et son utilisation. Les utilisateurs négocient leurs propres règles, attribuent des responsabilités et des droits, et mettent en place des systèmes de contrôle pour identifier et pénaliser les resquilleurs. Certes, des ressources limitées peuvent se trouver surexploitées, mais c’est un risque bien davantage associé aux marchés libres qu’aux communs. Ce n’est pas une coïncidence si l’époque actuelle, où les marchés capitalistes et les droits de propriété privée prévalent à peu près partout, a produit la sixième extinction de masse de l’histoire de la Terre, une destruction sans précédent de sols fertiles, des perturbations du cycle hydrologique et un réchauffement extrêmement dangereux de l’atmosphère.
Comme nous le verrons, les communs sont si riches en facettes qu’ils ne peuvent être facilement contenus en une seule définition. Mais il est utile de préciser dès le début que certains termes souvent associés aux communs ne désignent pas, en fait, la même chose.
CE QUI EST UN COMMUN ET CE QUI NE L’EST PAS : QUELQUES CLARIFICATIONS
Les communs sont des systèmes sociaux vivants grâce auxquels les gens résolvent leurs problèmes partagés de manière auto-organisée. Malheureusement, certaines personnes utilisent ce terme à tort pour décrire des choses non possédées, comme les océans, l’espace et la Lune, ou bien des ressources qui font l’objet d’une propriété collective, comme l’eau, les forêts et la terre. En conséquence, le terme « communs » est souvent confondu avec des concepts économiques qui reflètent une vision du monde très différente. Des termes tels que « biens communs », « ressources communes » et « propriété commune » donnent une fausse image des communs, car ils mettent l’accent sur les objets et les individus, et non sur les relations et les systèmes. Voici quelques-uns de ces termes trompeurs.
Biens communs : terme utilisé en économie néoclassique pour distinguer les types de biens – biens communs, biens de club, biens publics et biens privés. Les biens communs sont réputés difficiles à clôturer (dans le jargon économique, ils sont « non exclusifs ») et susceptibles de s’épuiser (« rivaux »). En d’autres termes, les biens communs ont tendance à s’épuiser lorsque nous les partageons. L’économie conventionnelle présume que le caractère non exclusif et épuisable d’un bien commun est inhérent à ce bien lui-même, mais c’est une erreur. Ce n’est pas le bien qui est exclusif ou non ; ce sont les gens qui en sont exclus ou pas. Cela résulte d’un choix social. De même, l’épuisement d’un bien commun a peu à voir avec le bien lui-même et tout à voir avec la façon dont nous choisissons d’utiliser l’eau, la terre, l’espace ou les forêts. En qualifiant la terre, l’eau ou la forêt de « biens », les économistes portent en fait un jugement social : ils présument que quelque chose est une ressource à laquelle le marché peut attribuer un prix et qui peut être échangée – présomption qui pourrait être rejetée par une culture différente.
Ressources communes : terme employé par les spécialistes des communs, principalement dans la tradition inaugurée par Elinor Ostrom, pour analyser la manière dont les ressources partagées telles que les pêcheries, les aquifères ou les zones de pâturage peuvent être gérées. Les ressources communes sont considérées comme des communs, et en pratique ces deux termes sont très similaires. Toutefois, le terme « ressources communes » sert généralement à étudier comment les gens peuvent utiliser une ressource partagée sans en abuser.
Propriété commune : alors que les ressources communes font référence à une ressource en tant que telle, la propriété commune renvoie à un système juridique qui accorde des droits formels pour accéder à cette ressource ou l’utiliser. Ainsi, les termes « ressource commune » et « bien commun » désignent la ressource en tant que telle, tandis que la propriété commune désigne le système juridique qui réglemente la manière dont les gens peuvent l’utiliser. Parler de régime de propriété n’est pas la même chose que se référer directement à l’eau, à la terre, aux zones de pêche ou au code informatique. Chacun de ces objets peut être géré à travers un grand nombre de régimes juridiques différents ; la ressource et le régime juridique sont distincts. Certains commoneurs peuvent choisir d’utiliser un régime de propriété commune, mais ce régime ne constitue pas le commun.
Commun (nom singulier) : alors que certains traditionalistes utilisent le terme « le commun » au lieu des « communs » pour désigner la terre ou l’eau partagées, les théoriciens Antonio Negri et Michael Hardt ont donné une nouvelle tournure au terme « commun » dans leur livre Commonwealth, publié en 2009. Ils parlent du commun pour souligner les processus sociaux dans lesquels les gens s’engagent lorsqu’ils coopèrent et pour distinguer cette idée des communs en tant que ressources physiques. Hardt et Negri notent que ce sont « les langages que nous créons, les pratiques sociales que nous établissons, les modes de socialité qui définissent nos relations » qui constituent le commun. Pour eux, le commun est une forme de « production biopolitique » qui renvoie à un domaine audelà de la propriété, qui existe à côté du privé et du public, mais qui se déploie en engageant notre moi affectif. Bien qu’il soit similaire à notre utilisation du terme “commoning” – les communs comme pratique –, le terme « commun » dans l’acception de Hardt et Negri semble comprendre toutes les formes de coopération, sans considération de but, et pourrait donc inclure les gangs et la mafia.
Le bien commun : terme utilisé depuis les Grecs anciens pour désigner la recherche du bien de tous dans une société. Il s’agit d’une généralité brillante sans signification claire : pratiquement tous les systèmes politiques et économiques affirment produire le plus de bénéfices pour tout le monde.
LES COMMUNS DANS LA VIE RÉELLE
La meilleure façon de se familiariser avec les communs est de prendre connaissance de quelques exemples concrets. C’est pourquoi nous présentons ci-dessous cinq brefs exemples qui donneront une meilleure idée de la pratique des communs, de leurs contextes, de leurs réalités spécifiques et de leur grande diversité. Ces exemples nous aideront à comprendre les communs à la fois comme un paradigme général de gouvernance, d’approvisionnement et de pratique sociale – une vision du monde et une éthique, pourrait-on dire – et comme des phénomènes toujours éminemment singuliers. Chaque commun est unique en son genre. Il n’existe pas de modèle universel ni de « bonnes pratiques » qui définissent les communs et le commoning, mais seulement des expériences révélatrices et des motifs récurrents instructifs.
Camp de réfugiés de Zaatari
Le camp de réfugiés de Zaatari en Jordanie regroupe environ 78 000 Syriens déplacés, qui ont commencé à arriver en 2012. Il pourrait paraître improbable qu’il serve à illustrer les idées de ce livre. Et pourtant, dans un contexte de désolation, ces réfugiés ont conçu un vaste système très élaboré d’abris, de quartiers, de routes, et même d’adresses. Selon Kilian Kleinschmidt, fonctionnaire des Nations unies autrefois en charge du camp, le camp de Zaatari comptait en 2015 « 14 000 ménages, 10 000 pots d’égout et toilettes privées, 3 000 machines à laver, 150 jardins privés, 3 500 nouvelles entreprises et boutiques ». Un journaliste visitant le camp a noté que certaines des maisons les plus sophistiquées étaient « bricolées à partir d’abris, de tentes, de parpaings et de conteneurs d’expédition, avec des cours intérieures, des toilettes privées et des égouts de fortune ». La colonie dispose d’un salon de coiffure, d’une animalerie, d’un magasin de fleurs et d’un commerce de glaces artisanales. Il existe un service de livraison de pizzas et une agence de voyages proposant un service de prise en charge à l’aéroport. L’artère principale de Zaatari est appelée « les Champs-Élysées5 ».
Bien entendu, Zaatari reste un endroit difficile qui connaît de nombreux problèmes. L’État jordanien et les Nations unies sont aux commandes. Mais ce qui le rend si remarquable en tant que camp de réfugiés, c’est le rôle significatif que la participation auto- organisée depuis la base a joué pour construire une ville improvisée, mais stable. Il ne s’agit pas simplement d’un camp d’urgence de fortune où des populations misérables font la queue pour obtenir de la nourriture, où les administrateurs fournissent des services et où les gens sont traités comme des victimes sans défense. C’est un endroit où les réfugiés ont pu consacrer leur énergie et leur imagination à se construire un lieu de vie. Ils ont pu assumer une certaine responsabilité en matière d’autogestion et se réapproprier leur existence, regagnant au passage une bonne part de dignité. Il semblerait que les administrateurs et les résidents de Zaatari, même si c’est de manière partielle, aient reconnu les vertus de la pratique des communs. L’expérience de Zaatari en dit beaucoup sur le pouvoir de l’auto-organisation, un concept central des communs.
Buurtzorg Nederland
Dans la ville néerlandaise d’Almelo, un infirmier, Jos de Blok, s’inquiétait du déclin constant de la qualité des soins à domicile : « La qualité se détériorait de plus en plus, la satisfaction des clients diminuait et les dépenses augmentaient », se rappelle-t-il. De Blok et une petite équipe d’infirmières professionnelles ont décidé de créer une nouvelle organisation de soins à domicile, Buurtzorg Nederland6. Plutôt que de structurer les soins aux patients sur le modèle du travail à la chaîne en usine, en fournissant des unités mesurables de services marchands sur la base d’une division stricte du travail, Buurtzorg Nederland s’appuie sur de petites équipes auto-organisées d’infirmières hautement qualifiées qui s’occupent de cinquante à soixante personnes dans le même quartier. (Le nom de l’organisation, Buurtzorg, signifie « soins de quartier » en néerlandais.) Les soins sont holistiques et se concentrent sur les nombreux besoins personnels des patients, leur situation sociale et leur état de santé à long terme.
La première chose qu’une infirmière fait lorsqu’elle rend visite à un nouveau patient est de s’asseoir pour discuter et prendre une tasse de café. Comme le dit de Blok, « les gens ne sont pas des bicyclettes que l’on peut organiser selon un organigramme ». À cet égard, les infirmières de Buurtzorg appliquent une logique consistant à « passer du temps » (dans le commun) plutôt qu’à « gagner du temps » pour être des compétiteurs plus efficaces. Il est intéressant de noter que l’accent mis sur le temps passé avec les patients fait que ceux-ci ont besoin de moins de temps de soins professionnels. Si l’on y réfléchit, ce n’est pas vraiment une surprise : les soignants essaient principalement de se rendre inutiles dans la vie des patients aussi rapidement que possible, ce qui encourage les patients à devenir plus indépendants. Une étude réalisée en 2009 a montré que les patients de Buurtzorg guérissaient deux fois plus vite que les clients des concurrents et qu’ils ne demandaient finalement que 50 % des heures de soins prescrites7.
Les infirmières fournissent une gamme complète de services aux patients, depuis les soins médicaux jusqu’à une assistance comme les aider à se laver. Elles identifient également les réseaux informels de soutien dans le voisinage d’une personne, favorisent la vie sociale et encouragent l’autonomie en matière de soin et l’indépendance8. Buurtzorg est une organisation autogérée par les infirmières elles-mêmes. Cette autogestion est facilitée par une structure organisationnelle simple et horizontale et par les technologies de l’information, y compris l’utilisation de billets de blog mobilisateurs écrits par de Blok. Buurtzorg fonctionne efficacement à grande échelle sans avoir besoin ni de hiérarchie ni de consensus. En 2017, Buurtzorg employait environ 9 000 infirmières, qui s’occupaient de 100 000 patients dans l’ensemble des Pays-Bas, avec de nouvelles initiatives transnationales en développement aux États-Unis et en Europe9.
La reconceptualisation des soins à domicile par Buurtzorg a permis de créer un traitement humain de haute qualité pour un coût relativement faible. En 2015, les soins de Buurtzorg ont permis, selon une étude de KPMG, de réduire de 30 % les visites aux urgences et de diminuer les dépenses des contribuables pour les soins à domicile10. Les employés de Buurtzorg sont également les plus satisfaits de toutes les entreprises néerlandaises de plus de 1 000 salariés, selon une étude d’Ernst & Young11.
WikiHouse
En 2011, deux jeunes diplômés en architecture, Alastair Parvin et Nicholas Ierodiaconou, ont rejoint le cabinet de design londonien Zero Zero Architecture, où ils ont pu expérimenter leurs idées sur la conception ouverte. Ils se sont posé la question suivante : et si les architectes, au lieu de créer des bâtiments pour ceux qui ont les moyens de les commissionner, aidaient les citoyens ordinaires à concevoir et à construire leurs propres maisons ? Cette idée simple est à l’origine d’un étonnant kit de construction de logements en open source. Parvin et Ierodiaconou ont appris que, grâce à une technologie familière connue sous le nom de « production par commande numérique », ils pourraient réaliser des dessins numériques permettant de fabriquer de grandes pièces plates en contreplaqué ou autre matériau. Cela les a menés à l’idée de publier des fichiers open source pour les maisons afin que de nombreuses personnes puissent modifier et améliorer leurs designs selon les circonstances. Cela aiderait également une main-d’œuvre non qualifiée à ériger rapidement et à moindre coût l’enveloppe structurelle d’une maison. Ils ont appelé ce nouveau système de conception et de construction WikiHouse12.
Depuis ces modestes débuts, WikiHouse s’est épanoui pour devenir une communauté mondiale de design. En 2017, il comptait onze chapitres (collectifs aux périmètres et statuts adaptés au contexte local) dans le monde entier, chacun d’entre eux opérant indépendamment du WikiHouse original, devenu une fondation à but non lucratif qui conserve la même mission. Pour résumer, les participants à WikiHouse ont pour objectif de « mettre des solutions de conception pour construire des maisons à faible coût, à faible consommation d’énergie et à haute performance entre les mains de chaque citoyen et entreprise de la planète ». Ils veulent encourager les gens à produire cosmo-localement, un pattern décrit au chapitre 6. Et ils entendent « développer une nouvelle industrie du logement distribué, composée de nombreux citoyens, communautés et petites entreprises développant des maisons et des quartiers pour eux-mêmes, réduisant ainsi notre dépendance à l’égard des systèmes de logement de masse hiérarchiques et fondés sur l’endettement ».
La charte WikiHouse, qui énumère quinze principes, énonce les éléments de base de la construction de maisons open source du point de vue technologique, économique et des processus. Cette charte est l’un des nombreux exemples de la façon dont les commoneurs cultivent des buts et des valeurs partagés dans le cadre de la Gouvernance par les pairs (voir chapitre 5). Elle inclut des idées essentielles telles que privilégier des normes de conception minimisant le temps, les dépenses, les compétences et l’énergie nécessaires à la construction d’une maison, des normes ouvertes et des licences ouvertes « Partage à l’identique » pour les éléments de conception, ainsi que l’habilitation des utilisateurs à réparer et à modifier les caractéristiques de leurs maisons. En invitant les utilisateurs à adapter les designs et les outils pour répondre à leurs propres besoins, WikiHouse cherche à fournir un riche ensemble d’« outils conviviaux », tels que les décrit le critique social Ivan Illich. Les outils ne devraient pas tenter de contrôler les humains en prescrivant des façons étroites de faire les choses. Les logiciels ne devraient pas être encombrés de cryptage et d’obstacles à la réparation. Les outils conviviaux sont conçus pour libérer la créativité et l’autonomie personnelles13.
L’agriculture soutenue par la communauté
N’importe quel samedi matin dans la paisible ville de Hadley, dans le Massachusetts, vous verrez des familles arrivant à la ferme Next Barn Over pour cueillir des haricots et des fraises dans les champs, couper des herbes et des fleurs fraîches, et récupérer leur lot hebdomadaire de pommes de terre, de chou frisé, d’oignons, de radis, de tomates et autres denrées. Next Barn Over est une ferme fonctionnant sur le principe de l’agriculture soutenue par la communauté [comme les AMAP en France ou les GASAP en Belgique, NdT], ce qui signifie que les gens achètent à l’avance une part de la récolte saisonnière de la ferme et viennent ensuite chercher leurs produits frais chaque semaine d’avril à novembre. En d’autres termes, les participants mettent leur argent en commun avant la production et répartissent la récolte entre tous les membres. Cette pratique, utilisée par des milliers de fermes à travers le monde, nous a incités à identifier le fait de mettre en commun, plafonner et répartir comme une caractéristique importante de l’économie des communs (voir chapitre 6).
Une part pour deux personnes dans Next Barn Over coûte 415 dollars américains, soit environ 400 euros, tandis qu’une grande part, suffisante pour six personnes, coûte 725 dollars américains, soit environ 710 euros. En achetant des parts de la récolte au début de la saison, les membres fournissent aux agriculteurs les fonds de roulement dont ils ont besoin et partagent les risques de production – mauvais temps, maladies des cultures, problèmes d’équipement. On pourrait dire qu’ils se financent en harmonie avec les communs.
L’agriculture soutenue par la communauté n’est toutefois pas un modèle commercial, l’objectif n’étant pas de faire des bénéfices. Il s’agit pour les familles et les agriculteurs de se soutenir mutuellement dans le but de cultiver des aliments sains de manière écologiquement responsable. L’ensemble des 14 hectares de Next Barn Over est en agriculture biologique. La fertilité du sol est améliorée par l’utilisation de couvert végétal, d’engrais organiques, de compost et de fumier, avec une rotation régulière des cultures pour réduire les parasites et les maladies. La ferme utilise des panneaux solaires installés sur le toit de la grange. Des systèmes d’irrigation goutte à goutte minimisent la consommation d’eau. Next Barn Over organise régulièrement des dîners au cours desquels les familles peuvent se rencontrer, danser sur la musique de groupes locaux et en apprendre davantage sur les réalités de l’agriculture dans l’écosystème local.
Depuis le lancement de la première initiative d’agriculture soutenue par la communauté en 1986, celle-ci est devenue un mouvement international, avec plus de 1 700 structures rien qu’aux États-Unis (2018) et des centaines d’autres dans le monde entier. Si certaines structures américaines sont gérées dans une logique quasi commerciale, la philosophie initiale reste forte : tenter de développer de nouvelles formes de coopération entre les agriculteurs, les travailleurs et les membres, qui sont essentiellement des consommateurs. Certains s’inspirent du teikei, un modèle similaire très répandu au Japon depuis les années 1970 (le mot signifie « coopération » ou « entreprise commune »). Dans ce cas aussi, l’accent est mis sur l’agriculture biologique à petite échelle et sur les partenariats directs entre agriculteurs et consommateurs. L’un des acteurs centraux du teikei, l’Association japonaise pour l’agriculture biologique, a déclaré vouloir « développer un système de distribution alternatif qui ne dépende pas des marchés conventionnels14 ». Ces expériences inspirent aujourd’hui une variété de projets régionaux d’agriculture et de distribution alimentaire dans le monde entier, avec les mêmes objectifs : donner du pouvoir aux agriculteurs et aux gens ordinaires, renforcer les économies locales et éviter les problèmes causés par l’agriculture industrielle (pesticides, OGM, additifs, aliments transformés, coûts de transport). Le modèle socio-économique de l’agriculture soutenue par la communauté est si solide que le Schumacher Center for a New Economics, qui a contribué à l’incubation de la première initiative de ce type, développe actuellement l’idée d’une « industrie soutenue par la communauté » pour la production locale. L’idée est d’utiliser les principes de la mutualisation communautaire pour lancer et soutenir des entreprises locales – une usine de meubles, une conserverie de compote de pommes, un abattoir sans cruauté – afin d’accroître l’autonomie et la résilience économiques des territoires.
La plupart des gens imaginent que seule une grande entreprise de télécommunications ou un câblo-opérateur ayant ses entrées politiques et beaucoup de capitaux peut construire l’infrastructure nécessaire pour des réseaux Wi-Fi. En Catalogne, une modeste coopérative, Guifi.net, a prouvé le contraire, à savoir qu’il est tout à fait possible pour des gens ordinaires de construire et d’entretenir des connexions Internet de haute qualité abordables pour tous. En s’engageant à respecter les principes de propriété mutuelle, de neutralité du réseau et de contrôle citoyen, Guifi.net est passé d’un seul nœud Wi-Fi en 2004 à plus de 35 000 nœuds et à 63 000 kilomètres de connectivité sans fil en juillet 2018, particulièrement dans les zones rurales de Catalogne.
Guifi.net a vu le jour lorsque Ramon Roca, un ingénieur espagnol employé par Oracle, a piraté des routeurs standards pour les faire fonctionner comme des nœuds dans un système de type réseau maillé connecté à une seule ligne DSL appartenant à Telefónica et desservant les administrations municipales. Cette opération a permis à beaucoup de gens d’envoyer et de recevoir des données sur l’Internet en utilisant d’autres routeurs piratés de la même manière. Par l’effet du bouche-à-oreille, cette innovation de Roca pour faire face à la rareté de l’accès à l’Internet s’est rapidement répandue. Comme l’a raconté le magazine Wired, Guifi.net a développé son système grâce à une sorte de système improvisé de financement participatif, ou crowdfunding : « Il s’agissait d’annoncer un projet, d’en décrire le coût et de demander des contributions, explique M. Roca. Les fonds n’allaient pas à Guifi.net, mais aux fournisseurs de matériel et d’accès à l’Internet. Toutes ces initiatives ont jeté les bases non seulement de la construction du réseau global, mais aussi de l’émergence de nombreux fournisseurs d’accès. » Ce que Guifi.net a fait, c’est tout simplement mettre en commun et mutualiser (il a mis en commun les ressources et partagé l’Internet ; voir chapitre 6).
En 2008, Guifi.net a créé une fondation, qui a ensuite été enregistrée en tant qu’opérateur auprès de la Commission du marché des télécommunications (CMT) en avril 2009, pour aider à superviser les bénévoles, les opérations du réseau et la gouvernance de l’ensemble du système. Comme l’explique Wired, la fondation « a géré un trafic réseau vers et entre les fournisseurs internationaux, s’est connectée à CATNIX, l’un des principaux nœuds des réseaux, permettant ainsi d’accéder à d’énormes quantités de bande passante, a planifié le déploiement de la fibre et, surtout, a développé des systèmes pour s’assurer que les fournisseurs d’accès payaient leur juste part des coûts globaux de gestion des données et du réseau15 ».
L’ensemble du projet est guidé par le « Pacte pour un réseau libre, ouvert et neutre », une charte qui énonce les principes clés du commun qu’est Guifi.net et les droits et libertés de ses utilisateurs :
-
- Vous avez la liberté d’utiliser le réseau à n’importe quelle fin, tant que vous ne nuisez pas au fonctionnement du réseau lui-même, aux droits des autres utilisateurs ou aux principes de neutralité qui permettent aux contenus et aux services de circuler librement.
- Vous avez le droit de comprendre le réseau et ses compo-sants, et de partager la connaissance de ses mécanismes et de son fonctionnement.
- Vous avez le droit d’offrir des services et des contenus au réseau par vos propres moyens.
- Vous avez le droit d’adhérer au réseau et l’obligation d’étendre cet ensemble de droits à toute personne selon ces mêmes principes.
Tous ceux qui utilisent l’infrastructure de Guifi.net en Catalogne – internautes individuels, petites entreprises, administration, dizaines de petits fournisseurs d’accès Internet – sont engagés dans le « développement d’un réseau de télécommunications fondé sur les communs, libre, ouvert et neutre ». Cela a permis à Guifi.net de fournir un bien meilleur service haut débit à des prix moins élevés que celui demandé par les opérateurs dominant le marché espagnol (Telefónica, Orange et Vodafone). Les fournisseurs d’accès utilisant Guifi.net facturaient de 18 à 35 euros par mois en 2016 (environ 20 à 37 dollars) pour des connexions en fibre optique d’un gigabit, avec des prix beaucoup plus bas pour le Wi-Fi, alors que le prix moyen en Espagne était de 41 dollars (en 2017). Comme l’a souligné Wolfgang Sachs, les communs sont très efficients sur le plan financier. Ils nous permettent de devenir moins dépendants de l’argent et nous libèrent, ce faisant, de la coercition structurelle des marchés.
L’expérience de Guifi.net montre en outre qu’il est tout à fait possible de construire une « infrastructure haut débit à grande échelle, détenue localement, avec une meilleure couverture géographique que les opérateurs historiques », selon les termes du défenseur des technologies ouvertes Sascha Meinrath16. Ce succès tient pour une grande part à la mutualisation des coûts et des avantages que permet un régime fondé sur les communs.
COMPRENDRE LES COMMUNS « À L’ÉTAT SAUVAGE » DE MANIÈRE HOLISTIQUE
Comment donner du sens à ces communs si différents entre eux ? Ceux qui découvrent le sujet lèvent souvent les bras au ciel en signe de confusion, faute de percevoir les caractéristiques structurelles qui font d’un commun un commun. Ils sont perplexes à l’idée qu’un seul terme puisse être utilisé pour caractériser tant de phénomènes aussi divers. Il s’agit en fait d’un problème d’éducation de sa propre perception. Tout le monde connaît le « marché libre », même si ses manifestations – Bourses, épiceries, cinéma, mines, services personnels, travail – sont au moins aussi éclectiques que les communs. Culturellement, nous considérons la diversité des marchés comme normale, alors que les communs restent presque invisibles.
La vérité est que nous manquons presque totalement d’un langage ordinaire permettant de comprendre les communs contemporains. Les études en sciences sociales sur le sujet sont souvent obscures et très spécialisées, et la littérature économique a tendance à traiter les communs comme des ressources physiques et non comme des systèmes sociaux. Or, plutôt que de se focaliser sur la ressource singulière dont chaque commun dépend, il est plus judicieux de se concentrer sur leurs similitudes. Chaque commun dépend de ressources physiques, du partage des connaissances et de processus sociaux. Chacun d’entre eux connaît les mêmes difficultés à articuler le social, le politique (gouvernance) et l’économique (approvisionnement) en un tout intégré.
Tous les communs sont fondés sur des ressources naturelles.
Tout commun est un commun de savoirs.
Tout commun dépend d’un processus social.
Notre tâche est ainsi, pour une grande part, de nous réapproprier l’histoire sociale négligée des communs et d’en tirer des enseignements pour notre contexte contemporain. Pour cela, nous avons besoin d’un cadre conceptuel, d’un nouveau langage et d’histoires que tout le monde peut comprendre. On ne peut pas expliquer les communs avec le vocabulaire du capital, du « business » et de l’économie conventionnelle. Ce serait comme recourir à la métaphore d’une horloge ou d’une machine pour décrire des systèmes vivants complexes. Pour comprendre comment les communs fonctionnent effectivement, nous devons nous libérer d’habitudes de pensée profondément ancrées et cultiver de nouvelles perspectives.
La tâche devient plus facile dès lors que l’on reconnaît qu’il n’existe pas de modèle unique et universel pour apprécier un commun. Chaque commun porte les marques distinctives de ses origines particulières, d’une culture, de gens, d’un contexte. Pour autant, il y a aussi, dans la pratique des communs, des motifs récurrents profonds qui permettent de faire quelques généralisations prudentes. Des communs qui superficiellement paraissent très différents présentent en réalité souvent des similitudes remarquables dans la manière dont ils se gouvernent, se répartissent les ressources, se protègent contre les enclosures et cultivent des objectifs partagés.
En d’autres termes, les communs ne sont pas des machines standardisées qui peuvent être construites à partir d’un même plan. Ce sont des systèmes vivants qui évoluent, s’adaptent au fil du temps et nous surprennent toujours par leur créativité et leur ampleur.
Le terme de « pattern », ou motif récurrent, tel que nous l’utilisons ici mérite quelques explications. Nous nous inspirons ici des idées développées par l’architecte et philosophe Christopher Alexander dans son célèbre ouvrage publié en 1977, A Pattern Language [« Un langage de patterns »].Ces idées sont approfondies dans son chefd’œuvre en quatre volumes, The Nature of Order [« La nature de l’ordre »], résultat de vingt-sept années de recherches et de réflexion originales. Alexander et ses coauteurs ont brillamment mêlé une perspective scientifique empirique à une analyse du rôle formateur de la beauté et de la grâce dans la vie quotidienne et le design pour aboutir à ce que nous pourrions appeler l’« épanouissement17 ».
Pour Alexander, un pattern est un « problème qui se répète sans cesse dans notre environnement, puis décrit le cœur de la solution à ce problème, de telle sorte que vous pouvez utiliser cette solution un million de fois, sans jamais le faire deux fois de la même manière18 ». En d’autres termes, la pensée par patterns et les solutions qui en découlent ne sont jamais décontextualisées ni déconnectées de ce que nous pensons et ressentons. Il faut étudier de près les patterns sous-jacents aux communs florissants pour s’en inspirer, tout en gardant à l’esprit qu’il ne sera jamais possible de simplement « copier-coller » le fonctionnement de ce commun. Chacun doit développer ses propres solutions, localisées et adaptées à leur contexte. Chacun doit satisfaire à la fois des besoins pratiques et des aspirations et intérêts humains plus profonds.
Dans cet ouvrage, nous tentons d’identifier les patterns, ou motifs récurrents, qui sous-tendent une constellation de communs en pleine expansion – le Communivers. Notre récit se veut à la fois descriptif et ambitieux : descriptif lorsque nous examinons le fonctionnement de divers communs ; ambitieux lorsque nous essayons d’imaginer comment la dynamique actuelle des communs pourrait plausiblement se développer et devenir un secteur distinct de l’économie politique et de la culture. Nous nous appuyons sur les sciences sociales pour étudier certains aspects cruciaux des communs. Mais nous avons recours également à notre propre expérience de première main : nos discussions avec des commoneurs et nos écouvertes sur leurs remarquables communautés. Nous voulons faire la lumière sur un domaine richement texturé de créativité humaine et d’organisation sociale qui a été trop longtemps négligé, tout en rassurant le lecteur sur le fait que les communs ne sont pas si compliqués et si obscurs que seuls des experts pourraient les comprendre. En réalité, les communs prennent naissance dans l’action de gens ordinaires qui font des choses assez banales, lesquelles ne semblent inhabituelles que dans des sociétés focalisées sur le marché.
Au cours de nos voyages, nous avons été étonnés par la variété de circonstances à l’origine des communs. Cela nous a amenés à nous demander pourquoi tant de discussions sur les communs se fondaient sur des catégories économiques d’analyse (« types de biens », « allocation des ressources », « productivité », « coûts de transaction »), alors que les communs sont avant tout des systèmes sociaux permettant de répondre à des besoins partagés. Cette question nous a incités à entamer un processus de reconceptualisation de ce que signifie, dans son sens le plus large, s’engager dans la pratique des communs.
Nous pensons que cette perspective s’inscrit dans un changement de paradigme plus large. Elle contribue à redéfinir l’idée même d’économie et à élargir le champ fonctionnel de l’action démocratique. Les communs répondent à des besoins bien réels tout en provoquant un changement dans la culture et les identités. Ils influencent nos pratiques sociales, notre éthique et notre vision du monde et, ce faisant, modifient le caractère même de la politique. Pour comprendre ces courants plus profonds, nous avons besoin d’un cadre de pensée plus riche, donnant tout leur sens aux communs. Nous en avons besoin pour mieux expliquer la dynamique interne de la gouvernance et de l’approvisionnement par les pairs, ainsi que la manière dont la pratique des communs articule l’économie politique au sens large avec nos vies intérieures. Bref, nous devons reconnaître que les communs requièrent une nouvelle vision du monde.
II: Un Changement De Perspective Ontologique
Si les communs ont joué un rôle aussi important dans l’histoire de l’espèce humaine, pourquoi sont-ils généralement ignorés dans la vie moderne ? Pourquoi restent-ils une terra incognita systématiquement caricaturée et mal comprise ? Au fil des ans, en discutant avec des commoneurs dans d’innombrables contextes différents, nous nous sommes progressivement rendu compte que le problème ne venait pas de la pratique des communs elle-même. Il vient des catégories de pensée défectueuses de l’économie établie, du droit établi et de la politique établie. Leur vocabulaire et leur logique présupposent un monde fondé sur l’individualisme, la croissance économique et la maîtrise humaine de la « nature » (un terme qui implique une séparation nette entre l’humanité et le monde non humain). Ils présupposent un couple marché/État omnipotent qui refaçonne l’univers sur la base de ces idées mythopoétiques. Il n’est pas étonnant que les niches préservées de communs florissants semblent dès lors des créatures étranges venues d’une autre planète !
Un jour, après avoir longuement médité sur ce curieux décalage entre la pensée dominante et les réalités que nous avions observées au cours de nos recherches et de nos voyages, nous avons eu besoin d’une pause. Nous sommes allés faire un tour au Muséum d’Histoire naturelle Beneski de l’Amherst College dans le Massachusetts – détour qui nous a menés à une illumination inattendue. En parcourant les impressionnantes collections de squelettes de dinosaures et d’empreintes fossilisées, nous avons eu la même épiphanie : parfois, des vérités nouvelles ne peuvent se révéler qu’à travers un changement de perspective ontologique – ce que nous avons appelé un « Ontochangement ». Nous expliquerons cette idée plus en détail dans un moment. Revenons d’abord à notre visite au musée.
Tandis que la plupart des musées d’Histoire naturelle dans les grandes villes ont un penchant pour le grandiose et le spectaculaire, le modeste musée Beneski est un espace de travail bien aménagé destiné à enseigner aux étudiants de premier cycle comment donner du sens aux mystères géologiques. Une bonne partie de l’exposition permanente est consacrée aux recherches d’Edward Hitchcock. Ce géologue de premier plan des années 1830 a découvert des milliers de marques étranges dans les roches de carrières et de fermes de la région. Dans le musée sont exposés de nombreux squelettes et ossements de dinosaures, dont une effrayante tête de Tyrannosaurus rex, ainsi que des dizaines de roches sédimentaires disposées avec art sur les murs. Chacune de ces dalles de roche représentait à l’époque un mystère vieux de 270 millions d’années. S’agissait-il d’« empreintes de dindes », selon les habitants de la région, ou peut-être des traces du « corbeau de Noé », oiseau gigantesque de l’Arche biblique ? Il était difficile de trouver la clé de l’énigme, car aucun os fossilisé n’avait encore été retrouvé à l’époque1.
Pour résoudre ce mystère, Hitchcock, scientifique sérieux et chrétien dévot, avait pour seul cadre de référence ses propres yeux et la Bible. Découvrant des dépôts de gravier, de limon, de sable et de blocs rocheux à Cape Cod, il a trouvé tout à fait naturel de les appeler Diluvium, en référence au Déluge décrit dans la Bible. Cependant, comme l’ont conclu plus tard les scientifiques, ces dépôts étaient en réalité des moraines, des débris rocheux laissés par les glaciers pendant la période glaciaire. Bien que Hitchcock ait correspondu avec des personnalités comme Richard Owen, Charles Darwin et Charles Lyell, il restait convaincu que les « traces de pas » (comme il les appelait) préservées dans la roche sédimentaire étaient celles de grands oiseaux antiques.
Et pourquoi pas ? La découverte du monde préhistorique ne faisait alors que commencer. Le mot « dinosaure » n’a été inventé qu’en 1841 par le paléontologue britannique Richard Owen, et les premiers fossiles de dinosaures aux États-Unis n’ont été mis au jour qu’en 1858. L’ouvrage de Charles Darwin De l’origine des espèces n’a été publié qu’en 1859, et les découvertes les plus importantes de fossiles n’ont pas eu lieu avant les années 1890. Pour Hitchcock, qui croyait en la Bible, l’idée que d’énormes créatures ressemblant à des lézards aient pu évoluer dans un monde très différent il y a 273 millions d’années était littéralement impensable.
Dans son livre sur Hitchcock paru en 2006, Nancy Pick avoue son admiration pour ses réalisations scientifiques, mais conclut avec regret sous la forme d’une lettre à son adresse :
Je dois vous dire que beaucoup de vos convictions les plus profondément enracinées se sont révélées erronées. Vous avez eu tort de douter de l’existence d’une période glaciaire. Vous avez eu tort de nier la théorie de l’évolution. Et, pire encore, vous avez eu tort au sujet des animaux qui ont laissé vos chères empreintes fossiles. Ce n’étaient pas après tout d’antiques oiseaux gigantesques, mais des dinosaures.
Il est tentant pour la postérité de reprocher aux générations précédentes ce qu’elles ne savaient pas ou ne pouvaient pas savoir à leur époque. Ce n’est pas notre propos. Ce que nous trouvons fascinant est la manière dont une vision du monde encadre et limite ce que nous pouvons percevoir. Nous ne pouvons jamais vraiment voir le monde « tel qu’il est », car notre esprit est trop occupé à le constituer et à le créer. Nous croyons naturellement que la réalité que nous percevons est évidente et universelle – le « sens commun » – mais en vérité, toute vision de la réalité repose sur des présupposés sousjacents relatifs à la nature du monde. Nos croyances sont façonnées par des hypothèses invisibles elles-mêmes influencées par la culture, l’histoire et l’expérience personnelle.
Le langage contribue lui aussi à façonner notre conscience. Le langage propre à une économie politique et à une culture particulières nomme certains phénomènes que ces dernières considèrent comme significatifs et leur confère un contenu moral, tandis que d’autres phénomènes restent sans nom et ignorés. Les hommes politiques savent jouer de ces images mentales, de ces cadres pour percevoir ou ne pas percevoir. Par exemple, les conservateurs aiment parler d’« allègement fiscal » pour laisser entendre que les impôts sont un fardeau injuste et occulter cette vérité que « les impôts sont le prix à payer pour une société civilisée2 ». Dans son étude classique sur le « folklore du capitalisme », Thurman Arnold montre comment les entreprises sont considérées à tort comme des personnes possédant des libertés civiles qui leur seraient autrement refusées. Les entreprises et autres organisations sont décrites « dans le langage de la propriété privée personnelle, alors qu’en fait elles ne sont ni privées, ni propriété, ni personnelles3 ». Les spécialistes des sciences cognitives soulignent eux aussi le « caractère idéologiquement sélectif » des cadres de pensée, filtres très efficaces de la perception4.
Cela permet d’expliquer pourquoi des vérités nouvelles restent souvent cachées à la vue de tous. Lorsque John Maynard Keynes s’efforçait de réinventer l’économie dans les années 1930, il écrivait : « Les idées exprimées ici de manière si laborieuse sont extrêmement simples et devraient être évidentes. La difficulté ne réside pas dans ces nouvelles idées, mais dans le fait d’échapper aux anciennes, qui étendent leurs ramifications, pour ceux qui ont été éduqués comme la plupart d’entre nous l’ont été, dans tous les recoins de notre esprit5. » Hitchcock a essayé, mais n’a pas pu échapper à la vision du monde dont il avait hérité. Owen, Darwin et Lyell ont également essayé (avec une certaine inquiétude quant aux implications théologiques explosives de leurs nouvelles idées) et ont pour la plupart réussi. Tel est le pouvoir d’une vision du monde dominante : elle organise de manière invisible les phénomènes dans un cadre mental bien ordonné, lequel oblitère d’autres façons, potentiellement importantes, de voir le monde.
Le grand problème de notre époque n’est pas seulement que les institutions de l’État libéral et du capitalisme s’effritent. C’est que nos façons de percevoir et de nous représenter le monde – les récits fondamentaux que nous racontons sur le capitalisme – sont également en échec. Bien sûr, les deux problèmes sont intimement liés. Parfois, lorsque les systèmes politiques ne fonctionnent plus, c’est parce qu’ils s’appuient sur de vieux récits qui n’opèrent plus ou qui n’inspirent plus le respect. Les histoires et les catégories de pensée auxquels ils s’adossaient consciencieusement les empêchent de voir que les réalités ont changé. Les gardiens de l’ordre établi refusent généralement de reconnaître d’autres possibilités et s’accrochent à un langage archaïque pour valider leur point de vue. Parfois, les nouvelles réalités ne sont pas reconnues tout simplement parce qu’il n’existe pas encore de vocabulaire ou de logique pour les rendre culturellement lisibles. C’est ainsi que le mot « dinosaure » et la théorie de l’évolution de Darwin ont ouvert de nouvelles façons de voir, remettant en cause la vision du monde fondée sur la Bible.
Essayant d’expliquer le phénomène des communs, nous avons ressenti cette même frustration face à la déficience des discours établis. Nous nous sommes rendu compte que les discours de la politique et de l’économie conventionnelles n’étaient pas en adéquation avec ce dont nous voulions témoigner. Il y a une lacune dans le vocabulaire contemporain qui sert à maintenir certaines réalités et certaines idées dans l’obscurité. Pour reprendre les termes de l’historien E. P. Thompson : « Il a toujours été difficile d’expliquer les communs avec des catégories capitalistes. Ils avaient quelque chose d’étrange. Leur existence même soulevait des questions sur l’origine de la propriété et sur les titres historiques de propriété foncière6. »
Ce que nous voulons dire, c’est que les registres profonds de la perception sont tout aussi importants que les polémiques politiques qui font l’actualité. Si ce n’est plus importants. Le philosophe allemand Hans-Georg Gadamer a noté un jour que c’était une erreur de croire qu’il faut parler de politique pour changer la politique. Il avait raison. Nous devons d’abord parler de nos présupposés les plus profonds sur la nature du monde.
LA FENÊTRE À TRAVERS LAQUELLE NOUS VOYONS LE MONDE
L’étude de l’être et de la structure de la réalité – les fenêtres à travers lesquelles nous voyons le monde – s’appelle l’ontologie. Nous ne souhaitons pas particulièrement nous plonger dans des eaux métaphysiques profondes ; le sujet peut devenir très compliqué et abscons. Mais nous ne pouvons pas éviter de nous y baigner brièvement. Nos hypothèses fondamentales sur la réalité déterminent ce qui est considéré comme normal et souhaitable – ce qui est bon ou mauvais, juste et injuste. Elles constituent le « cadre conceptuel » de tout système de croyances qui façonne directement nos idées sur les types d’économie politique et de structures de gouvernance qui sont possibles ou pas. Une vision de la réalité où les gens sont considérés comme des individus déconnectés, par exemple, tend à promouvoir un ordre social qui privilégie la liberté individuelle au détriment des institutions collaboratives. Une vision de la réalité où les gens sont considérés comme interconnectés et dépendants les uns des autres et de la Terre ouvre des possibilités très différentes.
Une telle vision nécessite aussi des catégories d’analyse, des métaphores et des vocabulaires différents pour décrire le monde.
On pourrait dire que les présupposés ontologiques de chacun créent différentes possibilités, ou affordances – c’est-à-dire des capacités et des usages potentiels ayant des implications politiques plus larges. Un vélo crée certaines affordances de transport personnel (exercice physique, mobilité bon marché) qui sont différentes de celles créées par une automobile (plus rapide, plus sûre, plus fluide). Le stylo et le papier offrent des affordances de communication différentes (bon marché, faciles à utiliser) de celles des smartphones (interactifs, polyvalents). Il en va de même pour les ontologies : elles ont des affordances différentes en ce qui concerne le type de monde que l’on peut construire. À propos d’une vision de la réalité, il faut toujours se poser la question : qu’affirme-t-elle sur la manière dont les individus se rapportent les uns aux autres et aux groupes ? Implique-t-elle que les choses et les phénomènes incarnent des essences fixes ? Le caractère d’une personne est-il fixe et donné, ou bien évolue-t-il à travers ses relations ? Comment le changement se produit-il – à travers des agents individuels qui provoquent des effets comme le ferait une machine, ou à travers des interactions compliquées, subtiles et de long terme entre de multiples agents dans un environnement plus large ? Les phénomènes que nous observons sont-ils des invariants historiques et culturels – autrement dit, sont-ils universels – ou bien sont-ils au contraire variables et contextualisés ?
Généralement, ce genre de questionnement sur la réalité n’est pas considéré comme pertinent dans le monde pragmatique et tumultueux de la politique et de la gouvernance. Au vu de l’instabilité institutionnelle de notre époque, cependant, nous pensons que rien n’est plus stratégique que de réévaluer les catégories fondamentales à travers lesquelles nous percevons la réalité. Cet examen pourrait être qualifié d’onto-politique, car nos présupposés sur la réalité ont d’énormes implications sur la façon dont nous conceptualisons l’ordre social et politique. Si nous croyons que Dieu existe en tant que force omnipotente et qu’il est la source de la vérité et du sens de toutes les affaires humaines, nous établirons un ordre sociétal bien différent de celui dans lequel les humains se considèrent comme entièrement autonomes, sans direction ni protection divine. Parce que nos perspectives sur la réalité affectent la manière dont nous construisons les institutions sociales et politiques, nous ne pouvons pas nous contenter de regarder le monde à travers une fenêtre – comme si c’était la seule manière possible de percevoir. Nous devons faire une pause et commencer à regarder la fenêtre elle-même7. Margaret Stout, une théoricienne de l’administration, le dit en des termes tout simples : « L’ontologie est importante pour la théorie politique parce qu’elle façonne les présupposés sur tous les aspects de la vie et sur ce qui est bon et juste8. »
L’ONTORÉCIT DE L’OCCIDENT MODERNE
Le moment est venu, pour nous qui vivons dans l’Occident sécularisé, d’interroger le système général de croyance élaboré durant la Renaissance et développé au cours des xviiie et xixe siècles par les sociétés capitalistes qui en sont issues. Nous, modernes, vivons selon un grand récit sur la liberté individuelle, la propriété et l’État conçu par des philosophes tels que René Descartes, Thomas Hobbes et John Locke. L’Ontorécit que nous nous racontons à nous-mêmes voit les individus comme les acteurs fondamentaux d’un monde rempli d’objets inertes dotés de qualités fixes et essentielles. Nous avons en particulier l’habitude de nous référer à la « nature » et à l’« humanité » comme si chacune était une entité distincte de l’autre. Le grand récit séculier de l’Occident assure que nous, les humains, sommes nés avec une liberté illimitée dans un « état de nature » prépolitique. Mais nos ancêtres imaginaires (qui exactement ? quand ? où ?), qui auraient été prétendument préoccupés par la protection de leur propriété et de leur liberté individuelles, se seraient réunis (malgré leur individualisme radical) pour nouer entre eux un « contrat social9 ». Tout le monde aurait alors, poursuit le récit, autorisé la création de l’État pour qu’il devienne le garant de la liberté et de la propriété individuelles de chacun10.
Nous sommes aujourd’hui les héritiers de ce mythe des origines de l’État libéral séculier. Ce récit transfère certaines notions théologiques d’omnipotence (Dieu, les monarques) à l’État souverain (présidents, Parlements, tribunaux)11. L’État Léviathan exerce son pouvoir souverain afin de privilégier la liberté individuelle par rapport à toutes les affiliations ou identités sociales fondées sur l’histoire, l’ethnicité, la culture, la religion, les origines géographiques, et ainsi de suite. Les éléments fondamentaux de la société sont l’individu et l’État. Comme le note Margaret Stout, le libéralisme suppose une nature humaine « où des individus intéressés, atomistiques, avec des préférences indépendantes et statiques, se font concurrence dans le but de maximiser leurs propres bénéfices, avec un souci minimal ou nul des conséquences pour les autres. Dans cette formation politique, la représentation s’obtient à travers la concurrence entre individus souverains et la règle de la majorité12 ».
Ce récit sert également de base au capitalisme, qui présuppose un ordre social fondé sur l’autonomie et l’épanouissement individuels afin d’expliquer la concurrence de marché et les hiérarchies. Selon James Buchanan, Prix Nobel d’économie, les principes fondamentaux de sa discipline sont l’autonomie, la rationalité des choix et la coordination spontanée des gens au sein des « marchés libres13 ». Dans les temps contemporains, ces présupposés sont devenus des principes ordonnateurs pour une grande partie de la vie quotidienne. Tout concourt à célébrer la liberté de choix individuelle – celle de choisir nos chaînes de télévision, notre marque de bière et nos partis politiques préférés –, sans que l’on se préoccupe vraiment de la manière dont l’éventail de nos choix a été déterminé en premier lieu.
Remettre en question nos présupposés sur le monde n’est pas seulement un exercice académique. Cela a d’immenses conséquences sur le plan pratique. Des présupposés différents changeraient notre perception du monde et, par conséquent, le type de système politique que nous considérons comme réaliste et souhaitable. Selon une métaphore souvent utilisée par le physicien allemand Hans-Peter Dürr, les pêcheurs qui utilisent des filets avec des mailles de 5 centimètres concluront tout naturellement qu’il n’y a pas dans la mer de poissons de taille inférieure à 5 centimètres. De fait, aucun poisson de 3 centimètres n’apparaîtra jamais dans leurs filets. Si vous restez attaché à certains présupposés sur la réalité, vous serez limité quant à ce qui se retrouvera dans le filet de votre perception. Le lien entre l’ontologie, la politique et l’économie politique n’est peut-être pas évident pour les gens ordinaires ou les décideurs, mais il est assez basique. Imaginez que vous construisiez une maison et que vous posiez des fondations trop petites et trop faibles. Comment l’édifice pourra-t-il durer ? Ou bien que vous installiez un certain nombre de piliers qui peuvent soutenir, disons, un poids de 10 tonnes. Quelques années plus tard, si vous ajoutez un nouvel étage pesant 15 tonnes, la maison s’effondrera. Est-il vraiment judicieux d’investir dans une addition massive à la structure si la fondation elle-même est défectueuse ?
C’est exactement là le problème du capitalisme moderne. Il repose sur des prémisses défaillantes à propos des êtres humains et il ne peut donc plus soutenir le grand édifice mondial du couple État/marché. Ses formes institutionnelles sont de plus en plus inefficaces, nocives et discréditées, comme en témoignent l’aliénation et la colère croissantes des électeurs aux États-Unis et dans de nombreux pays européens. Lorsque la garantie des « libertés individuelles » est mise dans le même sac que le statut juridique de « personne morale » de grandes entreprises d’envergure mondiale, ou lorsque les investissements qui contribuent à dérégler le climat sont considérés comme devant être protégés comme « propriété privée », le système économique qui en résulte ne peut être qu’une cause de bouleversements et de danger mortel pour la planète. Les critiques habituelles s’en prennent au « capitalisme » et à l’« État », mais elles négligent généralement de s’interroger sur les prémisses onto- politiques qui sous-tendent leur vision de la réalité. C’est parce que la plupart d’entre nous ont intériorisé ces normes. Le critique social grec Andreas Karitzis écrit :
Le motif de vie dominant [du capitalisme moderne et de l’État libéral] promeut l’idée qu’une vie bonne est essentiellement une réussite individuelle. La société et la nature ne sont qu’une toile de fond, un papier peint pour notre ego, le contexte contingent dans lequel notre moi solitaire va évoluer en poursuivant des objectifs individuels. L’individu ne doit rien à personne, il n’a aucun sens du respect dû aux générations précédentes ni de sa responsabilité à l’égard des générations futures – et face aux problèmes et aux conditions sociales actuels, l’attitude appropriée est l’indifférence14.
Les pathologies évidentes du capitalisme – destruction écologique, précarité sociale, inégalités, exclusion, etc. – n’ont pas pour seules causes l’immoralité des multinationales et le cynisme des hommes politiques. Elles découlent d’un problème plus profond, plus fondamental : d’une compréhension fallacieuse de la réalité elle-même. Se confronter à ce problème peut sembler une lourde tâche. S’il est déjà difficile de percevoir les fondements réels de notre ordre socio-économique et politique, il l’est encore davantage d’agir en vue de les transformer. Nos normes culturelles sont subtiles, subliminales, tout en n’étant généralement pas reconnues comme telles.
Il y a cependant un moyen d’avancer. Nous pouvons nous efforcer de cultiver un sens différent et plus profond de la réalité en examinant de près le langage et les métaphores que nous utilisons, de même que les histoires que nous racontons. La conscience de soi qui en résulte, combinée à nos expériences et à nos pratiques réelles de commoning, peut indiquer la voie vers un nouvel ordre onto-politique fondé sur des présupposés différents. La première étape consiste à identifier comme telles les croyances cachées qui façonnent nos perceptions et notre culture politique. Nous devons apprendre à voir que tout est interdépendant et que notre bien-être individuel dépend du bien-être collectif. Comme le dit Arturo Escobar, notre organisation politique doit être « en accord avec la dimension relationnelle de la vie15 ».
LES ONTORÉCITS COMME DIMENSION
PROFONDE ET CACHÉE DE LA POLITIQUE
De nombreux débats publics, qui relèvent en apparence de désaccords sur les politiques ou les procédures, sont en réalité des désaccords sur la nature de la réalité et sur ce que cette réalité devrait être. Ils présupposent certains idéaux-types humains et certaines réalités existentielles qui enferment les discours dans le cadre dominant. Prenez l’idée du « self-made-man » dans les sociétés capitalistes. Elle reflète le fantasme culturel selon lequel les individus peuvent véritablement réussir par eux-mêmes, sans l’aide des autres. Ce récit devient alors le cadre au sein duquel se déroule le débat public. De même, notre présupposé selon lequel la Terre est une entité distincte, inerte, séparée de l’humanité conduit à percevoir la terre et l’eau comme des « ressources » que l’on peut s’approprier et commercialiser.
Les catégories de pensée conçues par les philosophes de la première modernité ont établi des modes de pensée standards que les sociétés contemporaines considèrent comme allant de soi. Dans les conceptions d’hommes tels que Francis Bacon, Thomas Hobbes, René Descartes et John Locke, le monde est vu comme un affrontement de dualités : l’individu et le collectif, l’humanité et la nature, la matière et l’esprit. Le domaine public est tenu pour distinct du domaine privé. L’objectif est opposé au subjectif. Cette habitude de pensée dualiste, comme moyen d’enregistrer la réalité, nous amène à croire que certains domaines de la vie sont totalement séparés et distincts des autres, voire diamétralement opposés les uns aux autres. Les sociétés capitalistes modernes ont construit des cultures entières sur ces présupposés. Elles reflètent ce que les chercheurs appellent un Ontorécit sur la réalité.
Les Ontorécits peuvent prendre d’innombrables formes. Mais en fin de compte, ils peuvent être classés en fonction de quelques traits distinctifs. Il existe des récits fondés sur l’idée que « l’être est tel qu’il est » (statique) et des récits dans lesquels l’existence est un constant devenir (dynamique). Dans un monde statique, le présent est vécu comme une réalité qui toujours est et toujours sera, un peu comme les membres du système des castes en Inde considèrent leur monde comme « le monde tel qu’il est ». Cette vision statique de la réalité trouve son expression politique dans la théocratie, la monarchie ou un régime autoritaire similaire. Dans un monde dynamique, en revanche, la réalité présente est toujours en train de se développer et de devenir quelque chose d’autre.
Il existe des Ontorécits fondés sur l’idée d’une source d’existence unique et unitaire, qui a trouvé son expression dans des formes politiques telles que le socialisme et le collectivisme. Inversement, les récits qui présupposent de nombreuses sources d’existence sont plus susceptibles de servir de support à un ordre politique comme le libéralisme moderne et l’anarchisme social. Dans certains Ontorécits, la vérité et le sens proviennent d’une source transcendante (Dieu, un roi, un pape), et dans les autres d’un espace immanent de l’expérience vécue (le divin à l’intérieur de chaque humain ou de tous les êtres)16.
Dans tous les cas, les Ontorécits reflètent une certaine vision du monde et établissent les affordances du système : ils structurent ses champs de possibilités. Ces récits attribuent une plus grande respectabilité à certains archétypes d’existence et d’effort humains. Les énergies humaines sont canalisées dans des formes culturellement acceptables. Le domaine envahissant de la publicité et du marketing, par exemple, ne se contente pas de vendre des produits ; il contribue aussi à renforcer un idéal de satisfaction humaine par la consommation individuelle. Il raconte un Ontorécit sur le monde tel qu’il est et qu’il devrait être. Notre identité dans ce monde est définie par ce que nous achetons ou devrions acheter. De nos jours, les grandes entreprises conçoivent de plus en plus leur propres Ontorécits sophistiqués pour définir la réalité et faire avancer ainsi leurs intérêts politiques et économiques. À partir de vastes quantités de données d’utilisateurs, Twitter a imaginé tout un système de classification de l’humanité – ceux qui achètent des produits de cuisine, ceux qui vivent dans un rayon de 8 kilomètres autour d’un supermarché, etc. – afin de vendre ces ensembles de données aux annonceurs17. Le secteur des assurances a mis au point des classifications complexes des maladies et des blessures afin de déterminer quels frais médicaux peuvent être remboursés. De nombreux tribunaux s’appuient sur des analyses de données sur les criminels (race, âge, quartier, revenus) pour évaluer la probabilité qu’ils commettront un autre crime et fixer ainsi des peines de prison « appropriées »18. Ces catégories de pensée reflètent une vision bien déterminée de l’existence humaine, du comportement en société et de la causalité.
L’appareil de sécurité nationale des États-Unis a lui-même, de fait, créé tout un Ontorécit pour pousser ses intérêts politiques, comme Brian Massumi le raconte de manière glaçante dans son livre Ontopower [« Ontopouvoir »]19. Plutôt que d’essayer de dissuader ou de prévenir les attaques terroristes sur la base de faits connus et prouvables – ce qui était historiquement la norme pour toute intervention militaire –, le gouvernement américain impose désormais sa propre conception du temps et de la causalité. L’affirmation de la possibilité d’une menace terroriste, telle qu’elle est établie unilatéralement par des experts en sécurité, peut être utilisée pour justifier une agression létale de l’État contre des « terroristes » avant même qu’il se soit passé quoi que ce soit. Des menaces théoriques sont définies comme des provocations. Des possibilités futures sont reclassées en faits justifiant d’agir dans l’ici et maintenant. Il s’agit d’une subtile redéfinition du temps et de la causalité. En créant un récit de « menace virtuelle permanente », écrit Massumi, l’armée américaine redéfinit la réalité pour légitimer la violence d’État et la surveillance de masse qui s’ensuit.
Ces exemples mettent en lumière le rôle des ontologies comme forces souterraines dans la lutte politique. Dès lors que nous acceptons l’idée du moi comme une unité indivisible et bornée capable d’agir de manière autonome, tout le reste suit naturellement : la manière dont nous abordons le monde, les cadres mentaux que les scientifiques utilisent pour analyser les phénomènes (« individualisme méthodologique »), la manière dont nous agissons dans le monde et concevons le leadership, la façon dont nous construisons nos institutions et nos politiques publiques. On pourrait dire que le lieu le plus important d’affrontement politique aujourd’hui ne se trouve ni dans les Parlements ni dans les tribunaux, mais à ce niveau de la « définition de la réalité ». Après tout, quel meilleur moyen d’avancer ses objectifs politiques à long terme que de propager une version intéressée de la « réalité » ? Elle marginalisera de manière préventive les visions alternatives de l’avenir tout en renforçant l’ordre politique et économique existant.
Mais il y a un hic : aucune ontologie, si largement acceptée soitelle, n’est certaine d’emporter l’adhésion et le respect. Une ontologie peut ne pas convaincre ou ne pas être à la hauteur de ses prétentions. La théorie de Hitchcock selon laquelle les empreintes fossilisées avaient été laissées par d’anciens oiseaux ne pouvait expliquer de manière crédible la découverte de fossiles de dinosaures. Le nouveau récit de Darwin sur l’évolution, quant à lui, le pouvait. De la même manière, les fondements ontologiques qui sous-tendent le capitalisme semblent aujourd’hui plus désuets que jamais. L’idée que les individus naissent libres et souverains – la pierre angulaire de l’État libéral et des « marchés libres » – a toujours été une sorte de fable. Mais aujourd’hui, sa crédibilité commence à sérieusement s’effilocher à mesure que les gens se rendent compte qu’ils vivent dans un monde étroitement interconnecté. L’effondrement progressif des écosystèmes discrédite également l’idée que l’humanité est séparée de la « nature » et que nous sommes des individus entièrement autonomes.
Beaucoup d’affrontements politiques virulents à travers le monde, qui portent en apparence sur les politiques publiques ou la législation, sont en réalité des Ontoconflits. Ils reflètent des désaccords profonds sur la nature de la réalité. Les conflits entre les peuples indigènes et le pouvoir de l’État sont peut-être l’exemple le plus répandu. De manière générale, l’État-nation considère les éléments de la nature comme des ressources marchandes à exploiter – notion qui est pour de nombreuses communautés indigènes une violation flagrante de leur cosmovision. En Nouvelle-Zélande, par exemple, les Maoris se sont opposés à l’approbation par le gouvernement de forages pétroliers dans leurs zones de pêche ancestrales, en violation du traité de Waitangi signé avec la reine Victoria en 1840. Dans ses études sur ce conflit, l’anthropologue Anne Salmond note que l’État et les Maoris ont « des onto-logiques fondamentalement différentes sur les relations humaines avec les océans20 ». L’État considère l’océan comme une ressource non vivante. Dès lors, celui-ci peut être divisé en unités quantifiées et délimitées et exploité selon une logique de marché abstraite. L’extraction pétrolière est parfaitement logique pour l’État néo-zélandais, dont le système juridique est conçu pour privilégier ce type d’activité. En revanche, les Maoris voient l’océan comme un être vivant qui entretient des liens intenses et intergénérationnels avec leur peuple. L’océan est imprégné de mana, un pouvoir ancestral qui doit être honoré par des rituels spirituels et des pratiques coutumières. (Si cela vous semble irrationnel, rappelez-vous que cette vision du monde a remarquablement bien fonctionné pour protéger à la fois les océans et les sociétés humaines.)
À l’évidence, les Ontoconflits entre l’État-nation et les commoneurs ne concernent pas seulement les cultures prémodernes. La géographe Andrea Nightingale a étudié les pêcheurs écossais qui s’opposent aux politiques et aux pratiques de pêche « rationnelles » que les régulateurs cherchent à leur imposer21. Quand il conçoit les règles relatives aux prises de pêche, par exemple, l’État présume que les pêcheurs sont des individualistes compétitifs qui cherchent à maximiser leurs prises personnelles. Il ne voit pas les subjectivités non rationnelles qui définissent la vie des pêcheurs écossais. Travailler sur de petits bateaux de pêche en plein océan est un travail dangereux et difficile, et les pêcheurs ont donc appris l’importance de la coopération et de l’interdépendance. La vie des pêcheurs est profondément liée « aux obligations communautaires, à la nécessité de préserver les relations de parenté [avec les autres villageois] et à un attachement affectif à la mer », écrit Nightingale. Les politiques publiques se fondent sur une réalité de vie et une « rationalité » très différentes de celles vécues par les pêcheurs.
Malgré l’omniprésence de ce type d’Ontoconflit, le capitalisme moderne et les États-nations libéraux restent obsessionnellement attachés à leur vision de la réalité. Celle-ci constitue le « lit de rivière »22 de la collectivité politique, à travers lequel tout doit s’écouler. Mais de plus en plus, les Ontorécits de l’État apparaissent comme des reliques d’une autre époque de l’histoire humaine – un costume en lambeaux, mal ajusté, qui n’est ni fonctionnel ni attrayant. Il est temps de se poser la question : comment pourrait-on imaginer et concevoir un costume différent ?
MOI-IMBRIQUÉ ET RATIONALITÉ UBUNTU :
L’ONTOLOGIE RELATIONNELLE DES COMMUNS
Le monde des communs constitue pour le capitalisme un défi immense, car il s’appuie sur une ontologie très différente. Beaucoup de gens ne s’en rendent pas vraiment compte parce qu’ils continuent à voir les communs selon une perspective ontologique archaïque – c’est-à-dire à travers les lunettes normatives de la culture occidentale moderne. Ils ont intériorisé le langage de la séparation et de l’individualisme méthodologique. Ils considèrent les objets comme dotés d’attributs fixes et essentiels, déconnectés de leurs origines et de leur contexte. La pratique des communs repose sur une orientation différente vis-à-vis du monde, ses actions étant fondées sur la profonde relationalité de tout. C’est un monde de connexions interpersonnelles denses et d’interdépendances. Les actions ne sont pas simplement affaire de causes et d’effets simples et directs entre les acteurs les plus proches et les plus visibles ; elles découlent d’un tissu culturel vivant et de myriades de relations à travers lesquelles de nouvelles choses émergent.
Pour ceux d’entre nous qui sont acculturés aux normes euro- américaines, il n’est pas si facile de reconnaître l’ontologie qui sous-tend les communs. Notre langage lui-même recèle toutes sortes de préjugés cachés qui nous orientent dans des directions différentes et nous empêchent de nommer les réseaux de relationalité. C’est pourquoi, afin de véritablement voir les communs, nous devons nous débarrasser de vieux concepts inappropriés et en inventer de nouveaux. La langue anglaise en particulier, en tant que langue mondiale dominante, est comme un filtre qui efface de nombreuses idées sur les communs, lesquels sont souvent mieux exprimées dans d’autres langues et expériences culturelles23.
Nous traiterons cette question de manière plus approfondie dans le prochain chapitre. Pour l’instant, nous souhaitons illustrer les conséquences énormes qui peuvent découler de certains présupposés de base sur la réalité. Lorsque nous essayons de communiquer les réalités de la pratique des communs, nous nous heurtons constamment à la dualité des concepts « moi » et « nous ». Ces mots mêmes établissent une opposition que la pratique des communs transcende. Voir le monde à travers un choix binaire entre « moi » et « nous » empêche une réelle compréhension des communs. Le langage lui-même devient un obstacle à la transmission d’un Ontorécit différent. Alors que nous réfléchissions à ce dilemme, un terme nous est un jour venu à l’esprit : Nested-I (Moi-imbriqué). Il nous aide à décrire les pratiques et l’identité d’un commoneur. Il permet de dépasser des préjugés profondément ancrés opposant l’identité et l’action individuelles aux objectifs collectifs. Le Moi-imbriqué est une tentative de rendre visibles les relations sociales subtiles et contextuelles qui intègrent le « moi » et le « nous ». Notre mentalité occidentale ne reconnaît pas facilement cette idée, mais c’est une réalité omniprésente. (Voir image 1 : Concept du Moi-imbriqué, téléchargeable sur www.eclm.fr)
Malgré les lacunes de notre langage, l’anthropologie confirme que nous, humains, sommes inéluctablement des Moi-imbriqués. Dans de nombreuses cultures non occidentales, selon la Britannique Marilyn Strathern, professeure d’anthropologie sociale, « la personne singulière peut être imaginée comme un microcosme social […] De fait, les personnes sont fréquemment construites comme le site pluriel et composite des relations qui les ont produites24 ». Pour Strathern, un individu ne parvient pas à l’autonomie en opposant ses intérêts personnels aux intérêts sociétaux, mais plutôt en « célébrant la socialité qu’il contient en lui-même25 ». Les identités des personnes sont « constituées de manière multiple » par un « enchaînement de relations26 ». Ou, comme le dit le poète Walt Whitman ; « Je suis vaste, je contiens des multitudes. » Johann Wolfgang von Goethe, le célèbre polymathe de l’âge des Lumières, considérait sa vie comme la synthèse de myriades de relations :
Tout ce que j’ai vu, entendu et observé, je l’ai collecté et exploité. Mes travaux ont été nourris par d’innombrables individus différents, des innocents et des sages, des personnes intelligentes et des imbéciles. L’enfance, la maturité et l’âge m’ont apporté leurs pensées […] leurs perspectives sur la vie. J’ai souvent récolté ce que d’autres avaient semé. Mon œuvre est celle d’un être collectif qui porte un nom : Goethe27.
L’un des grands sophismes de notre époque – en contraste total avec la conception de Goethe – est l’idée qu’une personne puisse faire fortune uniquement grâce à ses efforts individuels, selon le motif du « self-made-man », l’homme qui « s’est fait lui-même ». L’idée que quelqu’un puisse réellement exister et se développer séparément de ses amis, de sa famille, de ses collègues ou de la société est absurde – un « mythe malléable, pernicieux et irrépressible », selon les termes d’un observateur28. Les psychologues du développement vous diront qu’un individu ne peut venir à l’être qu’à travers l’engagement avec les autres. « Il faut un village pour élever un enfant », selon le proverbe. Et vice versa : le collectif ne peut venir à l’être qu’à travers les contributions et la coopération volontaire des individus. L’anthropologue Thomas Widlok suggère que nous devrions sans doute parler de nous tous comme ayant des « identités enchevêtrées », des « vies jointes » et des « moi étendus29 ». En d’autres termes, les individus et les collectifs ne sont pas des opposés incompatibles, comme l’huile et l’eau. Ils sont conjoints et interdépendants. De même que les termes « moi » et « nous » n’ont de sens qu’en relation l’un avec l’autre, les notions mêmes d’individu et de collectif sont relationnelles – elles ne peuvent avoir de sens que l’une à travers l’autre. L’utilisation du terme « Moi-imbriqué » nous aide à dépasser l’idée – dominante dans les enceintes intellectuelles respectables de l’économie, de la science de l’évolution, de la biologie et de diverses autres sciences sociales – que l’individu serait une catégorie de pensée évidente30.
Un autre terme que nous avons inventé pour donner à voir la relationalité des communs est celui de « Rationalité Ubuntu ». Dans certaines langues bantoues d’Afrique du Sud, la relation entre « moi » et « l’autre » est exprimée par le mot « Ubuntu31 ». Nous utilisons la notion de Rationalité Ubuntu pour désigner un mode de pensée qui cherche à aligner le bien-être individuel et collectif. Le philosophe et écrivain chrétien kényan John Mbeti a traduit le mot « Ubuntu » de la manière suivante : « Je suis parce que nous sommes, et puisque nous sommes, donc je suis32. » L’individu fait partie d’un « nous » – et, en fait, de plusieurs « nous ». Les deux sont profondément entremêlés33.
Dans les langues occidentales, nous n’avons pas d’équivalent d’Ubuntu, mais nous avons des pratiques sociales qui en reflètent l’esprit. Certes, il y a des tensions entre l’individu et le collectif, mais si les gens s’efforcent d’entretenir des relations profondes et honnêtes ainsi qu’un dialogue permanent, ces tensions sont minimisées et la dualité supposée s’estompe. Et nous avons tout intérêt à le faire : si nous réfléchissons aux réalités sociales, il est clair que l’Ubuntu est une source d’identité et un filet de sécurité sociale. L’individu trouve du sens et une identité à travers le contexte social des communautés et de la société – et la société se constitue à travers l’épanouissement de l’individu.
Ces idées ont été exprimées dans différents contextes par des théoriciens politiques féministes, des écophilosophes, des peuples indigènes, des cultures traditionnelles, des théologiens et des sages religieux. Rabindranath Tagore, poète et philosophe indien, a écrit : « La relation est la vérité fondamentale de ce monde d’apparence34. » L’argument central du classique de la philosophie existentielle, de Martin Buber, Je et Tu, est que la vie est relationnelle. Nous trouvons le sens dans les rencontres directes avec d’autres présences vivantes, qu’il s’agisse d’autres humains, de la nature ou de Dieu – et nous rencontrons la séparation lorsque nous considérons les autres comme des objets, exprimés par une attitude de Je-ça35. D’autres visionnaires ont exprimé à leur manière des idées similaires. Selon Martin Luther King Jr., « nous sommes inéluctablement pris dans un réseau de mutualité, liés dans un seul habit de destin36 ». Rachel Carson, dans son premier texte majeur, “Undersea37”, paru en 1937, et plus tard dans Printemps silencieux, décrit le vivant comme une toile profondément entrelacée.
Dans les prochains chapitres, nous introduirons d’autres termes permettant de nommer plus précisément les phénomènes relationnels de la pratique des communs. Pour l’instant, il suffit de noter que les philosophes qualifieraient notre perspective d’ontologie relationnelle. Dans une ontologie relationnelle, les relations entre les entités sont plus fondamentales que les entités elles-mêmes. Laissezvous pénétrer par cette idée. Elle signifie que les organismes vivants se développent et prospèrent grâce à leurs interactions les uns avec les autres. C’est la base de leur identité et de leur survie biologique. C’est la base de leur vitalité. En tant qu’organisme social vivant, un commun incarne une ontologie relationnelle qui s’exprime par des patterns comportementaux tels qu’établir des rituels de l’en- commun et faire confiance aux savoirs situés. Les commoneurs s’efforcent d’aborder les conflits en prenant soin des relations et de réfléchir à leur propre gouvernance.
De nombreux types d’ontologies relationnelles ont été théorisés par des chercheurs et des intellectuels, même s’ils ne s’accordent pas sur les « relations » spécifiques entre entités qui importent réellement et sur leur signification. En général, les relations sont considérées comme porteuses de signification ou exprimant une valeur – par exemple, la relation entre des personnes et un symbole partagé, comme un drapeau, est souvent associée à l’identité et à la fierté collectives. Mais on peut concevoir tellement de types de relations qu’il est impossible de proposer une théorie philosophique unifiée des ontologies relationnelles. Les gens peuvent avoir des relations avec la terre qu’ils cultivent, des relations subjectives ou spirituelles, des relations biologiques avec leurs parents et leur famille élargie, des relations circonstancielles avec des amis et des partenaires de travail, et des connexions passagères avec des personnes sur l’Internet, entre mille autres possibilités.
Il serait possible d’étudier de nombreux types d’ontologies relationnelles, mais nous souhaitons nous concentrer sur deux grands types génériques et souligner leurs différences. Ils nous racontent tous deux des histoires incompatibles entre elles sur la nature de l’être, et leurs ramifications politiques sont différentes. Le premier type est appelé ontologie relationnelle indifférenciée.
Dans ce cas, la source de l’être réside dans tous les êtres vivants comme une force transcendante. On peut l’imaginer comme une matriochka, ou poupée gigogne russe, dans laquelle la plus grande poupée englobe et absorbe toutes les plus petites. Lorsque « le tout » incorpore tout ce qui est « en lui », les pièces peuvent être qualifiées d’« indifférenciées » dans la mesure où toutes les parties sont définies par le tout. Par nécessité, aucun élément englobé par le tout ne possède sa propre autonomie d’action individuelle relative ni son caractère différencié. Tous les éléments sont plus ou moins égaux et considérés comme tels. Politiquement, cette ontologie implique un collectivisme forcé ou une monoculture centralisée, chaque chose ou chaque individu étant considéré comme une partie indifférenciée du tout.
Image 2 : Ontologie relationnelle indifférenciée et différenciée
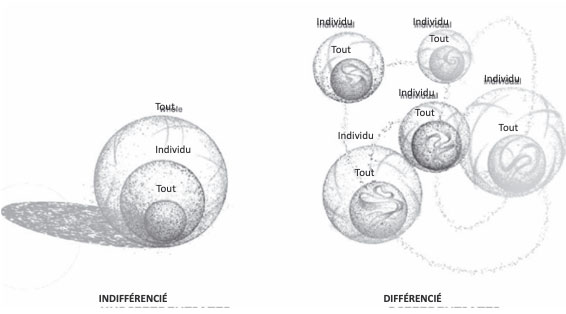
La réalité des pratiques des communs et d’une société fondée sur les communs ne peut être exprimée qu’à travers une autre ontologie, qui reconnaît la diversité et la différenciation inhérentes des systèmes vivants au sein du tout. Cette ontologie donne à chaque individu l’espace pour déployer son caractère unique. Les gens naissent avec des talents et des aspirations différents selon leur environnement et leur éducation, et chacun est confronté à des circonstances uniques. Une ontologie réaliste ne tente pas d’aplanir les différences individuelles réelles pour les réduire à une norme universelle.
Le type d’ontologie qui correspondra le mieux aux réalités des communs est donc une ontologie relationnelle différenciée, dans laquelle la source de l’être provient de tous les individus vivants et se manifeste de manières très différentes en fonction des situations. En même temps, chaque être vivant est relié aux autres et partage certains aspects élémentaires de la vie et de la conscience – tout comme le sang coule dans tous les corps humains, bien que chaque être humain soit unique. Dans une ontologie différenciée, les individus sont individualisés tout en étant liés les uns aux autres au sein d’un tout plus vaste. Chaque être vivant est « dans un état constant de devenir mutuel », selon Margaret Stout, dans un engagement dynamique avec le tout. Puisque chaque élément vivant est en constante évolution et affecté par de multiples influences, le monde n’a pas de définition ni de représentation unitaires. Nous ne vivons pas dans un « même monde unique pour tout le monde », comme le dit Arturo Escobar, mais plutôt dans un plurivers. Une diversité de formes de vie sont unies par une humanité commune et une appartenance à la vie sur Terre.
SCIENCE DE LA COMPLEXITÉ ET COMMUNS
Il pourrait être tentant de considérer toute cette discussion comme une digression abstraite sans valeur pratique. Pourtant, on peut faire valoir que le passage à une ontologie relationnelle a généré un nouveau paradigme de découverte scientifique : la science de la complexité, qui est en train de révolutionner la biologie, la chimie, les sciences de l’évolution, la physique, l’économie, les sciences sociales et d’autres domaines encore. La science de la complexité révèle également des choses importantes sur les communs, car elle considère le monde comme un ensemble dynamique et évolutif de systèmes vivants intégrés38. Si les organismes individuels peuvent avoir un degré important d’autonomie, ils ne peuvent être compris que dans le contexte de leurs myriades de relations et de contraintes imposées par des structures plus larges. Le rein, par exemple, n’est pas une unité autonome dans le corps humain. Il est imbriqué dans un ensemble plus vaste de systèmes physiologiques au sein duquel il doit s’adapter – et le corps humain, à son tour, doit lui aussi coexister dynamiquement dans un environnement encore plus vaste.
En regardant le monde à travers ces lunettes – celles d’une ontologie relationnelle qui dépasse les métaphores mécaniques et l’individualisme –, on peut rendre compte beaucoup plus facilement de toutes sortes de phénomènes humains et écologiques. On peut commencer à comprendre en quoi un commun est une forme de vie, et non une « ressource », et à l’envisager comme un système organique intégré, et non comme une addition de parties distinctes. La fenêtre sur la réalité qu’incarne un commun est plus englobante et plus réelle (selon nous !) que les ontologies qui relèguent les dynamiques relationnelles au second plan en tant que « variables exogènes39 ».
La science de la complexité offre une manière plus cohérente d’expliquer comment un système fonctionnel peut émerger sans avoir été d’abord conçu par un concepteur unique. Un tel système se développe lorsque des acteurs adaptatifs (tels que les commoneurs) interagissent les uns avec les autres. L’auto-organisation des acteurs – ce que nous appelons l’« organisation par les pairs » dans un commun – crée progressivement des systèmes organisationnels complexes40. Il n’y a pas, derrière ce processus, de plan directeur ni de connaissance experte appliquée d’en haut. Le processus émerge depuis les acteurs qui réagissent à leurs propres circonstances locales et particulières41. Au fur et à mesure que les gens expérimentent, régularisent et affinent leurs modes d’engagement les uns avec les autres, ils trouvent des solutions à leurs problèmes. Les noyaux de solutions qui fonctionnent peuvent être décrits comme des patterns, ou motifs récurrents. Un pattern n’est pas un plan directeur ; c’est un modèle générique qui inclut de nombreuses variations proches mais non identiques. Et ce, parce que chaque variation reflète une époque, un contexte, un ensemble d’acteurs particuliers.
Ces principes des systèmes adaptatifs complexes sont à l’œuvre dans la manière dont les microbes s’auto-organisent lorsqu’ils s’adaptent aux organismes hôtes, ou chez les fourmis lorsqu’elles construisent leurs nids, ou encore chez toutes les créatures vivantes qui, d’une manière ou d’une autre, s’autocoordonnent pour générer un ordre collectif global. Le biologiste Stuart Kauffman, théoricien pionnier de la science de la complexité, a identifié les principes clés de l’autocatalyse qui peut se produire lorsqu’une forme de matière entre en contact avec une autre42. Sur la base de ses observations expérimentales, il a proposé une théorie des origines de la reproduction moléculaire – selon une dynamique que d’autres ont confirmée à propos des métabolismes biologiques, des réseaux chimiques et en physique, entre autres domaines. L’émergence d’un ordre spontané, comme on l’appelle parfois, se produit à travers les interactions d’acteurs locaux sans supervision ni contrôle extérieur. Elle tend à être alimentée par des boucles de rétroaction positive au sein d’un système qui renforce les comportements constructifs et créateurs d’ordre. Les propriétés d’auto-ordonnancement et d’autoréparation sont intégrées au cœur même de ces systèmes et de leurs éléments constitutifs à un niveau très profond, ce qui les rend exceptionnellement résilients face aux perturbations.
Il s’agit évidemment de quelque chose de beaucoup plus complexe que ce que nous pouvons évoquer ici. Il suffit de noter pour notre propos que la dynamique d’auto-organisation43 peut générer un ordre stable et vivant dans un océan d’entropie chaotique et aléatoire. La deuxième loi de la thermodynamique postule que l’univers se trouve dans un état d’entropie constante et croissante qui évolue toujours vers le désordre. Mais selon certaines théories scientifiques novatrices, les organismes vivants – cellules, plantes, animaux (et communs ?) – sont capables de capter temporairement et de structurer leur utilisation des flux d’énergie entropique pour maintenir la vie. La vitalité et l’ordre naissent spontanément du désordre chaotique. Un organisme vivant s’appuie sur des membranes semiperméables qui lui permettent d’accéder à ce qui est utile dans l’environnement extérieur et de filtrer ce qui est nuisible, de manière congruente avec son contexte particulier44. « L’identité et l’environnement sont donc définis et déterminés réciproquement l’un par l’autre », écrit l’anthropologue biologique Terrence Deacon dans Incomplete Nature45. L’ordre n’est pas imposé par un horloger divin ou une force extérieure, mais par les systèmes internes d’un organisme qui métabolisent l’énergie et s’adaptent de manière créative à l’environnement. Les parallèles entre ce processus biologique et la pratique des communs sont très suggestifs et gagnent à être approfondis.
Certes, les scientifiques conventionnels tendent à se moquer de la plupart de ces idées. Mais de nombreux biologistes, chimistes, spécialistes de l’évolution et physiciens ont adopté la théorie de la complexité précisément parce qu’elle explique des choses que la science standard, opérant avec un cadre de pensée plus mécanique, individualiste et causal, ne peut pas expliquer. Une ontologie relationnelle permet aux scientifiques de voir le monde dans des termes plus dynamiques et plus holistiques. Elle nous rend plus conscients de notre propre réalité d’êtres personnellement immergés dans des phénomènes vivants. Alors que les économistes résistent généralement à cette idée (elle rompt avec trop de principes fondamentaux de l’économie classique !), Kate Raworth, dans son brillant ouvrage La Théorie du donut, a proposé un cadre économique concret et pratique fondé sur une nouvelle ontologie – selon laquelle les gens sont sociaux et relationnels (plutôt que rationnels et individualistes) ; le monde est dynamiquement complexe (plutôt que mécanique et tendu vers l’équilibre) ; et nos systèmes économiques doivent être conçus pour être régénérateurs46.
Le philosophe et biologiste Andreas Weber a bien exprimé le point de vue sur l’être que nous adoptons dans ce livre : « Le monde n’est pas peuplé d’êtres singuliers, autonomes et souverains. Il est constitué d’un réseau d’interactions dynamiques en constante oscillation, dans lequel une chose se modifie par le changement d’une autre. C’est la relation qui compte, pas la substance47. » Son livre Matter and Desire [« Matière et désir »] est une longue méditation autour de cette idée que la vie sur Terre est une question de « spécification réciproque – un acte d’engendrement mutuel. Ce n’est que dans un moment de rencontre que le caractère propre d’une personne se réalise pleinement. Le monde n’est pas une agrégation de choses, mais plutôt une symphonie de relations48… »
L’ONTOCHANGEMENT VERS LES COMMUNS
Si le monde est effectivement relationnel, la raison pour laquelle Garrett Hardin, dans son célèbre article sur la « tragédie des communs », ne pouvait pas vraiment considérer les communs comme un système social viable est maintenant claire. Il ne pouvait voir le monde qu’à travers la lentille d’une ontologie individualiste. Vivant dans ce cadre, il ne pouvait littéralement pas comprendre la pratique des communs ni imaginer un ensemble d’affordances politiques fondées sur des relations dynamiques.
Ainsi, pour véritablement comprendre la dynamique des communs, il faut d’abord s’extraire du cadre onto-politique de l’Occident moderne. Il faut faire ce que nous appelons un « Ontochangement » – reconnaître que les catégories relationnelles de pensée et d’expérience sont premières. Il ne s’agit pas simplement de considérer les interactions entre individus indépendants. Il s’agit d’intra-actions, un terme utilisé par la physicienne et philosophe Karen Barad pour décrire comment les relations elles-mêmes sont une force de changement, de transformation et d’émergence. Comme le dit un commentateur de Barad : « Lorsque les corps sont en intra-action, ils le font de manière co-constitutive. Les individus se matérialisent à travers des intra-actions, et la capacité d’agir émerge de l’intérieur de la relation, et non de l’extérieur49. » Vues sous cet angle, les catégories relationnelles ne sont pas simplement des interactions causales entre objets indépendants, comme des boules s’entrechoquant sur une table de billard. Ce sont des interactions qui engagent les dimensions intérieures des organismes vivants et qui, par là même, créent du changement et de la valeur. Il n’existe pas non plus d’individu unique et essentialiste, mais plutôt de nombreux « moi » dynamiques, dont chacun est impliqué dans de nombreuses communautés et fait donc partie de « nombreux nous ».
Vous vous demandez peut-être comment ces idées fonctionnent en pratique. Pour les personnes habituées à penser dans le cadre d’une ontologie individualiste et de dualités, voir le monde comme relationnel est un grand défi. Cela exige de développer un sens différent de la réalité. Il ne suffit pas d’annoncer haut et fort qu’on va adopter une nouvelle perspective. Cette nouvelle orientation doit être apprise et pratiquée. Dire adieu à de vieilles habitudes de pensée requiert de l’entraînement. Comme pour arrêter de fumer, il faut de la volonté, de l’attention et un apprentissage délibéré de nouvelles habitudes. C’est ce que les prochains chapitres proposent à ceux qui veulent « penser comme un commoneur » et réaliser leur propre « Ontochangement ».
Image 3 : Ontosemence au centre d’une galaxie de pratiques des communs
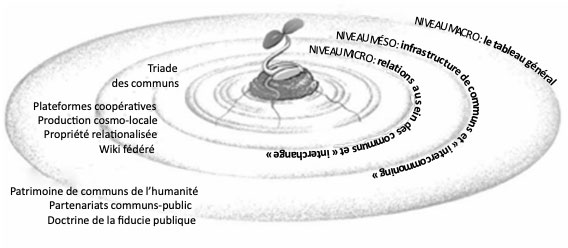
Jusqu’ici, nous avons posé les fondations d’une compréhension différente de la réalité. Dans le reste de cet ouvrage, nous fournissons les matériaux nécessaires pour la construire. Ce nouvel édifice nous aidera à envisager d’autres types de communautés, de pratiques sociales et d’institutions économiques – et, surtout, une nouvelle culture qui honore la coopération et le partage.
La première étape de ce voyage est le langage. Nous devons réfléchir à la manière dont les mots et la logique de notre langage quotidien véhiculent de vieilles habitudes de pensée et limitent notre sens du possible. Entraînons-nous donc à voir le monde d’une manière nouvelle grâce à de nouveaux mots, de nouvelles relations et de nouvelles pratiques sociales.
III: Le Langage Et La Créativité Des Communs
Si vous demandez à un Occidental quel est l’intrus parmi un clou, un crayon et une feuille de papier, il vous répondra probablement le clou. Mais si vous posez la même question à une personne originaire de la région du nord-ouest de l’Amazonie qui parle le bora, vous obtiendrez une réponse différente. Les locuteurs du bora ont « environ soixante-dix termes pour décrire la forme des objets : un pour les choses longues et fines, un autre pour les choses rondes, un autre encore pour celles qui sont plates avec des bords droits, et ainsi de suite1 ». L’ethnolinguiste Frank Seifart a mené un test empirique de « mise en relation d’objets » avec des locuteurs de la langue bora et a comparé leurs réponses à celles d’anglophones et d’hispanophones : il a constaté que les locuteurs de la langue bora répondaient dans 100 % des cas que c’étaient « crayon et clou » qui allaient ensemble. Pour eux, il y avait une relation évidente entre des objets de formes similaires. (Voir image 4 téléchargeable sur www.eclm.fr)
Comme le montre cette petite expérience, le langage façonne profondément la perception. Les mots, les termes et les catégories de pensée isolent et mettent en relation seulement certains aspects de la réalité. Ils déterminent ce que nous allons remarquer à propos d’un phénomène ou d’une chose donnés – et marginalisent d’autres aspects. Les termes et surtout les catégories analytiques nous indiquent ce qui « importe vraiment » en fonction de notre perspective culturelle ou de notre cadre théorique. Ils orientent subtilement la façon dont nous percevons le monde. Si les mots d’une langue donnée se concentrent sur les formes plutôt que sur la fonction, il n’y a rien d’étonnant à ce que les locuteurs de cette langue préfèrent grouper les objets en fonction de leur forme plutôt que de leur fonction.
Ainsi, même si nous aimons croire que notre langage quotidien exprime fidèlement les réalités que nous vivons, en réalité, ce n’est pas le cas. Nous n’habitons pas seulement des mondes distincts ; nous ne nous contentons pas seulement de décrire nos mondes dans des idiomes différents ; consciemment ou inconsciemment, nous habitons et créons des visions du monde distinctes à travers le langage. « Crayon et papier » peuvent sembler aller automatiquement de pair, mais comme en témoignera tout anthropologue, l’ordre social dont nous héritons ou que nous nous construisons est largement artificiel.
Mots, termes et catégories
Un mot est un symbole particulier – généralement un son de parole ou une combinaison de caractères – qui nous permet de communiquer une signification spécifique. En combinant un mot avec un autre et avec d’autres encore dans d’innombrables permutations syntaxiques, la communication humaine est formidablement versatile.
Un terme est un mot ou une phrase utilisés pour exprimer une notion ou un concept plus abstrait. Dès lors qu’il prend son origine dans un contexte historique et culturel spécifique, un terme est un signifiant dans l’histoire des idées et de la culture. Ainsi, « voiture sans chevaux » reflète une culture préautomobile, et les « quatre éléments » (air, eau, terre, feu) renvoient à l’ère préscientifique de la Grèce antique.
Une catégorie est un terme analytique de base qui rend visible une dimension singulière d’un phénomène. Une catégorie est générée par une méthodologie explicite et systématique. Elle détermine ce que nous rendons visible. La portée et la nature de notre cognition seront très différentes, par exemple, selon que nous utiliserons le terme Homo economicus comme catégorie analytique ou bien le terme Moi-imbriqué.
Une catégorie relationnelle est une catégorie fondée sur une compréhension relationnelle du monde, comme cela est expliqué au chapitre 2. Dans les sociétés modernes, l’économie, les maladies et l’État, par exemple, sont traités comme des choses, alors qu’il s’agit en fait de phénomènes relationnels. Une personne n’est pas seulement atteinte de tuberculose ou de cancer, mais est aussi partie prenante d’une reproduction dynamique de cellules vivantes, de virus, de bactéries, etc. De même, les termes l’« économie » et l’« État » objectivent un vaste ensemble de relations sociales et politiques.
Nos mots, termes et expressions déterminent subtilement ce que nous considérons comme pertinent et quelles sont les relations logiques qui comptent. L’absence de mots et de termes signale en creux ce que nous jugeons comme sans importance – après tout, nous avons refusé de le nommer. En résumé, nous pouvons penser que le sens de notre vocabulaire est évident et que notre mode de vie est normal, mais en fait, tous deux sont profondément circonstanciels et contextualisés. Le simple geste de la main avec le bout des doigts joints tournés vers le haut peut ainsi signifier des choses très différentes d’une culture à l’autre : les Égyptiens font ce geste pour dire : « Soyez patient ! », les Italiens pour demander : « Que voulez-vous dire exactement ? », et les Grecs pour s’exclamer ; « C’est tout simplement parfait2 ! » Une nouvelle fois, la réalité que nous habitons tous peut nous sembler robuste et évidente par ellemême, alors qu’en fait la signification des symboles que nous utilisons – qu’il s’agisse de gestes ou de mots – est en fin de compte plutôt arbitraire. (Voir image 5 : Trois gestes de la main, téléchargeable sur www.eclm.fr)
À la fin du chapitre précédent, nous avons noté que considérer les communs comme un paradigme général exige que nous regardions la réalité selon une nouvelle perspective – un Ontochangement. Dans ce chapitre, nous voulons expliquer pourquoi cette perspective ne peut s’exprimer qu’à travers un nouveau langage.
Au cours de la rédaction de ce livre, nous avons souvent ressenti le besoin désespéré de termes plus adéquats pour décrire la réalité des communs. Par exemple, nous avons constaté que le terme « ressource », tel qu’il est utilisé par les économistes et les décideurs politiques, implique un certain type de relations sociales – impersonnelles, instrumentales, axées sur le marché – qui ne correspondent pas véritablement aux communs. Nous avons constaté que la dualité « privé » et « public », qui divise le monde entre marché et État, n’est pas en mesure de reconnaître la spécificité des communs. En d’innombrables occasions, nous nous sommes trouvés captifs du vocabulaire de la culture dominante et frustrés par le manque de mots, de termes et de catégories relationnelles qui puissent donner une voix aux communs. Nous avons fini par nous rendre compte que si nous aspirions à une transformation sociale et politique, essayer de la faire advenir à partir du langage de l’économie de marché, du pouvoir de l’État et du libéralisme politique était voué à l’échec. D’une manière ou d’une autre, il nous faudrait échapper à la puissante inertie du langage des anciens paradigmes et trouver des mots qui désignent un ordre différent de la réalité sociale ! Les relations et les façons d’être et de faire qui sont à peine visibles dans la culture dominante doivent être rendues explicites par le langage.
L’OPINIÂTRETÉ DES SYSTÈMES D’OPINION ET L’HARMONIE DES ILLUSIONS
Tout au long de l’histoire, lorsque le langage utilisé pour représenter la réalité ne correspondait plus aux besoins et aux aspirations des gens, des problèmes sont survenus. Un ancien mode de pensée échoue lorsqu’il ne désigne pas correctement certains phénomènes que les gens ont besoin de comprendre pour gérer leurs affaires collectives. La question n’est pas seulement d’avoir une analyse et des représentations correctes ; il s’agit aussi d’exprimer des valeurs, des sentiments et des modes de relation qui seraient nécessaires. Au chapitre 2, nous avons raconté comment Edward Hitchcock avait été incapable de formuler et de faire valoir des faits nouveaux parce qu’il était trop immergé dans une vision biblique du monde. Il ne disposait pas de la terminologie qui lui aurait permis d’imaginer et d’interpréter la réalité du monde préhistorique des dinosaures. D’autres, comme Darwin et Lyell, ont pu le faire. Ils ont réinterprété la réalité en proposant de nouvelles terminologies, construisant ainsi un échafaudage de connaissances plus durable pour les générations futures. C’est un phénomène récurrent dans l’histoire des sciences : l’iconoclaste brise un cadre de compréhension conventionnel et en propose un autre qui – malgré sa nouveauté – est néanmoins reconnu par suffisamment de personnes comme étant plus explicatif et plus « vrai ».
Dans son célèbre livre La Structure des révolutions scientifiques, paru en 1962, Thomas Kuhn décrit la manière dont les anciens cadres de pensée s’effondrent face à de nouvelles interprétations et de nouvelles idées. Selon lui, les découvertes scientifiques tendent à se produire lorsque les idées nouvelles remettent en question un ensemble de règles et d’hypothèses sous-jacentes. Elles viennent supplanter une constellation de consensus sur la façon d’interpréter le monde et offrent des hypothèses, des règles et des explications nouvelles. Cela ouvre la voie à un « changement de paradigme3 ». L’idée de changement de paradigme peut être interprétée de manière très diverse et elle est devenue en quelque sorte un cliché. Le sens que nous donnons à cette expression est décrit au chapitre 2 à travers la notion d’Ontochangement. Un authentique changement de paradigme se produit lorsque nous modifions nos présupposés fondamentaux sur la réalité. Le défi, rarement relevé par les responsables politiques, est de savoir comment sortir d’une vision du monde figée et remettre en question les hypothèses implicites qui structurent notre système de connaissances.
Ludwik Fleck, un microbiologiste et philosophe des sciences polonais qui, dès 1935, a préfiguré la pensée de Kuhn avec une approche encore plus radicale, soulignant le conservatisme inhérent aux « communautés de pensée », écrit : « Lorsqu’une conception imprègne une communauté de pensée avec suffisamment de force pour qu’elle en pénètre la vie et le langage du quotidien, et devienne un point de vue au sens littéral du terme, toute contradiction paraît impensable et inimaginable4. » Fleck a rappelé comment l’idée de Christophe Colomb selon laquelle la Terre était sphérique dépassait l’imagination de son époque. Qui aurait pu croire que les gens de l’autre côté de la Terre marchaient sur la tête, les pieds en l’air ?
Une communauté de pensée agit comme le système immunitaire dans un corps vivant, veillant sans relâche face aux virus et aux autres menaces pour la sagesse établie, et autorisant parfois l’accès à certaines entités considérées comme des « étrangers amis ». « Ce qui ne rentre pas dans le système reste invisible, affirme Fleck. Si on le remarque, soit on le tient secret, soit on s’efforce de l’expliquer comme une exception qui ne contredit pas la règle5. » Bien sûr, certaines communautés de pensée sont beaucoup plus fermées et sur la défensive que d’autres. Certaines ont des conceptions et des méthodologies closes et hostiles au changement ; d’autres sont structurellement plus ouvertes aux opinions hétérodoxes, à la dissidence, au changement évolutif et aux méthodologies qui permettent d’intégrer de nouveaux systèmes de connaissances. Galilée a été confronté au rouleau compresseur du déni religieux lorsqu’il a remis en question la vision du cosmos qui plaçait la Terre en son centre. Mais finalement, le nouveau paradigme a fini par vaincre le contre-argument des « épicycles » orbitaux qui avaient été conçus pour préserver la place de la Terre au centre du cosmos. La tendance à interpréter les phénomènes d’une manière qui valide ses propres priorités – le biais de confirmation – fait partie de ce que Fleck appelle « l’opiniâtreté des systèmes d’opinion et l’harmonie des illusions »6. L’ordre établi doit être défendu, les opinions rebelles réfutées, et les dissidents dénigrés, voire persécutés.
L’arrivée d’un nouveau paradigme est généralement annoncée par de nouvelles catégories de pensée, de nouveaux termes et de nouveaux mots qui mettent en lumière des dimensions négligées ou invisibles de la réalité permettant à la culture de se les incorporer. L’idée que même les faits empiriques sont relatifs, que les visions du monde et les conceptions culturelles sont contingentes est une pilule difficile à avaler pour la modernité des Lumières. Et c’est pourquoi l’examen attentif de notre langage est important pour révéler à quel point notre sens de la réalité, médiatisé par ce langage, est plein de marqueurs de sens artificiels. Souvenez-vous de l’exemple papier-crayon-clou.
Toute société tend à privilégier un cadre dominant de perception et de signification. C’est certainement l’une des raisons pour lesquelles l’humanité a si bien réussi en tant qu’espèce. Alors qu’un individu ne peut s’approprier que de minuscules fragments du vaste réservoir de savoirs qu’est une culture, les cadres de pensée consensuels permettent d’accéder indirectement à tout le savoir partagé par la société. Ce système de savoirs constitue une sorte de système d’exploitation pour le corps/esprit, avec ses forces et ses limites. Il préorganise les possibilités de perception et de pensée autorisées, dont certaines sont renforcées de manière agressive par les institutions et les dirigeants. Lorsque les méthodologies et les convictions d’une communauté de pensée deviennent étouffantes ou nuisibles, la question se pose : comment introduire un nouveau « style de pensée » pour contester et supplanter l’ancien ? Nous sommes convaincus que l’utilisation d’un nouveau langage, offrant des moyens nouveaux et ouvrant de nouveaux horizons, est une stratégie essentielle dans cette perspective, bien qu’elle ne soit certainement pas la seule.
LE LANGAGE ET LA CRÉATION DU MONDE
Nous avons vu que le langage était un vecteur indispensable à travers lequel nous imaginons le monde ; il donne sa valeur socialement construite à un fait. On peut même aller plus loin : le langage est un moyen de co-créer le monde. Ce n’est qu’au cours des deux derniers siècles, par exemple, que la terre et certaines formes de travail humain ont été considérées comme du « capital7 » – un terme qui occupe pourtant une place assez centrale dans l’histoire moderne. Tout un vocabulaire économique a permis de rendre les relations sociales capitalistes plus réelles et plus normatives que l’expérience immédiate. À mesure que les capitalistes cherchaient à accroître la productivité de leur propriété, des termes tels que « capital humain » et « capital naturel » ont été adoptés pour nommer les relations entre les gens et entre eux et la nature. De même, l’Internet et la culture numérique ont donné naissance à des vocabulaires entièrement nouveaux, comme « spam », « phishing », « flaming », à des émoticônes ou à des acronymes comme LOL pour décrire les réalités de la vie en ligne. Les locuteurs de la langue bora dans le nord-ouest de l’Amazonie ont développé leurs propres termes pour nommer ce qui compte pour eux et pour se repérer dans leur territoire social et physique. De même pour le peuple Jahai, dans les forêts vierges tropicales du nord de la Malaisie, qui dispose d’une douzaine de mots différents pour désigner les odeurs qui imprègnent le paysage : un pour l’odeur des oignons bouillis, un autre pour l’arôme des viandes, d’autres encore pour le caoutchouc brûlé et le « sang qui attire les tigres8 ». Comme les locuteurs francophones n’ont pas vraiment besoin de tels concepts, ils doivent construire une analogie sophistiquée (« odeur des oignons bouillis ») pour disposer d’une traduction approximative d’un seul mot.
Dans son livre Landmarks [« Repères »], l’écrivain de la nature Robert Macfarlane a compilé des centaines de mots inventés par des communautés pour nommer les aspects distinctifs des paysages qui les entourent. Sur l’île de Lewis en Écosse, par exemple, le mot “èit” désigne « la pratique consistant à placer des pierres de quartz dans les ruisseaux de la lande pour qu’elles brillent au clair de lune et ainsi attirent les saumons à la fin de l’été et en automne9 ». Dans le Hertfordshire, en Angleterre, les pointes de flèches préhistoriques sont connues sous le nom de “fairy darts”, flèches des fées. Dans les Cotswolds, le bois pourri est appelé “droxy10”. Les innombrables mots utilisés par ces communautés hyperlocales sont dotés d’une « précision de compression » et de la capacité de faire des « discriminations ultrafines », écrit Macfarlane11. Pendant des siècles, ces vocabulaires « ont diffusé leur poésie dans la vie quotidienne. Ils constituent une anthologie d’histoire locale, d’anecdotes et de mythes qui lient les récits au lieu. Ils ont eu un rôle fonctionnel – opérant comme des marqueurs du territoire et des signes de propriété » –, aidant les gens à nommer les points de repère, à se repérer dans le paysage et à se relier à l’histoire de leurs ancêtres. Les mots fonctionnent comme des « cartes de mémoire ». Comme le dit Alec Finlay, le monde est « éclairé par la mnémotechnique des mots12 ».
Keith Basso, un éminent ethnologue du paysage et des langues, a fait remarquer que, pour les Apaches de l’ouest de l’Arizona, les mots sont bien plus que des référents. Ils les considèrent comme des moyens d’expression à la fois esthétiques, éthiques et musicaux, des moyens puissants de se relier à leurs propres géographies, cultures et histoires. Aujourd’hui, les spécialistes du marketing utilisent le pouvoir expressif des mots pour augmenter les ventes et valoriser l’identité des marques, allant par exemple jusqu’à l’achat de droits de « nommage » sur des stades ou des monuments urbains13. Lorsque les commoneurs remplacent les noms de lieux et la culture marchandisés par leurs propres toponymes, ils contribuent à restaurer le pouvoir expressif du langage et à réenchanter les communs. La culture elle-même devient un commun parce que les mots résonnent dans le cœur et l’expérience des gens ; ils ne sont pas réduits au statut de totems publicitaires qu’une entreprise peut s’acheter.
Au vu de ce rôle du langage, l’accélération de l’extinction des langues du fait de l’expansion continue de la monoculture du capitalisme mondialisé est profondément inquiétante. La diversité linguistique a permis aux humains de comprendre le monde non humain avec discernement et perspicacité. Aujourd’hui, cette composante cruciale de la culture humaine est en train de disparaître. La plupart des 250 langues aborigènes d’Australie se sont éteintes, privant l’humanité d’une partie de sa capacité à imaginer et à nommer les différentes relations humaines possibles avec la nature14. Selon un ethnologue, « sans un nom fait dans notre bouche, un animal ou un lieu aura du mal à trouver sa place dans notre esprit et dans notre cœur15 ».
LES CADRES COGNITIFS, LES MÉTAPHORES ET LES TERMES DE NOTRE COGNITION
Comme le suggèrent ces exemples, certaines des manières les plus importantes de « faire le monde » passent par le langage. Le langage n’est pas seulement un outil puissant qui nous permet de communiquer et de nous coordonner les uns avec les autres, il organise aussi notre connaissance et notre conscience de nous-mêmes. Le langage est notre principal véhicule pour exprimer des idées partagées et affirmer ce qui est important ; il est donc essentiel pour créer une culture. La question est de savoir quels concepts, quels faits et quelles perspectives nous devons mettre en avant et quel type de savoir partagé et de culture nous voulons propager.
Cette question nous amène à interroger les cadres cognitifs et les métaphores. Comme l’a expliqué le sociolinguiste George Lakoff dans ses nombreux livres, ce sont les cadres de notre langage qui, littéralement, mettent en œuvre notre cognition16. Les grandes entreprises se réfèrent fièrement à elles-mêmes comme à des « créatrices d’emplois », célébrant leur propre pouvoir tout en marginalisant le travail réel accompli par des personnes réelles. Les commerçants aiment à présenter l’achat d’un article en solde comme permettant d’« économiser de l’argent » au prétexte que l’on paie moins cher que le prix normal. Le but des cadres et des métaphores est de préconfigurer notre champ de vision et d’instiller subtilement des significations et des valeurs émotionnelles dans nos perceptions et nos pensées. Les cadres prédéterminent les réponses qui peuvent être données aux questions, en présupposant ce qu’il est important et permis de penser en premier lieu. Comme les cadres du langage transmettent les ontologies sur lesquelles ils se fondent, nous remarquons à peine comment ils s’insinuent silencieusement dans nos cerveaux. Même si nous allons à l’encontre du discours dominant (« le capitalisme est mauvais »), nous continuons à le mettre en œuvre inconsciemment par le biais des structures langagières et des termes que nous utilisons. C’est ainsi que les cadres façonnent les politiques. De fait, ils sont des politiques.
Dans une large mesure, les cadres opèrent par le biais de métaphores qui agissent au niveau des neurones. Notre esprit finit par intérioriser ces cadres et par les considérer comme normaux. Nous nous appréhendons différemment selon que nous parlons de nous-mêmes comme des « invités respectueux de la nature » (philosophie taoïste) ou bien comme des « conquérants de la nature » (philosophie occidentale moderne)17. Les métaphores mobilisent souvent des valeurs morales qui pèsent fortement sur notre façon de nous positionner face à une question donnée. Par exemple, la métaphore de la « destruction créatrice » utilisée par l’économiste Joseph Schumpeter pour décrire le capitalisme a été largement reprise pour valoriser l’innovation comme quelque chose de nouveau, de moderne et de progressiste – plutôt que de grossier et de rétrograde18. Le mot incorpore un jugement implicite et une évaluation morale. Ensemble, les métaphores et les cadres de notre langage tissent un réseau d’associations et d’attitudes culturelles. Il n’est donc guère étonnant que, dans une culture de marché, les cadres et les métaphores dominants ne parviennent pas à saisir les réalités des communs et de leurs pratiques !
Les paradigmes et leurs hypothèses, les métaphores et les cadres qu’elles créent, les catégories et les concepts qui les expliquent… tous ces ingrédients convergent pour former un « style de pensée », comme l’appelle Fleck. Une perception standardisée du monde produit une
« disposition à la perception et à l’action stylisées (c’est-à-dire orientées et limitées), au point que les réponses sont largement préfigurées dans les questions et que les décisions se limitent à un choix binaire (“oui” ou “non”) ou à une détermination numérique, au point que des méthodes et des appareils peuvent effectuer automatiquement la plus grande partie de notre travail intellectuel à notre place19 ». Les réponses ne sont correctes que dans la mesure où le collectif de pensée considère le discours lui-même comme admissible et fondé. Pour rester audibles au sein du collectif de pensée, la plupart des discours et des recherches se limitent à développer certaines prémisses établies. Les idées qui défient le collectif de pensée dominant (telles que les communs et leurs pratiques) n’ont pas de sens. Elles sont évitées, rejetées et niées. Leurs partisans sont ignorés et parfois persécutés.
Il existe de nombreux moyens de surmonter les cadres de pensée réducteurs et d’en introduire de nouveaux qui puissent les supplanter. Il faut tout d’abord déconstruire les cadres et les métaphores du discours dominant – ainsi que leurs logiques, valeurs et associations émotionnelles implicites. Toute la chaîne d’ontologie, des cadres cognitifs et du vocabulaire doit être éliminée jusqu’à la racine et remplacée – une entreprise qui ne peut évidemment être menée à bien d’un seul coup, mais avec le temps. Cela est nécessaire car continuer à utiliser les mêmes cadres, concepts et métaphores ne fera que raviver la vision passée du monde que nous essayons de transcender. Par exemple, le langage normatif qui identifie le travail à un emploi (rémunéré) porte en lui toute une vision du monde selon laquelle chacun doit gagner de l’argent par le travail marchandisé pour pouvoir vivre et s’épanouir dans le monde. Toute une vision du monde et un système social sont intégrés dans notre langage quotidien et intériorisés dans la manière dont nous interprétons la réalité sociale.
Nous avons donc besoin non seulement d’être plus conscients des concepts et des termes qui nous ramènent toujours à l’ordre de pensée existant, mais aussi de nous enseigner à nous-mêmes des termes nouveaux qui dessinent des manières d’être plus libératrices. Nous devons apprendre un langage qui nous aidera à effectuer un Ontochangement et à penser un autre monde possible en termes relationnels. Pour nous aider à prendre conscience du fardeau que sont les mots de notre lexique quotidien, nous proposons une collection de mots-clés d’une époque révolue et une sélection de binarités trompeuses. Pour nous aider à apprendre à nommer, à voir et à comprendre plus clairement la pratique des communs, nous proposons également un glossaire de termes propices aux communs. Vous pourrez parcourir ces glossaires dès à présent ou bien y revenir plus tard.
LE LANGAGE PORTE AVEC LUI UNE VISION DU MONDE
Nous tentons ici d’identifier les termes dont les significations pointent intrinsèquement dans la mauvaise direction. Ils nous ramènent insidieusement sur la voie de perceptions et de pensées enfermées dans des paradigmes anciens, tout en bloquant des formes plus constructives de cognition et de communication. De nombreux termes trop familiers de nos sociétés modernes évoquent en fait des réalités en train de s’effondrer ou en déclin. Nous pourrions les appeler les mots-clés d’une époque révolue – des termes autrefois importants qui paraissent de plus en plus désuets et archaïques.
Pourquoi avons-nous besoin d’un tel glossaire ? John Patrick Leary, historien de la culture du capitalisme et de son langage, explique que les mots-clés que nous utilisons en disent long sur la logique, les valeurs et les sensibilités d’un peuple. Il note qu’ils « nouent ensemble certaines manières de voir la culture et la société ». Citant le livre devenu un classique de Raymond Willliams sur les mots-clés, publié en 197620, Leary affirme que les mots qui retiennent notre attention aujourd’hui « entretiennent un lien d’affinité avec la hiérarchie et la célébration des vertus de la concurrence, du “marché” et des technologies virtuelles de notre époque21 ».
C’est précisément ce dont nous avons fait l’expérience en écrivant ces pages. Nous avons été confrontés à un défi singulier : essayer de communiquer les réalités subtiles des communs et de leurs pratiques avec des mots dont le sens était profondément ancré dans une culture différente, centrée sur le marché. La tâche était impossible ! Le problème ne résidait pas dans les mots eux-mêmes, mais dans le fait qu’ils ne pouvaient pas véritablement exprimer certaines vérités sur les communs. De nombreux termes sont insidieusement trompeurs, simplement parce que les idées qu’ils suggèrent semblent solides et dignes de confiance, alors qu’elles se réfèrent à des réalités en voie de disparition. Ces mots deviennent des enveloppes vides. Pensez au terme durable. Il est aujourd’hui utilisé pour décrire des modèles commerciaux plutôt que l’utilisation mesurée de richesses partagées de la nature de manière à garantir leur capacité de régénération. Certains termes reflètent une croyance en une vision du monde problématique en elle-même. Lorsque l’on cite le capital humain, on souscrit à l’idée d’un monde où le principal rôle des êtres humains est d’être des ressources pour le marché du travail. Lorsque vous parlez de croissance économique, vous invitez vos auditeurs à croire au récit faussement égalitaire selon lequel la croissance bénéficie à tous de la même manière, alors que la réalité est tout autre.
Dans ce sens, le vocabulaire peut être compris comme un univers vivant de sens communiqué à travers des mots séparés ; il ne s’agit pas d’un simple système de classification comme pourrait l’être une taxonomie. Si le vocabulaire est souvent décrit comme un « ensemble de termes accompagnés de leur explication » (vocabularium en latin), l’examen attentif du fonctionnement réel des vocabulaires révèle qu’il s’agit plutôt d’ensembles ouverts et évolutifs de mots et de termes qui reflètent un réseau caché de logiques et de relations. Un vocabulaire cohérent et partagé met en lumière les multiples relations entre les mots et nous aide à partager nos expériences et nos connaissances avec les autres. (C’est la raison d’être de ces glossaires !)
MOTS-CLÉS D’UNE ÉPOQUE RÉVOLUE
Le mot citoyen, également parfois remplacé par « ressortissant national », identifie une personne à travers son rapport à l’Étatnation et sous-entend qu’il s’agit là de son principal rôle politique. Le terme « citoyen » est souvent utilisé pour suggérer que les noncitoyens sont en quelque sorte des pairs moins égaux, lorsqu’ils ne sont pas « illégaux22 ». « Commoneur » est un terme plus universel.
Le développement est un terme d’économie politique promu par les États-Unis et les nations européennes pour inciter les pays « sous-développés » à adhérer au commerce mondialisé, à l’exploitation extractiviste des ressources et au consumérisme, tout en améliorant leurs infrastructures et leurs services d’éducation et de santé. Ce « développement » a généralement des effets secondaires néfastes : la destruction écologique, les inégalités, la répression politique et l’aliénation culturelle. L’écologiste allemand Wolfgang Sachs a caractérisé le développement comme un état d’esprit consistant à placer les économies politiques de toutes les nations sur une voie unique :
Les chefs de file montrent la voie ; ils sont l’avant-garde de l’évolution sociale, indiquant leur destination commune même à des pays qui ont connu des trajectoires historiques très différentes. De nombreuses histoires différentes fusionnent en une seule et même « histoire dominante », de nombreuses échelles de temps différentes fusionnent pour former un seul temps dominant. Ce temps imaginé est linéaire, ne laissant que deux possibilités : progresser ou régresser23.
Les entreprises sont des formes d’organisations qui, selon le célèbre économiste Ronald Coase, constituent une solution optimale pour éviter les coûts de transaction élevés. Cette analyse est aujourd’hui remise en cause par le partage sur les plateformes ouvertes et les communs, qui permettent aux gens de minimiser les coûts de leurs transactions à travers la collaboration au sein de communautés de confiance. À travers la pratique des communs, la souplesse et l’improvisation peuvent commencer à faire mieux que les entreprises et les marchés, alors même que ces approches souffrent généralement d’infrastructures et de modes de financement inadéquats.
La gouvernance fait référence à de multiples dispositions visant à guider et à contrôler le comportement humain. Comme le gouvernement, ce terme dérive du grec kubernaein [κυβερνάω], qui signifie littéralement « piloter ». La question est donc : qui pilote qui et par quelles techniques ? Le terme, tel qu’il est employé par les économistes et les politologues depuis le début des années 1990, signifie qu’une classe, un groupe distinct ou un appareil institutionnel se tient au-dessus des autres et les gouverne – c’est-à-dire que les gouvernants et les gouvernés sont séparés. Dans son usage courant, le terme de gouvernance n’englobe pas l’idée de coordination collective et de contrôle par les gens eux-mêmes. Notre alternative provisoire au terme de gouvernance est celui de Gouvernance par les pairs.
Les incitations sont des mécanismes, généralement monétaires, visant à motiver les gens et à orienter leurs actions dans un sens souhaité. Dans le contexte d’un système de récompenses, les incitations sont généralement destinées à encourager à travailler plus dur. (Il n’est guère étonnant qu’elles aient été popularisées en 1943 aux États-Unis dans un contexte d’économie de guerre.) Si les incitations externes ont certainement un rôle à jouer, de nombreuses études suggèrent que l’argent et les autres incitations finissent souvent par étouffer les motivations instinctives à créer et à contribuer. Lorsqu’on fait entrer en jeu l’argent dans un cadre donné, c’est le signe que des protocoles sociaux impersonnels et intéressés y sont la norme dominante, ce qui dissuade les personnes de contribuer sans contrainte. « L’argent est extraordinairement inadéquat pour répondre aux besoins avec soin », écrit Miki Kashtan24.
L’innovation fait référence à des idées, outils ou dispositifs nouveaux qui, par conséquent, seraient plus originaux, plus bénéfiques, plus progressistes et plus efficaces que ceux qui existaient déjà. On célèbre la prétendue force disruptive de l’innovation sur la société et les marchés même si le changement en question est souvent négligeable, antisocial ou écologiquement nuisible. Finalement, l’innovation est considérée comme un moyen d’obtenir un avantage concurrentiel et des rendements sur le capital investi. D’où l’aura positive de ce terme, particulièrement quand il est mis en regard de son opposé binaire, ce qui est jugé « statique, traditionnel et ancien », et associé à un manque d’imagination. Ce n’est cependant pas là la véritable alternative à l’innovation. Cette alternative, c’est l’adaptation créative à des besoins en constante évolution, selon des modalités partagées et conviviales.
Le mot leadership implique qu’un chef individuel – audacieux, courageux, perspicace – mobilise des partisans pour atteindre des objectifs collectifs qui, autrement, seraient inatteignables. Il ne fait aucun doute que certains individus sont des sources d’inspiration et des catalyseurs. Mais la compréhension du leadership tel qu’il se présente dans la plupart des contextes organisationnels contribue à enraciner dans nos esprits une vision hiérarchique. Le leadership est alors associé au fait de détenir du pouvoir sur les processus et les personnes. Cette vision occulte le potentiel des communs pour mener à bien le changement et organiser nos vies – ou, comme le dit Miki Kashtan, « habiter une intentionnalité de leadership sans détenir de pouvoir25 ». Il est tout à fait possible de mener à bien un changement structurel à travers des processus fondés sur un pouvoir distribué et des buts partagés, comme dans la sociocratie26, l’approche holocratique27, la théorie U28 et les pratiques de Gouvernance par les pairs.
Le terme d’organisation désigne généralement une institution ou une association dont les membres se coordonnent pour poursuivre des objectifs communs et parler d’une seule voix. Cette compréhension est aujourd’hui mise à mal par la puissance des réseaux ouverts, qui rend quelque peu archaïque l’idée d’une organisation stable avec des participants et des frontières bien identifiables. Les organisations conventionnelles, comme l’administration gouvernementale et les grandes entreprises, découvrent qu’à mesure que les frontières autour d’elles se font plus poreuses, les collaborations avec des « acteurs extérieurs » deviennent plus courantes, et les interactions plus fluides et plus dynamiques. Il est intéressant de noter que le mot « organisation » vient du grec órganon [ὄργανον], que l’on peut traduire par « outil permettant de composer un ensemble vital viable », comme le font les organes de notre corps. Plutôt que de se concentrer sur l’organisation en tant que forme, nous pensons qu’il est plus utile de se concentrer sur la qualité de l’organisation au sein d’une institution : l’auto-organisation consciente, les réseaux et la Gouvernance par les pairs.
Le terme de participation est souvent utilisé pour décrire l’implication des citoyens dans la vie politique, la communauté locale et les organisations sociales. Aujourd’hui, ce terme est généralement invoqué de manière positive pour signifier que la participation des citoyens (aux consultations publiques, aux espaces de prise de décision ou encore aux programmes de budget participatif) correspond aux idéaux démocratiques et confère une légitimité populaire aux décisions adoptées. C’est précisément là le défaut du terme de participation : il est souvent réduit à un ensemble prédéterminé d’options politiques et de stratégies de mise en œuvre « d’en haut ». Le public ne peut pas véritablement prendre d’initiative ni s’affirmer en acteur politique souverain au plein sens du terme. Il se contente de « participer » aux débats et aux processus publics dans des conditions que les dirigeants politiques, les fonctionnaires et les autres représentants de l’État ont préalablement jugées acceptables, donnant ainsi un vernis de légitimité aux décisions adoptées. Par contraste, la pratique des communs est un mode d’action politique plus indépendant et plus robuste.
Passer à l’échelle. « Comment faire passer cette idée à l’échelle ? » est souvent une façon de demander comment la rendre significative ou importante. Le terme implique une sorte de verticalité (de bas en haut, de haut en bas), comme si des hiérarchies centralisées étaient nécessaires pour étendre la portée d’une idée ou d’une pratique. Mais comme nous l’expliquons à propos d’émuler et fédérer(p. 236237), les projets locaux peuvent se développer grâce à la participation volontaire, l’organisation par les pairs et la fédération, sans besoin de systèmes de contrôle centralisés. Des infrastructures favorables sont souvent utiles, mais les projets qui passent à l’échelle génèrent invariablement de nouvelles complications et des coûts fixes, tout en réduisant les marges de manœuvre qui permettraient de trouver des solutions adaptées au contexte local et à la sensibilité des personnes29. À une certaine échelle, les systèmes d’organisation nécessitent pour fonctionner une quantité croissante d’énergie et de force de travail (des « nécessités regrettables », comme les appelle David Fleming), qui peut siphonner les ressources nécessaires à la satisfaction des besoins réels. La grande échelle est fondamentalement aliénante : « C’est comme une vague : on peut la chevaucher, mais pas la diriger », note Fleming30. C’est ici que la sagesse du designer Thomas Lommée est pertinente : « La prochaine grande chose, ce sera de nombreuses petites choses31. »
Le pluralisme est souvent considéré comme une vertu sociale parce qu’il prétend tolérer et accepter les différences de races, d’ethnies, de sexes, de religions, etc. Mais dans un État de marché libéral, le pluralisme est indissociable des normes sociales dominantes en matière d’aspirations et d’attitudes envers le capitalisme et la gouvernance. Par exemple, lorsque certains individus s’élèvent dans la hiérarchie d’une entreprise, ce serait la preuve qu’il permet l’émancipation des minorités et des femmes. Le pluralisme est important jusqu’à un certain point, mais il signifie généralement que la « diversité » doit, comme le dit l’anthropologue Arturo Escobar, fondamentalement accepter « un seul monde dans le monde »32. Accueillir un plurivers, impliquant la reconnaissance de multiples façons d’être dans le monde, est quelque chose de très différent.
Dans son acception courante, la rareté désigne un manque qui peut être comblé par l’économie de marché grâce à l’invention, l’innovation et la croissance économique. La « rareté » du pétrole, de la terre et de l’eau peut sembler évidente, mais en réalité ce terme ne reflète aucune propriété inhérente à une ressource. Le pétrole, la terre ou l’eau existent simplement en quantité limitée. Le terme de rareté reflète la vision du système social qui cherche à utiliser ces ressources. Une ressource est considérée comme « rare » si l’offre est insuffisante pour répondre à la demande réelle ou potentielle. Dans un contexte capitaliste, la rareté est parfois créée même lorsque l’offre est abondante, comme dans le cas des savoirs, du code informatique et de l’information. C’est précisément l’objectif du droit d’auteur et du droit des brevets que d’empêcher le partage des savoirs et des œuvres créatives. « Si nous faisons l’expérience de la rareté, écrit Alan Rosenblith, le problème vient de nos systèmes, pas de l’univers33. » Les Bushmen du Kalahari en Afrique connaissent une « prospérité sans abondance », selon le titre d’un livre qui leur est consacré34. Gérer des ressources limitées est l’un des principaux défis auxquels sont confrontés les communs. Pour les ressources limitées telles que la terre, relever ce défi passe généralement par une forme de plafonnement qui établit des limites à l’utilisation de la richesse partagée. La réponse à la rareté organisée du code logiciel se trouve dans les communautés de logiciels libres, gratuits et open source (FLOSS).
L’expression sans but lucratif (ou à but non lucratif) signifie qu’une organisation est tenue pour vertueuse et a une vocation sociale, par rapport à une entreprise commerciale à but lucratif. Mais une organisation à but non lucratif offre avant tout un statut juridique qui permet de bénéficier de certaines exonérations fiscales. Le terme non lucratif est trompeur dans la mesure où il suggère qu’il est possible de participer à l’économie capitaliste de manière socialement responsable et sans réaliser de bénéfices. Il serait plus exact de dire que les organisations à but non lucratif réinvestissent leurs bénéfices dans des objectifs sociaux. En fin de compte, elles dépendent, directement ou indirectement, des profits réalisés dans le reste de l’économie et n’offrent pas d’émancipation structurelle vis-à-vis du capitalisme lui-même.
BINARITÉS TROMPEUSES
Lorsque l’on recourt à des oppositions binaires, ou polaires, on sous-entend que chacun des pôles en jeu obéit à une logique radicalement différente de celle de l’autre et que ces logiques sont profondément incompatibles entre elles. Mais l’expérience concrète de la pratique des communs finit souvent par dissoudre ou transcender les oppositions supposées. Par exemple, les personnes qui participent à une démarche collaborative en matière de don de sang ou dans un cadre universitaire font l’expérience d’un Moi-imbriqué qui transcende la polarité de l’individuel et du collectif. En entrant dans le monde des communs, nous quittons celui des « binarités trompeuses ». En voici quelques-unes.
Collectif/individuel. Cette antinomie est souvent utilisée pour suggérer que l’intérêt d’un individu va à l’encontre des intérêts d’une entité collective. De tels conflits peuvent exister, c’est certain, et doivent être traités dans leur contexte spécifique. Les problèmes surgissent lorsque le « je » s’oppose au « nous » (ou que le « je » s’affirme en niant le « nous »). L’individu est alors considéré comme totalement séparé et distinct des autres – à l’image du « self-made-man ». C’est une illusion, car un individu ne peut développer ses talents et son identité que par sa participation à un collectif plus large. Et inversement, le collectif ne peut naître qu’à travers les individus. En d’autres termes, les deux sont conjoints et interdépendants, non opposés et non séparés. Nous essayons de souligner cette idée à travers la notion de Moi-imbriqué et de Rationalité Ubuntu.
Consommateur/producteur. L’économie standard considère généralement la relation entre consommateurs et producteurs comme duale : une entreprise produit, un individu consomme. Mais à mesure que les communs et les réseaux ouverts permettent aux gens de s’auto-approvisionner (individuellement et collectivement), la dualité de ces deux fonctions s’estompe. Certains observateurs ont tenté de reconnaître ce fait en inventant la notion de « prosommateurs », qui intègre production et consommation en un seul processus. Ce néologisme est intéressant, mais il continue à placer la discussion sur un plan économique et matérialiste – celui de la production et la consommation de biens par extraction de ressources, transformation et distribution.
Coopération/compétition. Ces deux termes sont souvent présentés comme opposés. Mais les spécialistes de l’évolution et les anthropologues estiment qu’ils sont souvent liés entre eux : les espèces ont tendance à entretenir des relations symbiotiques qui impliquent à la fois, selon les circonstances, la compétition et la coopération. Même les économistes ont remarqué ce type de dynamique dans divers contextes de marché, où des personnes et des entreprises se font concurrence et coopèrent simultanément. Sur les chaînes de montage, les ouvriers partagent régulièrement leurs outils et s’entraident. Il est donc trompeur d’affirmer ou de laisser entendre que « la concurrence est mauvaise » et que « la coopération est bonne ». Les deux se manifestent partout et tout le temps. La véritable question est de savoir si les fruits de la coopération profitent aux coopérateurs ou s’ils sont principalement captés par les investisseurs et les entreprises, comme dans ce que l’on qualifie communément d’« économie du partage ».
Égoïsme/altruisme. Le présupposé selon lequel le comportement d’une personne ne peut être qu’être soit intéressé, soit altruiste est une conséquence de l’idée profondément ancrée selon laquelle les gens seraient essentiellement des « moi isolés », séparés des collectifs sociaux plus étendus. Dans un monde de « moi isolés », il peut faire sens, dans une certaine mesure, d’opérer par choix calculés et rationnels. Mais le caractère infondé de l’opposition entre intérêt personnel et altruisme apparaît au grand jour dès lors que l’on considère que le soin de soi est une condition du soin des autres et inversement. L’égoïsme et l’altruisme se rejoignent. Faire preuve d’une grande sollicitude à l’égard d’autrui est aussi un moyen de conforter ses propres intérêts ; en prenant soin de soi, on développe sa capacité à prendre soin des autres. L’opposition entre les deux s’estompe.
Objectif/subjectif. Dans la vie moderne, ces deux modes de perception et de compréhension sont considérés comme opposés. Est jugé objectif ce qui est physique, vérifiable et mesurable, tandis que le subjectif se voit attribuer un statut inférieur, celui de simples sentiments, humeurs et intuitions, et il est donc considéré comme moins tangible et moins vrai. L’objectivité renvoie à des faits solides, immuables et qualifiés de « scientifiques », tandis que la subjectivité est considérée comme peu fiable et évanescente. Cependant, les neurologues, les spécialistes du comportement et les économistes ont montré que la séparation entre l’objectif et le subjectif était en grande partie une fiction, car elle présuppose une rationalité purement cognitive et consciente – et une subjectivité par définition irrationnelle. En réalité, l’objectif et le subjectif sont totalement intégrés l’un à l’autre. Les intuitions et les sentiments incarnés et non cognitifs peuvent également être tout à fait fiables et vrais.
Public/privé. Cette antinomie familière reflète les présupposés des sociétés industrielles modernes selon lesquels le gouvernement et les marchés sont clairement distincts et le plus souvent opposés. Le gouvernement est censé être une force au service d’objectifs « publics » et collectifs, et le marché un domaine de choix « privés » et de liberté individuelle (même si les tenants du libreéchange prétendent qu’à travers la fameuse « main invisible du marché » les « choix privés » peuvent satisfaire les objectifs publics). Cette approche est en grande partie une fable. La vie politique contemporaine montre à quel point le pouvoir d’État et les marchés capitalistes sont étroitement liés entre eux. Les désaccords occasionnels entre secteur public et secteur privé ne sont rien en comparaison de leur profond engagement l’un envers l’autre et de leur allégeance à une vision du monde fondée sur le capitalisme de marché et la dépendance structurelle de celui-ci à l’égard des financements publics, des infrastructures civiles, de la réglementation, etc. Les débats politiques qui tournent autour de l’opposition entre « public » et « privé » reposent sur un cadre conceptuel superficiel et spécieux qui ne reconnaît ni les communs ni les autres formes d’organisation non capitalistes.
Rationnel/irrationnel. Dans cette variante du clivage entre « objectif » et « subjectif » abordé ci-dessus, le « rationnel » est censé être objectif, tandis que l’« irrationnel » est simplement personnel et subjectif. Cela suppose que les modes de compréhension non rationnels (c’est-à-dire qualitatifs, émotionnels, spirituels, ou intuitifs) ne sont pas dignes de confiance. De fait, l’irrationnel est associé au féminin et relié à la sphère privée (famille, relations personnelles), tandis que le rationnel est rattaché à la vie publique (et au masculin). Cette distinction élémentaire donne naissance à des institutions qui prétendent prendre des décisions rationnelles en ignorant les facteurs non scientifiques, non quantifiables et les sentiments.
COMMENT LA PRATIQUE DES COMMUNS
DÉPASSE L’OPPOSITION OUVERT/FERMÉ
Lorsque l’Internet a créé un nouveau monde de partage instantané de l’information, l’opposition familière entre ouvert et fermé s’en est rapidement trouvée remise en cause. Cette distinction est rassurante car elle simplifie les choix auxquels nous sommes apparemment confrontés. Elle est souvent invoquée dans les débats sur les frontières territoriales et les droits de propriété – quelque chose doit être soit ouvert (accessible), soit fermé (d’accès restreint). C’est l’un ou l’autre. En réalité, l’ouverture et la fermeture ne sont que deux cas extrêmes dans un riche éventail de différentes règles d’accès pouvant être appliquées.
Dans les espaces numériques, l’opposition entre ouvert et fermé renvoie au statut juridique ou à l’accessibilité pratique des informations et des œuvres de création. Une œuvre est dite « fermée » si son propriétaire en a restreint l’accès en invoquant la loi sur le droit d’auteur ou en utilisant le cryptage ou un système payant sur un site web. Une œuvre fermée est dite « propriétaire » lorsque son auteur rend son accès exclusif – ce qui en fait un objet artificiellement rare – comme condition préalable à sa commercialisation sur le marché.
À l’inverse, une œuvre est dite « ouverte » lorsque tout le monde peut y accéder et l’utiliser librement, comme c’est le cas pour les logiciels libres, les écrits et les photos sous licence Creative Commons, ou les œuvres que la loi sur le droit d’auteur définit comme relevant du domaine public (ne donnant plus lieu à des droits de propriété intellectuelle). Les plateformes dites « ouvertes » sont couramment utilisées pour permettre aux gens de partager leurs travaux. Les scientifiques utilisent parfois des bases de données ouvertes pour partager leurs données, tandis que les professeurs se servent de manuels ouverts pour mettre du contenu pédagogique librement à la disposition d’étudiants. Pour rendre la recherche universitaire plus largement disponible, plus de 12 800 revues savantes en libre accès ont vu le jour au cours des dix dernières années35. Elles utilisent des licences Creative Commons pour s’assurer que leurs contenus sont accessibles gratuitement et à perpétuité.
Le terme « ouvert » suggère une opposition binaire avec « fermé », autrement dit « propriétaire », « privé » ou « non librement partagé et partageable ». À y regarder de plus près, cependant, cette opposition est elle-même problématique. Lorsque nous parlons, par exemple, d’une base de données « ouverte » ou « fermée », nous mettons l’accent sur la base de données, comme si elle incorporait d’elle-même cette caractéristique. Cette vision fait l’impasse sur les intérêts des personnes qui sont à l’origine de la création de la base de données. Cette communauté pourrait par exemple souhaiter autoriser un usage limité des données par certains collègues de confiance. Ou peut-être souhaite-t-elle partager la base de données seulement pour certains objectifs, tout en exigeant un paiement lorsque d’autres personnes l’utilisent.
Lorsque la discussion se réduit à l’opposition entre « ouvert » et « fermé », toutes ces possibilités ne peuvent précisément plus être évoquées. Les options « ouvert » et « fermé » sont censées être inhérentes à l’œuvre (ici la base de données), dans le cadre d’une opposition grossièrement binaire qui rend invisible l’action de la communauté créative. L’œuvre est conceptuellement séparée de la communauté qui en est à l’origine.
L’opposition entre « ouvert » et « fermé » ignore également la dynamique sociale par laquelle une communauté génère une œuvre – le processus de collaboration, la motivation à créer, le rôle social de l’argent dans la production, etc. Elle considère tous ces facteurs comme sans importance – et nous empêche, ce faisant, d’appréhender tout un écosystème d’interactions sociales de créativité et de partage. Nous ne voyons plus la communauté des citoyens-scientifiques à l’origine d’une base de données partagée, les rédacteurs qui contribuent à un wiki ou les amateurs de photos qui partagent leurs images en ligne, qui tous peuvent souhaiter contrôler et gérer l’accès à leurs œuvres en tant que commoneurs. Le partage dans un commun peut être défini spécifiquement en fonction de la situation, du moment, ou encore du type de personne avec qui les commoneurs souhaitent partager. L’opposition ouvert/fermé ne permet pas d’exprimer toutes ces possibilités. Elle n’offre aucun moyen de reconnaître la Gouvernance par les pairs dans les communs ni de formuler des modes de partage des œuvres intermédiaires entre l’ouverture et la fermeture absolues.
En pratique, il existe de nombreuses façons de gérer les droits d’accès et d’usage. Les licences Creative Commons – utilisées aujourd’hui pour plus de 1,1 milliard d’œuvres, dont ce livre36 – sont une manière ingénieuse d’aborder le problème. Elles offrent aux détenteurs de droits d’auteur des options simples et standardisées qui leur permettent d’accorder à l’avance l’autorisation d’utiliser et de partager une œuvre créative. Ces licences accordent à d’autres la possibilité de créer leurs propres œuvres dérivées, telles que des traductions ou des résumés de manuels scolaires. Elles permettent de copier, de distribuer, d’afficher et d’exécuter des œuvres si ce n’est pas à des fins commerciales, ou si elles ne sont pas modifiées lors de leur réutilisation, ou encore si l’œuvre dérivée est elle-même également rendue partageable pour les autres.
Ainsi, les licences Creative Commons offrent une bien plus grande liberté que la fermeture des contenus. Le problème avec cette approche est que toutes les décisions restent prises par des individus. Elle reflète la vision du monde dominante, où la création est vue comme le produit d’individus sans lien les uns avec les autres, comme dans des cellules isolées, qui ne tirent pas leur inspiration des communs et ne partagent pas d’autres intérêts plus larges. Cette vision implique également que nos intérêts individuels reposent sur une revendication de propriété privée sur l’œuvre. Bien qu’elles soient un « piratage » juridique des lois sur le droit d’auteur, les licences Creative Commons ne remettent pas en cause ces présupposés. Elles n’intègrent aucune reconnaissance juridique du fait que la créativité émerge d’un groupe indivisible – un commun – et que les commoneurs devraient disposer d’un cadre légal pour faire leurs choix en tant que collectif. C’est précisément ce dont se plaignent de nombreuses communautés autochtones à propos des lois occidentales sur les droits d’auteur et les brevets qui leur sont souvent imposées par les systèmes internationaux des régimes commerciaux. Ces lois ne reconnaissent pas que tout contenu est toujours influencé, à des degrés divers, par des groupes sociaux, contemporains ou passés (Propriété relationalisée). L’opposition ouvert/fermé ne nous laisse que deux choix : donner ou conserver la propriété privée (généralement dans le but de faire de l’argent).
Il n’est pas surprenant que, du fait de la prévalence de cette opposition binaire, « ouverture » et « communs » soient synonymes pour de nombreuses personnes, pour qui la caractéristique générale principale de ces derniers est d’être libres d’accès et sans coût. Cela n’est absolument pas vrai. L’objectif d’un commun est de maximiser le contrôle et les avantages partagés, ce qui nécessite des règles bien réfléchies d’accès et d’utilisation. L’accès ouvert ne peut fonctionner que pour une ressource non rivale, autrement dit qui ne s’épuise pas lorsqu’elle est utilisée et partagée, comme c’est le cas pour l’information numérique (et d’ailleurs, celle-ci, elle aussi, doit être gérée et protégée afin d’être disponible sans coût). Pour les ressources naturelles rivales susceptibles de s’épuiser, les communs doivent fixer des limites d’utilisation, restreindre l’accès à certaines périodes ou pour certaines personnes, etc.
Dépasser cette opposition binaire permet de constater le rôle crucial du collectif dans la génération de valeur (code partagé, informations, œuvres créatives) et dans sa conservation et son contrôle. Grâce au langage des communs, nous pouvons reconnaître la démarche collective et l’éthique d’un groupe37. Ce changement de perspective est important car, dans un monde défini selon l’alternative ouvert/fermé, l’acte de donner gratuitement son travail est considéré comme altruiste, insensé, ou les deux à la fois. Seul un crétin ou un idéaliste pourrait céder une découverte scientifique ou un livre remarquablement écrit susceptibles d’être une source de revenu. Dans le contexte économique et culturel du capitalisme, il devient difficile même d’imaginer qu’un livre puisse être à la fois partagé librement et vendu38.
Pourtant, c’est précisément ce qu’il faut comprendre – c’est possible ! Bien sûr, certaines complications doivent être surmontées. C’est le cas notamment de la place de l’argent (sujet que nous examinons dans une section sur le financement des communs). Si l’accès à une œuvre est régulé par le marché – « payez le prix ! » –, alors les personnes qui possèdent le plus d’argent auront automatiquement un meilleur accès et davantage de contrôle sur les ressources (alors même que la connaissance, l’information et le code tendent à prendre davantage de valeur lorsqu’ils sont partagés). Les commoneurs ont appris à contourner ce problème en choisissant de diffuser les savoirs généreusement, puis en développant d’autres modes de paiement pour couvrir les coûts associés (par exemple, mettre en commun, plafonner et répartir, le soutien en nature, des ventes contrôlées sur le marché, les soutiens croisés, etc.) Les commoneurs adoptent ces stratégies précisément parce qu’à long terme elles profitent à la fois à l’individu et au groupe (par exemple, en augmentant le nombre de lecteurs et d’utilisateurs). Il faut dépasser l’opposition binaire ouvert/fermé pour ouvrir à ces possibilités.
Cette approche nécessite donc un vocabulaire nouveau qui reconnaisse l’intention collective et préserve la valeur créée et entretenue par la pratique des communs. Nous proposons le couple de termes partager et préserver. Celui-ci permet de dépasser l’attention exclusive portée à l’œuvre elle-même qu’impose le cadrage ouvert/fermé. Il invite aussi à dépasser l’idée que rendre les œuvres partageables serait faire le choix stupide de les céder, comme si l’on renonçait à leur valeur. Mais la pratique des communs a un sens : si un groupe a créé de la valeur sous différentes formes (logiciels libres, wikis, réseaux de conception cosmo-locaux, etc.), il devrait évidemment être en mesure de protéger cette valeur et de la faire prospérer au fil du temps. Partager et préserver aide à exprimer le fait que la pratique des communs produit des valeurs et des affordances nouvelles en rendant les œuvres plus utiles et accessibles à tous. L’opposition binaire entre « ouvert » et « fermé » est aveugle à ces possibilités.
DES MOTS NOUVEAUX POUR SIGNIFIER LES COMMUNS
L’approvisionnement se réfère à la satisfaction des besoins des gens à travers les communs. Ce terme est une alternative au mot « production », qui est inextricablement associé à la marginalisation des sphères non marchandes que sont la famille, la communauté et le soin, et qui met l’accent sur les prix de marché, l’efficience, l’externalisation des coûts, etc. Le but de l’approvisionnement est de répondre aux besoins des gens, alors que le but de la production (qu’elle soit capitaliste ou socialiste) est de générer des profits pour ceux qui produisent les biens et les services. L’approvisionnement par les communs est une réalité omniprésente. Il génère une richesse partagée selon différentes méthodes d’allocation et de distribution. Un objectif fondamental de l’approvisionnement est de rendre à nouveau les comportements économiques des gens compatibles avec les autres aspects de leur existence, comme le bien-être social, les relations écologiques et les préoccupations éthiques.
L’arpentage des communs (“beating the bounds” en anglais) décrit le processus par lequel les commoneurs veillent sur les limites de leurs communs pour les protéger contre les enclosures, tout en célébrant leur identité en tant que communauté. Le terme dérive d’une antique coutume anglaise selon laquelle les membres d’une communauté, jeunes et vieux, parcouraient les limites de leurs communs pour familiariser tout le monde avec leurs terres et détruire les haies ou les clôtures qui les enclosent. Cette pérégrination était souvent suivie d’un festin.
Les circuits de financement public-communs sont des stratégies de financement collaboratif qui permettent d’utiliser l’argent des contribuables collecté par la puissance publique pour soutenir les communs – voire privilégier les stratégies fondées sur les communs. Contrairement aux subventions publiques accordées aux entreprises, qui visent principalement à stimuler la croissance économique et à procurer des avantages directs aux actionnaires, le financement public-communs vise à développer la pratique des communs et les infrastructures fondées sur les communs. L’objectif est d’aider les gens à réorganiser leur vie afin de gagner en autonomie et en indépendance vis-à-vis du marché et de l’État et de leurs contraintes.
Communs – commoneur – pratique des communs (commoning). D’abord, une brève excursion dans l’étymologie de ces termes : chacun de ces mots tire ses racines du latin cum et munus. Cum (« avec » en français) fait référence à la réunion d’éléments. Munus – que l’on retrouve également dans le mot « municipalité » – signifie « service », « devoir », « obligation » et parfois « don ». Tous les termes qui associent cum et munus, tels que communion, communauté, communisme et, bien sûr, communication, indiquent une obligation réciproque, un lien entre les droits d’usage, les avantages et les devoirs. Comme l’écrivent Pierre Dardot et Christian Laval, les communs désignent « non seulement ce qui est mis en commun », mais aussi les commoneurs eux-mêmes – « ceux qui ont des charges en commun39 ».
Les communs sont une forme de vie sociale omniprésente, hautement générative et négligée. Ce sont des processus complexes, adaptatifs et vivants qui génèrent des richesses (matérielles et immatérielles) et par lesquels les participants satisfont leurs besoins partagés en réduisant ou en faisant disparaître leur dépendance au marché ou à l’État. Un commun se constitue lorsque des personnes s’engagent dans des pratiques sociales de commoning, lorsqu’elles instituent une Gouvernance par les pairs et développent des formes collaboratives d’approvisionnement dans l’usage d’une ressource ou de la richesse-soin. Bien que chaque commun soit singulier, tous dépendent en fin de compte des dons matériels de la nature, ainsi que du partage, de la collaboration, du respect mutuel et de la réciprocité accommodante. Un commun est en perpétuel devenir.
Chaque commun naît de la pratique des communs, ou commoning, qui se décline sous trois formes symbiotiques : les habitudes sociales quotidiennes, la Gouvernance par les pairs et l’approvisionnement. C’est la triade du commoning.
Commoneur est une identité et un rôle social que les individus acquièrent lorsqu’ils s’engagent dans la pratique des communs. Il est associé à des actes réels, et non à un titre ou à une fonction sociale attribués. Tout le monde est potentiellement un commoneur. Plus une personne s’aligne sur une pratique et une vision du monde fondées sur les communs, plus elle devient un commoneur.
Le commoning, ou pratique des communs, est le processus exploratoire par lequel les personnes conçoivent et mettent en œuvre des systèmes d’approvisionnement contextualisés et une Gouvernance par les pairs qui s’inscrivent dans une perspective plus large d’épanouissement de notre humanité. Le commoning a lieu lorsque des personnes ordinaires décident de s’entendre entre elles pour identifier et satisfaire leurs besoins et gérer les richesses qu’elles ont en partage. Lorsqu’elles font appel à leurs savoirs situés pour évaluer leurs problèmes, elles se montrent capables de faire preuve de créativité dans l’élaboration de solutions qui leur semblent justes et efficaces. Elles apprennent également à vivre avec les ambiguïtés et les incertitudes qui sont inhérentes à la condition humaine. La pratique des communs est le seul moyen de devenir un commoneur. Le pouvoir des communs ne se limite pas à des relations interpersonnelles dans des petits groupes, mais s’étend également à l’organisation d’une société plus large.
Il n’y a pas de communs sans commoning et il n’y a pas de commoning sans Gouvernance par les pairs.
Le Communivers décrit un monde où différents types de communs sont reliés les uns aux autres par des relations souples. On peut le considérer comme un pluriversfédéré de communs. Contrairement au capitalisme (l’économie) et à la démocratie libérale (la sphère politique), le Communivers intègre l’économie aux sphères politique et sociale.
La communion est le processus par lequel les commoneurs sont engagés dans des relations d’interdépendance avec le monde pardelà l’humain. La communion fait passer la compréhension des relations entre l’homme et la nature du cadre économique (par exemple, la « gestion des ressources » ou la marchandisation et la financiarisation des « services de la nature ») à un cadre qui respecte la valeur intrinsèque du monde non humain. Cette prise de conscience fondamentale génère des sentiments de gratitude, de respect et de révérence pour les dimensions sacrées de la vie, qui se reflètent dans la manière d’organiser l’approvisionnement des humains.
Les communs démonétarisés sont une forme de commoning qui cherche à réduire le plus possible l’utilisation de l’argent et les interactions avec le marché. La pratique des communs permet de trouver des solutions démarchandisées aux problèmes – qui évitent de recourir au marché et à des dépenses extérieures –, ce qui exige de générer des revenus monétaires. La pratique des communs ellemême est démarchandisée dans la mesure où les commoneurs, par définition, s’appuient autant que possible sur le DIT, le co-usage, le partage, la répartition et la mutualisation. Le but des communs démonétarisés est d’aider les gens à se concentrer sur leurs besoins réels et à échapper au cycle infini d’achat et d’asservissement qu’implique généralement la culture consumériste.
Le couple marché/État. Bien que le marché et l’État soient souvent présentés comme des adversaires – le secteur public contre le secteur privé –, ils partagent en réalité de nombreux présupposés et objectifs profondément ancrés et sont extrêmement interdépendants. Il est plus exact de les caractériser comme des partenaires partageant une même vision. Tous deux considèrent l’économie marchande, la croissance économique, l’individualisme et l’innovation technologique comme les moteurs du progrès humain. Chacun dépend aussi de l’autre par bien des aspects. Les acteurs économiques sollicitent de l’État des subventions, des privilèges juridiques, un soutien à la recherche et l’atténuation de leurs externalités négatives comme la pollution et l’inégalité sociale. Les États, quant à eux, considèrent les acteurs marchands comme des sources de recettes fiscales, d’emplois et d’influence géopolitique.
DIT signifie « faites-le ensemble » (do-it-together). Le DIT est complémentaire du DIY, do-it-yourself (« faites-le vous-même »), qui, dans la pratique, prend souvent la forme d’un « faites-le ensemble ». DIT désigne une forme de DIY fondée sur les communs. Tous deux visent à éviter la dépendance envers l’argent et les marchés, et contribuent à une pratique des communs démonétarisée.
Le droit vernaculaire est une forme de droit enracinée dans les zones informelles et non officielles de la société, tenant lieu de norme morale et sociale. Que le droit vernaculaire soit moralement bon ou non, il s’oppose au droit étatique, qui reflète les préoccupations spécifiques de la puissance publique. La coutume fonctionne comme une forme de droit vernaculaire en exprimant les jugements pratiques, la sagesse éthique et les savoirs situés des gens enracinés dans un lieu ou des circonstances singulières.
L’émergence est le processus par lequel l’interaction entre des agents vivants produit de manière inattendue une organisation entièrement nouvelle et plus complexe à une plus grande échelle. Les nouvelles propriétés systémiques ne sont pas inscrites dans l’un des éléments ou dans l’agrégation de ces éléments, mais émergent spontanément sans cause ni effet évidents. Ce sont d’innombrables interactions locales et individuelles qui donnent naissance aux structures complexes du langage et de la culture. De même, les interactions entre pairs dans les communautés en réseau pour les logiciels libres, la recherche scientifique et la production cosmo-locale génèrent des effets émergents.
L’enclosure est l’acte de clôturer des terres, des forêts ou des pâturages pour transformer des richesses partagées collectivement, et dont les commoneurs dépendaient pour leurs besoins vitaux, en propriétés privées individuelles. Historiquement, les enclosures relevaient d’initiatives politiques de seigneurs féodaux et, plus tard, de capitalistes soutenus par le Parlement. Aujourd’hui, les enclosures sont généralement le fait d’investisseurs et de grandes entreprises, souvent en collusion avec l’État, qui cherchent à privatiser ou à marchandiser toutes sortes de ressources partagées – la terre, l’eau, l’information numérique, les œuvres de création, les connaissances génétiques – en dépossédant les commoneurs. L’enclosure peut être réalisée par des moyens techniques comme la gestion des droits numériques ou des systèmes de péages (paywalls) ; des moyens politiques tels que la privatisation, les traités commerciaux et la financiarisation ; des moyens sociaux tels que la culture de consommation, la publicité et l’acculturation forcée des gens à la culture capitaliste occidentale. L’enclosure est le contraire du commoning en ce qu’elle sépare les éléments que la pratique des communs relie : les gens et la terre, vous et moi, les générations présentes et futures, les infrastructures techniques et leur gouvernance, les dirigeants et les dirigés, les terres sauvages et les personnes qui en ont pris soin pendant des générations. L’enclosure est incluse ici en tant que concept propice (même s’il s’agit d’un acte hostile !) car elle nous permet de donner un nom à l’appropriation privée de la richesse partagée.
L’épanouissement (enlivenment) se réfère à la vie et à la vitalité comme à des catégories fondamentales pour penser le monde et sa constitution. Cela signifie que les sentiments, la subjectivité et la création de sens sont des dimensions empiriques des êtres vivants dont la science doit reconnaître le rôle important dans l’évolution. L’épanouissement est une idée centrale de l’écophilosophie (Andreas Weber), de la philosophie des patterns (Christopher Alexander) et des communs. Elle est produite, entre autres, par la Rationalité Ubuntu, le soin et l’utilisation d’outils conviviaux.
L’exonymie consiste à désigner des phénomènes par des termes erronés et trompeurs au regard de l’expérience des personnes concernées elles-mêmes. Le discours économique, par exemple, utilise généralement des termes ontologiquement incorrects lorsqu’il tente de décrire la pratique des communs. Ce que les économistes considèrent comme des « ressources » – des choses fongibles et utilitaires – sont aux yeux des commoneurs une bio-richesse et une richesse-soin qui donnent sens à leur communauté. La « rationalité » économique présuppose un idéal humain que les commoneurs ne reconnaîtraient pas. Le politologue et anthropologue James Scott a été le premier à attirer notre attention sur ce terme dans son livre Against the Grain40.
Le terme de faux commun est utilisé pour décrire une activité coopérative qui ressemble à la pratique des communs, mais qui est en fait hébergée ou régie par des non-commoneurs – entreprises, entités étatiques ou groupes d’investissement. Facebook est un exemple frappant. C’est une plateforme numérique de partage d’information fermée et propriétaire qui exploite les données de ses utilisateurs à des fins commerciales. Les plateformes numériques comme Airbnb et Uber prétendent promouvoir le partage, mais ce sont en fait des entreprises fondées sur des transactions commerciales et l’investissement capitaliste, pas des communs. Les partenariats contractuels de répartition des bénéfices, comme les communautés de brevets entre fabricants de médicaments, sont un autre exemple de faux commun. Ils sont motivés par des fins essentiellement commerciales et n’impliquent pas d’engagement de long terme de responsabilité partagée et de partage des bénéfices. Ces distinctions sont importantes car les entreprises commerciales sont souvent désireuses de dissimuler leurs intérêts mercantiles et de s’octroyer une légitimité démocratique en prétendant qu’elles sont au service du partage, de la communauté et du bien commun, ce que l’on pourrait qualifier de “commonswashing”.
Une fédération fait référence à un groupe de personnes, d’équipes ou d’organisations qui choisissent de se coordonner ou de collaborer les unes avec les autres sur la base d’objectifs convenus, de valeurs éthiques ou d’une histoire partagée. Bien que le terme de fédération soit généralement associé à l’idée d’États ou d’entités similaires se réunissant sous une forme ou une autre qualifiée de « fédérale », les collectifs et les organisations sociales peuvent eux aussi se fédérer pour se protéger, collaborer et se soutenir mutuellement. Une fédération se distingue d’un réseau en ce que les participants d’un réseau peuvent ou non partager des objectifs ou des engagements profonds, alors que ceux d’une fédération se consacrent activement à une mission commune. Autre différence : un réseau (distribué) est complètement horizontal et entièrement structuré de pair à pair, tandis qu’une fédération peut être hétérarchique (voir Hétérarchie).
La finance collaborative décrit les manières de financer les communs et de fournir un soutien structurel à la pratique des communs tout en protégeant ces activités des influences néfastes de l’argent et de la dette. Démarchandiser les relations entre les gens et avec le monde non humain est un objectif essentiel. La finance collaborative utilise l’argent et le crédit de sorte que les institutions des communs soient renforcées et que les gens se sentent en sécurité et libres car moins dépendants des marchés. Parmi les aspects importants de la finance collaborative, on peut citer les communs démonétarisés, les crédits de pair à pair, l’usage de l’argent dans le cadre d’une réciprocité accommodante et les nouveaux circuits financiers public-communs. Historiquement, la finance collaborative a inclus d’autres modèles encore tels que les sociétés de crédit mutuel et les groupements d’assurances, la finance coopérative, la microfinance contrôlée par la communauté et les monnaies locales.
Le financement par la foule (crowdfunding) est une pratique de financement collaboratif qui s’appuie sur des plateformes numériques. Il fait appel aux contributions d’un grand nombre de personnes (la « foule »), plutôt qu’aux seuls membres du groupe ou aux proches, afin de mettre en commun de petites sommes d’argent pour financer des projets qui génèrent des bénéfices collectifs. Le financement par la foule n’est pas exclusivement dédié aux communs. Certaines campagnes servent à récolter gratuitement des capitaux d’amorçage à des start-up dont le capital est privé et qui ne reposent pas sur la Gouvernance par les pairs. Cependant, de nombreuses initiatives de crowdfunding, telles que la plateforme Goteo basée à Madrid, sont explicitement et délibérément vouées à l’avancement des communs.
La Gouvernance par les pairs désigne la partie de la pratique des communs où les personnes prennent des décisions, fixent des limites, appliquent des règles et gèrent les conflits – à la fois au sein de chaque commun et entre différents communs. Dans un monde de Gouvernance par les pairs, les individus se considèrent comme des partenaires ayant le même potentiel de participation à un processus collectif, et non comme des adversaires rivalisant pour prendre le contrôle d’un appareil central de pouvoir. Dans les principes de coopération d’Elinor Ostrom, la Gouvernance par les pairs est centrale car il n’y a pas de pratique des communs ni de Communivers sans Gouvernance par les pairs, qui se distingue de la gouvernance pour le peuple ou avec le peuple (participation). Il s’agit de gouverner à travers le peuple.
Le terme d’hétérarchie est bien expliqué par le mot grec originel, ετεραρχία : hétér signifie « autre, différent », et archie veut dire « gouvernement, règles ». Dans une hétérarchie, différents types de règles et de structures organisationnelles se combinent. Elle peut intégrer, par exemple, des éléments de hiérarchie « du haut vers le bas » et de participation « du bas vers le haut » (toutes deux verticales), ainsi que des dynamiques de pair à pair (horizontales). Dans une hétérarchie, les gens peuvent atteindre une autonomie dans la poursuite d’objectifs sociaux en combinant plusieurs types de gouvernance dans un même système. Par exemple, il peut exister une forme de hiérarchie au sein d’une hétérarchie. Les hétérarchies ne sont pas simplement des formes distribuées d’organisation de pair à pair, qui sont souvent entravées par un manque de structure. L’hétérarchie n’est pas non plus le simple contraire de la hiérarchie. C’est plutôt un hybride qui permet une plus grande ouverture, une plus grande flexibilité, une plus grande participation démocratique et des dynamiques de fédération. Lorsque les tâches sont rendues modulaires, il devient plus facile pour les structures hétérarchiques de gouvernance de s’épanouir.
Les infrastructures non discriminantes sont des systèmes qui favorisent la mobilité, la communication, l’échange et le flux d’énergie d’une manière ouverte et égale pour tous. Le propriétaire ou le gestionnaire d’une telle infrastructure n’en restreint pas l’accès et l’usage en fonction de critères spécifiques comme l’origine ethnique, le sexe ou le statut social et ne fait pas payer une catégorie d’utilisateurs plus qu’une autre.
L’interopérabilité signifie que différents outils, systèmes informatiques ou produits technologiques peuvent s’interconnecter et fonctionner les uns avec les autres sans heurt et sans besoin d’intervention particulière. Par définition, l’interopérabilité repose sur des formats de données, des protocoles et des normes ouverts, comme la norme de codage des caractères pour la communication électronique ASCII (Abbreviated Standard Code for Information Interchange). L’interopérabilité est essentielle au bon fonctionnement de processus dans le cadre d’un environnement en réseau, comme dans la production cosmo-locale. Elle est également essentielle pour empêcher un agent ou un acteur du marché de s’octroyer un monopole ou de contrôler les autres en gardant la maîtrise des standards de conception.
L’intra-action est un concept inventé par la physicienne et philosophe Karen Barad pour décrire comment des entités individuelles se rassemblent afin de créer une nouvelle « capacité enchevêtrée » qui ne préexiste pas dans les individus. Pensez au comportement des foules et aux phénomènes culturels de viralité. Lorsque deux entités intra-agissent, leur capacité d’action émerge du sein de la relation elle-même, et non comme fonction des individus distincts impliqués. La capacité enchevêtrée évolue constamment et s’adapte avec la relation elle-même. Ce concept nous aide à dépasser les explications causales simplistes en suggérant que la responsabilité des actions est répartie entre des entités en intra-action, chacune d’elles pouvant avoir différents niveaux d’intentionnalité et différentes temporalités de manifestation. Du point de vue de l’intra-action, des idées familières telles que le dualisme sujet/objet, le temps linéaire et l’autonomie individuelle semblent incomplètes et peu à même d’expliquer comment les événements se produisent dans le monde (voir Émergence).
La liberté dans l’interconnexion est une conception de la liberté qui reconnaît que nous sommes reliés à la nature, aux autres personnes, aux communautés et aux institutions. C’est ainsi qu’un être humain se développe, découvre son identité et s’épanouit. C’est un idéal plus réaliste que les approches libertariennes de la liberté, qui tendent invariablement à maximiser le choix individuel et l’autonomie. En ce sens, l’idée de liberté telle qu’elle est communément conçue est une illusion, car aucun d’entre nous ne peut survivre en tant que moi-isolé, et encore moins déployer seul son potentiel. En fait, l’idée que l’individu puisse être totalement autonome et autosuffisant est ridicule car aucun humain ne peut survivre sans soutien psychologique et social (voir Moi-imbriqué).
Les logiciels libres et open source (Free/Libre and Open Source Software, FLOSS) sont des logiciels dont le code source est ouvert au partage et dont la licence permet à quiconque de les utiliser, de les copier, de les étudier et de les modifier. Ces libertés – rendues possibles par une variété de licences qui renversent le fonctionnement normal des droits de propriété intellectuelle – encouragent les utilisateurs à corriger les bugs et à améliorer et développer le logiciel. À l’inverse, un logiciel propriétaire utilise les droits de propriété intellectuelle pour interdire aux utilisateurs de voir ou de modifier le code source, créant ainsi une rareté artificielle (l’accès au code est restreint alors qu’il pourrait être partagé à peu de frais ou gratuitement). Les FLOSS augmentent la transparence du code, et par conséquent – en permettant à plus de personnes de l’examiner – sa sécurité et sa stabilité. Les FLOSS participent également à l’émancipation des gens en leur permettant d’adapter le code à leurs propres besoins et de rendre le logiciel plus à même de protéger leur vie privée. Le système d’exploitation GNU/Linux, qui équipe des millions de serveurs, d’ordinateurs de bureau et d’autres appareils, est peutêtre le programme FLOSS le plus connu.
Les membranes semi-perméables sont ce que les limites d’un commun devraient être. Comme les autres organismes sociaux vivants, les communs doivent se protéger des forces extérieures qui pourraient leur nuire tout en restant ouverts aux flux de nourriture et aux signaux de l’environnement. Par conséquent, un commun fonctionne mieux s’il développe autour de lui-même une membrane semi-perméable plutôt qu’une frontière stricte et rigide. Cette peau flexible, pour ainsi dire, assure son intégrité en empêchant les enclosures et d’autres dangers tout en lui permettant de développer des relations enrichissantes et symbiotiques avec d’autres organismes vivants.
La mise en commun est une manière de contribuer à un fonds commun ou à des réserves communes de toute nature. Les contributions sont rassemblées pour atteindre des objectifs convenus, puis elles sont réparties de manière convenue en fonction de ces objectifs.
Le Moi-imbriqué (Nested-I) décrit l’interdépendance existentielle des êtres humains les uns avec les autres et avec le monde en général, qui co-crée et soutient notre développement personnel. Utiliser le terme de Moi-imbriqué plutôt que celui d’individu, c’est reconnaître que l’identité, les talents et les aspirations d’une personne sont toujours ancrés dans des relations. Avec cette conscience de soi, la personne qui se reconnaît comme un Moi-imbriqué comprend que les intérêts personnels et collectifs ne sont pas opposés les uns aux autres (individuel/collectif), mais peuvent s’aligner les uns sur les autres. Le Moi-imbriqué s’oppose à l’idéal humain célébré dans les sociétés modernes laïques, selon lequel la vie de chacun est définie par ses réalisations et aspirations personnelles, indépendamment de sa communauté, de son histoire, de son ethnicité, de sa race, de sa religion, de son sexe, etc. Il est l’inverse du moi-isolé, archétype de l’Homo economicus brandi comme idéal humain par les économistes : une personne intéressée, rationnelle, maximisant l’utilité et absolument autonome (voir Liberté dans l’interconnexion et Rationalité Ubuntu).
Mutualiser signifie contribuer et appartenir à une entreprise collective ayant un objectif social large et durable ; cette participation donne droit en retour à certaines prestations individuelles. Cependant, les membres ne reçoivent pas tous nécessairement un avantage égal ou des allocations correspondant exactement à ce qu’ils ont donné, comme dans une transaction marchande. Ce qu’ils reçoivent est généralement évalué en fonction de leurs besoins réels ou d’autres critères. Les avantages de la mutualisation sont convenus socialement, souvent sur la base de parts différentielles et de formules prédéterminées. Les assurances mutuelles et la sécurité sociale sont des exemples classiques. Quelle que soit la manière dont la mutualisation est structurée, il est essentiel que chaque personne qui y participe puisse avoir son mot à dire. Il s’agit d’une réciprocité déterminée par les pairs, une forme spécifique de la pratique de la réciprocité accommodante.
L’Ontochangement est un changement dans les présupposés et les perspectives fondamentaux d’une personne sur la nature et la structure de la réalité. Les points de vue ontologiques se reflètent dans la manière de percevoir comment les personnes et les objets existent dans le monde, et par conséquent, quels systèmes culturels, d’économie politique et quelles structures de coordination sont possibles et souhaitables.
L’ontologie, en philosophie, est l’étude des présupposés fondamentaux d’une personne sur la nature et la structure de la réalité. L’ontologie est le « cadre constitutionnel » du système de croyances d’une personne – la fenêtre à travers laquelle elle voit le monde, sa façon de percevoir et d’interpréter la réalité. Le monde est-il divisé entre l’humanité et la nature, les individus et les collectifs ? Le monde est-il un espace statique ou en constante évolution ? Notre manière de percevoir et de décrire le monde qui nous entoure, et d’agir en son sein, est fonction de tels présupposés. Les acteurs politiques du monde moderne ont généralement une cosmo-vision différente, par exemple, de celle d’une culture indigène, qui considère la nature, les humains et les générations passées et futures comme un tout intégré. Ainsi, les Ontorécits auxquels on adhère ont des implications profondes sur les types d’ordre social, économique et politique qui nous semblent plausibles et attirants.
L’ontologie relationnelle soutient que les relations entre les entités sont plus importantes que les entités elles-mêmes. Cela signifie que les systèmes vivants se développent et prospèrent grâce à leurs interactions et leurs intra-actions les uns avec les autres. En tant que système social fondé sur des gens qui s’assemblent pour collaborer et se soutenir mutuellement, les communs s’appuient sur une ontologie relationnelle. Cette vision s’oppose à celle qui sous-tend le capitalisme de marché, selon laquelle le monde repose sur des individus isolés et se faisant eux-mêmes, sans que leur histoire, leur religion, leur origine ethnique, géographique, leur sexe ou autres aient une réelle importance. Concevoir la nature de la réalité à travers l’ontologie relationnelle nécessite d’utiliser des catégories relationnelles différentes, telles que le Moi-imbriqué et la Rationalité Ubuntu.
Ontorécit est un terme abrégé pour désigner un récit ontologique (voir Ontologie).
Outils conviviaux est un terme se référant à Ivan Illich dans son livre La Convivialité, publié en 1973. Il se réfère aux outils, technologies et infrastructures qui renforcent la créativité et l’autodétermination, tels que les outils d’usage quotidien, les patterns de commoning que nous suggérons dans ce livre, ou encore les outils fondés sur des logiciels libres tels qu’OpenStreetMap41. Ces outils conviviaux sont importants car, comme nous le rappelle Marshall McLuhan, « nous façonnons nos outils, puis nos outils nous façonnent42 ». Un outil est convivial si les gens peuvent comprendre la manière dont il est conçu et ont accès aux savoirs nécessaires pour le produire ; s’il se prête à une adaptation créative par chacun pour ses besoins propres ; s’il est adapté à des contextes locaux spécifiques (les matériaux et les compétences requis sont-ils disponibles ? Est-il compatible avec l’environnement et la culture locale ?). Les outils conviviaux sont fondamentalement émancipateurs car ils aident les gens à découvrir et à développer leurs priorités, leurs capacités d’apprentissage et leurs compétences. Ils nous libèrent des outils propriétaires et fermés qui entravent l’apprentissage personnel, le partage, la modification et la réutilisation. Cependant, l’utilisation d’outils conviviaux peut s’avérer peu pratique dans certaines circonstances en raison du temps que leur maîtrise exige.
Les pairs sont des gens qui détiennent un pouvoir social et politique égal à celui des autres membres d’un groupe ou d’un réseau. Les pairs ont des talents et des personnalités différents, mais ils se considèrent mutuellement comme ayant les mêmes droits et les mêmes capacités à contribuer à un projet collaboratif et à décider de son déroulement (voir Moi-imbriqué, Rationalité Ubuntu).
Le partage est un terme général et non spécifique qui désigne des formes non réciproques d’allocation. En fonction de ce qui est partagé, nous distinguons ici entre le partage, la répartition et le co-usage. Tous trois sont généralement précédés par une mise en commun.
Le partage est le transfert volontaire et non réciproque de savoirs, d’informations, d’idées, de codes, de designs et d’autres biens immatériels qui peuvent être copiés à peu de frais. Les communautés de logiciels libres et open source sont l’exemple classique du partage.
La répartition est l’allocation de ressources finies et épuisables. Elle se distingue du partage en ce que ce dernier augmente généralement la valeur d’usage de ce qui est partagé, ce que la répartition ne permet pas. (Le partage doit également être distingué de l’« économie du partage », qui désigne plutôt, dans les faits, des marchés de micro-location.)
Le co-usage est un arrangement social en vue de l’accès et de l’usage de ressources partagées et de la richesse-soin.
Un partenariat public-communs (PPC)est un accord de coopération à long terme entre des commoneurs et des institutions publiques pour répondre à des besoins spécifiques. L’un ou l’autre des partenaires peut initier un PPC, mais les commoneurs doivent conserver la maîtrise du processus. Les institutions publiques fournissent un soutien juridique, financier et/ou administratif essentiel aux commoneurs, et les commoneurs se fournissent des services à euxmêmes ainsi qu’au grand public. Cela peut prendre la forme de systèmes Wi-Fi communautaires, de soins infirmiers ou aux personnes âgées, ou de projets mis en œuvre par des habitants avec le soutien de la puissance publique. Un PPC permet aux commoneurs de créer des structures organisationnelles conviviales qui les aident à prendre leurs propres décisions et à apporter des solutions adaptées.
Les patterns, ou motifs récurrents, sont une manière de comprendre la nature de l’ordre dans le monde. Ils nous aident à identifier des régularités structurelles et des relations entre des phénomènes de types différents (tels que la pratique des communs) sans nous appuyer sur des abstractions ou des principes trop rigides qui tendent à ignorer la singularité des contextes et des histoires. Un motif récurrent d’interaction humaine distille l’essence de nombreuses solutions trouvées au fil du temps par des praticiens (comme les commoneurs) à des problèmes qui se répètent régulièrement dans des contextes similaires. Chaque commun, par exemple, doit relever le défi d’instaurer la confiance, de prendre des décisions qui reflètent les sentiments de chacun et d’utiliser l’argent de manière socialement saine en évitant les effets pernicieux. Les patterns sont ouverts et toujours interconnectés ; aucun n’est complet en soi.
Plafonner consiste à fixer une limite quantitative absolue à ce que les gens peuvent prélever sur des ressources finies et épuisables telles que la terre, le bois ou l’eau. La détermination d’un plafond alerte les gens sur le fait qu’ils ne peuvent puiser autant qu’ils le veulent dans la ressource sans nuire à la richesse naturelle dont le groupe dépend. Le plafonnement était utilisé dans les communs anglais médiévaux (voir Restriction), avant de revenir à l’ordre du jour dans la gouvernance mondiale contemporaine (cf. les propositions de « plafonnement et partage » telles que celles du Sky Trust43).
Le plurivers est une conception du monde dans laquelle d’innombrables groupes de personnes créent et recréent leurs propres réalités culturelles distinctes, chacune d’entre elles constituant un monde. Ce terme est nécessaire car de nombreuses crises contemporaines découlent de la croyance en l’existence d’un monde unique, sorte de réalité euro-moderne universelle. Dire que le monde est un plurivers, c’est affirmer qu’il n’y a pas de source unique de l’être (et donc revendiquer une ontologie plurielle) et qu’aucun système de connaissances n’est intrinsèquement supérieur aux autres. Un plurivers est un « monde dans lequel peuvent s’intégrer de nombreux mondes », comme le notent les zapatistes. D’où ce casse-tête auquel nous sommes confrontés : comment les différentes sociétés qui constituent l’espèce humaine peuventelles accepter la coexistence d’une multitude de mondes sur une seule et même planète ?
Un processus génératif est une démarche exploratoire, progressive et évolutive qui produit un environnement épanouissant, par exemple un commun. Il s’agit d’un processus vivant, dynamique et adaptatif, toujours en devenir et inachevé. Il s’oppose aux processus de fabrication où les plans sont entièrement fixés à l’avance. Un processus génératif est le seul moyen de créer des structures résilientes et d’approfondir les relations, car seuls les processus vivants peuvent engendrer des systèmes vivants. Ce qui a été généré crée une résonance plus profonde et des sentiments de plénitude et d’épanouissement44. Les collaborations qui ont permis de produire ce livre – non seulement entre les coauteurs, mais aussi avec leurs nombreux collègues et conseillers – sont un exemple de processus génératif de production. Toutes les personnes impliquées, ainsi que les idées elles-mêmes, ont grandi et se sont transformées au cours de son écriture.
La production cosmo-locale est un système d’approvisionnement fondé sur l’Internet où les gens échangent en ligne et de pair à pair des savoirs et des designs « légers », car immatériels, tandis que la fabrication « lourde » des objets physiques tels que des machines, des voitures, des logements, des meubles et des appareils électroniques se fait au niveau local45. La production cosmo-locale permet d’éviter les coûts liés aux designs propriétaires fondés sur des brevets ou des marques. Elle privilégie également l’usage de matériaux moins coûteux pouvant être obtenus localement et la conception de modules permettant l’interopérabilité, ce qui facilite la mise en commun et le partage.
La Propriété relationalisée renvoie à « d’autres manières de posséder » qui s’accordent à la pratique des communs et vont au-delà de la logique exclusive, extractive et commerciale associée à la propriété conventionnelle. Une société construite autour de la propriété privée tend à produire des nantis et des démunis, ainsi qu’une concentration abusive du capital et du pouvoir. La Propriété relationalisée est une nouvelle catégorie socio-juridique de gouvernance et de gestion qui neutralise partiellement ou complètement les droits de propriété exclusifs sur les choses considérées comme des biens. Les gens décident d’adopter un régime de Propriété relationalisée et de gérer leur richesse partagée à travers la Gouvernance par les pairs ; ce régime ne leur est pas imposé. Cela leur permet d’adopter des formes interreliées de possession des biens qui améliorent la vie et renforcent les relations – entre eux, avec le monde non humain, avec les générations passées et futures, et avec le bien commun.
La Rationalité Ubuntu est une logique d’interactions humaines qui reconnaît les liens profonds entre les intérêts d’une personne et le bien-être des autres. Elle met en évidence une dynamique dans laquelle l’épanouissement d’une personne nécessite l’épanouissement des autres, et vice versa. Ce terme s’oppose à l’idée conventionnelle de la rationalité des acteurs économiques, définie comme un comportement intéressé, calculateur et centré sur l’acquisition individuelle qui tend à se manifester au détriment des autres. Lorsque les gens peuvent se voir comme des Moi-imbriqués dans un ensemble de relations pluriverselles, ils commencent à faire preuve de Rationalité Ubuntu. « Ubuntu » est un terme utilisé dans diverses langues bantoues d’Afrique du Sud pour désigner la profonde interdépendance entre « moi » et « l’autre ».
La réciprocité accommodante est différente d’une réciprocité stricte, où les partenaires d’une transaction tentent de calculer précisément qui doit quoi à qui. Dans une relation de type donnant-donnant, l’objectif est d’obtenir un avantage supérieur, ou au moins équivalent, à celui que l’on cède. La réciprocité au sein d’un commun est généralement une réciprocité moins stricte, où les gens choisissent de ne pas calculer précisément qui doit une faveur, du temps, de l’argent ou du travail à qui. Dans un commun, il est important d’entretenir des relations de bon voisinage plutôt que de se comporter comme un acteur de marché « rationnel ». Les communs offrent un contexte accueillant pour enraciner la réciprocité accommodante dans le quotidien, ce qui renforce la confiance sociale et la capacité à travailler ensemble de manière constructive.
Répartir, qui est différent de partager, désigne l’allocation non réciproque d’objets – nourriture, argent, objets, terrains, bicyclettes, outils – entre les membres d’un groupe (qu’il s’agisse d’une famille ou d’inconnus, d’un petit groupe ou d’un grand réseau) sans calculer le bénéfice individuel précis qu’en retire chacun. La répartition répond parfois à des demandes tacites ou formelles.
Les réseaux P2P (peer-to-peer, de pair à pair) sont une puissante forme d’organisation dans laquelle les participants contribuent à la production de communs de manière non hiérarchique. L’Internet et les technologies numériques ont donné naissance à d’importants réseaux P2P consacrés aux logiciels libres et ouverts, à divers wikis dont Wikipédia, à des sites web de création de contenus collaboratifs et d’archives, et à des communautés d’envergure mondiale dans différents domaines de la conception et de la production. En tant que réseaux distribués permettant à n’importe quel nœud de se connecter directement à n’importe quel autre, les réseaux P2P libèrent des formes de créativité collaborative qui seraient tout simplement impossibles dans des réseaux centralisés, dans lesquels chaque nœud est relié à un pôle central unique, ou dans des réseaux décentralisés, où persistent certains points de passage obligés.
Une restriction (stint) est une règle d’accès visant à empêcher qu’une chose soit utilisée de manière excessive ou abusive. Dans les cultures de subsistance, il existe souvent des règles très précises sur la manière dont une personne peut récolter du bois dans la forêt ou des joncs dans une zone humide, et sur le moment où cela est possible. Un « commun sous restriction » est donc une ressource gérée de façon à protéger ses capacités naturelles de renouvellement. « Sans restrictions, il n’y a pas de véritables communs », écrit l’universitaire Lewis Hyde46 (voir Plafonner).
Richesse-soin (care-wealth en anglais). Lorsque les gens prennent soin des forêts, des terres agricoles, de l’eau ou des espaces urbains, ceux-ci deviennent une partie de leur histoire partagée, de leur culture, de leur vie sociale et de leur identité. Ainsi, lorsque les commoneurs subviennent à leurs propres besoins et interagissent avec le monde de tout leur être, ils développent une vision du cosmos différente. Ils ne produisent pas des biens ou des marchandises en tant qu’individus rationnels, comme le décriraient les économistes. Ils deviennent des gardiens de la richesse-soin – l’ensemble des choses, des systèmes vivants et des relations qui sont l’objet de leur affection, de leur soin, de leurs expériences partagées et de leurs attachements émotionnels. Le terme « ressource » nous invite à considérer la richesse partagée comme une chose qui doit être utilisée, extraite et transformée en variable d’un calcul économique. La notion de richesse-soin repose sur les relations affectives qui fondent la vie quotidienne et la culture de chacun et chacune.
Les savoirs situés font référence à l’expertise intuitive, incarnée, et au savoir-faire pratique qui s’acquiert au cours de la vie et du travail dans un domaine particulier. Lorsque les gens grandissent dans un environnement donné dès l’enfance, ils sont immergés dans certains rythmes et techniques. Ils s’approprient des connaissances subtiles sur les plantes, le bois, les matériaux utilisés dans l’artisanat, le gibier, la météo et de nombreux autres éléments du paysage qui les entoure. Ils développent une familiarité profonde avec leur environnement qui ne se trouve pas dans les livres.
Le soin (care en anglais) est une disposition et un engagement empathiques qui se manifestent dans la manière dont une personne entreprend une activité, y compris économique. Il décrit également certaines activités humaines élémentaires qui témoignent d’une conscience de l’interdépendance, du besoin et de l’appartenance comme des aspects essentiels de la condition humaine (voir Moi imbriqué et Rationalité Ubuntu). Ces activités relèvent, entre autres, de l’éducation des enfants, des soins apportés aux membres de la famille et aux amis, de la gouvernance et de l’approvisionnement par les pairs, de la gestion des ressources naturelles et des contributions d’intérêt général. Dans les études féministes, où il a une longue histoire, ce terme est utilisé pour mettre en évidence le travail non marchand et la valeur intrinsèque, généralement ignorée ou sous-estimée par la culture de marché. Le soin est parfois réduit à tort au seul travail des « soignants » qui, dans un contexte de marché, sont soumis à la loi de la productivité, ce qui les empêche de prodiguer des soins véritablement humains. En fait, alors que ces activités nécessitent d’accorder du temps avec générosité, les emplois de soignants tendent à se cantonner à une logique de gain de temps au nom de la rentabilité économique.
Souveraineté sur la valeur. Bien que la plupart des communs existent dans le cadre du système marché/État et soient de ce fait vulnérables à l’enclosure, ils s’efforcent généralement de protéger leur identité morale et culturelle et de garder un contrôle sur la valeur qu’ils génèrent. En bref, il cherche à assurer leur propre souveraineté sur la valeur.
La souveraineté sur les prix est la capacité de rejeter les conditions imposées par les marchés, y compris les prix. En atteignant une certaine indépendance vis-à-vis des marchés, les commoneurs acquièrent une souveraineté sur les prix en déterminant eux-mêmes, de manière transparente et collaborative, les termes de l’échange entre tous les partenaires impliqués dans la transaction. Ils peuvent dès lors choisir de répondre aux besoins des personnes gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux pratiqués par le marché. Il s’agit d’un pouvoir stratégique très souvent négligé qui confère aux personnes une autonomie importante par rapport aux pressions du marché et à la coercition de l’État. Avec la souveraineté sur les prix, les commoneurs se retirent des marchés au lieu de chercher à les dominer. Il ne s’agit donc pas en ce sens d’un comportement anticoncurrentiel comme celui que visent les lois dites « antitrust ».
Les systèmes adaptatifs complexes sont des systèmes vivants auto-organisés et résilients comme le cerveau, les cellules, les colonies de fourmis, la biosphère, les systèmes socio-écologiques et de nombreux communs. Ce terme est utilisé dans la science de la complexité, une approche scientifique hétérodoxe souvent appliquée dans les sciences de l’évolution, la chimie, la biologie et la physique. Cela permet de dépasser la vision newtonienne du monde, fondée sur la relation de cause à effet, pour adopter une vision holistique, non linéaire et interactive. L’interaction libre d’agents selon des principes simples au niveau local peut – sans connaissance d’un ensemble ni d’objectifs ultimes posés au départ – s’autoorganiser en systèmes plus vastes et plus complexes (ou, comme le dit la biologiste Lynn Margulis, être à l’origine d’une génération mutuelle de nouveaux systèmes vivants, connue sous le nom de « symbiogenèse47 »).
Deuxième Partie : La Triade Des Communs
Introduction
Ces dernières années, de nombreux écrits se sont attachés à conceptualiser les communs avec toujours plus de précision. Cependant, aucun de ces travaux ne s’est encore donné pour objet la constitution d’un cadre théorique qui engloberait tout à la fois le vécu ordinaire des pratiques d’auto-organisation, le type de transformation personnelle que ces pratiques des communs suscitent et la manière dont ces différents éléments sont susceptibles de transformer l’économie politique au fil du temps. Tel est le défi que nous tâchons de relever dans les trois prochains chapitres en esquissant les contours d’un cadre global de compréhension des communs et du commoning. À travers ces pages, nous espérons surmonter la confusion et les conceptions pseudo-populistes parfois associées à ces notions en proposant une conceptualisation rigoureuse. Comme nous le verrons, si la notion de communs est utilisée pour désigner tout ce que l’on aimerait voir partagé, elle perdra de son pouvoir de transformation.
Notons-le d’emblée : nos cadres cognitifs sont comme nos portes d’entrée. Ils influencent de manière aussi discrète qu’avérée notre perception du monde. Ils nous guident vers une certaine interprétation du réel, de la même façon qu’ouvrir telle porte nous mène à un certain endroit, laissant d’autres lieux inexplorés. En d’autres termes, tout cadre a pour effet de structurer notre perspective. La structure analytique et le langage qui y est associé confèrent un sens à ce que nous observons. C’est précisément une telle structure et un tel langage que les chapitres 4, 5 et 6 ont vocation à fournir, afin d’accompagner notre perception des communs et du commoning.
De ce point de vue, notre cadre prend appui sur l’ensemble des réflexions relatives au rôle de la subjectivité, de la relationalité et du langage qui ont occupé la première partie de cet ouvrage. Notre triade des communs – vie sociale, Gouvernance par les pairs et approvisionnement – est fondée sur le postulat que la pratique des communs consiste avant tout dans le fait de créer et de maintenir des relations – au sein de communautés et de réseaux plus ou moins grands – entre les humains et les non-humains, entre notre génération et les générations passées et futures. Cette conception proprement relationnelle du monde est nécessairement porteuse de nouvelles approches de la notion de valeur. Elle nous aide à prendre nos distances vis-à-vis des cadres politiques et économiques dominants. Mais elle doit également nous prémunir contre certaines acceptions simplistes des communs – pensons, par exemple, aux approches économiques et aux conceptualisations centrées sur les ressources qui font l’impasse sur les dynamiques sociales.
Deux ans avant d’écrire ces lignes, lorsque nous avons commencé à réfléchir à ce livre, nous n’avions pas pour intention de proposer un cadre nouveau. Cependant, à mesure que nous avancions, notre inconfort vis-à-vis des postulats ontologiques et du langage à l’œuvre dans la plupart des écrits sur les communs est devenu de plus en plus prégnant. Bien souvent, cette littérature ne parvient pas à décrire ce que nous observons dans le monde contemporain des communs. Après un an passé à jongler avec cet inconfort, nous nous sommes décidés à repartir de zéro. En mars 2017, nous avons commencé à réfléchir plus profondément aux contours d’un cadre conceptuel susceptible de lier théorie et pratique. Ce cadre, nous l’avons pensé pas à pas, lentement, de manière itérative. C’était comme si nous avions changé le point de départ de notre voyage. Pour explorer les alentours de Paris, on peut ainsi aussi bien partir de deux des principales gares de la ville – la gare du Nord ou la gare de l’Est, situées à quelques pas l’une de l’autre. Choisir la gare du Nord vous amène en direction de Lille, dans le nord de la France, ou à Saint-Quentin, dans la région des Hauts-de-France. Mais si l’on opte pour la gare de l’Est, à peine cinq cents mètres plus loin, c’est un tout autre choix de destinations qui s’offre : Mulhouse en Alsace ou Stuttgart en Allemagne, et des douzaines d’autres villes. La distance entre les gares est faible, mais le point de départ choisi induit une différence majeure quant au type de territoires que l’on découvrira. Il en va de même pour le cadre que l’on choisit pour interpréter le monde. Plus un cadre est en phase avec notre humanité, nos aspirations et notre contexte d’expérience, plus il est susceptible de nous conduire vers des horizons qui nous correspondent.
Le cadre que nous proposons a pour ambition de mettre en lumière certaines correspondances profondes au cœur de la diversité déconcertante des communs. En dépit des différences qui existent entre les communs centrés sur des ressources naturelles, sur des systèmes numériques ou encore sur la solidarité, tous présentent certaines similitudes au plan de leur structure et des dynamiques sociales. Ces affinités profondes n’ont jamais encore fait l’objet d’une caractérisation adéquate et n’ont jamais été articulées ensemble pour former un cadre général cohérent. Notre idée est donc de rendre visible ce qui connecte entre elles les expériences de communs, qu’elles émanent de la période médiévale ou du temps présent, de la sphère numérique ou d’autres sphères, des villes ou des campagnes, des communautés du libre ou des luttes pour l’eau. Mettre au jour le « patrimoine génétique » partagé permettant d’identifier ces connexions aide à comprendre comment les communs peuvent être tout à la fois aussi anciens que l’humanité et aussi modernes que l’Internet.
Les points communs structurels que nous identifions sont fondés sur des relations et des éléments que nous appelons ici patterns. Les patterns nous aident à percevoir ce qui lie entre eux les divers univers des communs sans gommer leurs différences. Une approche par patterns part du principe que chaque commun se développe et évolue dans un contexte singulier, dans un temps et un espace donnés. Chacun est conçu par des personnes particulières, dans des sociétés et des environnements uniques. Il est donc parfaitement naturel que chaque commun mette en pratique les motifs récurrents que nous avons identifiés en accord avec le contexte qui lui est propre. Allouer équitablement l’eau dans les Alpes suisses au xvie siècle suppose la mise en place de règles bien différentes de celles requises au xxie siècle pour partager équitablement une bande de fréquences. De la même manière, gouverner un commun représente un défi bien différent selon que l’on se situe au cœur des sociétés capitalistes modernes ou dans une culture indigène. Et pourtant, tous ces exemples de communs se caractérisent par la volonté de produire quelque chose qui sera équitablement partagé entre tous.
Lorsque l’on examine de plus près la manière dont les choses se passent au sein de différents types de communs, on se retrouve très vite face à un monde caractérisé par des récurrences. Une approche en termes de patterns nous permet de saisir l’idée que les communs existent et se développent de diverses manières, mais sans que ces pratiques soient pour autant arbitraires ou accidentelles. Certains éléments répétitifs peuvent être identifiés dans les communs, qui ne sont pas toujours désignés de façon explicite. John C. Thomas explique que les patterns « sont une manière de pointer des invariants tout en gardant une certaine flexibilité pour décrire ce qui relève plus spécifiquement de la géographie, de la culture, de la langue, des objectifs et des technologies1 ». De ce point de vue, les patterns sont comparables à l’ADN : ils désignent un ensemble d’instructions dont les contours demeurent suffisamment peu spécifiés pour pouvoir être adaptés aux circonstances locales.
« L’ADN contient-il une description complète de l’organisme auquel il va donner naissance ? », demande Christopher Alexander dans son livre The Nature of Order. La réponse est non. Le génome contient en réalité un programme d’instructions destinées à produire un organisme – un programme génératif – dans lequel les éléments cytoplasmiques des œufs et des cellules sont des agents essentiels à côté des gènes, comme le code ADN de la séquence d’amino-acides d’une protéine2.
Principes et patterns
Quelle est la différence entre un principe et un pattern dans l’optique de décrire les dimensions les plus importantes d’un commun ? Pourquoi préférons-nous parler de patterns plutôt que de principes du commoning ? Quand les patterns sont articulés de manière succincte – comme dans l’expression ritualiser l’être-ensemble ou pratiquer une réciprocité accommodante –, cette tournure pourrait aisément évoquer l’énoncé d’un principe. Pour autant, patterns et principes ne sont pas la même chose. Chacun renvoie à une façon bien spécifique de comprendre le monde et d’initier un changement social.
Un principe désigne un idéal éthique ou philosophique que tout le monde est censé suivre. Il implique un universel, une vérité immuable. « Tu ne tueras point » ou « la séparation des Églises et de l’État » en sont deux exemples typiques. Les principes évoquent des axiomes scientifiques, un terme qui provient du terme grec axíõma signifiant « ce qui est tenu pour digne de valeur ou approprié » et « ce qui s’impose avec la force de l’évidence3 ». En général, on considère que les axiomes vont tellement de soi qu’ils peuvent se passer de justification ou d’explication. La même remarque vaut pour les principes : ceux qui s’en réclament estiment que leur portée morale ou politique ne fait pas débat.
Un pattern, par contraste, désigne une clé de résolution des problèmes que l’on peut retrouver dans différents contextes. Le pattern reste le même, mais les solutions concrètes diffèrent. Ainsi, gérer une coopérative dans une ville française expose au même type de problèmes que dans une ville nord-américaine ; toutefois, les approches requises seront différentes du fait des réalités juridiques, économiques et culturelles différentes dans chacun de ces pays. Notre choix de raisonner en termes de patterns s’inspire du travail pionnier de Christopher Alexander et de ses collègues dans les années 1970 dans le domaine de l’architecture (voir chapitre 1). Un pattern n’est pas un idéal éthique ou philosophique, mais un concept qui distille l’essence d’une grande variété de solutions mises en œuvre par des individus parce qu’elles fonctionnent bien et contribuent à améliorer leur vie.
Les principes ont tendance à être exprimés sous la forme de déclarations universelles. Cela pose question dans la mesure où il est pour ainsi dire impossible de retrouver le même type de structures institutionnelles, de croyances culturelles et de normes sociales dans différents lieux et contextes. Par contraste, certains patterns universels sont effectivement observables dans la manière dont les individus interagissent. Prenons le cas du mariage : en tant que pattern, le mariage désigne une pratique sociale universelle qui, tout en présentant d’innombrables variations, passe par la formulation d’un engagement mutuel4. Un pattern ne décrit pas le mariage dans tous ses détails : il ne précise pas le sexe des personnes concernées ni les conditions auxquelles le contrat peut être scellé. Il désigne simplement une clé de résolution des problèmes dont les contours dérivent de l’observation de situations concrètes. Autrement dit, les patterns décrivent, mais ne prescrivent pas. Ils ont pour point de départ le besoin de répondre à des tensions ainsi qu’aux problèmes qui en découlent. Les tensions sont omniprésentes dans nos vies. Une description formelle en termes de pattern commence par reconnaître les forces positives et négatives qui affectent une situation donnée sans présupposer que ces forces peuvent être levées par l’invocation d’un principe5. La logique des principes, quant à elle, ne tient pas compte du caractère intriqué et profondément désordonné de ces forces ; elle cherche avant tout à énoncer une règle d’or, un idéal incontournable. De plus, un principe est généralement présenté comme une vérité qui se suffit à elle-même. On l’énonce sans considération d’un quelconque autre principe avec lequel il serait susceptible d’entrer en conflit. Ainsi, l’invocation de la liberté d’expression n’implique pas très souvent de réflexion approfondie sur les tensions à l’œuvre entre ce principe et le respect de la vie privée ou de la dignité d’autrui.
Les patterns, par contraste, sont comme des outils de conception susceptibles de nous aider face aux défis pratiques qui sont les nôtres, tout en respectant nos exigences intérieures en matière d’éthique, d’esthétique et de spiritualité. Les patterns sont des vecteurs de vitalité. Il ne s’agit pas d’un système de règles et de standards relatifs à la manière dont les choses doivent être contrôlées et régularisées, ni de déclarations de principe abstraites ayant une portée morale ou normative comme la « solidarité » ou la « durabilité ». Cela ne veut pas dire que les patterns soient dépourvus de dimension éthique, mais que les aspirations éthiques doivent prendre en compte les réalités situées. C’est la raison pour laquelle aucun pattern ne se suffit à lui-même et tout pattern se définit nécessairement en relation avec d’autres6.
Notre cadre s’appuie tout naturellement sur l’abondante littérature scientifique relative aux communs – un corpus qui s’est considérablement accru suite à l’obtention du prix Nobel d’économie par Elinor Ostrom en 2009 pour ses recherches pionnières sur la gestion des ressources collectives. L’Association internationale pour l’étude des communs (International Association for the Study of the Commons, IASC) et sa revue7 s’inscrivent dans le droit fil de ce précieux travail. Les huit principes identifiés par Elinor Ostrom comme conditions favorables à l’institution de communs robustes, en particulier, constituent un outil formidable de connaissance. Ces principes ont été formulés par Elinor Ostrom dans son ouvrage phare paru en 1990, La Gouvernance des biens communs, et ultérieurement approfondis par plusieurs centaines de ses collègues. Toutefois, ces principes en disent fort peu sur la vie interne des communs ou encore sur ce que signifie «pratiquer le commun ». (Ils parlent avant tout de questions de gouvernance, un aspect sur lequel nous revenons au chapitre 5.)
Notre cadre triadique insiste sur le fait que les commoneurs sont engagés dans l’acte de « faire-monde au sein d’un plurivers ». De notre point de vue, cette expression reflète l’objet majeur de la pratique des communs, à savoir la création de systèmes de Gouvernance par les pairs qui, ancrés dans des contextes spécifiques, contribuent à rendre nos vies libres, équitables et durables. Au cœur de ce cadre se situe notre triade constituée de trois sphères interconnectées : l’une a trait à la vie sociale, la deuxième à la Gouvernance par les pairs et la troisième à l’approvisionnement. Pour parler plus simplement, ces trois sphères représentent respectivement les dimensions sociale, institutionnelle et économique. S’il nous a semblé utile de structurer ainsi notre propos, cela ne signifie en aucun cas que ces trois sphères soient séparées ou distinctes. Chaque sphère de la triade offre une perspective spécifique sur le même phénomène. Et chacune est profondément connectée aux deux autres, comme l’image jointe le suggère.
On pourrait raisonnablement nous demander comment il est possible de formuler un énoncé général et cohérent sur les communs alors même qu’il n’existe pas d’universel culturel. De notre point de vue, une compréhension générale des communs n’a rien d’impossible – pour autant que celle-ci reconnaisse l’immense diversité des réalités concrètes et en extraie les régularités essentielles ! C’est précisément ce à quoi servent les patterns. Ils évitent l’écueil du réductionnisme, se gardent de simplifier outre mesure la complexité des situations vécues et n’ont pas besoin d’un modèle totalisant de compréhension du monde. Les patterns offrent un moyen de comprendre tout en prenant appui sur des savoirs situés – l’expérience des personnes, leur savoir-faire, leur intuition. Plus encore, ils participent à l’élaboration d’un cadre ouvert – un cadre d’emblée pensé pour être adaptable et qui ne prétend pas dire le dernier mot. L’enjeu n’est pas de fournir un plan, mais un modèle flexible – un vocabulaire des communs plutôt qu’une taxinomie classique et prescriptive.
Image 6 : La triade des communs

QUELQUES PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES
En apprenant à regarder à travers le prisme des patterns, nous sommes entrés dans une dynamique que nous pourrions qualifier de « prospection de patterns ». Nous avons procédé de manière relativement simple. Nous nous sommes demandé : quels types de problèmes apparaissent régulièrement au cœur des communs ? Concernent-ils les processus de décision ? L’argent ? Les enjeux de surexploitation des ressources ? etc. Il suffit de considérer la réalité concrète des communs pour énumérer une liste entière de problèmes pouvant être étudiés de cette façon.
Dans un deuxième temps, nous nous sommes mis en quête de solutions fructueuses mises en œuvre au sein de communs existants. Nous avons mené cette enquête dans toutes les directions – dans les différents domaines de la vie, au sein de la littérature scientifique et du côté des projets de terrain. Nous avons réfléchi à notre propre expérience des communs et mené plusieurs entretiens au long cours avec des commoneurs issus de diverses régions du monde, en documentant leurs activités et leurs réponses. Nous avons prêté une attention toute particulière aux solutions que ces individus et collectifs avaient mises en place pour répondre aux enjeux pratiques auxquels ils étaient confrontés. Ces solutions fonctionnent-elles ? Tiennent-elles sur le long terme? Sont-elles vulnérables aux assauts du capitalisme ? Nous avons comparé les approches mises en œuvre sur le terrain avec les perspectives et les affirmations théoriques sur les communs. Et pour finir, nous nous sommes permis de recourir à une forme d’abstraction – les patterns – pour construire notre cadre. Ces patterns ont par la suite été testés et affinés un à un dans le cadre d’un dialogue avec des commoneurs et des chercheurs. Nous avons demandé à ces interlocuteurs si nos propositions résonnaient avec leurs recherches et leurs expériences, ce qui nous a engagés dans un long processus de correction, d’élimination et d’adaptation.
Notre cadre triadique est l’aboutissement de cette démarche. Il organise et articule les différents patterns que nous avons identifiés. Cet ensemble est l’amorce d’un langage des communs – ou « langage des patterns des communs ». Nous ne prétendons aucunement que notre cadre suffise à rendre compte des communs dans leur ensemble. Ces derniers, notons-le d’emblée, sont avant tout affaire d’expérience vécue, irréductible à toute représentation. Ce que notre cadre prétend cependant offrir est quelque chose comme une cartographie. Autrement dit, il a vocation à proposer une structure, une terminologie et des chemins pour donner sens aux communs. Assurément, la carte n’est pas le territoire, et nous nous gardons bien d’opérer une telle confusion. Ce que nous livrons ici est une carte, ni plus ni moins. Et comme toute carte, elle est imprégnée de nos propres biais. Dès lors que le monde est un plurivers – une fédération fractale d’innombrables mondes à la fois uniques et interconnectés –, il faut bien reconnaître que notre cadre reflète immanquablement une perspective culturelle, et ce, quels que soient nos efforts pour embrasser une perspective cosmopolite.
Introduction
Ces dernières années, de nombreux écrits se sont attachés à conceptualiser les communs avec toujours plus de précision. Cependant, aucun de ces travaux ne s’est encore donné pour objet la constitution d’un cadre théorique qui engloberait tout à la fois le vécu ordinaire des pratiques d’auto-organisation, le type de transformation personnelle que ces pratiques des communs suscitent et la manière dont ces différents éléments sont susceptibles de transformer l’économie politique au fil du temps. Tel est le défi que nous tâchons de relever dans les trois prochains chapitres en esquissant les contours d’un cadre global de compréhension des communs et du commoning. À travers ces pages, nous espérons surmonter la confusion et les conceptions pseudo-populistes parfois associées à ces notions en proposant une conceptualisation rigoureuse. Comme nous le verrons, si la notion de communs est utilisée pour désigner tout ce que l’on aimerait voir partagé, elle perdra de son pouvoir de transformation.
Notons-le d’emblée : nos cadres cognitifs sont comme nos portes d’entrée. Ils influencent de manière aussi discrète qu’avérée notre perception du monde. Ils nous guident vers une certaine interprétation du réel, de la même façon qu’ouvrir telle porte nous mène à un certain endroit, laissant d’autres lieux inexplorés. En d’autres termes, tout cadre a pour effet de structurer notre perspective. La structure analytique et le langage qui y est associé confèrent un sens à ce que nous observons. C’est précisément une telle structure et un tel langage que les chapitres 4, 5 et 6 ont vocation à fournir, afin d’accompagner notre perception des communs et du commoning.
De ce point de vue, notre cadre prend appui sur l’ensemble des réflexions relatives au rôle de la subjectivité, de la relationalité et du langage qui ont occupé la première partie de cet ouvrage. Notre triade des communs – vie sociale, Gouvernance par les pairs et approvisionnement – est fondée sur le postulat que la pratique des communs consiste avant tout dans le fait de créer et de maintenir des relations – au sein de communautés et de réseaux plus ou moins grands – entre les humains et les non-humains, entre notre génération et les générations passées et futures. Cette conception proprement relationnelle du monde est nécessairement porteuse de nouvelles approches de la notion de valeur. Elle nous aide à prendre nos distances vis-à-vis des cadres politiques et économiques dominants. Mais elle doit également nous prémunir contre certaines acceptions simplistes des communs – pensons, par exemple, aux approches économiques et aux conceptualisations centrées sur les ressources qui font l’impasse sur les dynamiques sociales.
Deux ans avant d’écrire ces lignes, lorsque nous avons commencé à réfléchir à ce livre, nous n’avions pas pour intention de proposer un cadre nouveau. Cependant, à mesure que nous avancions, notre inconfort vis-à-vis des postulats ontologiques et du langage à l’œuvre dans la plupart des écrits sur les communs est devenu de plus en plus prégnant. Bien souvent, cette littérature ne parvient pas à décrire ce que nous observons dans le monde contemporain des communs. Après un an passé à jongler avec cet inconfort, nous nous sommes décidés à repartir de zéro. En mars 2017, nous avons commencé à réfléchir plus profondément aux contours d’un cadre conceptuel susceptible de lier théorie et pratique. Ce cadre, nous l’avons pensé pas à pas, lentement, de manière itérative. C’était comme si nous avions changé le point de départ de notre voyage. Pour explorer les alentours de Paris, on peut ainsi aussi bien partir de deux des principales gares de la ville – la gare du Nord ou la gare de l’Est, situées à quelques pas l’une de l’autre. Choisir la gare du Nord vous amène en direction de Lille, dans le nord de la France, ou à Saint-Quentin, dans la région des Hauts-de-France. Mais si l’on opte pour la gare de l’Est, à peine cinq cents mètres plus loin, c’est un tout autre choix de destinations qui s’offre : Mulhouse en Alsace ou Stuttgart en Allemagne, et des douzaines d’autres villes. La distance entre les gares est faible, mais le point de départ choisi induit une différence majeure quant au type de territoires que l’on découvrira. Il en va de même pour le cadre que l’on choisit pour interpréter le monde. Plus un cadre est en phase avec notre humanité, nos aspirations et notre contexte d’expérience, plus il est susceptible de nous conduire vers des horizons qui nous correspondent.
Le cadre que nous proposons a pour ambition de mettre en lumière certaines correspondances profondes au cœur de la diversité déconcertante des communs. En dépit des différences qui existent entre les communs centrés sur des ressources naturelles, sur des systèmes numériques ou encore sur la solidarité, tous présentent certaines similitudes au plan de leur structure et des dynamiques sociales. Ces affinités profondes n’ont jamais encore fait l’objet d’une caractérisation adéquate et n’ont jamais été articulées ensemble pour former un cadre général cohérent. Notre idée est donc de rendre visible ce qui connecte entre elles les expériences de communs, qu’elles émanent de la période médiévale ou du temps présent, de la sphère numérique ou d’autres sphères, des villes ou des campagnes, des communautés du libre ou des luttes pour l’eau. Mettre au jour le « patrimoine génétique » partagé permettant d’identifier ces connexions aide à comprendre comment les communs peuvent être tout à la fois aussi anciens que l’humanité et aussi modernes que l’Internet.
Les points communs structurels que nous identifions sont fondés sur des relations et des éléments que nous appelons ici patterns. Les patterns nous aident à percevoir ce qui lie entre eux les divers univers des communs sans gommer leurs différences. Une approche par patterns part du principe que chaque commun se développe et évolue dans un contexte singulier, dans un temps et un espace donnés. Chacun est conçu par des personnes particulières, dans des sociétés et des environnements uniques. Il est donc parfaitement naturel que chaque commun mette en pratique les motifs récurrents que nous avons identifiés en accord avec le contexte qui lui est propre. Allouer équitablement l’eau dans les Alpes suisses au xvie siècle suppose la mise en place de règles bien différentes de celles requises au xxie siècle pour partager équitablement une bande de fréquences. De la même manière, gouverner un commun représente un défi bien différent selon que l’on se situe au cœur des sociétés capitalistes modernes ou dans une culture indigène. Et pourtant, tous ces exemples de communs se caractérisent par la volonté de produire quelque chose qui sera équitablement partagé entre tous.
Lorsque l’on examine de plus près la manière dont les choses se passent au sein de différents types de communs, on se retrouve très vite face à un monde caractérisé par des récurrences. Une approche en termes de patterns nous permet de saisir l’idée que les communs existent et se développent de diverses manières, mais sans que ces pratiques soient pour autant arbitraires ou accidentelles. Certains éléments répétitifs peuvent être identifiés dans les communs, qui ne sont pas toujours désignés de façon explicite. John C. Thomas explique que les patterns « sont une manière de pointer des invariants tout en gardant une certaine flexibilité pour décrire ce qui relève plus spécifiquement de la géographie, de la culture, de la langue, des objectifs et des technologies1 ». De ce point de vue, les patterns sont comparables à l’ADN : ils désignent un ensemble d’instructions dont les contours demeurent suffisamment peu spécifiés pour pouvoir être adaptés aux circonstances locales.
« L’ADN contient-il une description complète de l’organisme auquel il va donner naissance ? », demande Christopher Alexander dans son livre The Nature of Order. La réponse est non. Le génome contient en réalité un programme d’instructions destinées à produire un organisme – un programme génératif – dans lequel les éléments cytoplasmiques des œufs et des cellules sont des agents essentiels à côté des gènes, comme le code ADN de la séquence d’amino-acides d’une protéine2.
Principes et patterns
Quelle est la différence entre un principe et un pattern dans l’optique de décrire les dimensions les plus importantes d’un commun ? Pourquoi préférons-nous parler de patterns plutôt que de principes du commoning ? Quand les patterns sont articulés de manière succincte – comme dans l’expression ritualiser l’être-ensemble ou pratiquer une réciprocité accommodante –, cette tournure pourrait aisément évoquer l’énoncé d’un principe. Pour autant, patterns et principes ne sont pas la même chose. Chacun renvoie à une façon bien spécifique de comprendre le monde et d’initier un changement social.
Un principe désigne un idéal éthique ou philosophique que tout le monde est censé suivre. Il implique un universel, une vérité immuable. « Tu ne tueras point » ou « la séparation des Églises et de l’État » en sont deux exemples typiques. Les principes évoquent des axiomes scientifiques, un terme qui provient du terme grec axíõma signifiant « ce qui est tenu pour digne de valeur ou approprié » et « ce qui s’impose avec la force de l’évidence3 ». En général, on considère que les axiomes vont tellement de soi qu’ils peuvent se passer de justification ou d’explication. La même remarque vaut pour les principes : ceux qui s’en réclament estiment que leur portée morale ou politique ne fait pas débat.
Un pattern, par contraste, désigne une clé de résolution des problèmes que l’on peut retrouver dans différents contextes. Le pattern reste le même, mais les solutions concrètes diffèrent. Ainsi, gérer une coopérative dans une ville française expose au même type de problèmes que dans une ville nord-américaine ; toutefois, les approches requises seront différentes du fait des réalités juridiques, économiques et culturelles différentes dans chacun de ces pays. Notre choix de raisonner en termes de patterns s’inspire du travail pionnier de Christopher Alexander et de ses collègues dans les années 1970 dans le domaine de l’architecture (voir chapitre 1). Un pattern n’est pas un idéal éthique ou philosophique, mais un concept qui distille l’essence d’une grande variété de solutions mises en œuvre par des individus parce qu’elles fonctionnent bien et contribuent à améliorer leur vie.
Les principes ont tendance à être exprimés sous la forme de déclarations universelles. Cela pose question dans la mesure où il est pour ainsi dire impossible de retrouver le même type de structures institutionnelles, de croyances culturelles et de normes sociales dans différents lieux et contextes. Par contraste, certains patterns universels sont effectivement observables dans la manière dont les individus interagissent. Prenons le cas du mariage : en tant que pattern, le mariage désigne une pratique sociale universelle qui, tout en présentant d’innombrables variations, passe par la formulation d’un engagement mutuel4. Un pattern ne décrit pas le mariage dans tous ses détails : il ne précise pas le sexe des personnes concernées ni les conditions auxquelles le contrat peut être scellé. Il désigne simplement une clé de résolution des problèmes dont les contours dérivent de l’observation de situations concrètes. Autrement dit, les patterns décrivent, mais ne prescrivent pas. Ils ont pour point de départ le besoin de répondre à des tensions ainsi qu’aux problèmes qui en découlent. Les tensions sont omniprésentes dans nos vies. Une description formelle en termes de pattern commence par reconnaître les forces positives et négatives qui affectent une situation donnée sans présupposer que ces forces peuvent être levées par l’invocation d’un principe5. La logique des principes, quant à elle, ne tient pas compte du caractère intriqué et profondément désordonné de ces forces ; elle cherche avant tout à énoncer une règle d’or, un idéal incontournable. De plus, un principe est généralement présenté comme une vérité qui se suffit à elle-même. On l’énonce sans considération d’un quelconque autre principe avec lequel il serait susceptible d’entrer en conflit. Ainsi, l’invocation de la liberté d’expression n’implique pas très souvent de réflexion approfondie sur les tensions à l’œuvre entre ce principe et le respect de la vie privée ou de la dignité d’autrui.
Les patterns, par contraste, sont comme des outils de conception susceptibles de nous aider face aux défis pratiques qui sont les nôtres, tout en respectant nos exigences intérieures en matière d’éthique, d’esthétique et de spiritualité. Les patterns sont des vecteurs de vitalité. Il ne s’agit pas d’un système de règles et de standards relatifs à la manière dont les choses doivent être contrôlées et régularisées, ni de déclarations de principe abstraites ayant une portée morale ou normative comme la « solidarité » ou la « durabilité ». Cela ne veut pas dire que les patterns soient dépourvus de dimension éthique, mais que les aspirations éthiques doivent prendre en compte les réalités situées. C’est la raison pour laquelle aucun pattern ne se suffit à lui-même et tout pattern se définit nécessairement en relation avec d’autres6.
Notre cadre s’appuie tout naturellement sur l’abondante littérature scientifique relative aux communs – un corpus qui s’est considérablement accru suite à l’obtention du prix Nobel d’économie par Elinor Ostrom en 2009 pour ses recherches pionnières sur la gestion des ressources collectives. L’Association internationale pour l’étude des communs (International Association for the Study of the Commons, IASC) et sa revue7 s’inscrivent dans le droit fil de ce précieux travail. Les huit principes identifiés par Elinor Ostrom comme conditions favorables à l’institution de communs robustes, en particulier, constituent un outil formidable de connaissance. Ces principes ont été formulés par Elinor Ostrom dans son ouvrage phare paru en 1990, La Gouvernance des biens communs, et ultérieurement approfondis par plusieurs centaines de ses collègues. Toutefois, ces principes en disent fort peu sur la vie interne des communs ou encore sur ce que signifie «pratiquer le commun ». (Ils parlent avant tout de questions de gouvernance, un aspect sur lequel nous revenons au chapitre 5.)
Notre cadre triadique insiste sur le fait que les commoneurs sont engagés dans l’acte de « faire-monde au sein d’un plurivers ». De notre point de vue, cette expression reflète l’objet majeur de la pratique des communs, à savoir la création de systèmes de Gouvernance par les pairs qui, ancrés dans des contextes spécifiques, contribuent à rendre nos vies libres, équitables et durables. Au cœur de ce cadre se situe notre triade constituée de trois sphères interconnectées : l’une a trait à la vie sociale, la deuxième à la Gouvernance par les pairs et la troisième à l’approvisionnement. Pour parler plus simplement, ces trois sphères représentent respectivement les dimensions sociale, institutionnelle et économique. S’il nous a semblé utile de structurer ainsi notre propos, cela ne signifie en aucun cas que ces trois sphères soient séparées ou distinctes. Chaque sphère de la triade offre une perspective spécifique sur le même phénomène. Et chacune est profondément connectée aux deux autres, comme l’image jointe le suggère.
On pourrait raisonnablement nous demander comment il est possible de formuler un énoncé général et cohérent sur les communs alors même qu’il n’existe pas d’universel culturel. De notre point de vue, une compréhension générale des communs n’a rien d’impossible – pour autant que celle-ci reconnaisse l’immense diversité des réalités concrètes et en extraie les régularités essentielles ! C’est précisément ce à quoi servent les patterns. Ils évitent l’écueil du réductionnisme, se gardent de simplifier outre mesure la complexité des situations vécues et n’ont pas besoin d’un modèle totalisant de compréhension du monde. Les patterns offrent un moyen de comprendre tout en prenant appui sur des savoirs situés – l’expérience des personnes, leur savoir-faire, leur intuition. Plus encore, ils participent à l’élaboration d’un cadre ouvert – un cadre d’emblée pensé pour être adaptable et qui ne prétend pas dire le dernier mot. L’enjeu n’est pas de fournir un plan, mais un modèle flexible – un vocabulaire des communs plutôt qu’une taxinomie classique et prescriptive.
Image 6 : La triade des communs

QUELQUES PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES
En apprenant à regarder à travers le prisme des patterns, nous sommes entrés dans une dynamique que nous pourrions qualifier de « prospection de patterns ». Nous avons procédé de manière relativement simple. Nous nous sommes demandé : quels types de problèmes apparaissent régulièrement au cœur des communs ? Concernent-ils les processus de décision ? L’argent ? Les enjeux de surexploitation des ressources ? etc. Il suffit de considérer la réalité concrète des communs pour énumérer une liste entière de problèmes pouvant être étudiés de cette façon.
Dans un deuxième temps, nous nous sommes mis en quête de solutions fructueuses mises en œuvre au sein de communs existants. Nous avons mené cette enquête dans toutes les directions – dans les différents domaines de la vie, au sein de la littérature scientifique et du côté des projets de terrain. Nous avons réfléchi à notre propre expérience des communs et mené plusieurs entretiens au long cours avec des commoneurs issus de diverses régions du monde, en documentant leurs activités et leurs réponses. Nous avons prêté une attention toute particulière aux solutions que ces individus et collectifs avaient mises en place pour répondre aux enjeux pratiques auxquels ils étaient confrontés. Ces solutions fonctionnent-elles ? Tiennent-elles sur le long terme? Sont-elles vulnérables aux assauts du capitalisme ? Nous avons comparé les approches mises en œuvre sur le terrain avec les perspectives et les affirmations théoriques sur les communs. Et pour finir, nous nous sommes permis de recourir à une forme d’abstraction – les patterns – pour construire notre cadre. Ces patterns ont par la suite été testés et affinés un à un dans le cadre d’un dialogue avec des commoneurs et des chercheurs. Nous avons demandé à ces interlocuteurs si nos propositions résonnaient avec leurs recherches et leurs expériences, ce qui nous a engagés dans un long processus de correction, d’élimination et d’adaptation.
Notre cadre triadique est l’aboutissement de cette démarche. Il organise et articule les différents patterns que nous avons identifiés. Cet ensemble est l’amorce d’un langage des communs – ou « langage des patterns des communs ». Nous ne prétendons aucunement que notre cadre suffise à rendre compte des communs dans leur ensemble. Ces derniers, notons-le d’emblée, sont avant tout affaire d’expérience vécue, irréductible à toute représentation. Ce que notre cadre prétend cependant offrir est quelque chose comme une cartographie. Autrement dit, il a vocation à proposer une structure, une terminologie et des chemins pour donner sens aux communs. Assurément, la carte n’est pas le territoire, et nous nous gardons bien d’opérer une telle confusion. Ce que nous livrons ici est une carte, ni plus ni moins. Et comme toute carte, elle est imprégnée de nos propres biais. Dès lors que le monde est un plurivers – une fédération fractale d’innombrables mondes à la fois uniques et interconnectés –, il faut bien reconnaître que notre cadre reflète immanquablement une perspective culturelle, et ce, quels que soient nos efforts pour embrasser une perspective cosmopolite.
IV. La Vie Sociale Des Communs
Le sociologue britannique Raymond Williams a écrit que « la culture, c’est l’ordinaire ». On pourrait en dire tout autant de la pratique des communs : il s’agit d’une activité éminemment ordinaire. La pratique des communs est ce que fait tout un chacun dans un contexte donné lorsqu’il veut s’entendre avec les autres et en même temps produire des richesses partagées par tous. Pour autant que la pratique des communs puisse être conçue comme un mode de vie, elle offre tout ce qu’une culture se doit d’offrir – « du sens, à la fois sur un plan formel et sur un plan plus fondamentalement existentiel », comme l’écrit le sociologue de l’art Pascal Gielen1. Les sociétés modernes ont largement perdu de vue ce qu’est la pratique des communs. C’est pourquoi mettre en lumière sa quotidienneté fondamentale est si important. Cela montre que les communs peuvent être une plateforme pour des alternatives concrètes et efficaces au capitalisme.
Nous commençons notre exploration en nous penchant sur la vie sociale des communs pour deux raisons : d’une part, parce que cette dimension constitue le cœur de tout commun ; d’autre part, parce qu’elle se manifeste également dans les deux autres sphères de notre triade – la Gouvernance par les pairs et l’approvisionnement. Au cours de ces quinze dernières années, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs dizaines de communs, nous avons parlé avec des centaines de personnes et lu une quantité importante d’écrits sur les communs, notamment dans la littérature scientifique. Durant ce cheminement, nous en sommes venus à mesurer à quel point les communs ne pouvaient pas être pensés sous la forme d’une alternative binaire, comme quelque chose qui soit existe, soit n’existe pas. La pratique des communs est avant tout affaire d’intensité, un peu à la manière d’un modulateur d’intensité lumineuse. L’intensité des différents patterns des communs peut être plus ou moins forte, selon ce que les gens font pratiquement, mais son degré d’illumination et de continuité peut nous rapprocher de l’auto- organisation consciente. Cela signifie que nous avons la capacité d’influencer le processus – en l’occurrence, d’intensifier la pratique des communs – à tout moment.
Certaines personnes ont une approche très réflexive à l’égard de ces patterns de vie sociale, d’autres non. Dans les cultures indigènes, la tradition et les habitudes peuvent donner l’impression que la pratique des communs est éminemment normale, ce qui tend au demeurant à l’invisibiliser. Dans les sociétés industrielles occidentales, la pratique des communs est tout aussi invisible, mais pour d’autres raisons : elle s’est trouvée culturellement marginalisée. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes attelés à cette « exploration archéologique » des communs à travers le monde – afin de porter au grand jour une réalité trop peu connue.
À nos yeux, il est important que chacun puisse expérimenter ces patterns afin de mieux comprendre ce que signifie la pratique de communs et développer de nouveaux modes de vie, de nouvelles formes d’approvisionnement et de gouvernance. Le changement est entre nos mains, et il est à la fois culturel, organisationnel, génératif et politique – pour parler dans les termes de notre schéma à trois sphères. La pratique des communs peut transformer notre économie et nos systèmes politiques, nos institutions ; elle peut également nous transformer nous-mêmes. Comme l’ont écrit J. K. GibsonGraham : « Si se changer soi-même revient à changer le monde, et si cette relation est réciproque, alors le projet de construire l’histoire n’est en aucun cas une idée distante. Il est au contraire bien présent, à la frontière de nos sens, de notre pensée, de nos sentiments et de nos corps en mouvement2. » In fine, la politique trouve en effet son origine au creux de nos subjectivités, selon Gibson-Graham, dans l’« expérience sensitive et gravitationnelle » de nos corps.
Pascal Gielen, quant à lui, caractérise la culture comme un « laboratoire discret pour de nouvelles formes de vie, un incubateur omniprésent, très peu relevé comme tel car on le retrouve partout3 ». Les communs sont un tel laboratoire. À l’époque actuelle, le capitalisme de marché et ses catégories de pensée régissent de manière plus ou moins coercitive la manière dont nous nous comportons, dont nous investissons, ou encore dont nous organisons nos institutions en présupposant que les individus sont typiquement égoïstes, matérialistes et tournés vers la maximisation de leurs besoins. Il n’est pas étonnant dans ce contexte que la pratique des communs puisse paraître déroutante. En effet, elle reflète une vision fondamentalement différente de l’humain. C’est ce qui lui a valu de se voir bien souvent éclipsée par les lumières superficielles de la modernité.
Pourtant, la capacité des communs à catalyser un changement est indiscutable : plus on est en phase avec une vision du monde fondée sur les communs et plus on s’engage dans la pratique des communs, plus on apprend à devenir un commoneur. Avec des conséquences considérables en matière économique, politique et culturelle. Les patterns de la vie sociale des communs désignent des formes spécifiques de coopération, de partage, et des façons singulières de se rapporter à autrui. On peut dire qu’un commun éclot lorsque ces patterns de la vie sociale atteignent une densité de pratique, un niveau d’auto-organisation et une continuité suffisants pour former une institution sociale cohérente.
CULTIVER DES INTENTIONS ET DES VALEURS PARTAGÉES
Les objectifs et les valeurs partagés constituent l’essence de tout commun. Sans eux, un commun perd sa cohérence et sa vitalité. Toutefois, ces objectifs et ces valeurs partagés ne peuvent émerger que lorsque les gens s’engagent d’eux-mêmes par passion, se connectent les uns aux autres et échangent leurs expériences. Un commun ne commence pas nécessairement par des objectifs et des valeurs partagés. Au contraire, ces objectifs et ces valeurs partagés sont bien souvent le produit du travail mené par les commoneurs pour recouper et aligner les diverses perspectives en présence. Autrement dit, le partage d’une vision commune ne peut en aucun cas être simplement imposé ou affirmé. Il ne peut émerger que de façon organique et progressive, du sein d’un véritable processus de pratique des communs. Une culture solide et bien ancrée ne s’est jamais construite en une nuit. (Voir image 7 : Cultiver des intentions et des valeurs partagées, téléchargeable sur www.eclm.fr)
Se contenter de déclarer des valeurs et des buts partagés revient à planter un arbre sans l’arroser. Objectifs et valeurs partagés doivent en effet être cultivés dans le temps, ce qui suppose une réflexion collective, mais aussi des traditions communes, des formes de célébration et la participation conjointe à diverses activités. Tous ces éléments jouent un rôle majeur pour renforcer l’engagement mutuel des gens. Bien entendu, la structure formelle des organisations et les infrastructures peuvent aussi y contribuer, mais il n’existe pas de substitut au processus même du commoning pour ce qui est d’aligner et d’approfondir les préoccupations et les perspectives des participants. Et cela prend du temps.
Au sein de Next Barn Over – la ferme décrite dans le chapitre 1 qui fonctionne sur la base de l’agriculture soutenue par la communauté –, l’engagement en faveur d’une alimentation biologique et locale passe notamment par l’organisation de repas familiaux, le recours à des bénévoles, l’élaboration de recettes pensées à partir de légumes de saison, ou encore diverses actions de solidarité en direction de quartiers défavorisés. In fine, la clé pour faire participer les gens réside très largement dans l’authenticité de la démarche. Dans l’idéal, tout le monde devrait pouvoir trouver une manière de contribuer au projet en fonction de ce qu’il ou elle aime vraiment faire. La question la plus utile n’est pas : « De quoi avons-nous besoin ? » mais bien plutôt : « De quoi disposons-nous ? Qu’est-ce qui est possible au regard de ce dont nous disposons ici et maintenant ? »
RITUALISER L’ÊTRE-ENSEMBLE
Un puissant moyen de renforcer les objectifs et les valeurs partagés est de ritualiser les moments où l’on se retrouve ensemble : se rencontrer régulièrement, partager, cuisiner ensemble, célébrer les succès du collectif et évaluer honnêtement ce qui a pu échouer. Tout cela est essentiel pour bâtir une culture des communs et une identité partagée. (Voir image 8 : Ritualiser l’être-ensemble, téléchargeable sur www.eclm.fr)
Les rituels de l’être-ensemble peuvent consister tout simplement dans la tenue de réunions régulières. Mais ils peuvent également revêtir des formes beaucoup plus complexes, à l’instar des pratiques hautement spécialisées que mettent en œuvre certains communs agro-écologiques. Une certaine dose de plaisir collectif et de jeu est parfois requise. Les nombreux paysans du Mexique, du Nouveau-Mexique et du Colorado qui prennent part aux acequias, des communs d’irrigation, ont appris au fil des siècles à ritualiser leur être-ensemble. Bien entendu, chacun se soucie de son propre quota d’eau, mais tous travaillent également ensemble pour maintenir en bon état les canaux d’irrigation et pour veiller au respect des limites écologiques dans l’utilisation de l’eau. De même, les hackers sont réputés pour leurs rituels créatifs, à l’image des hackahtons qui leur permettent de s’atteler collectivement à la résolution de problèmes de logiciels. Ils sont également connus pour leurs jargons compris seulement d’eux-mêmes. Les Quechuas qui gèrent le Parc de la pomme de terre au Pérou sont liés entre eux par un ensemble de valeurs spirituelles et de pratiques. Il en va de même des paysans indonésiens qui produisent le riz en subak : leurs pratiques religieuses les aident à se coordonner entre eux au sujet des périodes de semis et pour tout ce qui relève de l’irrigation des parcelles, le tout dans un souci de conservation des ressources en eau.
En général, les rituels fonctionnent d’autant mieux qu’ils sont intégrés à la vie quotidienne, autrement dit qu’ils ne sont pas traités comme des événements à part ou inhabituels. Au sein d’Enspiral, une guilde en réseau regroupant plusieurs centaines de participants, la vie du collectif est rythmée par l’organisation régulière de retraites auxquelles sont conviés les membres. Dans plusieurs pays tels que la Grèce, l’Italie, la France et la Finlande, la tenue de festivals régionaux offre une occasion de célébrer l’éthique et les accomplissements des communs. Quelle meilleure manière de ritualiser l’être-ensemble qu’une fête ou un festival, tout particulièrement lorsque les gens ne se connaissent pas ? Pour certains commoneurs, toute opportunité est bonne pour festoyer. Prenons l’exemple de Komglomerat, une initiative basée à Dresde, en Allemagne : dans les multiples ateliers ouverts animés par l’organisation, lorsque l’heure vient de ranger les salles, les machines ou encore les toilettes, les membres inscrivent à l’agenda collectif un temps de « Putzival ». En allemand, l’adjectif putzig signifie « mignon » tandis que le verbe putzen veut dire « nettoyer ». Les « Putzival » désignent ainsi un moment festif de ménage au cours duquel les participants s’attaquent ensemble et en musique à la poussière et à la saleté.
CONTRIBUER SANS CONTRAINTE
Contribuer sans contrainte signifie donner sans attendre de recevoir quoi que ce soit de valeur équivalente en retour, en tout cas pas ici et pas maintenant. Cela signifie également qu’une personne qui reçoit quelque chose ne se sent pas tenue de rendre directement ou immédiatement la réciproque. Lorsque nous contribuons sans contrainte, nous minimisons le besoin de fixer des contreparties, et les potentialités en termes de partage et de répartition s’en trouvent démultipliées. C’est dans cet esprit que les membres d’un jardin partagé retournent la terre au début du printemps ou que des individus soumettent un contenu éditorial à Wikipédia sans attendre un quelconque geste en retour, pas même d’être formellement crédités. Les motivations en la matière sont d’un autre ordre : gagner en compétence, rejoindre une communauté, obtenir du respect, acquérir une qualification professionnelle, ou tout simplement se sentir partie prenante de quelque chose. En contribuant librement, les gens peuvent aussi en retirer quelque chose qui leur fait particulièrement plaisir, comme les fleurs qui ornent un jardin partagé ou les légumes qui y poussent. On contribue sans contrainte lorsque l’on donne de l’argent dans le cadre d’une campagne de financement participatif, lorsque l’on offre bénévolement sa force de travail pour entretenir un chemin de randonnée ou encore lorsque l’on organise des événements de quartier. L’acte de donner constitue en somme sa propre récompense. (Voir image 9 : Contribuer sans contrainte, téléchargeable sur www.eclm.fr)
Il est important de ne pas faire d’assertions trop générales sur la manière de contribuer sans contrainte dans un commun : tout dépend des situations. La seule condition est que la contribution des gens doit se faire sans coercition. Il ne peut y avoir non plus de calcul de réciprocité au sens strict, quand bien même la tentation s’en fait souvent sentir. La plupart du temps, pourtant, une forme de rétribution finit d’une manière ou d’une autre par revenir à celui ou celle qui a contribué au départ. Dans son ouvrage classique The Gift [« Le don »], Lewis Hyde examine la signification spirituelle et émotionnelle de l’échange de présents tel qu’il se manifeste dans diverses cultures, l’anthropologie et la littérature.
Expliquant la différence entre le don « circulaire » et le don réciproque, Hyde écrit :
Lorsque je donne à quelqu’un dont je ne reçois rien (et que je reçois d’ailleurs), c’est comme si le don faisait un détour avant de revenir. Il faut que je donne aveuglément. Et la gratitude que je ressentirai sera en quelque sorte aveugle elle aussi […] Lorsque le don tourne en cercle, son mouvement échappe au contrôle de l’ego personnel, de sorte que chaque participant doit faire partie du groupe et que chaque donation est un acte de foi social4.
L’idée de contribuer sans contrainte ne signifie pas que l’acte de donner soit inconditionnel ou perpétuel. Elle ne signifie pas nécessairement que le don doive être circulaire. Mais si l’objectif est de contribuer à un commun résilient, les donneurs doivent s’assurer que leurs contributions sont volontaires et acceptées par chacun, autrement dit qu’elles ne résultent d’aucune forme de pression ou de sanction venues du dehors. Un commun ne peut survivre sans contribution donnée librement. La manière spécifique dont des gens contribuent à un commun – où ? quand ? comment ? en quelle quantité ? – dépend avant toute chose de ce qu’ils peuvent réellement donner. Et ce qu’ils peuvent donner est fonction de leur propre situation socio-économique, des règles coutumières qui sont les leurs, de leur degré d’engagement, de leur sentiment à l’égard du processus, de leur confiance dans les processus de prise de décision, ou encore de leur niveau de participation. Bien sûr, donner peut aussi tout simplement être une expression de joie et de bonne volonté, ou une manière de soutenir une cause.
Contribuer sans contrainte participe à la construction de communs sains. C’est en effet une manière d’affirmer et d’enraciner la norme éthique du partage, de la répartition et de la coopération entre les gens. Un suivi strict de qui donne et qui reçoit peut s’avérer utile dans certains cas, mais ce n’est pas toujours requis. Si tenir des comptes peut fonctionner au sein de larges groupes où les relations sont parfois quelque peu impersonnelles, une attention trop méticuleuse au calcul des contributions et des dettes de chacun expose au risque de miner ce qui fait la singularité d’un commun : être un espace où l’argent ne décide pas tout.
PRATIQUER UNE RÉCIPROCITÉ ACCOMMODANTE
Si les communs reposent sur la capacité des gens à contribuer sans contrainte, ils ne sont pas pour autant un pays de conte de fées peuplé de bienfaiteurs prêts à sacrifier tous leurs intérêts. Certains échanges sociaux supposent en effet bel et bien une forme de réciprocité entre les gens. Mais cette réciprocité dans un commun revêt un caractère très différent de celle à l’œuvre dans la relation marchande. Le fonctionnement des marchés repose sur l’action d’individus qui marchandent pour extraire le maximum pour
eux-mêmes dans le cadre d’échanges de valeur monétaire équivalente (prix). (Voir image 10 : Pratiquer une réciprocité accommodante, téléchargeable sur www.eclm.fr)
Ce qui compte est le sentiment de justice, ce qui n’implique pas nécessairement de donner à chacun une part absolument égale ou une valeur d’échange monétaire équivalente. La justice consiste à s’assurer que tous les besoins ont été pris en compte et satisfaits. Un commun robuste et bienveillant est donc un commun qui donne la possibilité à des égaux de procéder à des échanges globalement équilibrés (mais non absolument équivalents) au cours du temps. Choisir de ne pas calculer précisément qui doit quoi à qui relève de ce que nous appelons ici la « réciprocité accommodante ». C’est bien souvent une affaire de sagesse sociale et de tolérance. Pratiquer la réciprocité directe stricte en identifiant d’entrée de jeu des débiteurs et des créditeurs peut contribuer à entériner des distinctions sociales injustes et alimenter des sentiments de jalousie. Dans le même temps, permettre à des resquilleurs de s’exonérer de leur juste contribution à l’effort du groupe peut également susciter des ressentiments tout en diminuant la richesse partagée et la bonne volonté du collectif. Comme l’a écrit un jour Elinor Ostrom, « personne ne veut être le dindon de la farce, celui qui tient les promesses que tout le monde brise5 ». En somme, un commun doit s’assurer qu’il existe une certaine équivalence globale des contributions et des droits entre ses participants sans inciter pour autant à une réciprocité pure et parfaite et sans imposer de contribution de manière coercitive.
FAIRE CONFIANCE AUX SAVOIRS SITUÉS
Ceux qui savent faire du vélo, jouer du piano ou courir un marathon sont bien souvent incapables d’expliquer comment ils le font. Ils ne savent pas consciemment ce que pourtant ils savent. Et pour cause : une part importante du savoir dont nous disposons est un savoir tacite ou incorporé plutôt que conscient et cognitif. « Nous pouvons en savoir plus que nous ne pouvons dire », comme l’écrit Michael Polanyi dans son livre sur le sujet6. Nos corps savent souvent d’autres choses que notre esprit conscient. Nous sentons l’arrivée du printemps, nous percevons lorsque quelque chose cloche dans une situation sociale, et nous nous détendons lorsque nous retrouvons des rivières ou des lacs qui nous sont chers. On peut dire que la pratique des communs commence au plus près de ces savoirs et de ces perceptions incarnés et situés. (Voir image 11 : Faire confiance aux savoirs situés, téléchargeable sur www.eclm.fr)
Le politiste Frank Fischer a documenté la tendance des experts et des bureaucraties à « ignorer les savoirs locaux susceptibles de faire le lien entre faits techniques et valeurs sociales7 ». De nombreux mouvements et organisations s’efforcent aujourd’hui de changer cette situation en mettant en lumière la profonde sagesse des savoirs situés. Les permaculteurs insistent, par exemple, sur la nécessité d’« observer » et d’« interagir », ainsi que de promouvoir des « usages créatifs » et de « répondre au changement8 ». De même, les acteurs du mouvement des Villes en transition conçoivent leur contribution à la création d’un monde post-fossile comme une œuvre conjointe de l’« esprit, le cœur et la main ».
Rien ne remplace l’expérience incarnée pour ce qui est de comprendre, par-delà les théories cognitives et comportementalistes, la bonne manière de gouverner les gens et les ressources partagées. Elle renvoie à d’autres formes de savoirs – l’intuition, les sentiments, l’inconscient, l’expérience historique. Tout comme le corps humain donne naissance d’une manière ou d’une autre à la conscience, la rencontre entre un « je » et un « nous » crée une nouvelle sphère de conscience de groupe qui passe avant tout par l’expérience et non par le langage. L’anthropologue James Suzman raconte sa perplexité face à la signification du terme n!ow utilisé par les Bushmen Ju’hoansi d’Afrique du Sud. À première vue, le terme renvoie à une propriété fondamentale des personnes et du bétail qui se manifeste à travers le temps qu’il fait lors de la mise à mort d’un animal ou lorsqu’un individu naît ou décède. Après avoir échoué à saisir complètement cette idée du n!ow, Suzman a fini par conclure que certains savoirs expérientiels et incarnés ne pouvaient tout simplement pas être exprimés par le biais du langage, et encore moins traduits dans un autre langage : « Pour connaître le n!ow et le comprendre, il faut être soi-même le produit de cette terre, s’être forgé au rythme de ses saisons, et avoir fait l’expérience des liens qui se tissent entre les chasseurs et leur proie9. »
Nous sommes particulièrement sensibles aux changements qui surviennent dans le monde naturel ou dans nos relations sociales. Dans son livre Tending the Wild [« Cultiver la vie sauvage »], M. Kat Anderson montre que les tribus indigènes vivant dans ce qui constitue aujourd’hui la Californie ont développé une connaissance incroyablement fine de leurs écosystèmes locaux et de la vie de certaines espèces animales et végétales :
Plusieurs observations importantes se sont présentées à moi tandis que je marchais avec des Amérindiens et que je les accompagnais dans leur cueillette. La première d’entre elles est que l’on obtient le respect de la nature en faisant d’elle un usage judicieux. En utilisant une plante ou un animal, en interagissant avec eux à l’endroit même où ils vivent et en reliant son propre bien-être à leur existence, on peut forger avec eux une relation intime et commencer à les comprendre10.
Bien entendu, les savoirs situés ne sont aucunement l’apanage des peuples traditionnels. De telles formes de savoirs et de savoirfaire se retrouvent chez les alpinistes lorsqu’ils évaluent la robustesse d’une calotte glaciaire, chez les athlètes capables de dire dans quelle direction et à quelle vitesse un ballon se déplace, ou encore chez des politiciens lorsqu’ils s’attachent à estimer l’état de l’opinion publique. Le savoir situé est une notion particulièrement importante en matière de communs, où les individus prêtent une attention majeure à la richesse des rapports humains. C’est même ce qui rend tant de communs si vitaux et si robustes. Le savoir situé, en somme, n’est pas un simple « savoir ». C’est un produit de la pratique et de l’expérience – qui repose souvent sur une communion approfondie avec la nature et sur un travail affectif de soin et de préservation. La philosophe Donna Haraway s’est attaquée aux idées d’« objectivité » scientifique en décrivant notamment les savoirs situés comme une forme d’« empirisme féministe11 ».
En dépit de l’hégémonie écrasante du rationalisme scientifique, utilisé comme un instrument de pouvoir par les administrations publiques, il est encore possible aujourd’hui d’honorer les savoirs situés et de les appliquer. Ils restent présents en nous et tout autour de nous, même s’ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur.
APPROFONDIR SA COMMUNION AVEC LA NATURE
Le grand attrait de la plupart des communs réside dans la manière dont ils nous invitent – et souvent, de fait, nous obligent – à entrer en communion approfondie avec la nature. Dans le cas des communs ayant pour objet la richesse bio-naturelle, comme l’eau, les prairies, les forêts, les pêcheries ou encore le gibier sauvage [wild game], les gens se rendent rapidement compte de l’existence de certaines limites naturelles. En effet, s’impliquer dans des projets d’agroécologie, de permaculture, de gestion communautaire d’une forêt ou d’un système d’irrigation traditionnel rend chacun très attentif aux rythmes des systèmes naturels, ainsi qu’aux indicateurs les plus subtils qui permettent d’en évaluer l’état. (Voir image 12 : Approfondir sa communion avec la nature, téléchargeable sur www.eclm.fr)
Les commoneurs ne s’intéressent pas à la valeur d’échange ou à la financiarisation de ce que l’on appelle le « capital naturel ». Plus ils entrent en relation directe avec la nature, plus ils développent une relation intime de respect et de compréhension avec la Terre en tant que système vivant à la fois sacré et élégant. Les communs offrent ainsi aux gens le moyen d’approfondir leur relation à la nature. Quand M. Kat Anderson a demandé à des anciens parmi les indigènes de Californie pourquoi certaines plantes et espèces animales étaient en train de disparaître, ces derniers ont pointé du doigt l’« absence d’interaction humaine avec les plantes et les animaux ». Ils suggéraient, ce faisant, que nous avons besoin d’une relation active avec le monde naturel puisque « non seulement les plantes tirent profit de leur utilisation par les hommes, mais certaines d’entre elles pourraient même dépendre de cette utilisation. La conservation des espèces en danger et la restauration des éco- systèmes pourraient nécessiter la réintroduction prudente d’une certaine forme d’intervention des humains, plutôt qu’une forme de préservation impliquant le retrait de toute présence humaine12 ». La sagesse indigène suggère donc que les humains doivent interagir avec la nature en tant qu’utilisateurs consciencieux, protecteurs et gardiens. Cette idée fait aujourd’hui son chemin dans certaines politiques publiques. Au Guatemala, le gouvernement a longtemps essayé sans succès d’empêcher les propriétaires de ranchs, les agriculteurs, les déforesteurs illégaux et les trafiquants de drogue de détruire les terres dans la réserve de biosphère Maya. Se rendant compte qu’il ne parvenait pas à endiguer ces pratiques, il a pris conscience que « la manière la plus efficace de protéger les forêts [était] d’en conférer le contrôle aux communautés qui y viv[ai] ent d’ores et déjà13 ».
La même chose s’est produite au Népal, où la participation des communautés à la gestion des forêts a grandement contribué à améliorer la préservation des écosystèmes. Après la réintroduction du multipartisme au Népal en 1990, de nouvelles politiques publiques et de nouveaux mécanismes de financement ont été mis en place pour soutenir des groupes locaux autogérés. Au total, quelque 16 000 groupes d’utilisateurs des forêts communautaires gèrent aujourd’hui 1,2 million d’hectares de terres, soit près d’un quart de la zone forestière du pays14.
Il ne s’agit pas simplement de développer des politiques économiques ou gouvernementales plus « durables ». L’important est que les personnes aient l’opportunité d’approfondir leurs relations avec les systèmes naturels et, ce faisant, apprennent à les connaître, à les aimer et à les protéger. C’est à partir de telles graines qu’ont éclos les savoirs à la fois situés et structurés de la permaculture ou du design biomimétique15, ainsi que de nombreuses autres innovations écologiques. C’est l’« envoûtement du sensuel », pour reprendre les termes de David Abram, qui nous pousse à une compréhension toujours plus profonde de la nature et de nous-mêmes16. L’écophilosophe Andreas Weber soutient que nos connexions avec la nature sont si profondes et si existentielles que nos vies intérieures et nos sentiments portent l’empreinte du monde extérieur. Les organismes vivants font l’expérience d’eux-mêmes en tant que matière physique par le biais de leurs émotions, lesquelles s’inscrivent dans un tissu de relations biopoétiques entre les créatures vivantes. « Nous sommes faits de la même matière » que le monde dans son ensemble, écrit Weber, ce qui explique qu’une balade à travers champ ou l’arrivée du printemps puissent nous procurer un si grand plaisir17. Approfondir notre communion avec la nature est une étape indispensable dans l’optique de prendre soin du monde vivant foisonnant qui s’étend au-delà de l’humain.
ABORDER LES CONFLITS EN PRENANT SOIN DES RELATIONS
Toute démarche coopérative se heurte nécessairement à des difficultés, dont beaucoup découlent de comportements individuels ou de relations de pouvoir. La question n’est pas de savoir si mais comment ces conflits inévitables peuvent être gérés. Les ignorer n’est pas une solution. Dès lors, ce que nous entendons par « prendre soin des relations » dans la gestion des conflits trouve sa meilleure description dans les écrits d’Elinor Ostrom. (Voir image 13 : Aborder les conflits en prenant soin des relations, téléchargeable sur www.eclm.fr)
Comme toute institution, un commun requiert des règles et des normes qui s’appliquent à tous. Mais ce qui importe également est la manière dont on fait respecter ces règles et ces normes. Il faut reconnaître les conflits et les violations de manière honnête et transparente, dans un esprit de respect et en manifestant de l’attention envers toutes les personnes concernées. Dans beaucoup de situations, les gens n’ont pas la possibilité de s’en aller ailleurs. Préserver la qualité des relations au cœur de la gestion des conflits devient dès lors une réelle priorité. D’où le recours à des dispositifs de sanctions graduées, l’un des huit principes de fonctionnement des communs identifiés par Elinor Ostrom (voir annexe D). Il est important de reconnaître et de rectifier le dommage causé, mais aussi d’honorer la dignité des personnes impliquées et leurs relations avec les autres commoneurs. Constater les problèmes de complicité tacite de groupe ou d’autres enjeux systémiques est aussi un moyen de prendre soin des relations. Il ne s’agit certainement pas de préserver un consensus à coups de menaces et de punitions, mais bien plutôt de prévenir d’emblée le développement de relations conflictuelles. Lorsque des transgressions sont bel et bien constatées, il est important d’infliger les sanctions par ordre de sévérité croissante, dans une atmosphère de confiance, de franchise et d’honnêteté. Pour ce faire, une technique éprouvée consiste à s’asseoir en cercle pour discuter de la situation ou du comportement problématique. Nous avons assisté à des séances de délibération en cercle qui se sont révélées efficaces même avec plus de cent personnes. La clé est de donner à chacun le droit d’être entendu, de témoigner et de suggérer des changements tandis que l’on discute du problème et de ses implications en toute transparence.
Lorsque nous avons assisté à une grande réunion des membres de la fédération de coopératives vénézuélienne Cecosesola, nous sommes restés perplexes face à la manière dont les plaintes exprimées à l’encontre de certaines personnes étaient mêlées de déclarations d’affection, de telle sorte que les réunions se finissaient par une accolade aux « accusés ». Après ce qui avait tout l’air d’une discussion éprouvante, impliquant des émotions profondes et réveillant des conflits interpersonnels, ces marques de respect et ces accolades ostentatoires montraient bien qu’une critique honnête et profonde ne va pas sans une forme de respect et d’attention à l’autre. D’autres communs peuvent avoir recours à la médiation ou à d’autres formes de délibération collective. Ainsi, de nombreux communs logiciels se réservent la possibilité, en cas de conflit, de préserver ou non les relations qui lient leurs membres. La pratique consistant à « forker un code » s’inscrit dans cette perspective : elle a pour effet de séparer le projet en deux projets distincts. Un ou plusieurs participants décident de partir, mais tous continuent à travailler sur la même base de code, emportant le logiciel en cours de conception dans différentes directions créatives. À l’évidence, tous les conflits ne peuvent être résolus en conservant le collectif en l’état. À partir d’un certain point, « forker » un projet ou exclure une personne peut devenir la seule option envisageable. Ce qui demeure cependant est la nécessité de maintenir le moral collectif tout en se montrant résolument honnête. Le déni et l’aveuglement n’aident personne.
RÉFLÉCHIR À SA GOUVERNANCE
Il arrive fréquemment que les commoneurs ne soient pas entièrement conscients des pratiques qui sont les leurs. Les valeurs sousjacentes et les dynamiques sociales – des plus constructives aux plus problématiques – peuvent être perçues de manière très floue. Cela rend le commun d’autant plus vulnérable. En effet, même les personnes les plus impliquées oublient parfois comment le commun se perpétue face aux défis opérationnels qui ponctuent le quotidien, à la nécessité de faire de l’argent (et aux séductions qui l’accompagnent), aux attraits du pouvoir, aux évolutions de la gouvernance organisationnelle, etc. Dès lors, réfléchir à leur propre Gouvernance par les pairs est d’une importance vitale pour les commoneurs. C’est même la seule manière pour eux de préserver l’intégrité du commun face aux processus d’enclosure, aux tentatives de cooptation ou à l’entropie qui peuvent aisément vider les organisations de leur énergie.
Si nous incluons ce pattern, réfléchir à sa gouvernance, dans la partie consacrée à la vie sociale des communs et non dans celle consacrée à la Gouvernance par les pairs, c’est que nous y voyons une nécessité première et fondamentale. L’économiste et penseur des communs allemand Johannes Euler a souligné que, tout comme il n’y a pas de communs sans commoning, il n’y a pas de commoning sans Gouvernance par les pairs. Pour qu’un commun survive durant plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, il est essentiel que les pratiques de gouvernance soient explicites et discutées ouvertement. Une pratique des communs inconsciente d’elle-même court le risque de perdre son chemin au fil du temps. À moins que le groupe n’ait derrière lui plusieurs siècles de traditions, de culture et de rituels susceptibles de le stabiliser, les commoneurs doivent réfléchir consciemment aux processus qui font que le commun fonctionne ou qui peuvent l’améliorer. (Voir image 14 : Réfléchir à sa gouvernance, téléchargeable sur www.eclm.fr)
***
En dernière instance, la pratique des communs ne désigne pas un simple état avancé de la conscience et de l’être, à l’image de la pratique du zen ou de l’agir en pleine conscience. La pratique des communs désigne avant tout la mise en œuvre de la gouvernance et de l’approvisionnement par les pairs. Elle est la condition et le moyen pour que la gouvernance et l’approvisionnement par les pairs aient lieu. On pourrait ajouter que la pratique des communs constitue la forme culturelle d’une nouvelle sorte de politique. Dans son acception la plus ambitieuse, la pratique des communs invite à repenser les termes de la civilisation humaine moderne à l’heure où l’Homo economicus, comme représentation idéalisée des aspirations humaines, se révèle profondément antisocial, indifférent aux normes démocratiques et écologiquement irresponsable.
En ce sens, un aspect majeur de la vie sociale des communs est le renforcement de l’idée du Moi-imbriqué. Il ne s’agit pas d’un pattern en tant que tel, puisqu’il représente ce qui arrive plus généralement lorsque d’autres patterns sont mis en œuvre : nos intérêts individuels et collectifs convergent et s’alignent. Nous entrons en symbiose entre nous et avec notre environnement. Ainsi, les participants au réseau WikiHouse donnent corps au concept du Moi-imbriqué lorsqu’ils échangent et rendent partageables leurs innovations de design. Le recours à des standards ouverts et la modularité des processus encourage tout un chacun à contribuer sans contrainte à ce projet qui les dépasse individuellement, tout en tirant également une forme de bénéfice personnel. L’idée du Moi-imbriqué est également au cœur de l’utilisation des wikis fédérés, lesquels offrent aux individus l’autonomie requise pour créer un wiki personnalisé – ajusté à leurs goûts et à leurs idées – tout en inscrivant ce dernier au sein de fédérations plus larges (que l’on désigne sous le terme de « quartiers ») pour faciliter le partage de pages de wiki (voir p. 288-295).
La réalité du Moi-imbriqué peut être conçue comme le propre de l’espèce humaine, et ce, quand bien même l’économie dominante continue de croire en l’idée du moi-isolé comme agent souverain et rationnel. Ce que l’économie ignore ainsi est l’absurdité biophysique d’une telle prémisse. Les êtres vivants sont profondément et dynamiquement connectés les uns aux autres. Même l’obsession de la médecine moderne pour l’identification d’agents pathogènes uniques censés entretenir avec notre corps une relation de cause à effet est en train de céder la place à des approches plus complexes.
De plus en plus, les scientifiques remarquent combien les systèmes vivants individuels sont imbriqués dans des systèmes vivants plus larges, tout en étant eux-mêmes constitués d’éléments vivants plus petits. C’est un holisme qui se vérifie depuis la plus petite échelle jusqu’à la plus grande ! Le projet Microbiome humain a identifié environ 100 000 milliards de formes vivantes non humaines – bactéries, champignons, etc. – vivant dans notre corps, tout particulièrement dans notre appareil digestif, et représentant entre 1 et 2 kilos de notre poids total. Or il s’avère que ces organismes sont essentiels à notre santé et à notre bien-être en tant qu’« individus ». En ce sens, on peut dire que nos corps n’ont pas de frontières définitives : nous sommes immergés dans toutes sortes de relations symbiotiques, avec les aliments que nous ingérons, avec le paysage local, avec les bactéries autour de nous et en nous. En somme, la notion de Moiimbriqué a une dimension plus qu’humaine. En tant qu’humains, nous sommes littéralement indissociables d’un réseau plus large d’organismes et de systèmes vivants18.
C’est là ce que l’idée du Moi-imbriqué et de la Rationalité Ubuntu cherche à exprimer : l’action d’un individu ne sert pas seulement ses propres intérêts, elle est toujours partie prenante d’une symphonie plus large et plus complexe à travers laquelle des êtres vivants négocient et évoluent au sein d’une planète elle-même en mouvement. À ce titre, si l’envie de travailler avec d’autres commoneurs se présente souvent comme un choix délibéré, elle résulte également d’un instinct premier et fondamentalement non rationnel. Renforcer le Moi-imbriqué implique de déployer un espace pour l’expression des affects, le respect, le rire, le jeu, la passion et l’amour au cœur du travail routinier du collectif et au plus près de cet être-ensemble ritualisé que tout commun se doit d’honorer19.
Il convient également de noter qu’un commun peut tout à fait échouer à trouver le bon équilibre entre contrôle collectif et individualisme. Un groupe exerce parfois une pression démesurée, rendant l’atmosphère suffocante pour les participants ou certains types de participants. Le patriarcat est également un problème fréquent au sein de nombreux communs numériques ou de subsistance, en dépit du rôle fondamental des femmes en matière de pratique des communs. Un conformisme coercitif peut transformer un collectif en quasi-secte. Des leaders charismatiques réussissent à faire avancer les choses en consolidant leur pouvoir, mais au prix d’une culture interne plus faible et moins robuste. Nourrir le Moiimbriqué passe par la recherche d’un équilibre à la fois fin et respectueux entre les besoins des individus et les impératifs du groupe.
V. La Gouvernance Par Les Pairs Dans Les Communs
Comme nous l’avons vu au chapitre 4, la pratique des communs peut prendre racine dans une grande variété de perspectives et de comportements sociaux. Robert Ellickson, spécialiste des droits de propriété, a décrit comment les éleveurs de bétail de la vallée de Shasta, en Californie, ont résolu le problème posé par les bovins qui s’échappaient de leurs pâtures et empiétaient sur les terres des autres. Ils ont établi d’eux-mêmes des règles informelles et des normes sociales – ce qu’Ellickson appelle l’« ordre sans la loi1 ». Les éleveurs voisins, par exemple, ont souvent pour tradition de diviser par moitié les coûts de construction et d’entretien d’une clôture partagée. Ils peuvent aussi convenir qu’un éleveur fournira les matériaux, et l’autre la main-d’œuvre. Si un éleveur a proportionnellement davantage de bétail d’un côté de la clôture, la coutume veut qu’il y ait une certaine proportionnalité dans la répartition des coûts. Si un éleveur négligent enfreint la norme sociale consistant à récupérer rapidement le bétail errant, la communauté des éleveurs le fait délibérément savoir publiquement pour le sanctionner et lui faire honte en entachant sa réputation sociale.
La dynamique de la Gouvernance par les pairs au niveau cellulaire des pratiques du quotidien est cruciale, car elle assure la régularité et la stabilité d’un commun. L’étudier au cas par cas nous aide également à concevoir des structures plus vastes, telles que des communs fédérés, des lois et des politiques favorables aux communs, des infrastructures et des partenariats communs-public, comme nous le verrons dans les chapitres suivants. Ici, nous abordons dix dynamiques de Gouvernance par les pairs qui tendent à se retrouver dans tous les communs florissants. Les sept premières tournent autour des relations interpersonnelles et sociales. Les trois suivantes sont des méthodes fondées sur les communs pour gérer la propriété, l’argent et les marchés.
QUELQUES MOTS SUR LA GOUVERNANCE
Dans le langage courant, la gouvernance renvoie généralement à la domination d’un petit nombre sur un plus grand nombre par le biais du gouvernement. Le gouvernement exerce son autorité et son contrôle sur les gens au moyen de lois adoptées par des corps législatifs, de décisions rendues par les tribunaux et de politiques publiques conçues par des fonctionnaires et des élus. En fin de compte, la plupart des gens considèrent le gouvernement comme un objet distant, indifférent à leurs préoccupations. C’est quelque chose qu’un groupe de personnes dotées de pouvoir fait à et pour un autre groupe de personnes, parfois avec leur participation et leur consentement, parfois sans. Cependant, le gouvernement et la gouvernance sont en réalité des choses différentes. On pourrait dire que, dans les communs, il y a une gouvernance mais pas de gouvernement.
En réfléchissant à la manière dont un commun parvient à se coordonner, nous avons hésité à utiliser le terme « gouvernance », parce qu’il est trop étroitement associé à l’idée que les intérêts collectifs doivent l’emporter sur la liberté individuelle. Cet antagonisme apparent est si profondément ancré qu’il semble difficile d’imaginer une résolution effective de cette tension. Or il existe pourtant une solution : satisfaire les besoins individuels en répondant aux besoins collectifs. Le dualisme supposé entre le collectif et l’individuel peut être surmonté par le partage de l’autorité entre toutes les personnes directement concernées par les décisions. L’autorité, le pouvoir et la responsabilité de mettre en œuvre les règles et les décisions sont répartis entre des personnes identifiables, chacune d’entre elles ayant la possibilité de délibérer et de prendre ces décisions avec d’autres.
C’est pourquoi nous préférons parler de Gouvernance par les pairs plutôt que de gouvernance tout court. Ce terme désigne un processus continu de dialogue, de coordination et d’auto- organisation. Dès que l’on reconnaît les individus comme des pairs actifs dans un processus collectif plutôt que comme des adversaires en concurrence pour contrôler un objet distant et séparé, en l’occurrence le gouvernement, un autre mode de gouvernance plus digne de confiance peut émerger. Les citoyens d’un État-nation sont nominalement souverains (« nous, le peuple »), mais cette souveraineté est immédiatement déléguée à des législatures représentatives et à des bureaucraties rigides et formalistes, avec quelques mécanismes de contrôle très rudimentaires. Pas étonnant que l’État soit perçu comme étranger ou hostile ! Dans un commun, la gouvernance est davantage susceptible de tenir compte des besoins et des réalités du terrain.
La Gouvernance par les pairs repose sur une dialectique politique subtile entre culture et structure. Les motivations et les visions partagées que les commoneurs souhaitent mettre en œuvre doivent être suffisamment structurées d’un point de vue juridique, organisationnel et financier pour être protégées et cultivées. Mais il doit également y avoir suffisamment d’espace ouvert pour que la créativité, la délibération et l’action des individus puissent s’épanouir, ce qui, en retour, améliore de manière récursive les structures juridiques, organisationnelles et financières qui font avancer le commun. Pour qu’un commun soit cohérent et durable, il a besoin de formes organisationnelles claires et de régularités. Pour qu’il soit résilient et vivant, il doit offrir un espace accueillant pour le libre jeu, la flexibilité et la nouveauté créative. On pourrait dire que l’informel et la créativité doivent être stabilisés – mais non contrôlés – par un soutien structurel et des contraintes favorables. Les commoneurs doivent trouver le juste équilibre entre structuration et créativité2.
Trouver cette bonne articulation est le grand art de la gouvernance des communs. Pour le mettre en lumière, nous présentons dans ce chapitre les patterns génériques de la Gouvernance par les pairs qui contribuent au bon fonctionnement d’un commun. Comment se développe une forme d’auto-organisation et comment se transforme-t-elle en un organisme social stable et créatif ? Existe-t-il un processus général de développement indispensable à chaque commun ? Nous ne pensons pas que ce soit le cas, mais il y a des patterns dont nous pouvons prendre conscience et qui nous aideront à comprendre comment un commun peut se maintenir dans le temps. Ce serait une erreur de proposer des formules prescriptives de Gouvernance par les pairs, car elles ne fonctionneraient pas dans des systèmes complexes. Vous ne pouvez pas créer un commun simplement en rassemblant un certain nombre de personnes, en adoptant certaines valeurs et en appliquant certaines règles opérationnelles et certains mécanismes de contrôle. Suivre les huit principes de conception mis en avant par Elinor Ostrom est utile3, mais insuffisant en dernière instance. Ces principes ne permettent pas aux gens de répondre de manière flexible aux conséquences de leurs actions et de leurs décisions dans des systèmes dynamiques. Notre analyse de la Gouvernance par les pairs va donc au-delà des célèbres principes de conception d’Ostrom, et ce, de plusieurs manières. Premièrement, nous examinons toutes sortes de communs contemporains – sociaux, numériques et urbains, entre autres – et pas seulement les communs issus des ressources naturelles. Nous tentons également d’aller au-delà des questions de gestion et d’allocation des ressources, considérées d’un point de vue essentiellement économique, pour mettre l’accent sur les communs en tant que système social. Enfin, l’étude de la gouvernance des communs ne peut pas ignorer les menaces systémiques que constituent les marchés et le pouvoir de l’État. Nous considérons donc la Gouvernance par les pairs comme une forme de souveraineté morale et politique qui fonctionne en contrepoint du couple État/marché.
Faire vivre la Gouvernance par les pairs doit être un processus vivant et évolutif en lui-même. C’est pourquoi, plutôt qu’un ensemble complet de formules prescriptives, nos patterns consistent plutôt en lignes directrices et manières de faire offrant un cheminement progressif et adaptable pour développer un commun – un peu à la manière dont l’ADN fournit une direction générale, mais pas d’instructions strictes, en vue du développement autonome et de la différenciation d’un embryon.
La mauvaise nouvelle est donc qu’il n’y a pas de plan préétabli, pas de panacée. La Gouvernance par les pairs n’est pas un programme normatif s’appuyant sur des règles strictes pour fabriquer des communs ou gérer des ressources. Mais la bonne nouvelle est que la Gouvernance par les pairs est un processus génératif. C’est un moyen fiable par lequel les commoneurs peuvent construire des relations authentiques et vivantes entre eux et, ce faisant, constituer un commun cohérent et stable.
Cette démarche est cohérente avec les idées de Christopher Alexander sur la manière de créer des environnements épanouissants sur la durée. Alexander écrit qu’un processus qui génère de la vie doit lui-même être un processus vivant :
[C’est] la SEULE façon, je crois, de rendre possible de générer des bâtiments ou des communautés dotés de vie. Une structure vivante […] ne peut être créée par la force brute à partir de plans. Elle peut seulement provenir d’un programme génératif – et donc d’un processus génératif existant au sein du processus productif de la société – de sorte que […] sa conception, son plan, son design, sa disposition détaillée, sa conception structurelle et ses détails matériels se déploient tous, étape par étape, dans le TEMPS4 [majuscules dans le texte original].
Des structures formelles sont bien entendu nécessaires, mais les processus vivants, qui ont leurs propres régularités, sont le véritable cœur d’un commun. La pratique des communs est le processus exploratoire par lequel les gens identifient leurs besoins et conçoivent des systèmes d’approvisionnement et de gouvernance adaptés à leur situation. Les gens ont le pouvoir de s’appuyer sur leurs propres savoirs pour évaluer leurs problèmes. Ils doivent vivre avec des ambiguïtés et des incertitudes, et faire preuve de créativité pour élaborer des solutions qui leur semblent justes et efficaces.
La Gouvernance par les pairs est un processus ouvert. Ses caractéristiques et la manière dont elle sera mise en œuvre ne peuvent être entièrement connues ou spécifiées à l’avance. Cela va évidemment à l’encontre de la sensibilité moderne, qui s’efforce généralement de concevoir à l’avance des plans détaillés qu’il n’y a plus qu’à appliquer. Les objectifs premiers des systèmes modernes sont l’uniformité et la simplicité, dans un souci de contrôlabilité et de crédibilité politique. James Scott, dans son livre Seeing Like a State [« Voir comme un État »], offre une brillante analyse de la manière dont cela se traduit dans l’exercice du pouvoir d’État. Comme condition préalable à un contrôle efficace, les systèmes modernes recourent à des indices prédéfinis, à des indicateurs de développement et au savoir expert. Les catégories de pensée formelles et les politiques publiques tendent à mener leur vie propre en devenant plus réelles que les réalités du terrain.
L’Union européenne en fournit un exemple révélateur avec son exigence que les États membres [qui utilisent l’euro] maintiennent leur déficit budgétaire en dessous de 3 % du PIB sous prétexte que les gouvernements doivent gérer prudemment leurs finances publiques. Ce chiffre talisman posé en signe de bonne gestion a en réalité été inventé par deux fonctionnaires français en 19815. Le président François Mitterrand, qui cherchait un moyen de maîtriser les déficits budgétaires de son gouvernement, avait demandé au service du budget de concevoir une règle simple mais économiquement crédible pour contenir les dépenses publiques. Mitterrand aurait demandé à ses collaborateurs de trouver une « sorte de règle, quelque chose de simple [qui dégage] une apparence de compétence économique ». Deux d’entre eux ont eu l’idée de proposer comme mesure de la responsabilité fiscale un déficit budgétaire égal ou inférieur à 3 % du PIB. L’un des deux explique : « À l’époque, nous nous dirigions vers un déficit de 100 milliards de francs. Cela correspondait à environ 2,6 % du PIB. Nous nous sommes donc dit qu’un déficit de 1 % serait trop difficile et irréalisable. 2 % aurait mis trop de pression sur le gouvernement. Alors nous avons dit 3 %. »
En d’autres termes, le sacro-saint critère du déficit budgétaire a été fixé de manière purement circonstancielle, sans aucun fondement théorique ou matériel. L’ancien président de la Bundesbank Hans Tietmeyer a lui-même confirmé que le critère des 3 % n’était « pas facile à justifier… en termes économiques ». Cependant, après que la France a réussi à contenir ses déficits pendant quelques années, l’UE a décidé de l’adopter. Bien qu’il ne repose sur aucune base, le seuil de 3 % est devenu, au cours des trente dernières années, un symbole incontournable de l’orthodoxie budgétaire. Ce chiffre, inscrit dans le traité de Maastricht qui a créé l’Union européenne en 1992, est régulièrement cité par les politiciens et les économistes conservateurs. Mais seuls trois États membres ont effectivement respecté cette norme entre 1999 et 20156, ce qui montre à quel point les indicateurs officiels (en l’occurrence arbitraires) peuvent facilement prendre le pas sur les savoirs situés et la capacité de réaction des gens.
Les communs et la Gouvernance par les pairs doivent être cultivés et se développer au fil du temps face à d’innombrables incertitudes qui ne peuvent être entièrement prévues. Il faut du temps pour qu’une culture de confiance et de transparence émerge et produise un réseau de relations. Des rituels doivent être inventés, et les habitudes doivent mûrir pour devenir des traditions. Il est donc essentiel que les commoneurs décident consciemment comment construire leurs systèmes de gouvernance.
Ce processus n’est ni aléatoire ni prédéterminé. Il présente néanmoins certaines régularités. Il s’apparente à la méthode pour faire un feu en plein air : il n’existe pas de manière de faire unique et universellement correcte, mais certaines étapes de développement doivent être respectées, et ce, dans un certain ordre. Il faut d’abord rassembler des matériaux inflammables de différentes tailles – bûches, petit bois – et les disposer de manière que ceux qui s’enflamment le plus facilement soient en dessous, ce qui aidera les plus gros morceaux à s’embraser. Une étincelle doit être produite par une allumette, une flamme ou tout autre moyen. Il doit y avoir un lieu délimité pour contenir le feu (une cheminée, un cercle de pierres, un hibachi), ainsi qu’un débit d’oxygène et une ventilation suffisants. La manière concrète de faire un feu varie selon que l’on se trouve dans une forêt tempérée, où le bois est abondant, ou dans un désert, où les combustibles inflammables sont rares. Les résultats – feu de camp rugissant, feu de cuisson, braises à combustion lente – sont eux aussi très variables. Mais le fait est que, malgré les nombreuses façons de faire du feu et les différents feux qui en résultent, les principes de base restent les mêmes.
Il en va de même pour la mise en place de la Gouvernance par les pairs : il existe quelques patterns généraux sur lesquels s’appuyer, mais aussi de nombreuses manières idiosyncratiques de procéder. Les communs commencent généralement par des motivations ou des aspirations partagées par les participants – le besoin des agriculteurs d’irriguer leurs cultures, le désir des programmeurs de logiciels de disposer d’un programme de cartographie facile à utiliser et à partager, le besoin des pêcheurs de garantir un accès équitable à une pêcherie.
Quel que soit le problème spécifique abordé, le futur commun doit offrir une vision crédible pour le résoudre à des personnes qui ont souvent des perspectives différentes. Même s’il n’y a pas encore de stratégies ou de solutions concrètes, un commun, dans sa phase initiale, doit fournir une étincelle et un courant ascendant qui alimentent l’intérêt et la motivation. Si les gens sentent que le processus est en résonance avec leurs besoins et leurs circonstances, ils seront désireux de s’engager. Il faut néanmoins une force d’attraction qui les pousse à s’auto-organiser et à accorder leurs actions à leurs intentions7. Cela peut être la nécessité de survivre, le désir de renouer avec les écosystèmes locaux, la quête d’une alternative séduisante à une économie purement extractive, l’aspiration à une coopération équitable, ou tout autre facteur.
PATTERNS DE LA GOUVERNANCE PAR LES PAIRS
Au fil de nos pérégrinations analytiques à travers la riche diversité des communs, nous avons identifié dix patterns de la Gouvernance par les pairs. Ils ne contribuent pas seulement à établir des systèmes de délibération et de coordination plus dignes de confiance et plus transparents. Ils sont aussi la démonstration en acte de l’efficacité des communs en tant que système de gouvernance, notamment en comparaison avec le marché et l’État-nation. Lorsqu’un commun fonctionne bien, c’est généralement parce que les gens sont capables de diffuser l’autorité et la responsabilité et d’empêcher les concentrations abusives de pouvoir. La Gouvernance par les pairs encourage le partage ouvert et fréquent des savoirs afin que les meilleures idées et une forme de sagesse collective puissent émerger. Des systèmes définis de contrôle et de sanctions sont nécessaires pour protéger les communs contre les resquilleurs, les vandales et les enclosures.
Plus important encore, les commoneurs doivent trouver les moyens d’empêcher que les droits de propriété individuels et la quête d’argent ne viennent contaminer la dynamique de groupe. Il est donc nécessaire pour les commoneurs de développer des moyens de relationaliser la propriété – sujet que nous explorons au chapitre 8. Les relations avec les marchés et le capital soulèvent un ensemble de défis similaires pour la gouvernance. Aucun commun ne peut survivre s’il se laisse coloniser par les normes commerciales. C’est pourquoi la Gouvernance par les pairs s’efforce de distinguer entre communs et commerce.
Examinons maintenant chaque pattern de manière plus approfondie.
S’ASSEMBLER DANS LA DIVERSITÉ AUTOUR D’OBJECTIFS PARTAGÉS
Un commun n’est pas simplement un groupe de personnes partageant les mêmes idées qui se retrouvent les unes avec les autres comme par enchantement, ni une cohorte d’individus bien intentionnés prêts à être éduqués. C’est un système social qui ne peut se développer qu’au fil du temps, au travers de nombreux actes de construction de relations et de délibérations. Les gens arrivent presque toujours avec toutes sortes d’idées et de motivations, ne serait-ce qu’en raison de la diversité de leurs personnalités et de leurs parcours. Menée avec art, la Gouvernance par les pairs permet de rassembler des points de vue différents. Il est impossible de faire l’impasse sur ce processus car, sans lui, les gens risquent de s’engager sans réfléchir dans une perspective d’avenir abstraite et imaginaire qui ne reflète pas nécessairement leurs sentiments, leurs besoins et les possibilités réelles. (Voir image 15 : S’assembler dans la diversité autour d’objectifs partagés, téléchargeable sur www.eclm.fr)
C’est là l’idée maîtresse des organisations autochtones et non autochtones qui ont créé Unitierra – Universidad de la Tierra – dans l’État d’Oaxaca au Mexique. Il s’agit d’une « université désinstitutionnalisée » fondée par des commoneurs et pour des commoneurs, s’appuyant sur le refus des rôles formels et de la hiérarchie8. Les fondateurs d’Unitierra considèrent l’idée de buts et d’objectifs partagés comme inutile ; ce qui compte pour eux, c’est l’action partagée. Dans un véritable commun, dit Gustavo Esteva, père intellectuel et ancien d’Unitierra, les gens partagent souvent des raisons d’agir et d’agir ensemble, mais au départ, ils n’ont pas forcément de but partagé. Au sein d’Unitierra, on évite d’essayer de « tirer depuis le futur9 » en posant à l’avance une idée imaginée de l’endroit où l’on veut aller. On essaie plutôt de « pousser depuis la base et depuis le passé » en s’appuyant sur les expériences et les motivations de chacun.
À travers la pratique des communs, un objectif partagé finit par émerger. Il n’est pas nécessairement évident ou identifiable au préalable. Une communauté intentionnelle peut avoir un objectif et des valeurs partagés dès le départ, mais dans la plupart des cas, un groupe hétéroclite de personnes se retrouve et s’apprend mutuellement à marcher, à courir, puis à danser. Le processus est certainement plus facile si les gens vivent dans un espace commun ou dépendent de la même rivière ou de la même forêt. Le fait de partager les mêmes aspirations – augmenter le rendement des cultures, améliorer les échanges et la mutualisation au niveau local, faire en sorte que les informations puissent être partagées – peut également accélérer l’esprit de coopération et de solidarité. Dans tous les cas, dans un commun, l’objectif partagé n’est jamais un donné. Mais il doit, selon nous, être identifié et clarifié si l’on veut que des actions efficaces s’ensuivent.
Henry David Thoreau, l’essayiste et poète américain, a joliment décrit ce processus : « Si vous avez construit vos châteaux dans l’air, votre travail n’est pas nécessairement perdu ; c’est là qu’ils doivent être. Maintenant, posez les fondations en dessous. » Bien que cette phrase soit souvent prise pour l’expression d’un idéalisme fantasque, elle décrit en fait très bien la manière dont une vision est d’abord formulée, puis concrétisée à travers un travail difficile pour amener différentes personnes à un accord général. La tâche essentielle consiste à respecter l’individualité des différents membres tout en forgeant une éthique de la solidarité. Cela est fondamental car un commun, comme tout écosystème, a besoin d’une certaine variété pour bien fonctionner.
Sur les origines de la Gouvernance par les pairs
La Gouvernance par les pairs dans un commun peut se développer de plusieurs manières, mais trois grandes voies sont fréquemment empruntées : l’attraction spontanée, la tradition et la conception délibérée.
L’attraction spontanée. Comme nous l’avons raconté précédemment, un petit groupe d’amis du quartier de Kumpula à Helsinki s’est réuni pour discuter de la manière dont ils pourraient bien avoir un impact en matière de changement climatique. Comme s’ils étaient guidés par une muse collective, ils se sont lancés avec enthousiasme dans une « Bourse de crédit » pour échanger des services entre eux. L’idée est rapidement devenue populaire et, en 2014, quelque 3 000 personnes avaient rejoint le réseau, désormais appelé banque du temps d’Helsinki10. C’est peut-être la façon la plus courante dont un commun naît et se perpétue – quelqu’un identifie un problème et propose une solution constructive, pour ensuite constater que cette solution « parle » à de nombreuses personnes dans des circonstances similaires.
De nombreux projets qui ont acquis, depuis, un statut de légendes dans le domaine numérique ont été lancés par des créateurs iconoclastes qui, voulant faire quelque chose de différent, ont invité d’autres personnes à les rejoindre. En 1991, Linus Torvalds, un étudiant en informatique finlandais de 21 ans, a décidé de créer sa propre version partageable d’UNIX, un système d’exploitation complexe. En l’espace de quelques mois, des centaines de hackers – dont ceux qui soutenaient le projet de logiciel libre GNU lancé par Richard Stallman – se sont associés pour construire Linux. En quelques années, des milliers de programmeurs ont construit un système d’exploitation de classe mondiale qui rivalise désormais avec Windows de Microsoft et d’autres systèmes propriétaires. Une histoire similaire pourrait être racontée sur la façon dont Jimmy Wales a développé l’idée initiale de Wikipédia, laquelle a rapidement attiré des dizaines de milliers d’autres personnes qui ont rejoint ce projet mondial de rédaction d’une encyclopédie sur la base des contributions libres de tout un chacun, sans incitations monétaires. Il existe aujourd’hui 299 versions de Wikipédia, dans des langues allant de l’albanais au tarantino (un dialecte italien) en passant par le waray (la cinquième langue régionale la plus parlée des Philippines).
La tradition. Les objectifs et les valeurs partagés peuvent aussi s’établir au fil des décennies ou des siècles à travers les pratiques coutumières. Dans le Valais, en Suisse, les agriculteurs ont construit au xve siècle un réseau de canaux dans les montagnes pour amener l’eau d’irrigation à leurs champs11. Des systèmes d’irrigation similaires – connus sous les noms de waale, acequias, faladji, qanats, johad – existent dans le monde entier. Ils sont tous fondés sur des formes traditionnelles de coopération dans la gestion de l’eau, comme l’établissement de règles pour une allocation équitable de l’eau aux paysans. Sur l’île sud-coréenne de Jeju, une communauté de plongeuses âgées de 17 à plus de 70 ans pratique l’art traditionnel de récolter des coquillages jusqu’à 20 mètres de profondeur à l’aide d’un simple couteau ou d’un crochet en fer. Ces femmes, connues sous le nom de haenyeo, restent sous l’eau trois ou quatre minutes sans aucun appareil d’oxygène,en utilisant des techniques de respiration similaires à celles des baleines et des phoques. Les haenyeo ne se contentent pas de plonger ensemble (pour des raisons de sécurité), elles transmettent consciencieusement leurs connaissances traditionnelles aux jeunes générations pour préserver ce moyen de subsistance enraciné dans leur culture et respectueux de l’environnement12. La grande force des communs traditionnels est le recours à des pratiques culturelles qui respectent les caractéristiques singulières d’une forêt, d’une pêcherie, d’une rivière ou d’un pâturage.
La conception délibérée. Lorsque des étrangers s’assemblent pour collaborer, l’émergence d’un objectif et de valeurs partagés peut être facilitée par des systèmes délibérément conçus dans cette optique. Premier outil potentiellement fructueux : une charte sociale qui nomme explicitement les idées fondamentales et les pratiques de travail du groupe et, ce faisant, aide celui-ci à s’autoconstituer (pour en savoir plus sur les chartes, voir le chapitre 10). Les plateformes numériques peuvent aussi servir de support à la constitution d’un commun. Un pionnier notable dans ce domaine est Enspiral, un réseau d’entrepreneurs sociaux basé en Nouvelle-Zélande qui a développé Loomio, plateforme de délibération et de prise de décision. Loomio propose une série de choix par étapes grâce auxquels un groupe peut avancer de nouvelles idées, en débattre, ajouter des modifications et accepter ou rejeter les actions proposées. Enspiral a également développé CoBudget, un système logiciel collaboratif pour aider les gens à tenir un budget partagé et à allouer des fonds à des propositions soumises par les membres13.
Concevoir une plateforme technologique destinée à faciliter la gouvernance est une entreprise délicate. Les libertariens semblent penser qu’ils peuvent intégrer leurs valeurs et leurs normes dans la conception d’une plateforme technologique et éviter ainsi les multiples dissensions que les êtres humains créent inévitablement lorsqu’ils se gouvernent eux-mêmes. Par exemple, les concepteurs de certaines monnaies numériques comme le bitcoin croient à tort que la gouvernance est largement inutile et oppressive, et que l’authentification sécurisée d’une monnaie numérique suffit à faire s’épanouir la liberté sur le mode libertarien14. Les violentes querelles au sein des cercles bitcoins sur l’avenir du design de la blockchain prouvent le contraire. Dans la vie réelle, la gouvernance, les pratiques sociales et la culture jouent un rôle incompressible et permanent dans le fonctionnement de tout système, et ce, quelle que soit l’importance structurelle des conceptions logicielles.
CRÉER DES MEMBRANES SEMI-PERMÉABLES
Comme nous avons coutume de le répéter, les communs ont besoin de protection. Les chercheurs ont confirmé, sur la base de recherches de terrain approfondies, la nécessité de ce qu’ils appellent des limites. Le premier des célèbres principes de conception d’Ostrom pour des communs florissants est celui de « limites clairement définies », nécessaires pour délimiter les frontières du système de ressources et les membres du commun. Bien que nous soyons d’accord avec l’idée générale selon laquelle les limites sont essentielles à la gestion et à la protection des ressources, nous pensons que « membrane semi-perméable » serait un concept plus adéquat. Après tout, il ne s’agit pas d’établir un système hermétiquement clos dont tout le monde serait exclu et d’accaparer les ressources pour ses seuls membres – ce qui est le but de la propriété privée ou des « biens de club » (comme disent les économistes). Le but est d’exclure les influences qui sapent la Rationalité Ubuntu au sein d’un commun tout en restant ouvert aux flux d’énergie et de vie qui créent de la valeur dans ce commun et le rendent plus durable. (Voir image 16 :
Créer des membranes semi-perméables, téléchargeable sur www.eclm.fr)
Les commoneurs doivent donc apprendre à gérer un paradoxe : il faut se protéger contre les menaces capitalistes d’enclosure de la richesse commune tout en puisant de la nourriture dans la riche diversité de la vie. Pour réussir ce tour de force, ils doivent créer autour d’eux des membranes semi-perméables, comme le fait tout organisme vivant. Contrairement aux frontières strictes, les membranes semi-perméables autorisent sélectivement ce qui peut ou ne peut pas entrer dans un commun, tout comme nous choisissons notre alimentation et nos relations. Un commun doit rester ouvert à tous les nutriments extérieurs susceptibles de le renforcer.
C’est un élément central de la capacité des communs de générer un nouveau système de valeur qu’ils puissent protéger et faire grandir. Alors que le capitalisme est fondé sur l’accumulation et la centralisation des richesses, les communs s’appuient sur leurs membranes semi-perméables pour interagir en toute sécurité avec le reste du monde. Ils captent et stockent les flux d’énergie dans des « zones de captage », pour reprendre le langage de la permaculture. Joline Blais, spécialiste des médias et de la permaculture, écrit :
Le captage est un système permettant d’accumuler une masse critique d’une ressource nécessaire, comme l’eau, le sol ou les minéraux, afin de faire émerger des systèmes auto-organisés, c’est-à-dire des formes de vie, qui se répandent ensuite dans le paysage. Parmi les exemples naturels de captage, citons le soleil, les plantes, les féculents, les masses d’eau, l’énergie géothermique et la tectonique des plaques15.
La vie naît lorsque les flux d’énergie sont suffisants. C’est précisément ce que les communs tentent de faire : créer des zones de captage pour l’auto-organisation de la vie. Ainsi, plutôt que de concevoir les communs comme des systèmes fermés de propriété commune gérés par un « club », il est plus pertinent de les voir comme des organismes sociaux qui, grâce à leurs membranes semi-perméables, peuvent interagir avec des forces de vie plus vastes – communautés, écosystèmes, autres communs.
Cela n’est pas sans ressembler au fonctionnement de la barrière hémato-encéphalique qui sépare le sang circulant dans notre corps du liquide cérébral dans le système nerveux central, le cerveau. La barrière hémato-encéphalique permet le passage de l’eau, de certains gaz et de molécules liposolubles, ainsi que le transport sélectif de molécules telles que le glucose et les acides aminés, qui sont essentielles à la fonction neuronale. Mais – et ceci est essentiel – elle empêche le passage dans le cerveau de neurotoxines.
Tout commun a besoin d’une membrane aussi efficace pour permettre le passage des substances bénéfiques tout en éliminant les « neurotoxines » qui pourraient nuire à son bon fonctionnement. L’impact social de l’argent dans une communauté – qui en profite, à quelles fins il est utilisé, la distorsion des relations qu’il peut engendrer – est sans doute la principale source de perturbation pour un commun. (Voir Distinguer entre communs et commerce, p. 180.) Dans une société capitaliste, il est souvent impossible de simplement se soustraire au pouvoir de l’argent et aux relations commerciales. Une membrane semi-perméable peut aider un commun à empêcher les marchés de le coloniser et de le détruire. Elle aide les commoneurs à protéger efficacement leur richesse vivante (plutôt que leur richesse marchandisée).
PRATIQUER LA TRANSPARENCE
DANS UN ESPACE DE CONFIANCE
On pourrait dire qu’il y a deux sortes de transparence : la transparence formelle, que les démocraties libérales exigent pour faire en sorte que les dirigeants rendent des comptes, et la transparence réelle qui ne peut exister que lorsque les gens se connaissent et se font confiance. La véritable transparence ne se limite pas à la responsabilité de rendre des comptes fondée sur une autorité et des protocoles formels – celle qui consiste à « couvrir ses arrières » d’un point de vue bureaucratique. Il s’agit de divulgation personnelle et de partage des sentiments authentiques de chacun. Lorsqu’une décision difficile doit être prise en plein combat, par exemple, et si un général de haut rang donne un ordre que ses subordonnés considèrent comme problématique, à qui ces derniers doivent-ils obéir – à leur supérieur officiel dans la chaîne de commandement, ou bien à leurs proches collègues qu’ils connaissent et en qui ils ont confiance ? En politique et dans les bureaucraties, la transparence est souvent davantage un exercice imposé formel qu’un partage sincère de ses connaissances, car tout ce qui est divulgué pourra être et sera utilisé contre vous. La règle est donc celle de la divulgation minimale acceptable. (Voir image 17 : Pratiquer la transparence dans un espace de confiance, téléchargeable sur www.eclm.fr)
La transparence réelle a davantage de sens, précisément parce qu’elle va au-delà de la surface policée des rôles et des règles formels. C’est l’une des raisons pour lesquelles la pratique des communs n’est pas seulement un défi, mais aussi une transformation personnelle très profonde. Stefan Brunnhuber, éminent économiste et thérapeute clinique, affirme que les transformations culturelles ne peuvent pas être correctement conçues ou menées à bien par le seul biais des approches conventionnelles rationnelles et discursives. Brunnhuber note que « tenter de réduire la complexité par, disons, davantage de transparence [divulgation d’informations uniquement] ou la simplification des procédures ne servira pas à grand-chose ». Ce qu’il faut, c’est une « pratique psychosociale différente16 ».
C’est précisément ce qu’est le commoning. La pratique des communs nous permet de faire en sorte que la transparence ne soit pas seulement organisée, mais ressentie. Il ne suffit pas de s’appuyer sur des formes organisationnelles ou des obligations de divulgation pour aborder des questions qui touchent au cœur et à la culture. Comme le dit Brunnhuber, « nous devons faire face à la complexité de manière émotionnelle17 ». Cela vaut également pour la complexité de la pratique des communs où un dialogue permanent doit avoir lieu entre la structure organisationnelle et la culture. En dernière instance, nous ne pouvons pas compter sur les structures pour faire le travail de la culture. La transparence n’est pas seulement une question d’arrangements et de procédures formelles, mais aussi de pratiques sociales qui instaurent la confiance18.
Le réseau de coopératives Cecosesola au Venezuela pratique une culture de confiance si profonde que les gens sont prêts à exprimer ou à recevoir des critiques acerbes tout en faisant preuve d’un grand respect et d’une grande affection les uns envers les autres (voir p. 142). Ce type de transparence dans un espace de confiance est essentiel. C’est le seul moyen d’obtenir des informations fiables – possiblement embarrassantes – tout en maintenant des relations personnelles solides. Un commun a besoin de jugements honnêtes et de sagesse, pas seulement de professionnalisme formel.
Bien sûr, dans la plupart des groupes et des réseaux, des mauvais comportements et des cliques peuvent rendre difficile ou impossible d’instaurer une confiance sérieuse, sans parler d’être ouvert et transparent. De même, la petite taille d’un groupe n’est pas en soi une garantie de confiance ou de transparence. Mais en combinaison avec d’autres patterns de Gouvernance par les pairs – comme diffuser les savoirs généreusement et miser sur l’hétérarchie –, la pratique des communs peut s’épanouir de manière plus cohérente. Le commoning peut être une réussite sur le temps long.
DIFFUSER LES SAVOIRS GÉNÉREUSEMENT
Si l’on retrouve dans tous les communs une forme de partage des savoirs (ou de leur cousin objectivé, l’information), ce n’est pas seulement pour faire joli. C’est un outil crucial pour que les gens puissent générer un ordre social qui leur soit propre. C’est ainsi que les communautés en ligne, par exemple, développent des logiciels libres et ouverts. Christopher Kelty, historien de la culture de ce petit monde, estime que nous devons aller au-delà de l’affirmation basique selon laquelle « le partage est une condition naturelle de la vie humaine ». Pour lui, l’histoire est bien plus intéressante encore : « Le partage produit son propre genre d’ordre moral et technique, c’est-à-dire que “l’information fait que les gens veulent la liberté” et que la façon dont ils la veulent est liée à la façon dont cette information est créée et circule19. » (Voir image 18 : Diffuser les savoirs généreusement, téléchargeable sur www.eclm.fr)
Les projets pionniers visant à développer des corpus partagés de code – comme le système d’exploitation UNIX qui a fini par devenir Linux – ont montré à quel point le partage des savoirs est en lui-même génératif. À mesure que l’information est partagée, des systèmes sociaux complexes émergent progressivement. Kelty écrit : « Le fait que les geeks aient l’habitude de parler de la “philosophie UNIX” signifie qu’UNIX n’est pas seulement un système d’exploitation, mais une façon d’organiser les relations complexes de la vie et du travail par des moyens techniques20… » UNIX et Linux sont les artefacts d’une économie relationnelle générative.
Les circuits spécifiques de partage des savoirs définissent le caractère d’un commun. La diversité des contributeurs, leur savoir-faire et leurs modes de savoir, leurs critères de validation, les méthodes par lesquelles les gens absorbent et utilisent les savoirs explicites et tacites – tous ces éléments sont importants. Bien sûr, chaque commun s’y prend différemment. La forme la plus familière de partage des savoirs est certainement la réunion ou, dans les groupes plus importants, l’assemblée générale. Cecosesola a réinventé ses réunions pour en faire des rencontres peu structurées qui sont autant d’occasions de créer des liens sociaux et de partager des savoirs. Quelle que soit la manière dont les réunions sont structurées, l’objectif est de partager facilement et largement ses idées avec le groupe, afin que des choix collectifs judicieux puissent être identifiés et adoptés. Cela peut inclure des décisions sur la manière de limiter l’utilisation des ressources et de répartir les bénéfices.
Dans les cas où les gens ne peuvent pas tous se connaître (la taille d’un groupe est un élément important), de nombreux commoneurs rassemblent et partagent l’information par le biais d’un processus appelé « stigmergie », une sorte de partage situé d’informations qui fournit « à la fois le stimulus et les instructions en vue d’un travail ultérieur21 ». Les racines grecques du mot « stigmergie » signifient « inciter à travailler » ; c’est un concept clé utilisé par la science de la complexité pour décrire comment des règles simples dans des systèmes distribués peuvent produire une formidable intelligence collective. Pensez aux fourmis qui partent à la recherche de nourriture. Elles marquent leurs chemins avec des phéromones – c’està-dire qu’elles laissent une trace, un signal informationnel – afin que leurs congénères puissent suivre les chemins marqués aux phéromones pour trouver de la nourriture. La stigmergie permet de partager largement et rapidement des découvertes sans besoin de direction centralisée, en stimulant des réponses rapides et une auto-organisation distribuée. Les termites utilisent l’apprentissage et la coordination stigmergiques pour construire des nids complexes, sans concepteur ni superviseur. La coordination se produit horizontalement, de manière asynchrone et irrégulière, à mesure que les termites partagent des informations et adaptent immédiatement leurs comportements en conséquence.
La stigmergie est un moyen de diffuser des informations, des décisions et des responsabilités à un groupe large et diversifié de personnes, ce qui favorise la construction de sens, l’apprentissage et l’action, quand bien même tout le monde serait séparé géographiquement. Pour les contributeurs de Wikipédia, les fameux liens rouges que l’on trouve dans de nombreuses entrées de Wikipédia – ceux sur lesquels on clique pour découvrir qu’il n’y a encore rien d’écrit sur le sujet – signalent qu’il y a un besoin d’informations supplémentaires. Ils sont une invitation à les fournir. Ce simple signal encourage la coordination stigmergique à grande échelle, aboutissant à un corpus complexe d’écrits : le plurivers de Wikipédia.
Pensez à la coordination par les pairs des bénévoles de l’équipe humanitaire d’OpenStreetMap. Après une catastrophe naturelle, comme lors du tremblement de terre d’Haïti en 2014, ces bénévoles de la technologie se dépêchent de créer des cartes détaillées en ligne afin d’aider les premiers secours à localiser les sources d’eau, de nourriture et de soins médicaux22. Chaque pépite d’information offerte par une personne, ou son amélioration intelligente de la carte, est partagée avec les autres, ce qui déclenche une cascade d’améliorations successives. Des personnes aux talents variés, vivant dans différents endroits du monde, établissent bientôt une carte numérique qui est souvent plus précise et produite plus rapidement que les cartes réalisées par des équipes de professionnels.
Le défi pour la Gouvernance par les pairs est de faire en sorte que les informations et les savoirs puissent circuler largement et souvent – avec un minimum de résistance. Cela engendre des circuits sociaux de communication et de coordination qui, au fil du temps, favorisent l’émergence d’un ordre fondé sur les communs.
DÉCIDER PAR CONSENTEMENT
Il est essentiel que les commoneurs aient leur mot à dire dans l’élaboration des règles par lesquelles ils seront gouvernés. La manière dont les gens participent concrètement peut bien sûr varier énormément, mais les commoneurs doivent au minimum être en mesure de faire connaître leurs points de vue sur la Gouvernance par les pairs et de consentir aux décisions prises. Ce modèle s’apparente au troisième principe de conception d’Ostrom : « La plupart des individus affectés par les règles opérationnelles peuvent participer à la modification de ces règles23. » (Voir image 19 : Décider par consentement, téléchargeable sur www.eclm.fr)
En petits groupes, les pratiques habituelles pour prendre des décisions sont la discussion et la conversation en cercle. Cette approche est utilisée dans les panchayats, ou conseils de village, en Inde, qui sont chargés de gérer les forêts ou les terres agricoles communautaires. Certains communs peuvent être gouvernés en grande partie par des comités de direction ou des employés en charge de la coordination, et donc offrir une participation moins directe. C’est le cas, par exemple, des conseils d’administration de revues savantes en libre accès telles que la Public Library of Science, des gestionnaires des banques de temps, de certaines exploitations agricoles soutenues par la communauté (comme les AMAP en France) ou des fondations liées aux projets de logiciels libres. Pourtant, même les communs ayant une forme centralisée de gestion sont généralement conscients de la nécessité de consulter les personnes concernées par les décisions.
Le respect des traditions est une autre manière pour les commoneurs d’adhérer aux règles. Les pratiques coutumières équivalent à une sorte de « consentement général par défaut ». Cela ne prend peut-être pas toujours des formes très progressistes, mais cela permet d’intégrer les règles de la Gouvernance par les pairs au plus profond de la culture. Les paysans de Bali qui irriguent leurs champs, par exemple, ont pu surmonter de nombreuses difficultés, telles que les épidémies de parasites et les pénuries d’eau, grâce à l’observation de rituels religieux à des dates spécifiques. Dans le cadre des pratiques d’irrigation subak24 (subak signifie « communauté d’irrigation »), les paysans coordonnent leurs pratiques de culture en adhérant à des rituels précis. Ils plantent le riz à des moments différents pour éviter une trop grande demande en eau et donc des pénuries, mais ils récoltent le riz au même moment, ce qui minimise la prolifération des parasites. Cette synchronisation des pratiques sociales et religieuses avec le calendrier écologique opère comme une sorte de système collectif de consentement et de coordination25. Les prêtres des temples de l’eau supervisent la gestion de l’eau, interprétant la philosophie Tri Hita Karana qui traite des relations entre les personnes, la Terre et le divin. Ce qui, pour un esprit occidental, paraît du conservatisme religieux ou des traditions culturelles étranges est une solution magnifiquement coordonnée aux problèmes écologiques. Il est intéressant de noter qu’en l’occurrence les décisions ne sont pas vraiment « prises » – elles sont le résultat d’un processus coutumier.
Dans de nombreuses circonstances, cependant, un processus de prise de décision explicite est nécessaire. Et dans un tel contexte, ce qui compte autant que le processus, ce sont les critères par lesquels les décisions sont finalement justifiées. On présuppose généralement que le consensus est la voie idéale dans les communs, ou que tout le monde doit être d’accord sur tout. Mais ce type d’harmonie n’existe pas nécessairement. En fait, cette notion de consensus est quelque peu caricaturale. Le désaccord est une réalité de l’existence humaine. Et même lorsqu’un consensus peut être atteint, il n’est pas synonyme d’unanimité. Des petits groupes peuvent s’efforcer d’atteindre l’unanimité ou d’appliquer la règle de l’« unanimité moins un » ou de l’« unanimité moins deux » (c’est-à-dire décider d’agir malgré un ou deux désaccords). Mais il convient de noter que le besoin de procédures de prise de décision n’est pas limité aux petits groupes. Dans des communs de grande ampleur, il peut être compliqué de prendre des décisions sur des ressources indivisibles, particulièrement dans un contexte de division forte entre factions majoritaires et minoritaires. La méthodologie de la sociocratie (voir l’encadré p. 169-170) peut se révéler très utile pour faire émerger les objections et les préoccupations tacites, et pour élever la discussion à un niveau plus substantiel de manière cohérente et équitable.
Pour augmenter les chances de succès d’un commun, petit ou grand, il faut rejeter d’emblée tout schéma produisant des gagnants et des perdants – c’est le grand défaut structurel de la règle de la majorité, également connue sous le nom de « vote démocratique ». La règle de la majorité requiert généralement le soutien de plus de la moitié des personnes ayant le droit de vote. Si 49,99 % ne sont pas d’accord, tant pis ; 50,01 % suffit pour l’emporter. Il n’est guère étonnant que les démocraties représentatives, fondées sur ce postulat, aient du mal à surmonter leurs profondes divisions et à obtenir la coopération de la minorité qui a perdu. Ni que des idéologies se développent pour accentuer les différences entre partis plutôt que pour trouver des terrains d’entente. C’est une conséquence inéluctable du fait de s’appuyer sur un vote compétitif structuré selon une alternative binaire gagner/perdre. Les décisions à la majorité relative, où le bloc le plus important d’un groupe l’emporte même s’il n’atteint pas la majorité absolue, présentent le même défaut fondamental26.
Mais comment sortir du schéma des gagnants et des perdants ? Comment s’assurer que toutes les parties prenantes acceptent de suivre une certaine ligne de conduite sans se sentir contraintes ou manipulées ? Et, plus profondément, comment concevoir le processus décisionnel de telle sorte qu’il ne finisse pas par créer des frustrations, qu’il doit ensuite réprimer et qui s’expriment souvent à travers toutes sortes d’agressions secondaires ?
Comme il a été mentionné plus haut, il est crucial que tout processus de prise de décision encourage une discussion ouverte et contribue à faire ressortir les préoccupations profondes, souvent non exprimées, des gens. Ces processus peuvent être organisés de multiples manières, mais ils doivent impérativement permettre l’élaboration collaborative de propositions afin que les gens puissent affiner les idées et les résolutions d’action. Un certain nombre de modèles ont été développés en ce sens, comme le modèle quaker ou les célèbres signes de la main utilisés par les manifestants d’Occupy dans leurs délibérations collectives27. Maintenant que l’Internet est partout et que les logiciels sont devenus très sophistiqués, il est possible, pour la première fois dans l’histoire, que des personnes étrangères les unes aux autres participent à ce type de prise de décision collaborative à l’échelle mondiale. Les plateformes numériques offrent une grande polyvalence pour structurer l’interaction entre les personnes. Elles permettent de communiquer de manière asynchrone et d’utiliser des procédures échelonnées pour la modération, la délibération, le vote, etc. L’une des principales infrastructures conçues pour faciliter ce type de processus décisionnels est Loomio.
Les concepteurs de Loomio, au sein de la coopérative Enspiral basée en Nouvelle-Zélande, ont délibérément évité un schéma hiérarchique de prise de décision. Ils souhaitaient trouver un processus qui permette aux gens de délibérer et de se mettre d’accord à partir de décisions émergeant de la base. Cependant, comme les processus collectifs sont parfois étouffés par des factions plus bruyantes qui marginalisent les autres personnes et leurs perspectives, Loomio a été conçu pour donner aux participants de nombreuses occasions d’exprimer des opinions alternatives et dissidentes. Comme l’explique Richard Bartlett :
La valeur ajoutée de Loomio est que la délibération et la conclusion sont affichées côte à côte [sur l’écran de l’ordinateur]. Le désaccord est visualisé par le biais d’un graphique de type « camembert », de telle sorte que vous devez y prêter attention et tenir compte des préoccupations. C’est la différence avec les sondages et les mécanismes de vote : vous pouvez changer d’avis au fur et à mesure que vous discutez de la proposition. Cela devient donc presque comme un jeu : les participants doivent répondre aux préoccupations et les faire évoluer28.
Loomio ne permet pas à un groupe d’examiner plusieurs propositions à la fois, car l’idée est de forcer le groupe, à un moment donné d’une discussion, à accorder toute son attention à une seule proposition en suspens et à prendre une décision finale à son sujet. On pourrait considérer qu’il s’agit là d’une lacune de conception car, à un moment donné, la plateforme empêche l’examen simultané d’autres propositions. En revanche, la conception minimaliste mais adaptable de Loomio permet à un groupe de faire ses propres choix sur la manière de délibérer et de décider – y compris en appliquant la règle de la majorité au besoin – tout en documentant les arguments présentés par les uns et les autres.
Il est clair qu’il n’existe pas de méthode optimale de prise de décision. Ce qui est essentiel, c’est de choisir le bon processus, les bons critères et les bons outils (ou la bonne combinaison d’outils) pour chaque circonstance. Deux distinctions basiques sont importantes dans l’optique de décider par consentement. La première est la distinction entre consensus et consentement. La seconde est la distinction entre les critères communs et le vote.
Donner mon consentement à une proposition ne signifie pas nécessairement que celle-ci était mon premier choix. Il se peut que je souhaite simplement coopérer avec le groupe et ne pas lui faire obstacle. Il se peut que je n’aie pas de meilleure proposition ou que j’espère que les autres mettront entre parenthèses leurs préférences personnelles la prochaine fois, comme je l’ai fait cette fois-ci. Parfois, les commoneurs choisissent d’utiliser un standard de décision très flexible. Ils organisent le vote sur la base d’une question comme : « Est-ce que vous pouvez vivre avec cette proposition ? » Cette approche peut aider à obtenir un consentement total, ce qui, encore une fois, ne signifie pas que tout le monde est 100 % d’accord.
Le consentement – par opposition à l’accord – est défini par l’absence d’objections raisonnables. L’hypothèse est que les gens ont généralement de bonnes raisons de ne pas être d’accord avec quelque chose et qu’il faut qu’il y ait un lieu et un espace pour que ces raisons s’expriment. En d’autres termes, « le consentement recherche délibérément les objections, qui révèlent une sagesse pouvant être utilisée pour améliorer les propositions et les accords29 ». Le consentement est obtenu en choisissant la proposition qui suscite le moins d’objections. Le niveau le plus bas d’objection – la réticence – donne lieu à la plus grande acceptation.
La sociocratie et la décision par consentement
Certains détestent le principe de la Gouvernance par les pairs car les discussions peuvent être très difficiles et prendre beaucoup de temps. Parfois, un Monsieur-je-saistout domine les discussions, et d’autres points de vue importants ne sont pas entendus. La sociocratie s’attaque à ces problèmes en réunissant des cercles formels de personnes auxquels sont confiées des responsabilités spécifiques. Il s’agit d’un processus formel qui repose sur le consentement plutôt que sur la règle de la majorité. James Priest, cofondateur de la pratique de la sociocratie 3.0, écrit : « Le consensus consiste à chercher à trouver la meilleure décision pour le but recherché. La prise de décision par consentement consiste à trouver une décision suffisamment bonne qui peut ensuite être essayée, testée et améliorée au fil du temps30. » « Dans la sociocratie, le processus par défaut est le tour de parole, expliquent Jerry Koch-Gonzalez et Ted J. Rau de Sociocracy for All. Tout le monde a la possibilité de s’exprimer, un par un. Cela signifie que vous pouvez être sûr que vous aurez la parole. Personne ne peut être ignoré. À long terme, cela fait gagner du temps31 ! » Lorsque des objections sont soulevées, comme cela arrive inévitablement, chacun est invité à améliorer la proposition à travers des retours et des modifications.
La sociocratie a été largement utilisée dans des écoles, des groupes d’habitat participatif, des coopératives et dans de nombreux autres contextes à travers le monde. Mais elle ne concerne pas seulement des petits groupes interagissant en face à face. Les petites équipes qui utilisent la sociocratie peuvent être englobées dans un « cercle parent » plus vaste, lequel a des responsabilités de supervision et de prise de décision. Cela permet de s’assurer que le pouvoir est distribué autant que possible aux niveaux les plus bas possible (« subsidiarité »), tout en coordonnant le travail de l’ensemble. Pour ce faire, chaque cercle est « doublement lié », ce qui signifie que deux personnes sont membres à part entière à la fois de la petite équipe et du cercle parent. Cela permet à chaque équipe de se concentrer sur ce qui est important pour elle, tout en garantissant que les informations importantes sont partagées avec tout le monde et qu’il y sera donné suite. (Voir image 20 : Cercle de la sociocratie, téléchargeable sur www.eclm.fr)
La sociocratie est une méthode de gouvernance fondée sur les communs car elle repose sur l’hétérarchie (ou, comme l’appellent Rau et Koch-Gonzalez, la « hiérarchie circulaire »). Elle aide les groupes à atteindre une transparence et des opportunités de participation maximales, avec des résultats effectifs reposant sur la sagesse collective32. Malheureusement, certains groupes et consultants qui se sont dédiés aux méthodes sociocratiques ont choisi de présenter leurs systèmes comme propriétaires. Nous favorisons les approches plus en phase avec les communs, comme celle de Sociocracy for All, qui utilisent les licences Creative Commons.
Une autre méthode de recherche de décisions « suffisamment bonnes » est le consentement systémique, qui pourrait bien être considéré comme une des pierres angulaires de la Gouvernance par les pairs. Le consentement systémique a été créé en 2005 par le médecin et mathématicien autrichien Erich Visotschnig. Ce système invite les participants à évaluer plusieurs propositions sur une échelle de 0 à 10, 0 (aucune résistance) signifiant : « Je n’ai aucune objection, je soutiens fortement cette proposition », et 10 (résistance maximale) : « J’ai d’énormes objections. Je rejette catégoriquement cette proposition. » Les valeurs intermédiaires de 1 à 9 sont choisies en fonction du jugement subjectif de chaque individu. Une « option zéro » appropriée à chaque contexte est généralement incluse pour signifier : « Gardez tout en l’état » ou « Décidons la prochaine fois ». Cette option peut être considérée comme la « limite du raisonnable ». Aucune proposition ne peut être acceptée par le groupe si elle est classée en dessous de cette option zéro.
Quiconque a eu recours au principe du consentement systémique apprécie le fait que chaque proposition est non seulement prise en compte, mais reste dans le jeu jusqu’à la toute fin. N’importe qui peut exprimer des objections à n’importe quelle proposition tout au long du processus33. Des plateformes numériques telles que Systemic Konsensing (http://konsensieren.eu/en) permettent à un grand nombre de personnes dans le monde entier de se ranger à des propositions de manière systématique, sans passer trop de temps à en discuter en face à face et sans se sentir déconnectées d’un centre de décision – parce qu’un tel centre n’existe pas.
Outre la distinction entre consensus et consentement, une seconde distinction est utile pour guider la prise de décision dans les communs : celle qui concerne les critères communs et le vote. Les critères communs sont, par exemple, des normes générales d’éthique et de pratique sur lesquelles les gens peuvent s’entendre pour guider leur prise de décision. Ils constituent généralement une alternative séduisante au vote, parce que les gens préfèrent souvent utiliser leur temps pour agir plutôt que pour débattre et voter sur des propositions complexes.
Dans la fédération des coopératives de Cecosesola (voir p. 216218), il n’y a pas de système représentatif ni de vote pour prendre les décisions, mais des rencontres et des cercles ouverts qui permettent à chacun de faire entendre sa voix et de discuter des besoins quotidiens. Des centaines de décisions opérationnelles sont prises chaque jour, dont beaucoup exigent une grande clairvoyance, comme la manière de gérer les pénuries de médicaments à l’hôpital ou la décision de suspendre les procédures normales parce que les producteurs sont arrivés avec de grosses charges de légumes six heures plus tôt que prévu. Et pourtant, les participants ne votent jamais, car ils ne veulent pas se diviser en une majorité et une minorité. Leurs décisions sont guidées par les critères communs qu’ils ont élaborés pour toutes sortes de situations quotidiennes. « En définitive, la décision elle-même peut être prise par une, deux ou trois personnes. L’un des critères communs est que celui qui prend la décision est également responsable de la décision et de la communiquer34. » Noel Vale Valera explique : « Nous ne nous attendons jamais à prendre des décisions ensemble dans nos assemblées. Mais nous parlons beaucoup de la manière dont une décision pourra être prise et selon quels critères. » Sa collègue Lizeth précise : « Cela fonctionne depuis des décennies. Bien sûr, ce n’est pas facile. Après tout, nous sommes un groupe de 1 300 personnes. Mais nous ne sommes pas obligés de discuter de tout tous ensemble », ajoutant que les membres se font confiance les uns aux autres pour faire des choix appropriés reflétant le sentiment du groupe.
S’accorder sur des critères communs de prise de décision – au lieu de prendre chaque décision collectivement par le biais du vote – requiert et favorise une culture de confiance et de solidarité. Cette délégation par défaut, fondée sur la confiance, des prises de décision aux individus sur la base de critères communs est un moyen à la fois souple et fiable de garantir le consentement des citoyens tout en laissant aux individus la liberté de porter leurs propres jugements dans une situation donnée. Ce processus n’est pas entièrement rationnel, mais plutôt guidé par les jugements des gens et le sentiment intuitif que l’on peut faire confiance aux membres du groupe pour faire ce qui est juste dans la plupart des cas.
MISER SUR L’HÉTÉRARCHIE
Contrairement aux structures centralisées et hiérarchiques, les communs tendent à fonctionner comme des hétérarchies.
Une hiérarchie attribue aux gens des rôles formels clairement définis dans un organigramme pyramidal et divise les groupes en catégories et sous-catégories de plus en plus petites. C’est un ordre rigide, fondé sur l’interaction entre échelons35, où le pouvoir est consolidé et structuré dans un cadre formel. (Voir image 21 : Miser sur l’hétérarchie, téléchargeable sur www.eclm.fr)
L’hétérarchie est une conjonction de dynamiques hiérarchiques descendantes et ascendantes et de dynamiques de pair à pair. On peut la considérer comme une forme d’articulation entre réseaux distribués et hiérarchies36. Elle a le potentiel pour concilier l’autonomie et la responsabilité individuelles avec le besoin d’une gouvernance à plusieurs niveaux (d’où une certaine forme de hiérarchie). Une hétérarchie permet aux gens de choisir eux-mêmes la manière dont ils interagissent, ce qui rend le système plus souple et plus adaptable que les hiérarchies conventionnelles37. Elle tend à privilégier les relations horizontales non hiérarchisées de pouvoir et d’autorité entre les participants, ce qui permet de reconfigurer le rôle des agents individuels au sein du système de multiples façons. Bien qu’il y ait des éléments hiérarchiques dans une hétérarchie (les deux systèmes d’organisation ne sont pas des opposés binaires), une hétérarchie offre à un groupe la possibilité de se réunir et de se diviser de multiples façons. Une hiérarchie est une pyramide de relations de pouvoir prescrites de manière rigide ; une hétérarchie permet au pouvoir de circuler de manière dynamique à travers des nœuds multiples et changeants dans un réseau social.
Image 22 : Concept de l’hétérarchie

Comme nous l’avons vu à propos de Cecosesola, dans le cadre d’une culture de confiance et de responsabilité, les participants n’ont pas nécessairement besoin d’autorisation formelle préalable pour faire quelque chose. L’éthique du logiciel libre encourage cette même attitude dans de nombreux domaines : si vous repérez un bug, si vous avez une idée géniale, si un problème urgent nécessite une attention particulière, vous êtes toujours autorisé à agir. Il peut y avoir des révisions et des remises en cause ultérieures, voire des annulations de vos décisions. Mais l’expérience montre que l’initiative individuelle, lorsqu’elle est associée à un grand nombre d’actions du même type, est remarquablement fiable et efficace pour obtenir des résultats. Il n’est pas nécessaire de s’appuyer sur la représentation ou sur une délégation formelle pour s’attaquer à des tâches complexes et sophistiquées. La transparence dans une sphère de confiance, le partage des savoirs et les relations en réseau sont bien plus adaptés.
Les observateurs extérieurs considèrent généralement la gouvernance hétérarchique avec une certaine incrédulité. Lorsque les militants d’Occupy Wall Street ont organisé leur communauté dans le parc Zuccotti à Manhattan, le chroniqueur du New York Times Nicholas Kristof a écrit : « Les compétences Internet des manifestants sont éblouissantes, de même que leur capacité d’organisation. La place est divisée en une zone d’accueil, une zone média, une clinique médicale, une bibliothèque et une cafétéria. Le site web des manifestants comporte des liens permettant aux soutiens du monde entier de commander en ligne des pizzas (vegan de préférence) à une pizzeria du quartier qui les livre sur la place38. »
Il n’y avait pourtant aucun pouvoir exécutif central derrière cet ordre social improvisé. S’appuyant sur l’expérience de formes antérieures d’organisation par les pairs, cet ordre a émergé dans le feu de l’action, à mesure que les participants identifiaient ce qui devait être fait et coordonnaient leurs initiatives les uns avec les autres.
Nous connaissons tous le désir de collaborer au sein de projets partagés, de les porter à des niveaux supérieurs et de les rendre plus versatiles ; c’est sans doute là l’histoire même de l’espèce humaine. Nous savons aussi que les formes d’organisation spontanées, de pair à pair, ne durent pas toujours très longtemps. Le défi de notre époque – où le couple marché/État a réussi à capter et à contrôler tant de formes de coopération – est de concevoir de nouvelles structures capables de protéger l’impulsion coopérative et de l’étendre. Nous pensons que les motifs récurrents de la triade du commoning peuvent aider à concevoir et à mettre en place ces structures au sein d’un commun protégé. La Gouvernance par les pairs ne permet pas seulement d’accomplir des choses rapidement et efficacement : elle minimise les effets de caste, la bureaucratisation et l’inégalité. Il est plus facile d’atteindre une égalité approximative dans une hétérarchie car, comme le note l’article de Wikipédia à son propos, celle-ci autorise une « flexibilité des relations formelles à l’intérieur d’une organisation. Les liens de domination et de subordination peuvent être inversés et les privilèges peuvent être redistribués dans chaque situation ». L’article poursuit :
Les hétérarchies divisent et unissent les groupes de manière variable, en fonction de préoccupations multiples qui émergent ou disparaissent selon la perspective adoptée. Il est crucial de noter qu’aucune façon de diviser un système hétérarchique ne peut jamais être une vue totalisante ou globale du système ; chaque division est clairement partielle, et dans de nombreux cas, cette division partielle crée en nous, en tant que percepteurs, une envie de contradiction qui nous invite à concevoir une nouvelle façon de diviser les choses39.
Ce qui aurait paru totalement impraticable pour les organisations du xxe siècle est aujourd’hui – à l’ère de l’omniprésence des réseaux numériques et des émergences depuis la base – une forme de Gouvernance par les pairs parfaitement fonctionnelle.
CO-VEILLER AU RESPECT DES RÈGLES ET
APPLIQUER DES SANCTIONS GRADUELLES
Aucun commun ne pourra survivre bien longtemps s’il ne s’assure pas que ses membres adhèrent aux règles qu’ils ont acceptées. Si quelqu’un peut simplement « resquiller », autrement dit profiter du travail d’un commun sans y contribuer, ou bien se soustraire unilatéralement aux accords, la richesse partagée sera rapidement épuisée et la communauté se désintégrera. Les sanctions sont un moyen important de dissuader de tels comportements antisociaux et sont donc indispensables à tout système de Gouvernance par les pairs. (Voir image 23 : Co-veiller au respect des règles et appliquer des sanctions graduelles, téléchargeable sur www.eclm.fr)
Mais quelles devraient être ces sanctions, et comment devraientelles être appliquées ? Il existe une vaste littérature sur ce sujet, à la fois parmi les disciples universitaires d’Elinor Ostrom et dans le cadre de la sous-discipline économique qui se consacre à des questions comme le dilemme du prisonnier et la théorie des jeux. De multiples expériences et théories ont été avancées pour tenter d’expliquer comment et pourquoi les gens se soustraient à un accord et quelles sont les réponses susceptibles de favoriser une plus grande coopération.
Ostrom elle-même estime que les communs qui se maintiennent sur la durée tendent à introduire des sanctions graduelles. Le terme « graduel » signifie que les sanctions commencent par être légères – un avertissement, un appel à mieux faire – et deviennent ensuite plus sévères si nécessaire. Il y a besoin de sanctions pour persuader tout le monde de respecter les règles car, comme elle le souligne, « l’application effective des règles accroît la confiance des individus dans le fait qu’ils ne sont pas des pigeons40 ». Elle appelle cela, citant Margaret Levi, la « conformité quasi volontaire », en notant que la coopération dépend du fait que les gens constatent que les autres respectent eux aussi les règles. Tout comme, en matière de paiement des impôts, les gens sont prêts à faire quelque chose qu’ils préféreraient éviter, mais seulement si les autres se plient eux aussi à cette obligation. Dans la plupart des cas, une menace de coercition est essentielle pour obtenir la coopération. Mais cela fait une grande différence si cette menace de coercition vient de l’intérieur, sur la base du consentement des intéressés – comme dans un processus de Gouvernance par les pairs –, ou si elle est imposée de l’extérieur.
Ce qui est intéressant est que la simple existence de sanctions possibles est souvent déjà efficace en elle-même, quand bien même les sanctions effectives sont rares. S’il existe une grande solidarité au sein d’un commun, les conséquences sociales d’une violation des règles peuvent être sévères. Les infractions sont donc plutôt rares. Le fait qu’il y ait un contrôle n’est peut-être pas aussi important que le fait que la personne qui effectue ce contrôle soit un ami ou un voisin que vous ne souhaitez pas vous aliéner. Les sanctions jouent généralement un rôle mineur dans les communs car, comme Michael Cox et ses collègues l’ont noté à propos d’un système de gestion de l’eau au Zimbabwe, « les gens préfèrent passer plus de temps à négocier un consensus qu’à établir et imposer des sanctions41 ». Dans le Lake District en Angleterre, d’après James Rebanks, le fait qu’une personne trompe un autre berger ou vende un mouton à un prix exagéré est considéré comme une violation choquante du code d’honneur social. Les communautés d’irrigation zanjera des Philippines réduisent le fardeau de l’application des règles en présélectionnant les membres potentiels et en suspendant, voire en expulsant, toute personne prise en flagrant délit d’infraction42. Il semble donc que, dans les communs caractérisés par une forte cohésion sociale, les sanctions soient des outils importants, mais rarement utilisés. Pour les communs fondés sur des relations occasionnelles et informelles qui ne sont pas propices à une confiance totale – comme les communautés numériques –, les sanctions peuvent jouer un rôle plus important.
LA GOUVERNANCE PAR LES PAIRS ET LE MONDE DE L’ARGENT
Nous regroupons les trois prochains patterns de Gouvernance par les pairs car ils ont le même objet spécifique : protéger les communs des risques engendrés par l’argent, la propriété, la finance et les activités de marché, ainsi que par la rationalité calculatrice qui leur est associée. Ces modèles tentent de sauvegarder le Moiimbriqué, la Rationalité Ubuntu et les autres dimensions de la pratique des communs tout en rendant possibles les interactions nécessaires avec le monde de l’argent.
Relationaliser la propriété
En passant chaque jour la porte de leur maison, de nombreux Allemands se voient rappeler que leurs relations avec la propriété sont ambiguës. Les artisans du haut Moyen Âge inscrivaient en effet souvent un fragment de sagesse traditionnelle sur les façades des maisons : « Ceci est à moi mais n’est pas à moi. Ceci n’appartient pas non plus à celui qui l’a eu avant moi. Ce n’est ni à lui, ni à moi. Il est sorti, je suis entré. Et après moi, ce sera la même chose. » C’est l’énigme de la propriété : toutes sortes de choses peuvent être « possédées » en droit, mais ce qui compte vraiment, c’est leur détention effective et leur utilisation – et ces deux droits sont enracinés dans des relations sociales. (Voir image 24 : Relationaliser la propriété, téléchargeable sur www.eclm.fr)
L’objet du pattern « Relationaliser la propriété » est de reconnaître cette réalité. Il signifie que la richesse-soin d’un commun n’appartient pas de manière exclusive à une personne, ni même à un groupe bien délimité. Elle a des origines qui nous précèdent et elle nous survivra probablement. Or, de la même manière que l’Homo economicus est une caricature de ce que sont réellement les êtres humains, le droit de la propriété a été conçu pour légitimer uniquement certains types de relations humaines avec les ressources. L’objet de propriété est considéré comme une chose inerte et séparée avec laquelle nous pouvons faire ce que nous voulons.
Relationaliser la propriété, c’est inventer une nouvelle conception de la propriété qui tienne compte des relations sociales inextricablement mêlées à tout paysage, à toute œuvre créative, à tout bâtiment ou à tout lieu sacré. Comme l’a souligné à juste titre l’anthropologue du droit français Étienne Le Roy, ce qui compte vraiment, d’un point de vue juridique et politique, c’est l’interprétation du terme « appartenir ». À qui appartient un morceau de terre, un savoir ou la vie terrestre, et pourquoi ? Et comment le droit devraitil reconnaître et rendre opérationnelles ces relations ? Autant de questions que le droit de la propriété, tel qu’il existe actuellement, ignore. Ou du moins qu’il considère comme des choix que les individus doivent faire de manière unilatérale, généralement de manière égoïste43.
Pourtant, en pratique, les gens réussissent très bien à relationaliser la propriété – c’est au fond ce que les humains ont toujours fait et feront toujours. Ils nouent des relations partagées avec des parcs et des monuments publics, des œuvres d’art, des tombes et des lieux de culte. Ils ont des souvenirs et des expériences partagés avec certains édifices, plans d’eau, montagnes et forêts. Dans un commun, ces relations sont reconnues et respectées – en passant outre au faux dilemme entre droits individuels et intérêts collectifs. Car, comme le suggère notre examen antérieur du Moi-imbriqué, il est tout à fait possible de mélanger les deux pour former un nouveau paradigme, une sorte de « propriété Ubuntu ».
C’est ce que font les monastères depuis des siècles. Ils ont été créés pour être des environnements propices aux pratiques collectives, et pourtant, même dans ce cas, la plupart des ordres religieux ont veillé à ce que chaque individu dispose d’un espace privé suffisant. Les moines vivent dans de simples cellules ou logements personnels, mais ces derniers sont disposés autour d’un cloître ouvert à tous. Dans la célèbre chartreuse de Florence, dans le quartier de Galluzzo, en Italie, les habitations individuelles des moines comprennent même une cour et un petit couloir qui leur permet d’être seuls à l’extérieur lorsqu’il pleut. Dans ce cloître chartreux, les espaces individuels sont généreusement protégés et personne, à l’exception du moine qui y vit, n’y a accès. Les logements sont organisés de telle sorte que la porte de chaque cellule donne sur un grand couloir utilisé par tous. Ce n’est pas une coïncidence si les communs médiévaux, eux aussi, garantissaient aux individus leur espace privé, appelé « curtilage », dans le cadre même de la gestion collective des champs partagés44. Le curtilage a survécu dans la jurisprudence moderne pour désigner la zone autour de la maison d’une personne qui, selon les termes de la Cour suprême des ÉtatsUnis, abrite l’« activité intime associée au caractère sacré d’un foyer domestique et de la vie privée45 ».
Les pratiques foncières du Mouvement brésilien des travailleurs ruraux sans terre (Movimento Sem Terra, MST) illustrent ce mélange d’intérêts individuels et collectifs. Chacun est garant et gardien des terres occupées, qu’aucun individu ou groupe ne peut posséder de manière absolue. Dans les établissements du MST, les agriculteurs peuvent travailler leurs propres parcelles de terre et les utiliser comme ils le souhaitent, mais personne ne peut extraire sa parcelle de l’ensemble des terres occupées collectivement par le mouvement et la vendre individuellement. L’utilisation de la terre est indissociable de l’appartenance au mouvement. En d’autres termes, le destin des individus et celui du collectif sont inextricablement liés. Des centaines de milliers de familles brésiliennes46 vivent ou ont vécu dans les établissements d’occupation de terres du MST, qui a pour but de redistribuer les terres aux travailleurs ruraux pour une agriculture à petite échelle. L’approche et la pratique du MST s’inspirent de la doctrine sociale catholique, qui considère la dignité de l’être humain, le bien commun, la subsidiarité et la solidarité comme des principes fondamentaux. Il est intéressant de noter que l’on retrouve un fondement philosophique similaire dans la Grundgesetz – la Constitution de la République fédérale d’Allemagne –, où il est stipulé que la propriété privée n’est pas seulement destinée à satisfaire des intérêts individuels, mais doit également remplir une fonction sociale47. C’est pourquoi de nombreuses communautés autorisent les gens à utiliser la terre tant qu’ils la cultivent – une règle du type « utilisez-la ou perdez-la » qui accorde plus de valeur au besoin qu’à la propriété absolue.
L’essence de la Propriété relationalisée est la fusion des intérêts individuels et collectifs en un nouveau paradigme. Nous développons ce thème dans le chapitre 8 à travers l’examen de cinq exemples spécifiques d’« autres façons d’avoir ». Dans chacun de ces cas, la Propriété relationalisée aide les commoneurs à éviter les rôles sociaux de domination ou de dépendance que les droits de propriété conventionnels entraînent généralement. La coopérative alimentaire de Park Slope utilise le travail non rémunéré et démarchandisé comme un moyen de mettre en commun et partager les avantages qu’apporte un supermarché entre ses membres. L’Open Source Seed Initiative a inventé des moyens innovants pour que les agriculteurs puissent conserver, replanter et partager leurs semences, ainsi que créer de nouvelles variétés, en toute légalité. Une grande fédération de projets d’habitat collectif allemands, le Mietshäuser Syndikat, a retiré une grande quantité de logements du marché, en permettant aux résidents de gérer leurs habitations et en empêchant la vente ou la liquidation de leurs logements.
Tous ces projets d’avant-garde incarnent une co-possession et une co-utilisation existentielles qui s’opposent à la notion de domination absolue à laquelle la propriété est généralement associée. L’objectif de la Propriété relationalisée est d’entretenir et de nourrir délibérément nos relations les uns avec les autres, avec le monde non humain et avec les générations passées et futures.
Distinguer entre communs et commerce
Le lecteur se demande peut-être pourquoi les coopératives sont souvent citées comme des exemples de communs, alors qu’en pratique nombre d’entre elles semblent produire pour le marché et dépendre entièrement de celui-ci. Comment se fait-il qu’il existe des dizaines de milliers de coopératives rassemblant « plus d’un milliard de personnes dans le monde », selon l’Alliance coopérative internationale, avec un chiffre d’affaires de 2,2 billions de dollars pour les 300 plus grandes coopératives mondiales48 – et que pourtant le modèle économique dominant reste fermement en place ? La raison en est que beaucoup de coopératives n’ont pas trouvé les moyens de maintenir dans leur culture interne la distinction entre les communs et le commerce. Le droit n’aide pas non plus. Il encourage et privilégie presque toujours les activités fondées sur le marché par rapport aux options non marchandes et fondées sur les communs. (Voir image 25 : Distinguer entre communs et commerce, téléchargeable sur www.eclm.fr)
L’une des priorités de tout commun est donc de préserver son intégrité face à un ordre marchand souvent prédateur. Un commun doit faire tout ce qui est nécessaire pour se protéger des enclosures.
Les enclosures, une menace pour les communs
L’enclosure est le contraire de la pratique des communs en ce sens qu’elle sépare ce que les communs relient – les gens et la terre, vous et moi, les générations actuelles et futures, les infrastructures techniques et leur gouvernance, les aires de conservation et les personnes qui en ont été les garants et les gardiens pendant des générations. Le processus d’enclosure est généralement mené par des investisseurs et des entreprises, souvent en collusion avec l’État-nation, afin de transformer en marchandises les terres, l’eau, les forêts, les gènes, les œuvres créatives et bien d’autres choses jusqu’alors partagées. La motivation est généralement de monétiser tout ce qui peut être transformé en propriété privée et vendu.
L’enclosure est donc un acte drastique de dépossession et de destruction culturelle qui impose aux gens à la fois la dépendance envers les marchés et les cadres de pensée du marché. Ils doivent désormais acheter l’accès aux choses essentielles de la vie. Ils doivent se plier aux conditions et aux prix fixés par les investisseurs-propriétaires. Ils doivent obtenir la permission d’utiliser des ressources qu’ils protégeaient autrefois pour eux-mêmes.
Les communs sont également mis en péril par ceux qui ont du mal à imaginer des alternatives sociales au marché (« cooptation de l’intérieur »). Cela peut être, par exemple, des membres de coopératives d’habitat qui cherchent à revendre lorsque les prix du marché augmentent, ou des chercheurs en médecine qui tentent de breveter des médicaments mis au point grâce à la collaboration de communautés. Ce que les enclosures renversent ainsi, c’est toute une culture globale de vie sociale, de gouvernance et d’approvisionnement par les pairs – toute une façon d’agir, de connaître et d’être dans le monde. Elles introduisent une culture de rationalité calculatrice et de relations impersonnelles qui sape la pratique des communs.
Dans une société où l’on accorde tant d’importance à l’argent, la collision entre les communs et le commerce est impossible à éviter. Si l’on veut protéger la pratique des communs, il est indispensable de prendre des mesures proactives afin de maintenir le commerce à distance. C’est la leçon que l’on peut tirer de l’histoire des logiciels libres. Comme l’explique le développeur de logiciels libres et universitaire Benjamin Mako Hill, de nombreux développeurs voient « leur environnement de développement radicalement modifié, parfois pour le pire, par l’arrivée dans leur communauté d’une main-d’œuvre rémunérée49 ». Une fois que l’argent s’introduit dans un commun dédié au développement de logiciels libres, note-t-il, « il apporte un nouveau style de travail et un nouveau type de relations entre développeurs ». Les commoneurs perdent leur motivation à contribuer sans contrainte (voir p. 134135), pas nécessairement parce qu’ils n’en ont pas les moyens, mais parce qu’ils ont le sentiment d’être floués si d’autres sont payés. Dès que l’argent entre en ligne de compte, les gens tendent à réorienter leurs aspirations et à s’aligner sur les normes que les marchés considèrent comme importantes. Lentement et insidieusement, la force d’attraction de l’argent tend à saper l’intégrité des communs – ses relations sociales, ses valeurs indépendantes et ses objectifs à long terme.
Hill donne des preuves empiriques montrant que le travail rémunéré dans les initiatives à vocation sociale tend à décourager les bénévoles, qui considèrent leur travail comme moins indispensable et moins significatif, ce qui les incite à moins contribuer, voire à partir50. Une fois qu’il y a de l’argent, le problème se pose aussi de savoir comment le dépenser et qui prend ces décisions. Comme l’a souligné un jour Hill, « il est plus facile pour un projet de logiciel libre bénévole qui marche bien d’obtenir de l’argent que de décider comment le dépenser ». Bien sûr, ce n’est pas un obstacle insurmontable. Et de nombreux besoins ne peuvent être satisfaits que grâce aux marchés. Mais si l’achat de biens et de services ou le travail rémunéré se substituent à ce qui peut être réalisé par le biais du commoning, cela contribuera inévitablement à éroder les motivations intrinsèques des commoneurs.
Certes, les commoneurs ont généralement besoin d’argent eux aussi, au moins de manière modeste. À l’époque médiévale, les communs étaient un moyen de satisfaire les besoins quotidiens et de limiter le besoin d’argent liquide à des achats occasionnels. Les communs fournissaient ce que nous appellerions aujourd’hui un revenu de base, à savoir l’accès aux ressources minimales permettant d’assurer sa survie. Si les communs contemporains peuvent difficilement éviter l’utilisation de l’argent, ils peuvent (et doivent) s’efforcer d’atteindre une indépendance structurelle aussi large que possible. C’est un processus progressif qui requiert une capacité à démentir les scénarios établis et à poser les bonnes questions. Au lieu de se demander comment gagner plus d’argent, il faudrait plutôt se demander comment organiser sa vie de manière à devenir moins dépendant de l’argent et comment démarchandiser sa vie quotidienne. Ces mêmes questions devraient être posées au niveau d’un projet, d’une initiative, d’une infrastructure ou d’une plateforme.
Ceux qui ont l’habitude d’acheter des services agissent généralement comme des consommateurs, une éthique qui va à l’encontre de la pratique des communs. D’une certaine manière, chaque fois que quelque chose est conçu sous la forme d’un processus d’appel d’offres, ou requiert un ensemble de produits livrables, ou se présente comme une transaction d’achat et de vente, ou que l’on vous prévient que si vous ne participez pas, d’autres le feront, la rationalité calculatrice et l’argent cherchent à prendre la place de la Gouvernance par les pairs. Cependant, il n’y a pas que la promesse ou l’échange d’argent qui puisse supplanter la Gouvernance par les pairs. Le présupposé erroné que « c’est la seule façon de faire les choses » y suffit.
Et pourtant, il existe des moyens pour qu’un commun interagisse avec l’économie de marché tout en empêchant la logique de la réciprocité stricte (échange équivalent), du plus offrant et du moindre prix de prévaloir. Lorsqu’un conseil municipal français a proposé de payer EnCommuns, un réseau de programmeurs de bases de données fondées sur les communs, pour effectuer certains travaux, cela a soudainement introduit des pressions externes en termes de performance, au détriment des objectifs initiaux du projet et des rythmes de travail qui avaient été autodéterminés. Comme l’explique un participant, « un fossé s’est creusé entre ceux qui produisaient beaucoup et obtenaient l’argent et ceux qui [ne pouvaient] produire que de temps en temps et le faisaient sans être payés ». Il en est résulté un changement subtil, presque imperceptible, dans la dynamique interne du commoning. Au lieu de contribuer au projet pour des raisons intrinsèques (plaisir, réseautage, apprendre des autres, impact social), les gens se sont concentrés sur le « respect du contrat ». Bientôt, les priorités d’un contractant extérieur ont été considérées comme plus importantes que les désirs des autres commoneurs. La logique de la concurrence et de l’efficacité a pris le dessus, éclipsant l’objectif de coopération volontaire. « Au lieu d’aider les gens à changer les modèles de comportement engendrés par un système économique problématique, note le participant, cela a contribué à renforcer ces modèles. »
EnCommuns a réagi en créant une membrane semi-perméable, un moyen ingénieux de préserver l’esprit de sa pratique des communs même en interagissant avec des acteurs commerciaux. Tout d’abord, EnCommuns a exigé que toute entreprise à but lucratif paie pour le travail produit par le commun, afin de générer de l’argent pour soutenir les activités (non marchandes) de celui-ci. Mais plutôt que de traiter cela comme une transaction marchande classique – le paiement de services spécifiques –, EnCommuns a demandé à toute entreprise contractante qu’elle apporte une contribution financière au commun pour un travail que les commoneurs auraient effectué de toute façon. En d’autres termes, l’entreprise ne « paie pas pour un service ou un produit particuliers », mais en faisant un don. En outre, toutes les contributions ont été rendues publiques. L’objectif d’EnCommuns était de s’assurer de ne pas dépendre des revenus tirés de la vente de quelque chose, qu’il s’agisse du travail des gens ou de produits. Pourquoi ? Parce qu’un commun constitué sur cette base donnera rapidement la priorité au succès commercial plutôt qu’aux besoins des commoneurs, ce qui risque de porter atteinte à sa cohésion. En traitant les paiements comme des dons, EnCommuns dissocie les actes de don et les prélèvements sur le commun, et reste souverain quant à la manière dont l’argent est utilisé au sein de ce commun. EnCommuns explique : « Notre idée est d’aider les organisations commerciales à gagner en confiance à l’égard des approches fondées sur les communs tout en aidant ces communs à se financer lorsqu’ils sont utilisés à des fins commerciales51. » La même approche a été utilisée par la Fondation P2P pour sa licence de production par les pairs (p. 112) qui accorde à quiconque la liberté d’utiliser les œuvres des communs, à l’exception des utilisateurs commerciaux qui doivent payer.
Le Guerrilla Media Collective – un groupe transnational de traducteurs, de designers et de travailleurs des médias dédiés aux causes sociales – a développé un système de gouvernance qui articule pratique des communs et travail rémunéré. Leur « modèle économique et de gouvernance de coopérative ouverte axé sur les communs », version 2.0, permet aux gens de mener de front du travail pro bono et du travail rémunéré tout en exigeant explicitement que les gens prennent soin de la santé du collectif et des membres individuels52. La prise de décision et les responsabilités au sein du groupe sont fondées sur différents niveaux d’engagement – participation occasionnelle et non rémunérée ; processus formel de « rencontre » partiellement rémunéré ; adhésion formelle rémunérée avec des responsabilités spécifiques. Un système de crédit permet de suivre les projets pro bono menés par les participants et leurs missions rémunérées, de sorte que le travail de soin est explicitement visualisé et pris en compte en contrepoint du travail productif. L’objectif est que la pratique des communs reste la priorité essentielle.
Dans cette même optique de distinguer entre communs et commerce, les gardiens de nombreuses forêts communautaires autorisent la coupe d’arbres uniquement pour un usage personnel, et non pour la vente sur le marché. Les communs de pêche stipulent souvent la quantité de poissons qu’un pêcheur individuel peut vendre librement sur le marché. Les administrations universitaires tendent à servir d’intermédiaires entre les financeurs et les scientifiques de sorte que les chercheurs puissent avoir des débats ouverts et honnêtes et partager leurs résultats sans être influencés par des intérêts économiques.
Financer l’approvisionnement par les communs
Dans un monde où la finance capitaliste et l’argent sont omniprésents et où ils sont le moyen par défaut pour tout faire, la question se pose : comment financer l’approvisionnement des communs en évitant les influences néfastes de l’argent et de la dette ? Nous avons constaté que trois approches générales peuvent aider les gens à échapper à la dépendance envers la finance capitaliste tout en protégeant leur sécurité et leur liberté. Il s’agit descommuns demonétarisés, qui réduisent au minimum le besoin d’argent et le recours aux marchés, du financement collaboratif, qui permet aux commoneurs de créer et de faire circuler l’argent ou le crédit pour eux-mêmes, entièrement au sein de leurs communs, et enfin des nouveaux circuits de financement public-communs, où l’argent des contribuables collecté par le gouvernement est utilisé pour soutenir les communs. (Voir image 26 : Financer l’approvisionnement par les communs, téléchargeable sur www.eclm.fr)
Avant d’examiner ces trois approches plus en détail, il convient de faire quelques observations générales. Comme nous l’avons vu, l’épanouissement d’un commun dépend de sa capacité à empêcher l’argent de dominer sa dynamique sociale. Si la dette ou le capital compromettent l’indépendance des gens ou sèment la division, un commun a toutes les chances de s’effondrer. Il est donc utile que les commoneurs (et pas seulement eux) deviennent moins dépendants de l’argent et des marchés. Les approches par les pairs permettent aux commoneurs de faire recirculer la valeur qu’ils créent pour leur bénéfice mutuel, plutôt que de laisser les créanciers ou les détenteurs extérieurs de capitaux siphonner cette valeur sous forme d’intérêts ou de dividendes.
Chaque commun, a dit un jour le théoricien français Philippe Aigrain, doit formuler une réponse à la question fondamentale suivante : quel type de relations voulons-nous voir exister entre l’économie monétaire et nos communs ? La question peut être posée autrement : quel type de culture les communs veulent-ils développer pour eux-mêmes vis-à-vis de l’argent ? La réponse apportée à ces questions doit faire en sorte qu’au minimum le capital ou l’argent ne métastasent pas et ne transforment pas des activités coopératives en activités capitalistes. La quête de l’argent et du succès commercial, généralement considérée comme nécessaire au bien-être de la communauté, finit trop souvent par subordonner ce bien-être aux marchés et aux capitaux extérieurs. Il est donc impératif de distinguer entre communs et commerce (p. 180). Une autre façon de minimiser l’influence néfaste de l’argent est de pratiquer une réciprocité accommodante (p. 136) afin que la rationalité calculatrice des relations marchandes ne devienne pas la norme culturelle, évinçant la solidarité et la créativité générative des communs.
L’entrepreneur en technologie Frank Karlitschek l’a appris à ses dépens. En 2010, il a lancé une communauté d’hébergement de fichiers open source, ownCloud, pour concurrencer les plateformes Dropbox, Google Drive et Microsoft OneDrive. Ces plateformes permettent aux internautes de synchroniser l’utilisation de données et de documents entre divers appareils numériques et de stocker ces informations dans le nuage, sur des serveurs tiers. Cette architecture logicielle permet à plusieurs usagers d’accéder de manière fiable à un grand ensemble de fichiers et de les utiliser de manière autorisée et sécurisée.
Pour rendre possible le développement de la plateforme ownCloud, Karlitschek a obtenu en 2011 des millions de dollars de financement en capital-risque pour créer une société, ownCloud, Inc, dont il est devenu le directeur de la technologie. Mais en 2016, il a découvert à quel point l’argent extérieur pouvait influencer les stratégies et les pratiques d’une organisation. Quand bien même des centaines de développeurs contribuaient à ownCloud en tant que projet open source, les dirigeants de l’entreprise ne reconnaissaient pas de manière adéquate, selon Karlitschek, ces contributions de la communauté et n’associaient pas celle-ci aux délibérations internes de l’entreprise. Assez brusquement, il a décidé de démissionner, craignant que les investisseurs n’aient « jeté le projet sous le bus ». Voici ce que Karlitschek a écrit dans sa lettre de démission :
Sans en dire trop, certaines questions morales se posent à moi. Qui est propriétaire de la communauté ? Qui est propriétaire d’ownCloud lui-même ? Et qu’est-ce qui compte le plus, l’argent à court terme ou la responsabilité et la croissance à long terme ? ownCloud est-il une entreprise comme les autres ou ne sommes-nous pas également responsables vis-à-vis des centaines de bénévoles qui contribuent et font de l’entreprise ce qu’elle est aujourd’hui ? Ces questions m’ont amené à prendre des décisions très difficiles : j’ai décidé de quitter aujourd’hui ma propre entreprise53.
Quelques semaines plus tard, Karlitschek a annoncé qu’il allait forker le code et reconstituer la communauté des contributeurs dans le cadre d’un nouveau projet, appelé NextCloud. Celui-ci n’aurait pas d’investisseurs extérieurs et serait fondé sur les talents et l’engagement d’une grande communauté de développeurs bénévoles, dans une démarche open source plus authentique. En outre, NextCloud, avec sa structure modulaire, offrirait une variété de nouvelles fonctionnalités, telles qu’un carnet d’adresses, une galerie de photos, la lecture de musique et de vidéos, un gestionnaire de tâches, un lecteur de flux, un programme de courrier électronique, un traitement de texte, des mindmaps, des outils administratifs, etc. En l’espace de deux ans, le projet Nextcloud a réuni 1 800 développeurs non rémunérés et des millions d’utilisateurs dans le monde, dont de nombreuses grandes entreprises comme Siemens et ARD. Il continue à développer sa vision, sans les limites artificielles imposées par les investisseurs. Lors de la conférence Bits & Bäume (Bits & Arbres) qui s’est tenue à Berlin en 2018 – le tout premier rassemblement d’écologistes et de hackers du logiciel libre (le « mouvement de technologie critique ») –, Karlitschek a déclaré que son expérience avec ownCloud lui avait appris à se préoccuper de son indépendance en matière de financement de ses initiatives. C’est une leçon essentielle pour tous les commoneurs.
Pour minimiser l’influence pernicieuse de l’argent, les commoneurs disposent d’une gamme de stratégies que nous allons maintenant examiner. Quelle que soit la stratégie choisie, il ne faut pas que ce soit « la queue qui remue le chien », c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas laisser l’argent guider leurs aspirations et leurs pratiques.
Communs démonétarisés. La pratique des communs implique de se fier au partage, à la répartition et à la mutualisation pour satisfaire les besoins dans la mesure du possible, ainsi que de recourir à un financement collaboratif. Cela permet aux gens de minimiser leur dépendance à l’égard de l’argent et des marchés. Nous appelons cela « démonétariser les communs » – une éthique et une pratique sociale consistant à réduire autant que possible le besoin d’argent grâce au partage, à la co-utilisation, au DIT (do-it-together, « faites-le ensemble ») et à d’autres pratiques qui minimisent le rôle de l’échange marchand. Cela est crucial pour tous les communs. Les commoneurs peuvent renforcer leur indépendance à long terme en se retirant autant que possible de tout échange avec le système marché/État.
C’est grâce à la démonétarisation des communs que les hackers ont contribué à neutraliser les abus de Microsoft à travers ses monopoles sur Windows et Office au début des années 2000 (voir p. 156157 et 162-163). Ils ont développé GNU/Linux, Open Office et des dizaines d’autres programmes open source de haute qualité, proposant ainsi des alternatives commodes, peu coûteuses ou gratuites, aux programmes standards proposés par les géants du marché. Grâce à ces programmes partageables et produits par des pairs, les gens peuvent créer leurs propres communs numériques et échapper aux accords de licence draconiens et aux contraintes techniques abusives. Les utilisateurs sont assurés que leur code est compatible avec d’autres systèmes et qu’il est légalement modifiable. On ne peut pas les forcer à payer pour des mises à jour coûteuses et inutiles.
En dehors de l’espace numérique, il existe de nombreux systèmes éprouvés pour réduire les coûts individuels ou éliminer le besoin de recourir au marché. Les fiducies foncières communautaires, en démarchandisant les parcelles de terrain, peuvent réduire le coût du logement et des petites entreprises. L’habitat participatif et les projets de covoiturage et de partage d’outils entre pairs sont des formes de communs démonétarisés. La production cosmolocale (voir p. 111) élimine les coûts de la conception propriétaire (fondée sur les brevets, les marques déposées, etc.) et permet une production locale modulaire et moins coûteuse.
L’objectif des communs démonétarisés est d’aider les gens à se concentrer sur leurs besoins réels et à échapper au cycle sans fin d’aliénation généralement associé à la culture consumériste. L’économie capitaliste dépense une énergie et un argent fous pour essayer d’amener les individus à consommer, alors même qu’une grande partie de cette consommation est totalement inutile. David Fleming appelle les infrastructures de dépendance qui en résultent des « nécessités regrettables » – qui donnent naissance à toute une série de produits, comme les voitures et les smartphones, bientôt considérés comme des biens essentiels. Les commoneurs peuvent se libérer de bon nombre de ces « nécessités » en développant leurs propres systèmes, infrastructures, espaces et ressources mutualisés.
Le financement collaboratif consiste à mettre en commun l’argent d’individus, de la communauté locale et du grand public pour financer la richesse commune. Cette stratégie permet non seulement de renforcer les communs ici et maintenant, mais aussi d’apporter un soutien structurel à la pratique des communs à long terme. Historiquement, le financement collaboratif passait par des modèles tels que les sociétés mutualistes de crédit ou d’assurance, la finance coopérative, la microfinance communautaire et les monnaies locales. Récemment, le « crowdfunding », ou financement participatif, a permis un changement d’échelle de ces pratiques, tant pour de petits que pour de très grands projets. Goteo, une plateforme de financement participatif pour les communs qui a vu le jour en Espagne, est un acteur majeur de la finance collaborative. Depuis sa création en 2012 jusqu’en 2017, Goteo a levé plus de 7,3 millions d’euros, financé plus de 900 projets de communs à travers l’Europe et l’Amérique latine, et fourni une assistance en ligne à 2 500 projets supplémentaires54. Goteo se distingue des sites de financement participatif conventionnels en exigeant que les projets fassent réellement progresser les principes des communs.
À plus grande échelle encore, en 2016-2017, le mouvement Wikimedia a reçu 6,1 millions de dons sur un total de 91 millions de dollars américains, avec un don moyen de 14,79 dollars. Cette mise en commun de l’argent, répartie entre seize projets de wiki, permet que n’importe qui ait accès, hors de tout contexte commercial, à un dictionnaire en ligne, une base de données de citations, des collections de livres numériques et de matériel pédagogique, des bases de données d’espèces végétales et animales, des archives de photographies et d’images, et des guides de voyage. En retirant ces ressources du marché où les vendeurs essaient constamment de capter les données personnelles des gens et de leur imposer de la publicité, ces nombreux projets wiki permettent aux gens d’échapper à tout cela.
Terre de Liens, une organisation française, met en commun des fonds pour acheter des terres à de futurs « agriculteurs paysans ». L’objectif est de démarchandiser les terres à perpétuité, c’est-à-dire de les retirer du marché et de les garder en fiducie pour toujours, à la manière d’une fiducie foncière communautaire. Une partie des fonds, consacrée à l’« épargne solidaire », est utilisée exclusivement pour aider à acquérir de nouvelles terres agricoles. En Allemagne, le Mietshäuser Syndikat, une fédération de communs de logement, opère selon un modèle similaire. Il propose un financement collaboratif pour aider des groupes de résidents à acheter des projets d’habitat collectif, ce qui revient à les démarchandiser. Ensuite, pour perpétuer le processus de ce qu’il appelle les « transferts de solidarité », le Syndikat collecte un dixième d’euro par mètre carré de surface habitable auprès de chaque résident de ses plus de 160 projets d’habitat participatif (pour en savoir plus sur le Mietshäuser Syndikat, voir chapitre 8).
Artabana, une fédération de financement de systèmes communautaires de soins de santé comptant des milliers d’affiliés en Suisse, en Allemagne et en Autriche, poursuit une stratégie similaire. La fédération est organisée en petits groupes dont les membres se fournissent mutuellement une assurance sociale. Il n’y a aucune restriction quant au choix du médecin et des traitements, médicaments ou remèdes. Les groupes déterminent ensemble, dans un espace de confiance, le niveau d’assistance mutuelle et l’allocation des ressources du fonds de solidarité que chaque groupe abonde. En outre, une partie de l’argent mis en commun localement est transférée dans un fonds d’urgence géré par Artabana International. En général, un groupe peut couvrir les dépenses de santé de ses membres simplement en mettant en commun l’argent et en le répartissant. Toutefois, si un membre d’un groupe local doit faire face de manière inattendue à des dépenses médicales élevées – par exemple, en cas de maladie chronique ou d’opération compliquée –, le fonds d’urgence de la fédération peut apporter un soutien supplémentaire. Il fonctionne comme une sorte de réassurance au sein d’un système d’assurance citoyenne.
Lorsqu’une Australienne, que nous appellerons Jane, a appris qu’elle devait être opérée pour un grave problème cardiaque, elle a envisagé avec son mari d’utiliser leur prêt immobilier pour financer le coût prévu du traitement, 35 000 dollars australiens. Mais il s’est avéré que son groupe Artabana local avait contacté Artabana Allemagne et que le fonds d’urgence a pu payer l’opération. « Nous avons été émus et surpris que le fonds d’urgence d’Artabana Allemagne me soutienne sans me connaître […] En une semaine, l’argent était sur notre compte à Artabana Hobart. Au début, il a été difficile d’accepter ce geste de la part d’inconnus. Nous nous sentions comme gênés par une telle générosité. » Tous les projets d’Artabana fonctionnent comme des fonds fédérés de financement permettant de démultiplier la couverture de risques et de besoins futurs.
Un mouvement mondial très actif tente de minimiser l’influence pernicieuse de l’argent en inventant ses propres monnaies créées et contrôlées par les communautés et les citoyens. Ces initiatives prennent souvent la forme de monnaies locales destinées à répondre à des besoins spécifiques dans une zone géographique bien délimitée ou parmi des utilisateurs enregistrés. Le Bangla Pesa et le Lida Pesa, par exemple, sont des monnaies utilisées dans des quartiers très pauvres du Kenya, appartenant aux habitants et contrôlées par eux dans le cadre du système de crédit Sarafu. Ces monnaies permettent aux participants de capter et de faire recirculer la valeur créée au sein de la communauté tout en empêchant l’économie extérieure de la siphonner. Ces systèmes sont complémentaires de l’argent conventionnel (fiduciaire) et constituent la base d’une économie fondée sur les communs. Le chercheur Grzegorz Sobiecki estime qu’il existe plus de 6 000 monnaies alternatives dans le monde55.
Chacune de ces plateformes et fédérations – Goteo, Terre de Liens, Mietshäuser Syndikat, Artabana, monnaies locales – exige ce que l’on pourrait qualifier de rendement collectif. Goteo, par exemple, impose que les productions soient publiées sous Creative Commons ou d’autres licences libres. Cela garantit que les futurs créateurs pourront copier, partager et/ou modifier ces œuvres. Le principe de base est que quiconque prend dans le commun doit lui rendre quelque chose. En outre, tous ces acteurs ne cherchent pas uniquement à amasser des contributions financières, mais à faire circuler toujours plus largement les avantages qu’ils offrent, afin que d’autres puissent en profiter ou que de futurs communs puissent être créés.
Créer de nouveaux circuits financiers public-communs. L’État soutient le capitalisme de marché de multiples manières, par exemple à travers des subventions, des privilèges légaux et des monopoles officiels. Il n’y a aucune raison pour que l’État ne reconnaisse pas et ne soutienne pas également la valeur des communs par le biais d’investissements publics, de cofinancements et d’outils et systèmes financiers adaptés. Cela pourrait prendre de nombreuses formes.
L’approche la plus évidente serait que l’État apporte un soutien financier direct et substantiel aux projets s’appuyant sur les communs. L’État utilise déjà l’argent des contribuables pour toutes sortes d’objectifs d’importance nationale ; or la pratique des communs crée une immense valeur qui devrait être soutenue de la même manière. Malheureusement, le financement de l’État repose généralement sur des procédures bureaucratiques restrictives et des « délivrables » clairement établis, alors que tout commun requiert l’espace et le temps nécessaires à l’expérimentation et à l’évolution créative. Dans leurs relations avec les programmes d’État qui sont censés soutenir les communs, les commoneurs doivent se méfier du fardeau bureaucratique lié aux financements publics et du risque de dépendance envers ces financements. Un financement gouvernemental peut fausser l’intégrité d’un projet, ouvrir la porte à des influences politiques extérieures, et expose au risque qu’il soit brusquement mis fin à ce soutien lorsque le vent politique tourne.
Certains de ces problèmes liés au financement direct par l’État pourraient être évités en instituant des régimes obligatoires de mise en commun des ressources, sous une forme similaire à une redevance forfaitaire imposée par le gouvernement sur la musique enregistrée, les concerts et d’autres types de contenu créatif. Cette redevance reconnaîtrait le soutien indéniable apporté par les communautés créatives non marchandes au secteur du divertissement commercial en ce sens qu’elles aident les entreprises à identifier et à recruter de nouveaux talents commercialement prometteurs et maintiennent en vie diverses traditions musicales. Pourquoi les acteurs commerciaux ne devraient-ils pas rembourser indirectement la dette qu’ils ont envers ces communautés créatives collaboratives ? Un mécanisme de financement via un prélèvement forfaitaire obligatoire serait prévisible et facilement extensible, et permettrait de soutenir de nombreux groupes de créateurs56.
De la même manière que les agences gouvernementales aident les entreprises à travers des garanties de prêt ou des prêts directs, l’État pourrait créer des programmes de financement public pour l’habitat fondé sur les communs, les Fab Labs, la production cosmolocale, les télécommunications et autres activités. L’État pourrait exiger qu’un pourcentage des recettes fiscales provenant de la pêche ou de l’exploitation forestière soit versé dans des fonds communs et géré par des organisations multipartites agissant en tant que fiducies communautaires pour s’occuper du littoral, des forêts ou des réserves naturelles. La forme de financement public-communs la plus ambitieuse serait sans doute le revenu de base inconditionnel. À l’heure actuelle, cette idée est déclinée de multiples manières. La forme de revenu de base qui donnerait le plus de pouvoir aux commoneurs serait celle qui laisserait les communautés décider de l’utilisation et du partage de leur temps et de leurs talents.
VI. L’approvisionnement Par Les Communs
Il existe un dicton dans la Silicon Valley : « Mangez votre propre nourriture pour chiens. » Cela signifie que les employés de l’entreprise doivent vraiment utiliser les logiciels qu’ils produisent, dans des circonstances réelles1. Cela est considéré comme le meilleur moyen de s’assurer qu’une chose fonctionne vraiment comme il faut. Le choix d’une telle métaphore par l’industrie du logiciel pour décrire le test de ses propres produits en interne est très révélateur. Il met en évidence une faiblesse cachée de l’économie conventionnelle, à savoir la séparation de la production et de la consommation en deux activités distinctes, ainsi que l’ultraspécialisation de la production qui crée des silos professionnels séparés pour la conception, la documentation et la fabrication. Cette bureaucratisation signifie que chaque employé dépend du produit du travail des autres sans vraiment comprendre les complexités en jeu. Il est également plus facile pour n’importe quel service de rogner sur la qualité et la sécurité, sachant que les consommateurs n’auront pas d’autre choix que de faire avec.
Certaines entreprises se rendent compte qu’il est indispensable d’intégrer les leçons de la consommation réelle dans le processus de conception et de production. Le principal créateur du logiciel de composition TeX Typesetting, Donald E. Knuth, l’a avoué un jour :
J’en suis arrivé à la conclusion que le concepteur d’un nouveau système ne doit pas seulement être celui qui le met en œuvre et l’utilise à grande échelle ; il doit également être celui qui rédige le premier manuel d’utilisation. La séparation de n’importe laquelle de ces quatre composantes aurait considérablement nui à TeX. Si je n’avais pas participé pleinement à toutes ces activités, des centaines d’améliorations n’auraient certainement jamais été apportées, car je n’y aurais jamais pensé et je n’aurais jamais compris pourquoi elles étaient si importantes2.
Les utilisateurs possèdent des connaissances de première main qui sont inestimables pour la conception et la production, même si les économistes considèrent la séparation de la production et de la consommation comme une donnée immuable de la vie moderne.
Entraînés à considérer le démembrement de processus de production complexes comme quelque chose d’efficace et de naturel, et leur séparation d’avec la consommation comme une prémisse fondamentale de l’« économie », les économistes ont tendance à négliger une approche plus élégante et plus pragmatique de l’approvisionnement – la pratique des communs. Le commoning est en son cœur un acte d’auto-organisation sociale et d’apprentissage constant dont l’objectif central est d’aider les gens à satisfaire leurs besoins en produisant des choses ou des services ensemble. Nous utilisons ici le mot « approvisionnement » comme une version non marchande de « production ». La satisfaction des besoins est depuis longtemps la définition standard de l’objet même de l’économie. Les communs devraient donc être considérés à juste titre comme faisant eux aussi partie de l’« économie », même si les manuels d’économie les ignorent totalement. Les communs permettent aux gens de produire de la nourriture et des vêtements, des logements et des moyens de transport, des machines et des microscopes, des logiciels et du matériel informatique, des médicaments, des soins de santé et même des prothèses3. Il est stupéfiant de constater à quel point les gens réussissent à subvenir à leurs besoins en alignant leurs intérêts, leurs motivations et leurs actions sur un objectif commun. La pratique des communs offre un moyen de tirer parti de la confiance sociale au sein de nouvelles formes d’organisation pour coordonner les actions des gens.
À travers les communs, les gens peuvent combiner leurs besoins sociaux et économiques, ce qui permet de réunifier la production et la consommation. Cette réunification est particulièrement répandue dans le domaine numérique, où les utilisateurs et les producteurs sont souvent les mêmes personnes (« prosommateurs »). En termes économiques classiques, un commun permet de réduire les besoins en matière d’administration, d’avocats, de gestion des « ressources humaines » et de marketing en s’appuyant sur une communauté d’individus de confiance et engagés. Qui a besoin de publicité lorsque l’objectif est de répondre aux besoins et non de promouvoir la consommation ?
Alors, pourquoi mettre les intérêts et les besoins des producteurs dans une boîte et ceux des consommateurs dans une autre boîte en supposant aveuglément que le marché réussira d’une manière ou d’une autre à les concilier ? Pourquoi ne pas réimaginer l’ensemble comme une entreprise où la production et la consommation sont intégrées dans un processus organique de planification, de conception, de documentation et d’approvisionnement, ainsi que d’utilisation, de réutilisation et de gestion des déchets ? La production ne consiste pas nécessairement en une série de marchés complexes imbriqués entre eux pour le travail, l’approvisionnement en matières premières, la fabrication, la distribution, la vente au détail, la publicité, etc. Elle peut se faire par le biais des communs, qui laissent les gens décider de fabriquer et d’utiliser conjointement ce dont ils ont réellement besoin, souvent avec une division du travail, mais sans que cette répartition des rôles soit organisée en hiérarchies. La différence la plus significative avec la bureaucratie d’entreprise est que le produit est mis à la disposition de chacun et que les bénéfices sont conservés et partagés avec tous. Des compétences, des talents et des connaissances différents peuvent tous être accordés entre eux pour contribuer à la production. Les connaissances peuvent être facilement partagées, les conceptions peuvent se concentrer sur la qualité, et les méthodes d’approvisionnement peuvent être ajustées pour améliorer les résultats – tout cela sans devoir répondre aux exigences de rendement trimestriel des investisseurs. Les tâches peuvent aussi faire l’objet d’une rotation afin que les gens n’aient pas à organiser leur travail en fonction de rôles restreints définis par une valeur artificiellement objectivée (prix, salaires) et des catégories d’emploi fixes. Une fois évacués les impératifs du marché, une plus grande flexibilité et une plus grande adaptabilité sont possibles.
En plus de réunifier la production et la consommation, ainsi que de rassembler les étapes fragmentées de la production, les communs peuvent aussi réincorporer le soin dans notre conceptualisation de l’économie. Avec l’essor du capitalisme, les soins, l’éducation des enfants et l’enseignement ont été considérés comme des activités extérieures au fonctionnement de l’économie. À l’exception de l’éducation publique, il s’agit d’activités dont les individus doivent s’occuper pendant leur temps libre et à leurs propres frais. Un commun n’externalise pas le travail de soin, il est donc plus à même de prendre en compte la vie complète d’une personne, et pas seulement son besoin de gagner de l’argent.
Dans ce chapitre, nous décrivons le caractère de la « production en commun » ou, plus précisément, de l’« approvisionnement par les communs » à travers dix patterns. Ils sont les régularités structurelles qui semblent requises pour l’approvisionnement par les communs. Ces motifs s’incarnent chaque fois de manière distincte, tout comme une fleur poussera différemment à l’ombre de la forêt, en plein soleil ou sur les berges humides d’une rivière. Quelles que soient les circonstances, l’approvisionnement reste une nécessité pratique qui vise à ce que « ce qui doit être fait soit fait ».
La différence essentielle entre la pratique des communs et l’économie centrée sur le capital est que cette dernière ne valorise presque exclusivement les résultats du travail que sous forme de produits commercialisables. Ce sont des artefacts fongibles dont la valeur n’est perçue qu’à travers leur prix. Tout comme les communs brouillent (ou même éliminent !) la frontière entre « producteurs » et « consommateurs », ils transforment également le caractère des « produits ». Les choses produites ne sont pas conçues pour être vendues, ni pour être vendues en grande quantité au prix le plus élevé, ni pour satisfaire nos fantasmes de consommation et ensuite se désagréger par obsolescence programmée afin que le cycle puisse être répété.
« Approvisionner » par les communs signifie produire des choses utiles et durables qui continueront d’avoir une importance sociale sur la durée pour leurs fabricants et leurs utilisateurs. Ainsi, les résultats finaux ne sont pas des « biens » ou des « marchandises », comme les appellerait un économiste classique. Les commoneurs cultivent plutôt des liens affectifs avec leur richesse-soin : forêts, terres agricoles, eau, espaces urbains, lesquels deviennent souvent des éléments à part entière de leur culture, de leur vie sociale et de leur identité. L’objectif de l’approvisionnement par les communs n’est pas l’efficacité maximale, le profit ou l’augmentation du PIB. Il vise simplement à répondre aux besoins et à offrir un mode de vie stable, équitable, satisfaisant et respectueux de l’environnement. L’approvisionnement n’est pas régi par l’impératif de croissance économique ; il l’est tout au plus par une aspiration à faire reculer, voire à remplacer, les pratiques onéreuses et d’exploitation qui sont celles des marchés.
La plupart des préoccupations obsessionnelles de l’économie dominante – croissance, part de marché, concurrence, droits d’auteur, brevets, publicité, image de marque, ouverture de nouveaux marchés – ne jouent pratiquement aucun rôle dans les communs. L’économie des communs invite les gens à réorienter leurs perspectives, elle est guidée par des aspirations différentes de celles du marché capitaliste – la satisfaction des besoins réels plutôt que des besoins artificiels, la sécurité, un sentiment d’appartenance et de connexion, une vie qui a du sens. De nombreux communs ont également pour objectif implicite de faire progresser la liberté, l’équité et la durabilité pour tous.
Le plus grand changement qu’apporte l’économie des communs est le passage d’une économie opérant comme une supermachine autonome et mondialisée à une économie qui nourrit la vie, selon ses propres termes, à des échelles appropriées. L’approvisionnement par les communs tisse une tapisserie de relations, confirmant la sagesse de l’écophilosophe Thomas Berry : « L’univers est avant tout une communion de sujets, et non une collection d’objets4. » La différence fondamentale entre les communs et les marchés axés sur le capital ne pourrait être énoncée de manière plus succincte.
Le véritable défi, cependant, est de savoir comment concevoir des structures et encourager la dynamique sociale pour d’approvisionnement par les communs. Nous avons identifié les dix patterns suivants qui permettent de construire une économie des communs plus robuste.
FABRIQUER ET UTILISER CONJOINTEMENT
Fabriquer et utiliser conjointement est un moyen immémorial pour les gens de répondre à des besoins partagés. Pour réduire les coûts et affirmer leur caractère commun, les gens décident souvent de co-créer et de partager l’accès à des gisements d’informations, de connaissances, d’argent, d’espaces de travail, d’outils et d’infrastructures. Fabriquer et utiliser quelque chose ensemble est aussi ancien que l’espèce humaine et aussi nouveau que l’Internet. (Voir image 27 : Fabriquer et utiliser conjointement, téléchargeable sur www.eclm.fr)
Comme pour les autres patterns présentés dans ces chapitres, le « et » est important. Le modèle est fabriquer et utiliser conjointement, et non simplement utiliser conjointement. Si vous pensez comme un commoneur, vous considérerez la chose produite et l’ensemble du processus génératif comme quelque chose que vousmême utiliserez et que d’autres potentiellement partageront et utiliseront. Le processus ne consiste pas principalement à fabriquer et à produire pour votre propre consommation ou celle des autres. Il s’agit de répondre à des besoins partagés. Lorsqu’elle crée de nouvelles œuvres créatives, une personne renonce à son droit de propriété au titre du droit d’auteur (en utilisant les licences Creative Commons) afin de garantir la disponibilité de certains droits d’utilisation tels que la copie et le partage. Les utilisateurs ne veulent pas empêcher les autres de co-produire la même chose ; ils veulent que le plus grand nombre possible de gens participe à l’entreprise. Il est très intéressant d’encourager le partage en ligne car, comme Linus Torvalds l’a découvert dans les premiers jours du World Wide Web, plus on est de fous, plus on rit. Sur les plateformes numériques ouvertes, où la reproduction ne coûte pratiquement rien (à l’exception de l’infrastructure à forte intensité énergétique), la valeur générée est d’autant plus grande que le nombre de participants est élevé.
La fabrication qui a lieu dans un commun ne devrait pas vraiment être considérée comme du DIY (do-it-yourself, « faites-le vousmême »), mais comme du DIT (do-it-together, « faites-le ensemble »), pour répondre à ses propres besoins et potentiellement aux besoins des autres. Cela explique pourquoi les fermes en AMAP, par exemple, n’ont aucun intérêt à empêcher d’autres de se former et de prospérer dans leur région. Il est rare de lire ou d’entendre parler d’une AMAP en concurrence avec une autre. C’est plutôt le contraire. En tant que membre, vous voulez encourager d’autres AMAP à se former, au moins jusqu’à ce que tout le monde ait facilement accès à une AMAP à proximité de chez soi.
Ce pattern se décline de manières infinies. C’est le processus standard dans les MakerSpaces (« lieux de fabrication »), les ateliers ouverts et les Fab Labs du monde entier qui rassemblent des hackers, des professionnels des technologies, des artistes numériques et des amateurs pour bricoler, expérimenter et fabriquer des objets ensemble. Selon une étude du Cedifa (Center for Digital Fabrication), un Fab Lab peut être ouvert en une semaine avec un investissement de base de seulement 5 000 dollars américains s’il s’appuie sur des approches fondées sur les communs, notamment l’utilisation de logiciels libres5. Les communautés de conception et de fabrication ouvertes produisent de cette manière des meubles, des appareils électroniques, des équipements agricoles et des véhicules auto-mobiles open source.
Dans certains communs, l’accent est mis sur l’utilisation partagée, dans d’autres sur la fabrication partagée. La popularité des deux approches peut s’observer dans les 260 ateliers ouverts dans les pays germanophones où amateurs, maîtres artisans et bien d’autres personnes travaillent avec du bois, des imprimantes 3D, du métal et des composants électroniques. Presque tout ce qui sort normalement d’une usine peut être produit par DIT : seaux bokashi pour le compostage urbain, vélos cargos et voitures, lampes, microscopes et cartes mères à énergie solaire, tissus, toilettes et pièces de rechange, meubles en bois et visières. Dans le monde entier, des bénévoles réparent des appareils électroménagers et des articles ménagers cassés dans plus de 1 300 Repair cafés, suite à une idée lancée en 2009 aux Pays-Bas par la journaliste et blogueuse Martine Postma6. Les ateliers ouverts et les Repair cafés sont des lieux de fabrication communautaire, de réflexion collective et d’apprentissage. Ils adaptent et renouvellent de manière créative (voir ci-dessous) d’innombrables objets considérés généralement comme des déchets, leur donnant ainsi une seconde vie.
SOUTENIR LE SOIN ET LE TRAVAIL DÉMARCHANDISÉ
Le travail dans un commun n’est pas une unité achetée de travail marchandisé, aussi appelé « force de travail ». C’est une activité qui s’appuie sur les passions et les valeurs profondes des gens, sur l’ensemble de leur personnalité. La géographe Neera Singh qualifie ce type d’engagement de « travail affectif7 », car les gens font preuve d’amour, de dévouement et de soin – ou simplement de conscience de ce qui doit être fait – lorsqu’ils gèrent une forêt, s’occupent de parents âgés, conçoivent et conservent des archives web, enseignent un métier ou s’occupent d’un jardin communautaire. Le soin et l’engagement dans une entreprise partagée sont essentiels à la pratique des communs. C’est la colle de base qui tient les gens ensemble. C’est le cas, par exemple, quand les parents cuisinent, nettoient et prennent soin de leurs enfants, de leurs proches et de leurs parents – le ménage étant le centre de l’économie, comme en témoigne le sens original du terme grec oikos. Dans un commun, le « ménage » est plus grand que dans une polis grecque ; il comprend l’espace et toutes les personnes et tous les éléments concernés par la satisfaction des besoins8. (Voir image 28 : Soutenir le soin et le travail démarchandisé, téléchargeable sur www. eclm.fr)
Il y a soin lorsque les gens apportent toute leur humanité à une tâche au lieu d’avoir des relations impersonnelles, médiatisées par l’argent, avec des ressources sur le marché. Le travail affectif transforme une simple marchandise en quelque chose dont on prend soin. On pourrait plus précisément encore parler de richesse-soin. Contrairement à une ressource marchande dont la valeur est définie par son prix, la richesse-soin a de la valeur parce qu’elle est associée à une nuée de souvenirs, de significations et de sentiments singuliers, résultat du temps et du soin que les gens lui consacrent. L’énergie sociale qui plane autour de la richesse-soin ressemble au halo d’énergie électrique qui pulse autour d’un aimant. Il n’est pas surprenant que de nombreuses communautés éprouvent des sentiments particuliers à l’égard de lieux sacrés ou de points de convergence du soin des gens – une place publique, le bord d’une rivière, un arbre ancien. Certains théâtres de commoning – une coopérative alimentaire, une forêt locale, une fiducie foncière, un site web collaboratif – acquièrent une signification et une résonance émotionnelle particulières lorsque (et, en fait, seulement si) les gens s’y engagent corps et âme.
Sans l’énergie prodiguée personnellement et collectivement à travers ce travail de soin, une société humaine ne pourrait pas se maintenir. Comme nous le montrons dans ce chapitre, d’innombrables communs dépendent des soins qui sont apportés librement, partagés, divisés ou développés grâce à une réciprocité accommodante. Le soin n’est pas le résultat de la pratique des communs, mais clairement une force centrale de la pratique des communs qui se manifeste partout, même sur les marchés. La différence avec l’économie de marché est que celle-ci – tout en accueillant ce que le soin et la motivation intrinsèque peuvent accomplir – est incapable de le générer et de le soutenir par lui-même. Les incitations financières (salaires, honoraires, pots-de-vin, subventions) ne suscitent pas de véritable soin, car les incitations du marché visent principalement le « travail productif », c’est-à-dire les avantages économiques mesurables et tangibles. Le soin et le partage, en revanche, tentent de s’adresser directement à notre moi intérieur, en tant que Moi-imbriqué, avec intégrité et sensibilité. Cela explique pourquoi les communs sont de meilleurs espaces d’accueil pour permettre aux soins et au travail démarchandisé de s’épanouir.
Certes, l’économie conventionnelle a transformé toutes sortes de soins en « travail du soin », y compris les soins aux enfants et les soins de santé. Ces soins sont alors souvent structurés en unités de travail organisées selon une logique de productivité et de mesurabilité. Or il est impossible de faire entrer les relations humaines et les soins dans un régime d’horaires, de formulaires et d’indicateurs de productivité. Lorsqu’il est soumis à une rationalité calculatrice, le soin n’est plus le soin. C’est une forme de robotique exécutée par des automates humains.
Pourtant, comme nous l’avons vu à propos de Buurtzorg Nederland, le service de soins à domicile de proximité décrit au chapitre 1, il est possible de fournir des soins authentiques à un grand nombre de personnes sans que les incitations du marché dégradent leur qualité humaine essentielle. L’essentiel est de conserver l’échelle appropriée. Comme le dit le fondateur de Buurtzorg, « les gens ne sont pas des bicyclettes que l’on peut organiser selon un organigramme ». Fournir des soins par le biais des communs, au mépris des principes du marché, ne signifie pas que la qualité des soins en souffre. Cela améliore au contraire le soin apporté, parce que les gens ont la liberté et le temps d’accorder une attention personnalisée et adaptée à la situation de chacun.
Si certaines activités de soins ont été ainsi marchandisées, la plupart des soins ont encore lieu en dehors de l’économie formelle. Les économistes les ont externalisés, ce qui est leur façon d’ignorer purement et simplement ce domaine de la vie. Cette indifférence à l’égard des soins et de la satisfaction des besoins humains fondamentaux signifie que la prise en charge d’innombrables problèmes de société – vie familiale, soutien intergénérationnel dans les familles élargies, culture locale, activités sociales informelles – est rendue invisible. Les emplois de « soignants » créés par les marchés sont non seulement mal payés, mais aussi généralement réservés aux femmes, aux immigrants et aux minorités non blanches.
L’ironie est que le soin et le travail démarchandisé sont absolument indispensables au fonctionnement de l’économie, y compris au « travail productif ». Aucune civilisation ne pourrait fonctionner sans activités de soins. D’où viendrait la prochaine génération de salariés si les familles ne les élevaient pas, ne les éduquaient pas et ne les socialisaient pas ? Comment une communauté pourraitelle exister si les gens ne s’entraidaient pas en tant que voisins et ne socialisaient pas les jeunes pour en faire de bons citoyens ? Une fois que vous avez énuméré tout le travail non marchandisé nécessaire au fonctionnement d’une société – l’approvisionnement en denrées de subsistance, le ménage, la vie civique, le bénévolat, etc. –, « le travail non rémunéré vaut des milliards », comme l’a dit un journaliste allemand en utilisant le seul langage que beaucoup semblent comprendre9.
Soutenir le soin et le travail démarchandisé, c’est sauver de l’oubli ce secteur négligé du soin et le placer au centre de la réflexion économique. C’est valider une logique différente d’organisation de l’économie. La pratique des communs nous invite à renoncer à notre propre avantage plutôt que de maximiser le gain personnel. En fournissant des soins, nous nous rendons vulnérables et dépendants vis-à-vis des autres. Nous sacrifions notre temps, notre énergie et notre conscience afin de développer des relations saines – envers nous-mêmes et notre corps, envers les autres et envers la nature. Au lieu de nous efforcer d’être super-efficaces avec notre temps et notre argent, nous donnons la priorité à la présence humaine et à la connexion. À cet égard, les communs remettent en question le cœur même de l’économie de marché en privilégiant des normes d’évaluation différentes. Lorsque les traditionalistes de l’économie affirment que les modèles de soins ne peuvent être développés à grande échelle, ils passent à côté de l’essentiel : le véritable soin a lieu dans des contextes restreints et intimes où des relations authentiques peuvent se développer. Les grands systèmes ont évidemment un rôle à jouer, mais les soins ne se réduisent pas à des unités de prestation de services. Il s’agit d’une autre façon de comprendre l’économie comme une « oikonomie » ou une « écommonie », où « l’économie est le soin », comme le dit Ina Prätorius de Care Revolution, un réseau de défense des droits en Suisse, en Allemagne et en Autriche. (Voir image 29 : Iceberg de l’économie de marché, téléchargeable sur www.eclm.fr)
Deux générations d’économistes féministes10, dont beaucoup sont associées à l’International Association for Feminist Economics, et des chercheuses comme Diane Elson, Julie Nelson, Alicia Girón González, Brigitte Young, Adelheid Biesecker et Friederike Habermann ont formulé des critiques incisives sur les déficiences de l’économie dominante au regard du soin. Ce sont les mêmes déficiences que l’on observe vis-à-vis de la pratique des communs. Soin et communs sont tous deux généralement ignorés ou rejetés en tant qu’externalités. Les deux démarches tentent de passer outre aux prémisses erronées de l’économie standard (par exemple, l’Homo economicus, la valeur réduite au prix) en affirmant un cadre épistémologique différent.
Des études montrent que celles et ceux qui parviennent à échapper aux régimes d’évaluation des marchés (par l’argent, les prix) font souvent preuve de davantage de soin, de motivation et de souci de la qualité11. La raison en est que l’utilisation de salaires, de primes, de pots-de-vin et autres incitations financières envoie souvent un signal qui incite les gens à se comporter comme des acteurs compétitifs, voire cyniques, du marché. En revanche, la pratique des communs tend à encourager les gens à donner le meilleur d’eux-mêmes et à nourrir des relations plus profondes ainsi qu’une confiance réciproque. En fournissant des soins et un travail démarchandisé, ils deviennent un Moi-imbriqué. L’exemple classique de cette dynamique (pas nécessairement consciente) est l’économie du don de sang. Dans les années 1960, le chercheur britannique Richard Titmuss a découvert que les volontaires qui donnaient leur sang étaient davantage susceptibles d’avoir un sang plus sûr et plus sain que les personnes payées pour cela – parce que ces dernières avaient souvent des problèmes de toxicomanie ou des pathologies12.
PARTAGER LES RISQUES
DE L’APPROVISIONNEMENT
Dans l’économie capitaliste, les entreprises prétendent assumer les risques liés à la création et à la commercialisation d’un produit, alors même que leur budget de recherche et développement est souvent subventionné par les contribuables et qu’elles reportent souvent les risques et les dépenses sur les consommateurs, l’environnement et les générations futures. C’est au nom de ces risques qu’elles estiment avoir le droit de rafler l’ensemble des bénéfices liés à la production. Dans une économie planifiée, certains risques sont assumés par l’État ou simplement ignorés. En revanche, dans un commun, où la distinction entre consommateur et producteur s’estompe, toute personne activement impliquée accepte la coresponsabilité du partage des risques avant et pendant la production. Ces risques sont de divers types : l’incertitude sur les rendements des cultures d’une ferme en AMAP, les complications liées à la maintenance d’une infrastructure Wi-Fi communautaire telle que Guifi. net, ou encore les difficultés d’un processus open source requis pour concevoir un tracteur abordable et non propriétaire tel que le Life-Trac du projet Open Source Ecology13. (Voir image 30 : Partager les risques de l’approvisionnement, téléchargeable sur www.eclm.fr)
De même, il existe de nombreux moyens de partager les risques. Dans les campagnes de financement participatif, les participants font un don aux porteurs de projet pour développer une nouvelle application logicielle, une invention ou un service socialisé. Lorsque les contributions sont mises en commun en vue d’un investissement collectif, les risques sont assez faibles pour chaque individu, alors que les avantages potentiels pour tous sont importants. Dans de nombreuses AMAP allemandes, il existe un processus connu sous le nom de « tour d’enchères » (Bieterrunde) au cours duquel l’agriculteur ou l’agricultrice informe les membres au début de la saison de la somme d’argent qui sera nécessaire pour produire les cultures de l’année. Les membres se réunissent alors en cercle, réfléchissent ensemble aux besoins globaux du groupe et décident individuellement de ce que chacun peut se permettre de donner. Ensuite, ils soumettent des promesses anonymes d’argent dans le pot commun. Si les fonds recueillis lors du premier tour de soumission ne sont pas suffisants, l’ampleur du manque à gagner est annoncée et un deuxième tour de contributions commence. En général, la somme nécessaire est réunie en deux tours seulement. C’est ainsi que les risques liés à la culture des produits de la saison sont partagés sans que des personnes de capacités inégales aient à contribuer à parts égales au coût de la récolte.
Lorsque les risques sont partagés, tout change : les relations de pouvoir, les processus de décision sur ce qu’il faut produire et comment, les flux de trésorerie et, évidemment, le partage de la richesse. Pour ces raisons, le partage des risques de l’approvisionnement est une étape importante en vue de dépasser l’économie de marché. Ce qui nous amène aux quatre patterns suivants de l’approvisionnement par les communs, qui décrivent différentes manières d’allouer la richesse générée. Avant d’examiner chaque pattern séparément, il est utile d’apporter quelques clarifications conceptuelles et de passer en revue les choix fondamentaux auxquels les commoneurs sont confrontés.
CONTRIBUER ET PARTAGER
Mettre en commun consiste à contribuer à un stock de ressources pour atteindre un objectif commun ou résoudre un problème spécifique, de manière spontanée ou par accord volontaire. Ce qui est mis en commun est ensuite partagé. Quasiment tout peut être mis en commun : savoirs, ressources matérielles, temps, énergie, nourriture, outils, idées ou argent. La mise en commun ne consiste pas seulement à mettre des choses dans un pot collectif, mais aussi à apporter ses talents, son énergie, son imagination et ses services pour créer un commun dont chacun puisse bénéficier. Lorsque les gens contribuent et partagent, tous les participants contribuent librement (parfois avec un léger coup de pouce) à ce qui est nécessaire. Ensuite, ce qui a été réuni est partagé sans calculer le bénéfice individuel de chacun. Les participants réduisent leurs coûts individuels d’approvisionnement, augmentent la probabilité de mieux répondre aux besoins de tous et développent un sentiment de coresponsabilité et de solidarité. Comme dans mettre en commun et répartir, tout le monde peut participer, quels que soient ses moyens financiers ou son statut social. (Voir image 31 : Contribuer et partager, téléchargeable sur www.eclm.fr)
Contribuer et partager fonctionne dans tous les domaines de la pratique des communs, mais est particulièrement fort dans les réseaux ouverts, où l’utilité des informations, des idées, des connaissances, du code et de la conception augmente à mesure qu’ils sont partagés et adaptés. Cependant, ce qui importe le plus ici aussi, c’est le « et ». Mettre en commun sans partager dans les communs, c’est comme faire du shopping sans argent dans le capitalisme : ça ne marche pas. Vous ne pouvez partager que ce que vous mettez en commun, ce à quoi vous contribuez ou ce que vous coproduisez en premier lieu.
Contribuer à un code de logiciel a été comparé au fait de jeter des légumes dans une marmite commune dans laquelle chacun apporte ce qu’il a et peut prendre ce qu’il souhaite14. De fait, contribuer et partager est une pratique courante parmi les programmeurs et les concepteurs qui contribuent à un corpus partagé de codes et de designs. C’est également une pratique courante parmi les communautés mondiales de concepteurs d’équipements open source qui créent des plans partageables pour des équipements agricoles (Open Source Ecology, Atelier Paysan), des meubles (Open Desk), des maisons (WikiHouse), des véhicules à moteur (Wikispeed) et des prothèses (Open Prosthetics Project). Les institutions peuvent elles aussi contribuer et partager. Un exemple classique est l’initiative Europeana regroupant près de 400 musées, archives et institutions culturelles qui collaborent à un processus public d’étiquetage et de préservation des œuvres d’art du domaine public.
Formes variées d’allocation au sein d’un commun
Après la mise en commun des richesses ou des talents, les choses commencent à devenir intéressantes. Le partage n’est qu’une option parmi d’autres pour allouer ce qui est produit. Une ressource peut être répartie entre les personnes d’une manière négociée ou équitable, en tenant compte des besoins individuels, mais pas en unités égales. Ou bien la ressource est mutualisée selon une formule convenue à l’avance entre les participants, peut-être en corrélation avec la contribution d’un individu… ou pas. Il existe encore une autre solution : échanger les produits du commun contre de l’argent. Cette décision doit être mûrement réfléchie (voir Distinguer entre communs et commerce, p. 180) car elle pourrait faire sortir brusquement le groupe du paradigme des communs pour le faire entrer dans le monde des marchés et de leurs pièges.
Chacune des approches possibles pour l’allocation et la distribution de la richesse commune met en avant une rationalité particulière qui façonne l’identité du groupe. Chacune engendre des attentes et des sentiments différents chez les participants. Certaines de ces approches ne diffèrent que par des nuances ; d’autres ont des conséquences majeures sur la mission fondamentale du groupe et ses principes constitutifs. Examinons deux distinctions élémentaires qui doivent être faites.
La première concerne les caractéristiques d’une ressource donnée. La question clé est la suivante : la ressource est-elle quelque chose qui risque d’être épuisé (elle est « rivale », dans le jargon économique) ou quelque chose qui ne peut pas être épuisé (elles est « non rivale ») ? Dans le cas d’une ressource rivale, cela signifie que si une personne l’utilise, il y en aura moins ou pas du tout pour une autre personne. Il se peut qu’il n’y en ait pas assez pour tout le monde ou que la ressource soit surexploitée.
Pensez à l’eau ou à la nourriture. Si je mange une pomme, vous ne pourrez pas la manger. Le nombre d’agriculteurs qui peuvent utiliser l’eau d’une rivière pour l’irrigation est limité, sinon elle finirait par se tarir. En revanche, certains types de ressources – œuvres créatives, connaissances, idées, informations, codes logiciels, traditions – ne s’épuisent pas. Ces ressources ne sont pas rivales. De fait, comme nous l’avons mentionné précédemment, la participation d’un grand nombre de personnes peut en augmenter considérablement la valeur et générer des bénéfices collectifs, surtout si cela se passe sur les réseaux numériques. C’est l’une des raisons pour lesquelles Linux et la conception ouverte ont pris autant de valeur. Pour les biens qui ne peuvent jamais être surexploités, le problème n’est pas celui des resquilleurs qui pourraient les épuiser ; le défi consiste à garder le code, les informations ou la musique intangibles, à empêcher les vandales et les trolls de perturber la coopération et à assurer un financement adéquat de ces communs.
La seconde distinction fondamentale concerne les termes sociaux de l’échange et de la circulation. Doivent-ils être réciproques ou non réciproques ? Partager et répartir sont non réciproques, parce que le donneur ne reçoit ou n’attend pas nécessairement quelque chose en retour. C’est une relation qui se situe entre donner et prendre. Si l’allocation d’une ressource est réciproque, il existe deux options : la mutualisation et l’échange. Dans chaque cas, le donneur, le contributeur ou le vendeur est assuré d’obtenir quelque chose en retour. Les échanges réciproques, que ce soit par la mutualisation ou le commerce, sont une bête sociale très différente du partage et de la répartition non réciproques.
En gardant à l’esprit ces deux distinctions, examinons de plus près les différentes manières dont les gens interagissent.
Interactions non réciproques
Partager. Nous utilisons ce terme uniquement lorsque nous faisons référence au partage de choses qui ne s’épuisent pas à mesure de leur usage. Le partage est une façon d’allouer ces ressources de manière informelle, flexible et même parfois improvisée. Cette définition du partage contraste fortement avec l’usage trop large et confus qui en est fait aujourd’hui à propos de l’activité commerciale d’Uber ou d’Airbnb lorsqu’elle est qualifiée d’« économie du partage » plutôt que ce qu’elle est réellement : une économie de la micro-location.
Répartir. Nous parlons de répartition lorsque quelque chose qui risque d’être épuisé est partagé. La répartition est une allocation non réciproque d’objets – nourriture, argent, terre, bicyclettes, outils – entre les membres d’une famille ou des étrangers, des petits groupes ou des grands réseaux, sans calculer les contributions ou les avantages individuels de chacun en unités distinctes. Lorsque nous répartissons quelque chose, un individu peut obtenir plus qu’un autre en fonction de ses besoins personnels et du contexte. La répartition se fait en réponse à des demandes aussi bien tacites que formelles.
Nous pensons qu’il est utile d’utiliser des mots différents pour faire la distinction entre le partage des biens incorporels et des informations (ce que nous appelons « partage » tout court) et le partage des choses (« répartition »). Cette distinction a été portée à notre attention par le psychologue Michael Tomasello, qui souligne que les effets de l’obligation de partager quelque chose qui s’épuise sont différents de ceux du partage de quelque chose qui ne s’épuise pas. Plutôt que d’utiliser le même mot pour décrire les deux (« partage »), nous utilisons le verbe « répartir » pour décrire le défi particulier que représente l’allocation équitable d’une ressource qui peut être épuisée.
Interactions réciproques
Mutualiser. Mutualiser signifie contribuer et participer à un effort collectif en vue d’un objectif social large et durable, puis en recevoir un avantage individuel spécifique. Cependant, les membres ne reçoivent pas nécessairement une valeur égale en échange de ce qu’ils donnent, comme dans une transaction marchande. Ils reçoivent généralement un avantage déterminé en fonction de leurs besoins ou d’autres critères. Les groupements d’assurances et les fonds de sécurité sociale sont des exemples classiques de mutualisation.
La mutualisation est clairement un processus réciproque, mais les avantages que chacun en retire ne sont pas nécessairement égaux à ce qui est apporté. Il s’agit plutôt d’avantages déterminés socialement que les membres acceptent lors de la fondation du groupe et confirment à travers leurs décisions de gouvernance. La part des bénéfices de chacun est généralement déterminée de manière précise en fonction d’un calcul en unités individuelles mais différenciées, et selon des formules ou des accords prédéterminés.
Quelle que soit la structure de la mutualisation, il est essentiel que toutes les parties prenantes du système de ressources aient leur mot à dire sur la teneur de l’accord. Il s’agit d’une réciprocité déterminée par les pairs.
La mutualisation présente certaines ressemblances avec l’échange marchand. Ce qui la distingue, c’est que les participants ont généralement un intérêt les uns pour les autres et des objectifs qui ne sont pas seulement monétaires. Cette condition s’efface dans les systèmes de mutualisation nationaux, administrés par l’État, où les populations ont peu de relations entre elles en dehors de la citoyenneté. Dans les régimes de mutualisation, il est probable qu’il y ait des objectifs sociaux partagés, une histoire commune ou de solides traditions.
S’engager dans des échanges marchands. L’échange marchand est également un processus réciproque. Il repose sur l’idée d’un échange équivalent, déterminé par un prix signalant que les deux choses échangées sont considérées comme ayant une valeur équivalente, exprimée en termes monétaires. C’est l’essence même d’un marché : une rencontre fondée sur une transaction monétaire (échange d’argent contre une marchandise) plutôt qu’une relation sociale durable. Une personne qui échange sur le marché ne se préoccupe généralement que de la transaction elle-même ; toute relation ou tout engagement social est secondaire ou totalement absent. C’est précisément pourquoi l’expression « Les affaires sont les affaires » est souvent invoquée pour justifier une transaction commerciale dont les conséquences personnelles ou sociales peuvent être négatives. Pour faire bref, la mutualisation est une réciprocité orientée par un intérêt social, alors que l’échange marchand est une réciprocité s’appuyant sur le marché.
PLAFONNER L’USAGE DES RESSOURCES
Le plafonnement consiste à fixer une limite absolue à la quantité d’une ressource pouvant être utilisée au cours d’une période donnée, généralement pour éviter une surexploitation dommageable. Une telle limitation est souvent nécessaire pour les ressources finies et épuisables telles que la terre, les récoltes agricoles et l’eau d’irrigation, qui seraient épuisées si chacun pouvait en consommer autant qu’il le souhaite. Le plafonnement était le mécanisme classique appliqué dans les communs de l’Angleterre médiévale pour préserver une ressource collective. Lewis Hyde écrit :
Les communs n’étaient pas ouverts ; ils faisaient l’objet de restrictions. Si, par exemple, vous étiez un fermier anglais du xviie siècle, vous pouviez avoir le droit de couper des joncs dans le commun, mais seulement entre Noël et la Chandeleur (2 février). Ou vous pouviez avoir le droit de couper les branches des arbres, mais seulement jusqu’à une certaine hauteur et seulement après le 10 novembre. Ou encore, vous pouviez avoir le droit de couper les arbustes épineux à feuilles persistantes appelés furze, mais seulement la quantité que vous pouviez porter sur votre dos, et uniquement pour chauffer votre propre maison.
Hyde note que « les restrictions imposées à l’utilisation au nom de la longévité » se retrouvent dans tous les communs durables. « Sans elles, il n’y a pas de véritable commun15. »
Les plafonnements sont utilisés dans toutes sortes de contextes – rural, urbain, écologique, numérique. Dans les régions arides d’Amérique latine où l’eau d’irrigation est précieuse, les commoneurs qui gèrent les acequias fixent des plafonds à l’utilisation de l’eau afin que les besoins de chacun puissent être satisfaits. Soucieux du respect de la vie privée, les communs numériques qui consolident des données provenant de nombreuses sources imposent des limites à la manière dont les données peuvent être collectées et utilisées. Les immeubles d’habitation gérés en coopérative ont un nombre limité d’unités de vie pouvant être louées ou vendues – une simple limite physique.
Le plafonnement est souvent élastique, car il peut y avoir moyen d’accueillir un participant-utilisateur de plus, mais à un certain point, les groupes se rendent généralement compte qu’il n’y a pas assez de revenus, d’espace physique ou d’infrastructure organisationnelle pour accueillir tout le monde.
Au sein de la coopérative d’habitat SSM de Cologne, la façon habituelle de traiter les personnes qui veulent faire trop d’achats est de procéder à des limitations discrétionnaires. On commence par identifier les limitations discrétionnaires – « Cette nouvelle télévision ne peut tout simplement pas être achetée » –, puis on « va plus en profondeur pour demander ce dont les gens ont vraiment besoin », explique Rainer Kippe, cofondateur de SSM16. La coopérative, par principe, ne renvoie pas les gens et ne demande pas à l’État des fonds d’aide publique supplémentaires.
Le plafonnement est un principe de gouvernance classique qui est souvent aujourd’hui associé à l’échange, comme le mécanisme familier de « plafonnement et échange » (cap and trade en anglais) utilisé pour gérer les émissions de CO2 au moyen de quotas d’émission transférables. Dans le cadre des systèmes de plafonnement et d’échange, les entreprises reçoivent ou achètent des droits d’émettre des quantités spécifiques de polluants. Si les entreprises choisissent de réduire leurs émissions, il se peut qu’elles n’aient pas besoin de leurs « droits de polluer » et elles peuvent alors choisir de les vendre à d’autres entreprises pour lesquelles il est moins cher d’acheter les droits que de réduire leurs propres émissions.
Si le plafonnement est souvent indispensable, la création d’un droit de polluer en tant que produit commercialisable peut compromettre l’objectif même du plafonnement. Cela peut, par exemple, donner lieu à des contournements sophistiqués des plafonds et à des instrumentalisations abusives du système. Les plus gros acteurs peuvent utiliser leur pouvoir disproportionné sur le marché pour manipuler les prix. Un système de « plafonnement et échange » donne aussi un poids disproportionné à l’évaluation financière par rapport à la valeur inhérente des écosystèmes, des communautés affectées et de leurs cultures. En réalité, c’est un système de prix qui prétend abusivement rendre compte de la valeur écologique. Pour la même raison, les systèmes de « plafonnement et échange » finissent par ignorer les capacités réelles des écosystèmes, car les plafonds tendent à refléter des compromis politiques et non des réalités écologiques.
C’est pourquoi nous préférons à l’approche « plafonnement et échange » celles qui consistent à plafonner et répartir – mieux connue sous le nom de « plafonner et partager » – et à plafonner et mutualiser. Le « plafonnement » présente l’avantage d’inciter les personnes concernées à mobiliser leurs savoirs, leur créativité et leur compétence, ainsi que leur capacité de contrôle mutuel par les pairs, pour relever le défi de la réduction de l’usage de la ressource naturelle partagée. L’argent est moins efficace pour mobiliser ces énergies.
METTRE EN COMMUN, PLAFONNER ET RÉPARTIR
Dans les cas où une ressource commune est en quantité finie et susceptible d’être épuisée, la formule mettre en commun, plafonner et répartir est comme une variante de « mettre en commun et partager ». Un plafond d’utilisation, fixé par le biais d’un processus de Gouvernance par les pairs, permet de faire face à la menace de surutilisation ou d’approvisionnement insuffisant qui pourrait survenir si chacun prenait ce qu’il voulait. Mettre en commun, plafonner et répartir fait référence à une expérience et à une nécessité intemporelles. Les chasseurs ne parviennent à tuer qu’une quantité limitée de gibier, mais de nombreuses personnes ont besoin de manger… Les cueilleurs ne peuvent récolter qu’un stock limité de noix et de fruits… Les invités à un repas partagé n’apportent qu’une quantité limitée de denrées, qui doivent être utilisées pour satisfaire tout le monde. (Voir Image 32 : mettre en commun, plafonner et répartir, téléchargeable sur www.eclm.fr)
Les agriculteurs ou les bergers qui utilisent les mêmes terres pour l’agriculture ou le pâturage des animaux créent souvent des règles pour définir combien et quels mois un individu pourra récolter. Il est fréquent dans un commun de limiter l’utilisation individuelle afin que la terre ne soit pas surexploitée. La répartition de l’eau, des ressources halieutiques, des fruits et des récoltes disponibles peut se faire de manières très variées et parfois inattendues.
Mettre en commun, plafonner et répartir est sans doute le modèle de coopération le plus répandu dans le monde aujourd’hui. Il l’a toujours été. Sa prévalence et sa commodité restent souvent ignorées parce que cela n’est pas conforme au récit économique standard, selon lequel les individus sont par nature égoïstes, matérialistes et rationnels, incapables de négocier une répartition équitable des bénéfices. « Dans l’économie conventionnelle, ils [les économistes] ne peuvent plus voir ce qui fonctionne vraiment, remarque Rainer Kippe de la coopérative SSM. Ce que nous faisons semble impossible à un économiste orthodoxe formé aux théories classiques. Selon ces dernières, ce que nous faisons ne peut pas fonctionner. Mais dans les faits… nous le faisons tous les jours17 ! » Les membres de SSM « mettent en commun, plafonnent et répartissent ». En effet, au-delà du champ de vision de l’économie classique, pas moins de 2,5 milliards de personnes dans le monde gèrent environ 8 milliards d’hectares de terres grâce à des systèmes de propriété communautaire, selon l’International Land Coalition (ILC)18. Pour des biens comme la terre, l’eau, les forêts et le gibier, mettre en commun, plafonner et répartir est sans doute la stratégie la plus juste et la plus pratique.METTRE EN COMMUN, PLAFONNER ET MUTUALISER
Mettre en commun, plafonner et mutualiser est utile pour gérer des ressources limitées que vous souhaitez utiliser et gérer en commun, mais que vous ne voulez pas nécessairement répartir. Chacun n’en recevra pas nécessairement une part absolument égale à celle des autres. Il s’agit pour un groupe spécifique de coopérateurs de satisfaire collectivement leurs besoins de manière à peu près équivalente et, ce faisant, de manifester une forme de solidarité sociale. Mettre en commun, plafonner et mutualiser est un principe moderne familier, utilisé pour les systèmes de sécurité sociale et les soins de santé. On le retrouve également dans le système d’assurance-maladie communautaire Artabana, décrit précédemment. (Voir image 33 : Mettre en commun, plafonner et mutualiser, téléchargeable sur www.eclm.fr)
Ce pattern repose sur une certaine réciprocité dans la mesure où chacun contribue à superviser l’utilisation correcte et respectueuse des communs tout en en tirant des bénéfices. Mais cette réciprocité n’est pas une transaction de type commercial, car l’accord entre les commoneurs repose sur la solidarité de voisinage et la flexibilité. Cela est très différent d’un système « plafonnement et échange » dans la mesure où le plafond acceptable d’usage est déterminé par les utilisateurs sur la base de leurs propres expériences et observations. Un autre avantage du système mettre en commun, plafonner et mutualiser est qu’il préserve une intentionnalité partagée au sein du groupe d’utilisateurs, alors que l’échange encourage l’exploitation individuelle de la ressource jusqu’aux limites maximales autorisées (et parfois au-delà), ce que l’on pourrait appeler la« tragédie du marché ».
NOUER DES ÉCHANGES MARCHANDS EN PRÉSERVANT SA SOUVERAINETÉ
L’un des plus importants avantages des communs est leur capacité à s’émanciper des marchés – et des prix dictés par les marchés. Une personne qui participe à un commun n’a plus besoin de se soumettre à la toute-puissance des marchés. Un commun permet aux gens de suivre leur propre chemin. S’ils ont besoin de s’engager avec le marché, ils peuvent choisir de le faire à leurs propres conditions. (Voir image 34 : Nouer des échanges marchands en préservant sa souveraineté, téléchargeable sur www.eclm.fr)
Aux États-Unis, la militante des droits civiques Fannie Lou Hamer a mis au point, dans les années 1960, une stratégie astucieuse pour aider les communautés exclues, du fait, en l’occurrence, des pratiques abusives d’entreprises appartenant à des Blancs. Avec le soutien du chanteur Harry Belafonte et d’une organisation caritative du Wisconsin, Measure for Measure, elle a fondé en 1969 une coopérative agricole interraciale sur quelques dizaines d’hectares de terres dans le delta du Mississippi. L’objectif était de donner aux Noirs pauvres les moyens de cultiver leur propre nourriture. « Lorsque vous avez 400 litres de soupe de gombo et de légumes verts pour l’hiver, personne ne peut vous bousculer ou vous dire ce que vous devez dire ou faire », a expliqué Hamer19. Imaginez ce qui pourrait advenir si les commoneurs imitaient cette stratégie dans tous les domaines. Ils parviendraient à mettre le marché sérieusement sur la défensive ! C’est ce que l’on peut déjà constater dans le nordouest du Venezuela avec l’approvisionnement par les communs de Cecosesola.
Cecosesola, ou comment ignorer le marché
Cecosesola est un « omni-commun » robuste et mature qui relie entre elles de nombreuses entités plus petites sous la forme d’une fédération d’une trentaine de coopératives et d’un nombre équivalent d’organisations de base qui, ensemble, comptent environ 20 000 membres20. Les coopératives urbaines et rurales dispersées dans l’État de Lara, dans la partie préandine du Venezuela, ont réussi à surmonter les circonstances économiques et politiques les plus difficiles pour fournir de la nourriture, des soins, des transports et même des services funéraires communaux depuis plus de cinq décennies. La priorité absolue de Cecosesola est d’accueillir un processus de création d’espaces d’être-ensemble. Mais elle est aussi profondément ancrée dans l’économie locale depuis ses débuts à la fin des années 1960.
Cecosesola a réussi en adoptant une stratégie audacieuse : ignorer le marché. Elle fixe ses propres prix et ses propres espaces d’échange – quatre énormes marchés, un dans chaque section de la capitale de l’État, Barquisimeto, une métropole de 1,25 million d’habitants située dans le nord-ouest du pays. Sur les marchés communautaires de Cecosesola, la fédération vend quelque 700 tonnes de produits frais à un prix unique au kilo, nettement inférieur aux prix pratiqués par les commerçants conventionnels. L’impact est tel que les marchés communautaires de Cecosesola ont fait baisser les prix du marché dans la région. Environ 700 000 personnes bénéficient grâce à ce système de prix plus bas et couvrent ainsi la moitié de leurs besoins en alimentation.
Vous vous demandez peut-être comment tout cela peut bien fonctionner. Cecosesola pose une question simple à ses agriculteurs et à ses prestataires de services, tous membres de la fédération : de quoi avez-vous besoin pour produire votre récolte ? (C’est exactement la même question que les membres d’une AMAP posent à leurs maraîchers ou maraîchères afin qu’ils puissent partager le risque de l’approvisionnement.) Les membres de la coopérative rurale qui travaillent dans les champs et les membres de Cecosesola qui coordonnent la fédération ou vendent sur les marchés de Barquisimeto se réunissent à l’ombre d’un arbre, assis sur de simples bancs en bois. Leur discussion décontractée se transforme progressivement en un sérieux travail d’évaluation des besoins de la production : tant de jours de travail, tant de semences, tant de carburant, tant de tuyaux d’irrigation, etc. Les membres les plus expérimentés rappellent à ceux qui le sont moins que certaines choses peuvent tomber en ruine et qu’il faudra les renouveler, ou qu’il faudra peut-être acheter plus de fourrage pour les mules parce que les 800 derniers mètres de dénivelé augmenteront les coûts de transport. Petit à petit, les membres mettent à profit leurs savoirs situés. Ensemble, ils identifient les coûts de production correspondant à leurs conditions spécifiques de vie et d’agriculture. Les producteurs et les distributeurs (les personnes du bureau central de Cecosesola en ville, les commerçants ou les intermédiaires dans l’économie conventionnelle) se coordonnent ensemble.
Les prix sont fixés sous le regard de chacun. Chaque coopérative du système Cecosesola agit de même. À la fin, la fédération fait la somme des résultats de toutes les réunions, ajoute quelque argent supplémentaire pour les extras et les pertes (oui, les tomates se gâtent en route vers la capitale et certaines sont volées sur le marché). Puis Cecosesola prend une mesure radicale, contre-intuitive :
Nous découplons le prix des légumes du temps et des efforts que nous y consacrons, explique Noel Vale Valera, membre de la coopérative. Nous addition-
nons d’une part le nombre de kilogrammes produits sur l’ensemble de la gamme de produits et d’autre part les coûts. Ensuite, nous divisons l’un par l’autre pour obtenir le prix moyen par kilo. Notre seul critère de référence sont les coûts de production, y compris ce dont les producteurs ont besoin pour vivre… Ce qui compte pour nous, c’est que nous gagnions ce dont nous avons besoin.
Les membres de Cecosesola ne considèrent pas les producteurs, les commerçants et les consommateurs comme des gens séparés ayant des intérêts séparés. Ils voient tout le monde comme un tout, dans lequel chacun doit satisfaire ses besoins en même temps que ceux du système dans son ensemble.
Jorge Rath, collègue de Vale, insiste : « Ce système permet aux gens d’économiser beaucoup d’argent… Notre prix au kilo réduit la paperasserie, nous ne travaillons pas avec des intermédiaires, et les fluctuations saisonnières ne font pas de différence non plus21. » Le prix unique au kilo pour tous les produits est le résultat d’une discussion ouverte entre ceux qui produisent et les nombreux autres qui collaborent avec eux. Finalement, il n’est pas étonnant que les coûts et donc les prix soient nettement inférieurs à ceux des marchés conventionnels. Il n’y a pas de coûts cachés car la confiance et la transparence règnent au sein de Cecosesola. Il n’y a pas de frais de marketing et de publicité. Il n’y a pas d’intermédiaires, de grossistes ou de distributeurs qui facturent des prix exagérés. Cecosesola est capable de faire preuve d’efficacité monétaire et de souveraineté sur ses prix.
Ce qu’il y a plus impressionnant avec Cecosesola est la remarquable résilience de son système d’approvisionnement en temps de crise politique et économique. Cette résilience provient essentiellement de la capacité d’adaptation rapide de la fédération en cas de changements radicaux. Au moment où nous terminions l’écriture de ce livre, le peuple vénézuélien subissait le choc de l’hyperinflation, estimée à un million de pour cent en 2018. Et pourtant, de manière étonnante, Cecosesola a pu résister au ralentissement économique et aux bouleversements politiques du pays en adaptant, une fois de plus, ses systèmes opérationnels. Fin 2016, Cecosesola a commencé à identifier de nouvelles sources de production agricole dans la partie rurale de l’État de Lara. Cela a fait connaître l’approche de la fédération à davantage de gens et de producteurs, non pas pour établir une relation vendeur-acheteur (qui n’a de toute façon aucun sens dans un contexte hyperinflationniste), mais pour forger un partenariat fondé sur le principe du DIT afin de s’adapter aux changements incroyablement rapides de l’économie. C’est parce que la fédération entretient une culture de participation horizontale et de confiance qu’elle a pu gagner le soutien des producteurs et des consommateurs. Grâce à la réduction des dettes et des frais généraux et à sa culture de solidarité, Cecosesola et ses habitants ont réussi à se maintenir. Mais personne ne sait vraiment si et comment ils survivront si la crise du Venezuela perdure.
En créant un système d’approvisionnement quasi indépendant des marchés conventionnels, les commoneurs acquièrent une certaine liberté par rapport aux exigences du marché, y compris la détermination du prix. Ils peuvent fixer leurs propres conditions. La capacité d’affirmer sa souveraineté sur les prix est une source importante de pouvoir. Elle inclut le choix de fournir aux gens des biens et des services gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché conventionnel. Il s’agit d’un pouvoir stratégique souvent négligé. En démarchandisant la production et en l’enracinant dans les pratiques sociales et la confiance, les commoneurs se donnent la possibilité de poursuivre leurs propres objectifs face aux formidables pressions du capital et des grandes entreprises.
Les exercices de fixation des prix menés par Cecosesola (et d’autres communs) lui permettent d’être moins vulnérable face aux variations très irrégulières de l’offre et de la demande. Comme elle s’est partiellement retirée des marchés conventionnels, elle est donc moins dépendante de leur volatilité – bien que les paysans doivent toujours acheter leurs semences et d’autres intrants sur les marchés. Mais la souveraineté relative sur les prix n’est pas anticoncurrentielle au sens où l’entend la loi antitrust. La souveraineté sur les prix consiste à comptabiliser les coûts d’approvisionnement de manière précise et transparente en fonction des besoins réels et du contexte. Les prix fixés par les marchés conventionnels, en revanche, tendent à refléter les dépenses supplémentaires liées au fonctionnement d’un système hypertrophié : publicité, recrutement et rétention des employés, chaînes de valeur compliquées par la présence de fournisseurs et d’intermédiaires, avocats, études de marché, emballage, marques, lobbying auprès du gouvernement, financement de campagnes politiques pour obtenir une meilleure réglementation, etc. Toutes ces dépenses sont opaques et intégrées de manière invisible dans les prix. En comparaison, la pratique des communs a une structure de coûts beaucoup plus simple, qu’elle peut expliquer de manière transparente.
On pourrait dire qu’il y a deux formes de souveraineté sur les prix : la capacité d’un système géré par la communauté à déterminer les prix à travers ses propres processus internes ; la capacité à défendre sa souveraineté sur les prix lors des échanges avec le monde extérieur. Dans les deux cas, l’objectif est d’obtenir le plus d’autonomie possible pour préserver les communs des pressions du marché. En disposant d’un commun qui assure une part importante de leur subsistance et en obtenant leur souveraineté sur les prix, les commoneurs peuvent échanger avec les marchés de manière sélective, assurés que ces interactions ne mettront pas en danger l’intégrité du commun lui-même. Les commoneurs qui, par exemple, participent à un commun de recherche ou de bases de données partageables, ou qui récoltent la production d’une ferme coopérative, ou qui vivent sur une parcelle urbaine ou sur un terrain détenus par une fiducie foncière sont à l’abri des contraintes souvent sévères liées à l’endettement et à des prix élevés.
Le système d’exploitation Linux est un autre exemple de commun exerçant une souveraineté sur les prix dans ses relations avec le marché. Parce qu’il est disponible gratuitement pour tous, les distributeurs qui commercialisent une version particulière de Linux sont limités dans ce qu’ils peuvent facturer. De même, les revues savantes en libre accès telles que la Public Library of Science (PLoS) contournent entièrement le marché en mettant gratuitement à disposition des recherches scientifiques évaluées par des pairs hautement qualifiés. Certes, les revues PLoS en libre accès sont subventionnées par des fonds publics, mais le fait est qu’elles exercent une souveraineté sur les prix et choisissent le montant qui leur convient, y compris la gratuité. Cela a mis la pression sur les éditeurs de revues commerciales pour qu’ils proposent leurs propres revues en libre accès (qui, cependant, demandent souvent des frais d’auteur initiaux excessifs). Les revues en libre accès peuvent ainsi supplanter les revues commerciales en étant non pas plus compétitives, mais plus coopératives.
***
Une fois que les commoneurs ont mis leurs ressources en commun, doivent-ils les partager, les répartir ou les mutualiser ? Chacune de ces approches a des implications différentes, mais en général, chacune d’entre elles est susceptible de réduire les coûts individuels. Chacune est également susceptible de satisfaire les besoins des gens tout en développant un sentiment de responsabilité partagée pour l’ensemble du processus d’approvisionnement et ses impacts. Pour résumer cette discussion, voici un tableau montrant les différentes manières d’allouer les ressources dans un commun.
Modes généraux d’allocation dans les communs
| Type de transaction | Caractère de la richesse partagée | |
|---|---|---|
| Peut s’épuiser (rivale) | Ne peut pas s’épuiser (non rivale) | |
| Réciproque | Mutualiser ou nouer un échange commercial avec souveraineté sur les prix | L’échange réciproque de ressources non rivales n’a pas de sens |
| Non réciproque | Répartir | Partager |
Modes généraux d’allocation dans une économie de marché capitaliste
| Type de transaction | Caractère de la richesse partagée | |
|---|---|---|
| Peut s’épuiser (rivale) | Ne peut pas s’épuiser (non rivale) | |
| Réciproque | Échange commercial fondé sur les prix de marché | Privatisation et enclosure, puis échange commercial fondé sur les prix de marché |
| Non réciproque | Point aveugle de l’économie conventionnelle, où le soin, le partage et l’assistance ne sont pas considérés comme relevant de l’économie | |
UTILISER DES OUTILS CONVIVIAUX
Le terme « outils conviviaux » a été introduit par le philosophe et critique social Ivan Illich dans son livre La Convivialité, publié en 1973, qui imagine un monde dans lequel une communauté d’utilisateurs développe et entretient ses propres outils. L’utilisation d’outils conviviaux, un terme que nous étendons aux technologies, infrastructures et processus d’approvisionnement, vise à renforcer notre liberté individuelle tout en enrichissant nos relations et notre interdépendance – soit l’essence même d’un commun. (Voir image 35 :
Utiliser des outils conviviaux, téléchargeable sur www.eclm.fr)
De nombreux outils et technologies contemporains sont des systèmes fermés qui nous imposent leur manière particulière d’effectuer une tâche. Pensez à la chaîne de montage d’une usine, aux cultures génétiquement modifiées ou à un DVD crypté. De tels systèmes structurent la manière dont nous sommes autorisés à travailler et à entrer en relation avec les autres, tout en nous rendant dépendants d’entreprises ou de bureaucraties étatiques qui cherchent à contrôler ce que nous en faisons. Par contraste, les outils conviviaux sont des systèmes ouverts que chacun peut utiliser et adapter à ses propres fins, à sa manière. Comme l’explique
Illich :
Les outils favorisent la convivialité dans la mesure où ils peuvent être utilisés facilement, par n’importe qui, aussi souvent ou aussi rarement que souhaité, pour la réalisation d’un objectif choisi par l’utilisateur. L’utilisation de ces outils par une personne n’empêche pas une autre de les utiliser également. Ils ne nécessitent pas de certification préalable de l’utilisateur. Leur existence n’impose aucune obligation de les utiliser. Ils permettent à l’utilisateur d’exprimer son propre sens à travers l’action22.
Les techniques d’agriculture stables et écoresponsables telles que la permaculture et l’agroécologie sont des outils conviviaux car tout le monde peut les utiliser, les partager et contribuer à leur amélioration. Les semences OGM qui ont été génétiquement modifiées et brevetées, en revanche, peuvent être utilisées seulement dans le cadre que l’entreprise propriétaire nous impose. Un système d’exploitation informatique libre ou open source tel que GNU/Linux peut être utilisé, partagé et modifié comme bon nous semble, alors que Microsoft Windows® et iOS® d’Apple interdisent aux utilisateurs de consulter les codes sources du programme sans autorisation préalable. Les outils conviviaux invitent à des adaptations créatives dans une myriade de contextes. Ils renforcent les liens entre les personnes et avec le vivant. Ils aident à trouver des solutions modestes, progressives et socialement adaptées aux problèmes rencontrés. Les gens peuvent les utiliser pour échapper aux systèmes institutionnels qui inhibent notre humanité et créent des dépendances.
Le caractère social de nos outils et de nos technologies a de l’importance car, comme l’écrit Illich, « chaque individu se relie en action à sa société par l’utilisation d’outils qu’il maîtrise ou par lesquels il est passivement influencé. S’il maîtrise ses outils, il peut investir le monde de son sens ; s’il est maîtrisé par ses outils, leur forme détermine l’image qu’il a de lui-même ». En fin de compte, les outils que nous utilisons façonnent le type de société dans laquelle nous vivons. « Le résultat d’une grande partie du développement économique, note Illich, n’est pas l’épanouissement humain, mais souvent une “pauvreté modernisée”, la dépendance à un système hors de contrôle dont les humains deviennent des rouages usés23. » Cette dynamique atteint des sommets plus alarmants que jamais avec une nouvelle vague de technologies fondées sur l’intelligence artificielle qui s’immiscent dans notre vie familiale, nos foyers, notre santé personnelle et notre conscience.
De nos jours, les outils et les technologies open source sont des outils conviviaux qui ont un grand potentiel en termes d’approvisionnement par les communs car les utilisateurs peuvent en déterminer les usages. Ils sont ouverts, accessibles, modifiables et partageables selon les souhaits et les besoins des utilisateurs24. Ces outils conviviaux permettent de nombreuses applications, dont certaines sont très différentes de l’utilisation initialement prévue.
S’APPUYER SUR DES STRUCTURES DISTRIBUÉES
Il n’y a pas de raison inhérente qui ferait que les communs ne peuvent pas fonctionner à grande échelle, comme on peut le constater avec les innombrables communautés en réseau qui s’appuient sur des plateformes Internet. Cependant, pour qu’un commun grandisse, il faut non seulement un soutien politique, mais aussi des structures et des infrastructures non discriminantes qui facilitent le commoning. Les gens doivent disposer de moyens relativement simples pour participer et donner leur consentement. Leurs systèmes d’approvisionnement doivent être conçus de manière à favoriser la confiance sociale, les objectifs partagés et la cohérence. Lorsque cela est possible, ces (infra)structures devraient rendre possible une utilisation distribuée – par exemple, de pair à pair (logiciels libres), d’équipe à équipe (soins à domicile dans le quartier Buurtzorg) ou de nœud à nœud (FairCoop). (Voir image 36 : S’appuyer sur des structures distribuées, téléchargeable sur www.eclm.fr)
Cela signifie que les (infra)structures doivent permettre aux pairs, aux équipes et aux nœuds locaux de s’interconnecter et de former des sphères semi-autonomes d’approvisionnement et de gouvernance. Chaque partie de l’ensemble peut alors fonctionner selon ses propres règles et besoins contextualisés, tout en se coordonnant avec les autres pairs, équipes et nœuds semi-autonomes.
Les structures distribuées diffèrent des structures décentralisées en ce que ces dernières sont reliées à des nœuds centraux, tandis que les premières sont des pairs interconnectés (ou des équipes, des groupes, des nœuds ou des communautés locales interconnectés) qui sont en relation directe les uns avec les autres par le biais d’un réseau ou d’une fédération, sans nœud central25. Les structures distribuées ont tendance à se comporter de manière plus autonome et à jouir d’une plus grande autodétermination. Cela permet d’éviter une concentration du pouvoir politique et de rendre inutiles les systèmes coercitifs de commande et de contrôle, mais cela exige de l’initiative, de la créativité et de l’autoresponsabilisation. Les structures décentralisées sont généralement liées à un organisme central plus autoritaire (de la municipalité à la région puis au gouvernement national, des franchisés au siège de l’entreprise) auquel elles cèdent une partie de leur autonomie, de leur imagination et de leur potentiel.
Image 37 : Relations centralisées, décentralisées et distribuées
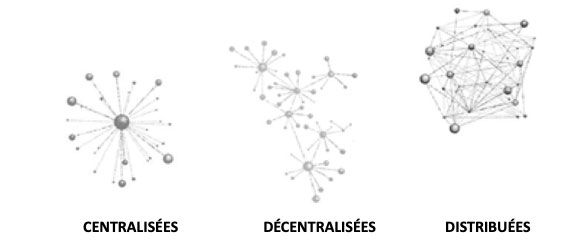
À l’époque moderne, nombre d’infrastructures et d’outils institutionnels – le droit, la bureaucratie, l’Internet – ont été utilisés pour organiser des larges groupes de manière stable et fonctionnelle. Si cela a permis la création d’institutions modernes, cela a également renforcé la centralisation du pouvoir au détriment de la participation individuelle et des savoirs locaux. Le défi consiste donc à transformer les institutions modernes de sorte qu’elles puissent être mises au service de l’autonomisation et de la convivialité.
Les communs peuvent-ils coordonner un grand nombre de personnes sur de vastes étendues géographiques tout en conservant une échelle humaine conviviale ? La réponse est oui, mais cela nécessite généralement une infrastructure robuste permettant aux participants de combiner les avantages de l’autodétermination distribuée et de la coopération à plus grande échelle. C’est de cette manière que de nombreux projets transnationaux fonctionnent aujourd’hui. Pour exemples, citons le financement et la coordination par la Fondation Wikimedia de plus d’une douzaine de projets wiki quasi autonomes avec des utilisateurs dispersés dans le monde entier ; les grandes communautés de logiciels libres, dont les fondations et les plateformes partagées, qui permettent à de petites armées de programmeurs de prendre des initiatives depuis la base ; ou encore les mouvements citoyens tels que les Villes en transition et la conception et la fabrication ouvertes, qui fonctionnent à l’échelle locale, mais se coordonnent au-delà des frontières politiques.
Dans chacun de ces cas, l’objectif n’est pas de consolider une gestion par le biais d’une entité centrale, mais d’entrer dans un processus d’émulation et de fédération avec l’aide de réseaux numériques. Le pouvoir et la créativité peuvent alors être disséminés à l’échelle locale ou régionale en même temps qu’une forme de coordination s’opère à grande échelle.
ADAPTER ET RENOUVELER DE MANIÈRE CRÉATIVE
La culture industrielle moderne accorde une telle importance à l’« innovation » – soutenue en grande partie par la quête sans fin d’avantages concurrentiels – que celle-ci est souvent considérée comme un bien absolu en elle-même. Dans cette vision du monde, l’objectif principal est d’aider les entreprises à s’imposer face à leurs concurrents sur le marché, d’améliorer le retour sur investissement et d’inciter les consommateurs à acheter un flux continu de produits « nouveaux et améliorés ». Par contraste, les communs, en tant que système d’approvisionnement, sont souvent considérés comme arriérés, prémodernes ou tribaux – ces modes de production seraient statiques, indigestes et non innovants. (Voir image 38 : Adapter et renouveler de manière créative, téléchargeable sur www.eclm.fr)
Il s’agit d’une caricature grossière, voire d’une contre-vérité, car de nombreux commoneurs sont parfaitement capables de s’adapter à l’évolution des besoins, y compris à la nécessité de réduire notre empreinte écologique. Dans un commun, il n’y a pas d’impératif à accroître constamment la production et les profits, et la créativité peut donc se concentrer sur ce qui compte vraiment – l’amélioration de la qualité, de la durabilité, de la résilience et de la stabilité holistique. L’innovation n’a pas nécessairement pour objectif la stimulation des ventes au détriment de la santé de la planète. L’activité quotidienne d’innombrables communs est fondée sur le pattern adapter et renouveler de manière créative.
Comme le montre Eric von Hippel dans son livre Democratizing Innovation [« Démocratiser l’innovation »], toutes sortes de communautés de pratiques – cyclistes, deltaplanistes, skieurs, amateurs de sports extrêmes – ont développé des idées révolutionnaires qui ont ensuite été commercialisées par des entreprises conventionnelles26. Les peuples indigènes, eux aussi, longtemps considérés comme figés dans leurs traditions, ont fait preuve d’une immense créativité au fil des siècles en contribuant à la création d’écosystèmes robustes par la sélection des semences et la domestication des animaux. Le sol fertile de la région amazonienne, connu sous le nom de Terra Preta do Índio – « la terre noire des Indiens » –, « n’est pas le résultat du hasard, mais plutôt une création délibérée des agriculteurs indigènes qui pratiquaient il y a longtemps l’agroforesterie «slash-and-char» dans la région, écrit l’économiste James Boyce. Une caractéristique notable de la Terra Preta est sa remarquable capacité d’autorégénération, que les scientifiques attribuent aux micro-organismes présents dans le sol27 ». Il en va de même pour la création de l’irrigation gravitaire des acequias dans la haute vallée du rio Grande, qui a transformé une région semi-aride en un riche paysage de zones humides, de champs cultivés et de corridors naturels permettant à de nombreuses espèces animales de prospérer. L’ETC Group, une organisation qui étudie l’innovation technologique, qualifie cette forme de créativité d’« innovation indigène » et d’« innovation coopérative28 », car les peuples indigènes ont fait d’innombrables découvertes ethnobotaniques et écologiques que les multinationales sont ensuite allées chercher pour se les approprier gratuitement et les privatiser (« biopiraterie »).
C’est en adaptant et en renouvelant de manière créativeque les commoneurs survivent. C’est dans leur nature. Ils ont l’habitude de se contenter de ce qui est disponible et d’improviser. Chez les paysans et les pauvres en Inde, il existe un mot pour désigner cette innovation : jugaad – la pratique indienne de l’innovation improvisée à partir de ce qu’on a à portée de main29. L’adaptation créative, en vérité, fait partie de la condition humaine. La lutte et le besoin obligent à la créativité comme moyen de survie.
***
Les patterns d’approvisionnement que nous avons décrits ici sont dynamiques et vivants – ce qui signifie qu’en émergent souvent de nouvelles configurations de communs. L’un des exemples récents les plus marquants est l’essor de ce que beaucoup appellent la production cosmo-locale. Les gens partagent des savoirs et des designs « légers » par le biais de l’apprentissage entre pairs et via l’Internet, mais construisent localement les objets physiques « lourds » tels que les machines, les voitures, les logements, les meubles et les appareils électroniques. Dans la communauté P2P (pair à pair), un dicton énonce : « Si c’est léger, partagez-le mondialement ; si c’est lourd, produisez-le localement. »
Ce phénomène peut prendre différentes formes. Imaginez un agriculteur cubain travaillant avec ses pairs en Inde et au Pérou pour trouver des moyens d’améliorer le rendement du riz, une pratique courante chez les agriculteurs associés au Système d’intensification du riz. Ou imaginez des designers à Amsterdam travaillant avec des ingénieurs et des architectes en Australie et aux États-Unis pour concevoir des logements modulaires à bas coût que chacun pourra construire avec des matériaux locaux. Ce type de collaboration est devenue la norme parmi les membres du réseau mondial WikiHouse. Il existe aussi une longue tradition de coopération cosmo-locale dans l’agriculture, comme en témoignent des réseaux tels que Campesino a Campesino. Il s’agit d’un projet international d’entraide autogéré que des paysans ont lancé au Guatemala au début des années 1970 en tant qu’alternative à l’aide internationale au développement30. Masipag est un autre exemple de partenariat à but non lucratif, entre des agriculteurs pauvres et des scientifiques d’institutions de recherche du monde entier, consacré à la sélection et à la culture de semences localement adaptées31.
Image 39 : Structures hétérarchiques et fédérées
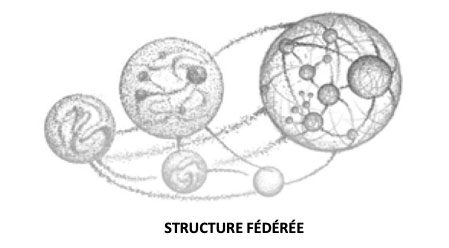
Ces dernières années, les technologies numériques ont considérablement contribué au renforcement de collaborations à l’échelle mondiale qui produisent leurs effets localement. Des communautés mondiales de concepteurs, d’ingénieurs et de programmeurs collaborent en ligne en vue de concevoir des prototypes pour toutes sortes d’équipements agricoles (tracteurs, éoliennes, motoculteurs et pulvérisateurs de terre, presses de compression pour la fabrication de briques)32, des microscopes scientifiques haut de gamme (OpenSPIM)33 et des robots voiliers pour surveiller la pollution des océans (Scoutbots)34. Toutes ces machines font l’objet de licences open source permettant de les partager. Cela signifie que tout agriculteur, chercheur scientifique ou amateur curieux qui le souhaite peut profiter de ces innovations, d’où qu’elles viennent dans le monde, pour construire ses propres outils à moindre coût à l’aide de matériaux modulaires, adaptables et d’origine locale.
Open Source Ecology, un de ces projets, conçoit divers types d’équipements et de machines agricoles libres pouvant être produits localement. Le projet a débuté en 2003 aux États-Unis et dispose maintenant de relais locaux en Allemagne, au Guatemala et d’autres endroits du monde. Un groupe d’architectes, d’ingénieurs et de concepteurs du projet WikiHouse a mis au point un « kit de construction open source » qui s’apparente à « un grand kit IKEA pour votre maison, facile à assembler et abordable ». Dans la même veine, l’Open Building Institute, une émanation d’Open Source Ecology, conçoit des maisons modulaires à bas prix, écologiques et économes en énergie, en utilisant des techniques libres, conviviales et distribuées. Ces formes remarquables de « localisme cosmopolite », selon les termes de Wolfgang Sachs35, ne pourraient pas fonctionner sans outils conviviaux.
La même dynamique d’approvisionnement cosmo-local est à l’œuvre dans le projet Wikispeed. Celui-ci vise à construire des véhicules pour la distribution du courrier ou pour un service de taxi de nouvelle génération en utilisant les principes du logiciel libre à l’échelle mondiale. On peut également citer Arduino, une communauté mondiale qui conçoit du matériel et des logiciels sous licence libre, faciles à utiliser, pour l’impression 3D, l’éducation, l’informatique portable et l’Internet des objets.
Michel Bauwens, fondateur de la Fondation P2P et principal théoricien de la production entre pairs, divise la production cosmolocale en trois étapes distinctes : les intrants, le processus et le produit. Les intrants (ressources, talent, créativité) proviennent de contributeurs volontaires qui n’ont pas à demander la permission de participer. Ils peuvent utiliser une « matière première ouverte et gratuite, libre de droits de propriété intellectuelle restrictifs, afin qu’elle puisse être librement améliorée et modifiée », écrit Bauwens36. Le processus est un système de production entre pairs ouvert et conçu pour être inclusif. « Les seuils à franchir pour participer sont faibles. Le projet propose des tâches modulaires librement disponibles, plutôt que des emplois fonctionnels. Il se dote d’un système communal de validation de la qualité et de l’excellence des alternatives », explique Bauwens.
Pour finir, le produitest mis sous licence afin de garantir que la valeur générée par le commun restera accessible à tous – là encore, sans avoir à demander la permission. Les licences couramment utilisées sont la licence publique générale pour les logiciels, les licences Creative Commons pour diverses sortes de contenus et la Peer Production License. Les communs créés par les communautés de pairs sont utilisés à leur tour pour créer une nouvelle génération de matériels et de contenus ouverts et gratuits, qui peuvent eux-mêmes être utilisés lors d’une nouvelle itération. De manière générale, la conception ouverte à l’échelle mondiale combinée avec la fabrication locale offre la possibilité de réduire la consommation de matériaux dans le processus de production et surtout l’énergie nécessaire au transport. Les auteurs d’un rapport publié en 2017 affirment que « la mutualisation et la relocalisation » sont des « réponses au problème des matériaux non renouvelables37 ».
Troisième Partie : Étendre Le Communivers
Introduction
Nous avons parcouru un long chemin. La première partie a expliqué l’importance d’un Ontochangement pour comprendre le pouvoir rebelle des communs et comment le langage est un outil indispensable pour nous aider à nous débarrasser des conceptions archaïques et à cultiver des perspectives favorables aux communs. Puis, dans la deuxième partie, nous avons présenté la triade du commoning pour expliquer comment les gens peuvent mettre en œuvre les communs en s’inspirant de patterns de vie sociale, de Gouvernance par les pairs et d’approvisionnement. Ces six premiers chapitres nous donnent une assez bonne idée de la dynamique du commoning. Ils expliquent comment, au sein des communs, les gens peuvent produire un monde libre, équitable et vivant.
Mais alors que le capitalisme vacille sous le poids de ses propres contradictions, entraîne des crises existentielles telles que l’effondrement du climat, les inégalités économiques et la violence nationaliste, une question évidente se pose à la plupart des gens : comment le Communivers peut-il s’élargir et transformer l’économie politique et la culture ? Comment changer le pouvoir d’État, le droit et la politique grâce aux communs ? Ces questions sont au centre de cette troisième partie.
Il s’avère que les patterns de la pratique des communs, en particulier la Gouvernance par les pairs, sont essentiels non seulement au sein d’un même commun, mais également pour aborder les relations entre les communs. C’est à ces deux niveaux à la fois qu’il est important de s’assembler dans la diversité autour d’objectifs partagés, de décider par consentement et de diffuser les savoirs généreusement, pour ne citer que ces quelques patterns identifiés dans la triade du commoning. Cependant, à mesure que les communs se développent et donnent naissance à un écosystème varié d’acteurs, de nouvelles complications surgissent. Chaque commun doit apprendre à se connecter et à se coordonner avec les autres sur la base de l’éthique des communs décrite dans la partie II. Cela nécessite de nouvelles formes de coopération non seulement au sein des communs (le niveau « micro »), mais aussi dans les espaces entre les communs individuels (le niveau « méso ») et dans le cadre des luttes et des négociations difficiles menées au niveau de la société tout entière (le niveau « macro »). Cette division tripartite des niveaux est trop simpliste, car les dynamiques à chaque niveau sont toutes entremêlées. C’est néanmoins une manière utile de se représenter la manière dont les communs s’inscrivent dans un contexte sociétal plus large.
Quatre stratégies sont particulièrement importantes. Premièrement, les commoneurs doivent apprendre à « arpenter les limites » de leur commun afin d’empêcher les enclosures et/ou de récupérer des richesses qui auraient été privatisées. C’est un impératif fondamental de survie. Beating the bounds, « arpenter les limites », vous vous en souvenez peut-être, est la coutume au sein de nombreux villages anglais qui consistait à parcourir le périmètre de leurs terres pour identifier toute clôture ou haie qui aurait empiété sur leur richesse commune. À notre époque, beating the bounds peut signifier résister par action directe, pratiquer la désobéissance civile contre les enclosures et tenter de les « désenclore ». L’objectif est de rétablir un certain degré de pratique des communs en ce qui concerne la terre, l’eau, les semences, le code, le travail créatif et la culture et de restaurer l’intégrité de la communauté. De telles tactiques peuvent être suivies de stratégies à plus long terme comme la promulgation de lois favorables, le développement de garanties technologiques ou l’adoption de traditions sociales protectrices. La stabilité institutionnelle et la sécurité juridique sont fondamentales.
Mais ce n’est qu’un début. À mesure que le nombre de communs dans un domaine d’activité donné augmente, il est important pour les commoneurs d’émuler et fédérer pour construire des réseaux collaboratifs plus intégrés et des infrastructures partagées. C’est l’approche utilisée par La Via Campesina, un mouvement de base décentralisé regroupant des millions de paysans, de petits exploitants, de sans-terre, de femmes et de jeunes ruraux, de peuples indigènes, de migrants et de travailleurs agricoles. Ce mouvement constitue une grande fédération transnationale flexible. De même, les exploitations agricoles allemandes équivalentes des AMAP, soutenues par la communauté (et connues sous l’acronyme allemand SoLaWi), se sont fédérées sous le nom de Netzwerk Solidarische Landwirtschaft, suite à leur croissance dans le pays. Le nombre de fermes fonctionnant sur ce modèle est passé de 2003 à 39 en 2013 et à environ 200 début 2019. L’objectif de la fédération est de permettre aux fermes individuelles d’échanger des idées, de commanditer des recherches, de développer de nouvelles initiatives, de mettre en relation commoneurs et agriculteurs, et d’écrire des logiciels libres partageables spécialement conçus pour répondre aux besoins des fermes. Dans la sphère numérique, il existe de nombreuses formes de collaboration entre communs tels les logiciels libres et open source, les licences Creative Commons, les publications scientifiques en libre accès, le mouvement des ressources éducatives ouvertes et les initiatives de données ouvertes, entre autres. Les participants d’une communauté de pratiques suivent les développements au sein d’autres communautés, comme de nouvelles interfaces utilisateur, de nouveaux protocoles de sécurité ou de nouveaux comportements de partage, et les adaptent à leurs propres besoins.
Ces fédérations, qu’elles soient organisées ou informelles, ne fonctionnent pas comme des organes représentatifs au sens traditionnel du terme. Ce sont des espaces communs où se forgent des engagements mutuels. Ce sont des hétérarchies évolutives d’assistance mutuelle, de recherche de consensus et d’action conjointe entre commoneurs. L’objectif des fédérations est de renforcer les nombreux communs individuels tout en développant des projets de collaboration en matière d’infrastructures, de financement ou d’action politique conjointe.
Au-delà des activités consistant à émuler et fédérer, il est important que les projets et les réseaux de communs poursuivent des stratégies d’intercommoning, autrement dit de commoning entre communs. C’est un processus de collaboration active et de soutien mutuel qui permet d’aider et d’inspirer les projets individuels, de donner un sens à ce qui se passe et de développer des stratégies proactives. Tout ce dont on a besoin, c’est d’un espace ouvert dans lequel des personnes qui ne se rencontreraient pas autrement puissent se réunir pour travailler librement, sur la base d’un ordre du jour qu’elles ont elles-mêmes fixé : des hackers avec des agriculteurs, par exemple, ou des personnes à faible revenu avec des « MakerSpaces », ou des militants des ressources éducatives ouvertes avec des résidents en habitat participatif. Le processus d’intercommoning permet également de construire une culture commune, en particulier lorsqu’un nouveau langage des communs prend racine.
Pourquoi tout cela est-il nécessaire ? Parce qu’autrement les dures réalités du système marché/État entraveront le développement de ces communs. Le pouvoir d’État est réel et bien établi, et il privilégie généralement les modes de production et la culture capitalistes comme la norme. Il se fait le protecteur de cadres juridiques qui légitiment la propriété privée, les transactions de marché capitalistes et les contrats entre individus. Dès lors, si l’on souhaite amorcer un Ontochangement, il faut trouver des moyens ingénieux de surmonter certains biais profondément enracinés dans l’économie capitaliste qui se reflètent dans les diverses structures du pouvoir d’État, dans la loi, les politiques publiques et l’organisation sociale des marchés.
C’est à l’évidence un défi formidable ! Cependant, la résilience de nombreux communs au fil des siècles suggère qu’ils peuvent avoir une remarquable capacité d’autoprotection et d’expansion créative. Simplement, les commoneurs ne bénéficient généralement pas du soutien du droit conventionnel, de la finance, de la technologie et du pouvoir d’État, soutien que les acteurs de l’économie de marché peuvent considérer comme acquis.
Les prochains chapitres s’embarquent donc dans une quête audacieuse. Nous essayons d’imaginer comment le pouvoir d’État et le droit pourraient commencer à apporter un véritable soutien aux communs, sur le plan tant opérationnel que structurel. Cependant, contrairement à de nombreuses propositions qui se concentrent sur la mise en place de nouvelles lois, réglementations ou politiques publiques visant à modifier les structures existantes du marché ou de l’État – ce qui ne peut qu’amener des résultats décevants –, nous proposons une stratégie radicale et ambitieuse dont l’énergie et la force proviendraient du changement ontologique et des patterns de commoning présentés ci-dessus. En d’autres termes, ni la politique ni le droit étatique ne seront les principaux moteurs du changement. Ce moteur ne peut être que la pratique des communs elle-même. Il est possible de réaliser beaucoup de choses dès maintenant sans avoir à se noyer dans les compromis, les trahisons, la cooptation et la paralysie juridique de la politique conventionnelle et de l’administration. Cela ne veut pas dire que la politique et les pouvoirs d’État puissent être ignorés ou totalement évités ; c’est simplement que la pratique des communs doit être au cœur de toute stratégie de changement. La politique doit rester un moyen en vue d’une fin, et non une fin en soi. Le meilleur moyen d’éviter les séductions de la politique et du pouvoir d’État, qui ont souvent aveuglé nos dirigeants et fait dérailler des mouvements sociaux, est de garder comme unique boussole les patterns du commoning, même pour des projets de grande envergure.
Il est naturel de se demander si le pouvoir des communs est vraiment aussi transformationnel que cela. Comment être sûr que la pratique des communs peut réellement servir de levier à une grande transition qui permettrait de passer d’un fondamentalisme de marché soutenu par l’État à quelque chose de meilleur ? La géographe Dina Hestad, de l’université d’Oxford, a étudié les caractéristiques indispensables pour que des actions et des stratégies soient socialement transformatrices. Elle a provisoirement identifié les critères suivants1 :
-
- Œuvrer à une vision qui reflète la nécessité de vivre en équilibre avec la capacité de charge de la Terre.
- Tenir compte du fait que le changement dans un système complexe ne peut être contrôlé en raison de l’incertitude.
- Éviter de déplacer les problèmes vers d’autres lieux ou à d’autres moments, ce qui pourrait empêcher un changement plus global de système.
- S’attaquer aux causes profondes de l’accélération et de la croissance – les boucles de rétroaction qui sont à l’origine de la plupart des crises écologiques et sociales actuelles.
- Travailler à des systèmes qui évitent les déséquilibres de pouvoir non contrôlés et permettent d’éviter de déclencher les circuits tribaux anciens (destructeurs) des êtres humains.
- Promouvoir la conscience de ce que les humains sont une partie d’un ensemble beaucoup plus vaste et créer des possibilités de résonance et de relations affectives significatives entre les personnes et la nature.
- Développer une action humaine saine aux niveaux indi-viduel et collectif pour transformer et co-créer notre avenir.
- Ouvrir de nouvelles possibilités d’action plutôt que de réduire nos opportunités d’agir.
- Communiquer une histoire convaincante et inspirante de changement systémique qui nomme les problèmes, identifie les leviers pertinents et trouve un écho auprès de personnes de tous horizons et de toutes idéologies.
- Promouvoir la cohésion sociale et un sentiment d’être-ensemble à différents niveaux, ce qui inclut la confiance, un sentiment d’appartenance et une volonté de participer et d’aider.
- Promouvoir la pensée critique, la générosité d’esprit et l’ou-verture d’esprit pour apprendre à partir d’idées et de perspectives diverses.
La pratique des communs, dans toute sa richesse, permet de répondre à tous ces critères. Bien sûr, toute la difficulté est dans la mise en œuvre ! En d’autres termes, il sera très difficile de renforcer et d’étendre les communs dans le contexte du couple marché/État. Mais c’est tout à fait faisable. Les quatre chapitres qui composent la partie III proposent quelques recommandations générales.
* * *
Avant de détailler nos propositions sur la manière dont le pouvoir d’État pourrait soutenir la pratique des communs, nous nous empressons d’attirer l’attention sur ce que nous ne proposons pas. Nous n’essayons pas de réimaginer la politique. Nous n’essayons pas de réinventer l’État-nation, même si c’est peut-être nécessaire. Nous n’essayons pas de détruire le capitalisme en un sens révolutionnaire classique, même si, bien sûr, toute avancée des communs diminue d’autant le pouvoir de celui-ci et représente un pas vers le moment où il sera surmonté. Les communs ont certainement beaucoup à nous dire sur ces défis, tant sur le plan philosophique que politique. Mais il ne s’agit pas de proposer un programme grandiose et de long terme, puis d’essayer d’éduquer les autres à accepter et à suivre nos prescriptions. Cette approche ignore la sagesse profonde des communs, qui accepte l’idée d’actes de commoning distribués, locaux et divers, dont la vitalité même produit la créativité et l’engagement nécessaires pour élaborer des solutions adaptées à chaque contexte.
En ce sens, l’objectif à long terme doit être celui d’une émergence par la pratique des communs. Notre priorité doit être de développer la capacité de penser comme un commoneur et de faire croître le Communivers, autant que possible dès maintenant, en plantant des graines de culture, de pratique sociale et de pouvoir institutionnel qui puissent se développer dans la plénitude du temps. C’est d’ailleurs ce déploiement progressif de l’éthique des communs qui la rend si résistante. C’est cette dynamique que nous devons honorer et développer plutôt que de nous lancer prématurément ou naïvement dans des assauts frontaux contre un système de marché/État bien fortifié, cette stratégie étant vouée à l’échec.
La porte d’entrée la plus naturelle pour la coopération entre le pouvoir d’État et les commoneurs est le niveau local. Dans les contextes politiques de petite échelle, les gouvernants tendent à être moins motivés par l’idéologie ou la politique politicienne que par les simples questions pratiques – qu’est-ce qui fonctionne ? Au niveau local, les hommes politiques ne peuvent pas si facilement ignorer les besoins ni se cacher derrière une doctrine. En outre, les gens peuvent plus facilement faire entendre leur voix au niveau local et faire pression sur leurs dirigeants pour qu’ils innovent, comme le montre le mouvement florissant de « La ville comme commun » en Europe et les dizaines d’initiatives de communs urbains documentées par le magazine Shareable2. Ce n’est pas un hasard si les mots « communs » et « municipalité » partagent la même étymologie, avec comme racine le mot latin munus, qui signifie à la fois « don » et « devoir ». Notre défi consiste à trouver des moyens de réinventer cette éthique dans le cadre des structures étatiques modernes plus vastes où nous sommes inexorablement empêtrés.
Troisième Partie Étendre Le Communivers
Introduction
Nous avons parcouru un long chemin. La première partie a expliqué l’importance d’un Ontochangement pour comprendre le pouvoir rebelle des communs et comment le langage est un outil indispensable pour nous aider à nous débarrasser des conceptions archaïques et à cultiver des perspectives favorables aux communs. Puis, dans la deuxième partie, nous avons présenté la triade du commoning pour expliquer comment les gens peuvent mettre en œuvre les communs en s’inspirant de patterns de vie sociale, de Gouvernance par les pairs et d’approvisionnement. Ces six premiers chapitres nous donnent une assez bonne idée de la dynamique du commoning. Ils expliquent comment, au sein des communs, les gens peuvent produire un monde libre, équitable et vivant.
Mais alors que le capitalisme vacille sous le poids de ses propres contradictions, entraîne des crises existentielles telles que l’effondrement du climat, les inégalités économiques et la violence nationaliste, une question évidente se pose à la plupart des gens : comment le Communivers peut-il s’élargir et transformer l’économie politique et la culture ? Comment changer le pouvoir d’État, le droit et la politique grâce aux communs ? Ces questions sont au centre de cette troisième partie.
Il s’avère que les patterns de la pratique des communs, en particulier la Gouvernance par les pairs, sont essentiels non seulement au sein d’un même commun, mais également pour aborder les relations entre les communs. C’est à ces deux niveaux à la fois qu’il est important de s’assembler dans la diversité autour d’objectifs partagés, de décider par consentement et de diffuser les savoirs généreusement, pour ne citer que ces quelques patterns identifiés dans la triade du commoning. Cependant, à mesure que les communs se développent et donnent naissance à un écosystème varié d’acteurs, de nouvelles complications surgissent. Chaque commun doit apprendre à se connecter et à se coordonner avec les autres sur la base de l’éthique des communs décrite dans la partie II. Cela nécessite de nouvelles formes de coopération non seulement au sein des communs (le niveau « micro »), mais aussi dans les espaces entre les communs individuels (le niveau « méso ») et dans le cadre des luttes et des négociations difficiles menées au niveau de la société tout entière (le niveau « macro »). Cette division tripartite des niveaux est trop simpliste, car les dynamiques à chaque niveau sont toutes entremêlées. C’est néanmoins une manière utile de se représenter la manière dont les communs s’inscrivent dans un contexte sociétal plus large.
Quatre stratégies sont particulièrement importantes. Premièrement, les commoneurs doivent apprendre à « arpenter les limites » de leur commun afin d’empêcher les enclosures et/ou de récupérer des richesses qui auraient été privatisées. C’est un impératif fondamental de survie. Beating the bounds, « arpenter les limites », vous vous en souvenez peut-être, est la coutume au sein de nombreux villages anglais qui consistait à parcourir le périmètre de leurs terres pour identifier toute clôture ou haie qui aurait empiété sur leur richesse commune. À notre époque, beating the bounds peut signifier résister par action directe, pratiquer la désobéissance civile contre les enclosures et tenter de les « désenclore ». L’objectif est de rétablir un certain degré de pratique des communs en ce qui concerne la terre, l’eau, les semences, le code, le travail créatif et la culture et de restaurer l’intégrité de la communauté. De telles tactiques peuvent être suivies de stratégies à plus long terme comme la promulgation de lois favorables, le développement de garanties technologiques ou l’adoption de traditions sociales protectrices. La stabilité institutionnelle et la sécurité juridique sont fondamentales.
Mais ce n’est qu’un début. À mesure que le nombre de communs dans un domaine d’activité donné augmente, il est important pour les commoneurs d’émuler et fédérer pour construire des réseaux collaboratifs plus intégrés et des infrastructures partagées. C’est l’approche utilisée par La Via Campesina, un mouvement de base décentralisé regroupant des millions de paysans, de petits exploitants, de sans-terre, de femmes et de jeunes ruraux, de peuples indigènes, de migrants et de travailleurs agricoles. Ce mouvement constitue une grande fédération transnationale flexible. De même, les exploitations agricoles allemandes équivalentes des AMAP, soutenues par la communauté (et connues sous l’acronyme allemand SoLaWi), se sont fédérées sous le nom de Netzwerk Solidarische Landwirtschaft, suite à leur croissance dans le pays. Le nombre de fermes fonctionnant sur ce modèle est passé de 2003 à 39 en 2013 et à environ 200 début 2019. L’objectif de la fédération est de permettre aux fermes individuelles d’échanger des idées, de commanditer des recherches, de développer de nouvelles initiatives, de mettre en relation commoneurs et agriculteurs, et d’écrire des logiciels libres partageables spécialement conçus pour répondre aux besoins des fermes. Dans la sphère numérique, il existe de nombreuses formes de collaboration entre communs tels les logiciels libres et open source, les licences Creative Commons, les publications scientifiques en libre accès, le mouvement des ressources éducatives ouvertes et les initiatives de données ouvertes, entre autres. Les participants d’une communauté de pratiques suivent les développements au sein d’autres communautés, comme de nouvelles interfaces utilisateur, de nouveaux protocoles de sécurité ou de nouveaux comportements de partage, et les adaptent à leurs propres besoins.
Ces fédérations, qu’elles soient organisées ou informelles, ne fonctionnent pas comme des organes représentatifs au sens traditionnel du terme. Ce sont des espaces communs où se forgent des engagements mutuels. Ce sont des hétérarchies évolutives d’assistance mutuelle, de recherche de consensus et d’action conjointe entre commoneurs. L’objectif des fédérations est de renforcer les nombreux communs individuels tout en développant des projets de collaboration en matière d’infrastructures, de financement ou d’action politique conjointe.
Au-delà des activités consistant à émuler et fédérer, il est important que les projets et les réseaux de communs poursuivent des stratégies d’intercommoning, autrement dit de commoning entre communs. C’est un processus de collaboration active et de soutien mutuel qui permet d’aider et d’inspirer les projets individuels, de donner un sens à ce qui se passe et de développer des stratégies proactives. Tout ce dont on a besoin, c’est d’un espace ouvert dans lequel des personnes qui ne se rencontreraient pas autrement puissent se réunir pour travailler librement, sur la base d’un ordre du jour qu’elles ont elles-mêmes fixé : des hackers avec des agriculteurs, par exemple, ou des personnes à faible revenu avec des « MakerSpaces », ou des militants des ressources éducatives ouvertes avec des résidents en habitat participatif. Le processus d’intercommoning permet également de construire une culture commune, en particulier lorsqu’un nouveau langage des communs prend racine.
Pourquoi tout cela est-il nécessaire ? Parce qu’autrement les dures réalités du système marché/État entraveront le développement de ces communs. Le pouvoir d’État est réel et bien établi, et il privilégie généralement les modes de production et la culture capitalistes comme la norme. Il se fait le protecteur de cadres juridiques qui légitiment la propriété privée, les transactions de marché capitalistes et les contrats entre individus. Dès lors, si l’on souhaite amorcer un Ontochangement, il faut trouver des moyens ingénieux de surmonter certains biais profondément enracinés dans l’économie capitaliste qui se reflètent dans les diverses structures du pouvoir d’État, dans la loi, les politiques publiques et l’organisation sociale des marchés.
C’est à l’évidence un défi formidable ! Cependant, la résilience de nombreux communs au fil des siècles suggère qu’ils peuvent avoir une remarquable capacité d’autoprotection et d’expansion créative. Simplement, les commoneurs ne bénéficient généralement pas du soutien du droit conventionnel, de la finance, de la technologie et du pouvoir d’État, soutien que les acteurs de l’économie de marché peuvent considérer comme acquis.
Les prochains chapitres s’embarquent donc dans une quête audacieuse. Nous essayons d’imaginer comment le pouvoir d’État et le droit pourraient commencer à apporter un véritable soutien aux communs, sur le plan tant opérationnel que structurel. Cependant, contrairement à de nombreuses propositions qui se concentrent sur la mise en place de nouvelles lois, réglementations ou politiques publiques visant à modifier les structures existantes du marché ou de l’État – ce qui ne peut qu’amener des résultats décevants –, nous proposons une stratégie radicale et ambitieuse dont l’énergie et la force proviendraient du changement ontologique et des patterns de commoning présentés ci-dessus. En d’autres termes, ni la politique ni le droit étatique ne seront les principaux moteurs du changement. Ce moteur ne peut être que la pratique des communs elle-même. Il est possible de réaliser beaucoup de choses dès maintenant sans avoir à se noyer dans les compromis, les trahisons, la cooptation et la paralysie juridique de la politique conventionnelle et de l’administration. Cela ne veut pas dire que la politique et les pouvoirs d’État puissent être ignorés ou totalement évités ; c’est simplement que la pratique des communs doit être au cœur de toute stratégie de changement. La politique doit rester un moyen en vue d’une fin, et non une fin en soi. Le meilleur moyen d’éviter les séductions de la politique et du pouvoir d’État, qui ont souvent aveuglé nos dirigeants et fait dérailler des mouvements sociaux, est de garder comme unique boussole les patterns du commoning, même pour des projets de grande envergure.
Il est naturel de se demander si le pouvoir des communs est vraiment aussi transformationnel que cela. Comment être sûr que la pratique des communs peut réellement servir de levier à une grande transition qui permettrait de passer d’un fondamentalisme de marché soutenu par l’État à quelque chose de meilleur ? La géographe Dina Hestad, de l’université d’Oxford, a étudié les caractéristiques indispensables pour que des actions et des stratégies soient socialement transformatrices. Elle a provisoirement identifié les critères suivants1 :
-
- Œuvrer à une vision qui reflète la nécessité de vivre en équilibre avec la capacité de charge de la Terre.
- Tenir compte du fait que le changement dans un système complexe ne peut être contrôlé en raison de l’incertitude.
- Éviter de déplacer les problèmes vers d’autres lieux ou à d’autres moments, ce qui pourrait empêcher un changement plus global de système.
- S’attaquer aux causes profondes de l’accélération et de la croissance – les boucles de rétroaction qui sont à l’origine de la plupart des crises écologiques et sociales actuelles.
- Travailler à des systèmes qui évitent les déséquilibres de pouvoir non contrôlés et permettent d’éviter de déclencher les circuits tribaux anciens (destructeurs) des êtres humains.
- Promouvoir la conscience de ce que les humains sont une partie d’un ensemble beaucoup plus vaste et créer des possibilités de résonance et de relations affectives significatives entre les personnes et la nature.
- Développer une action humaine saine aux niveaux indi-viduel et collectif pour transformer et co-créer notre avenir.
- Ouvrir de nouvelles possibilités d’action plutôt que de réduire nos opportunités d’agir.
- Communiquer une histoire convaincante et inspirante de changement systémique qui nomme les problèmes, identifie les leviers pertinents et trouve un écho auprès de personnes de tous horizons et de toutes idéologies.
- Promouvoir la cohésion sociale et un sentiment d’être-ensemble à différents niveaux, ce qui inclut la confiance, un sentiment d’appartenance et une volonté de participer et d’aider.
- Promouvoir la pensée critique, la générosité d’esprit et l’ou-verture d’esprit pour apprendre à partir d’idées et de perspectives diverses.
La pratique des communs, dans toute sa richesse, permet de répondre à tous ces critères. Bien sûr, toute la difficulté est dans la mise en œuvre ! En d’autres termes, il sera très difficile de renforcer et d’étendre les communs dans le contexte du couple marché/État. Mais c’est tout à fait faisable. Les quatre chapitres qui composent la partie III proposent quelques recommandations générales.
* * *
Avant de détailler nos propositions sur la manière dont le pouvoir d’État pourrait soutenir la pratique des communs, nous nous empressons d’attirer l’attention sur ce que nous ne proposons pas. Nous n’essayons pas de réimaginer la politique. Nous n’essayons pas de réinventer l’État-nation, même si c’est peut-être nécessaire. Nous n’essayons pas de détruire le capitalisme en un sens révolutionnaire classique, même si, bien sûr, toute avancée des communs diminue d’autant le pouvoir de celui-ci et représente un pas vers le moment où il sera surmonté. Les communs ont certainement beaucoup à nous dire sur ces défis, tant sur le plan philosophique que politique. Mais il ne s’agit pas de proposer un programme grandiose et de long terme, puis d’essayer d’éduquer les autres à accepter et à suivre nos prescriptions. Cette approche ignore la sagesse profonde des communs, qui accepte l’idée d’actes de commoning distribués, locaux et divers, dont la vitalité même produit la créativité et l’engagement nécessaires pour élaborer des solutions adaptées à chaque contexte.
En ce sens, l’objectif à long terme doit être celui d’une émergence par la pratique des communs. Notre priorité doit être de développer la capacité de penser comme un commoneur et de faire croître le Communivers, autant que possible dès maintenant, en plantant des graines de culture, de pratique sociale et de pouvoir institutionnel qui puissent se développer dans la plénitude du temps. C’est d’ailleurs ce déploiement progressif de l’éthique des communs qui la rend si résistante. C’est cette dynamique que nous devons honorer et développer plutôt que de nous lancer prématurément ou naïvement dans des assauts frontaux contre un système de marché/État bien fortifié, cette stratégie étant vouée à l’échec.
La porte d’entrée la plus naturelle pour la coopération entre le pouvoir d’État et les commoneurs est le niveau local. Dans les contextes politiques de petite échelle, les gouvernants tendent à être moins motivés par l’idéologie ou la politique politicienne que par les simples questions pratiques – qu’est-ce qui fonctionne ? Au niveau local, les hommes politiques ne peuvent pas si facilement ignorer les besoins ni se cacher derrière une doctrine. En outre, les gens peuvent plus facilement faire entendre leur voix au niveau local et faire pression sur leurs dirigeants pour qu’ils innovent, comme le montre le mouvement florissant de « La ville comme commun » en Europe et les dizaines d’initiatives de communs urbains documentées par le magazine Shareable2. Ce n’est pas un hasard si les mots « communs » et « municipalité » partagent la même étymologie, avec comme racine le mot latin munus, qui signifie à la fois « don » et « devoir ». Notre défi consiste à trouver des moyens de réinventer cette éthique dans le cadre des structures étatiques modernes plus vastes où nous sommes inexorablement empêtrés.
VII. Repenser La Propriété
Visiter le centre de Florence aujourd’hui, c’est se promener au milieu de dizaines de bâtiments et de places publiques datant du xive au xviiie siècle, restaurés avec soin (la Galleria dell’Accademia où se trouve la statue de David de Michel-Ange, le musée des Offices et ses œuvres d’art inestimables), de cafés hors de prix et de boutiques de souvenirs criardes qui font le bonheur des touristes. Mais regardez de plus près, juste derrière l’abside de l’église del Carmine, de l’autre côté de l’Arno, là où la Renaissance a commencé, et vous découvrirez la dernière partie de la vieille ville qui n’a pas encore été transformée en un Disneyland de la Renaissance.
Ce quartier, la paroisse de San Frediano, n’est qu’à quelques pas du mondialement célèbre Ponte Vecchio. Bien qu’il se trouve dans une zone gentrifiée, le visiteur qui tombera inopinément sur le jardin communautaire de Nidiaci découvrira, surtout l’aprèsmidi, une oasis de verdure remplie d’enfants énergiques et bruyants accompagnés de leurs parents. Des enfants de 6 ans turbulents courent sur le terrain et jouent sur des balançoires pendant que leurs frères plus âgés suivent des leçons dans la seule école de football autogérée de la ville, « les Lebowskis ». Certains jours, un musicien portugais qui vit à proximité apprend le violon aux enfants. D’autres jours, un écrivain britannique enseigne l’anglais dans un studio situé sur le terrain. Des familles organisent des échanges gratuits de vêtements d’enfants usagés. Certains résidents cultivent un petit potager. D’autres ont mis en place un projet de surveillance de la pollution et de la circulation automobile.
Cet espace de convivialité, niché dans un coin du centre-ville, est géré comme un commun. Son utilisation « dépend de ce que les gens décident d’y mettre, explique Miguel Martinez, historien amateur du jardin de Nidiaci. Il est difficile de dire ce que nous y faisons, car tout dépend de ce que les nouveaux arrivants veulent créer ». Mais dans un quartier où environ 40 % des enfants sont issus de familles nées à l’étranger, le simple fait d’avoir un espace à partager n’est pas une mince affaire.
Comment est-il possible, demanderez-vous, que ce bel endroit en plein centre de Florence – qui vaudrait facilement plusieurs millions d’euros sur le marché immobilier – n’ait pas encore été vendu au plus offrant et transformé en appartements de luxe ? Comment se fait-il qu’il soit effectivement géré par un groupe de voisins ? En cherchant des réponses à ces questions, nous avons énormément appris sur la façon dont le droit de la propriété pouvait être utilisé pour autre chose que l’achat et la vente de biens immobiliers – pour aider les gens à mener une vie communautaire plus satisfaisante.
Grâce aux recherches menées avec ténacité par certains habitants du quartier dans les années 1990, un document légal datant des années 1920 a été retrouvé, démontrant que le terrain était censé être géré au profit des enfants. Les familles du quartier de San Frediano ont organisé des manifestations publiques en 2011 pour tenter de rétablir la fiducie, sans succès. Cependant, la Ville – désireuse de faire des économies et piquée au vif par les protestations des habitants – a accepté de laisser les résidents gérer eux-mêmes le jardin, à leurs risques, à leurs frais et en en assumant toute la responsabilité. Une association de quartier a été créée pour signer une convention avec la Ville afin de mettre l’espace à la disposition des gens, sans frais pour l’administration municipale. Cette convention ressemble à d’autres accords similaires conclus pour d’autres jardins de quartier à Florence, dans lesquels les résidents sont autorisés à agir en tant que responsables des jardins, mais, ici, la municipalité s’est réservé le droit de révoquer l’accès à tout moment par une décision non susceptible d’appel. La pratique des communs dans le jardin de Nidiaci peut se poursuivre, mais elle reste juridiquement vulnérable – comme le sont d’innombrables communs à travers le monde.
Il existe des milliers d’histoires comme celle-ci de gens qui tentent de trouver une protection juridique pour les communs. Ces histoires diffèrent entre elles, mais sont généralement similaires sous au moins deux aspects. Premièrement, les formes juridiques sont importantes car elles privilégient certaines utilisations des choses qui nous entourent et certaines relations sociales. Deuxièmement, la réalité sociale de la pratique des communs doit précéder toute forme de propriété. La reconquête du jardin Nidiaci n’a pu avoir lieu que parce que les habitants du quartier se sont organisés pour faire pression en faveur de solutions juridiques et politiques adaptées. Les formes juridiques sont importantes car, comme on le voit dans l’histoire du jardin de Nidiaci, une fiducie peut être un meilleur véhicule juridique que la propriété publique pour faire avancer les objectifs du donateur et des habitants du quartier. Mais même si les habitants de Nidiaci ont obtenu gain de cause en un sens (la pratique des communs y est désormais possible), ils ont fini par comprendre qu’il n’existait pas vraiment de forme de droit de propriété approprié pour protéger les relations sociales qu’ils souhaitaient cultiver.
C’est souvent le cas. Les commoneurs doivent généralement recourir à des formes juridiques « étrangères » pour protéger leur richesse commune et leur culture communautaire. Par exemple, les programmeurs de logiciels qui voulaient s’assurer que leur code pourrait être partagé et modifié par n’importe qui – logiciel libre et open source – ont découvert qu’ils devaient procéder à un « piratage juridique » de la loi sur le droit d’auteur, qui est normalement utilisée pour transformer les œuvres créatives en propriété privée. Lorsque l’entrepreneur américain Douglas Tompkins a voulu préserver plus de 800 000 hectares de nature sauvage au Chili et en Argentine, il n’a trouvé aucun instrument juridique permettant de les gérer comme des communs. Il a dû acheter les terres en tant que propriété privée pour en faire don à une fiducie foncière privée qui les a ensuite cédées aux gouvernements de ces deux pays pour qu’ils les gèrent comme des biens publics. Il arrive qu’un groupe d’agriculteurs fasse d’un restaurant local leur lieu de rencontre préféré, ou que les motards et les fans de football d’une ville donnée fassent d’un certain bar leur lieu de prédilection. Mais les propriétaires de ces établissements commerciaux privés peuvent avoir leurs propres idées sur la gestion de ces communs sociaux de fait, ce qui entraîne parfois des tensions entre propriétaires et clients.
Comme le suggèrent ces exemples, le droit de propriété et la pratique des communs ne sont généralement pas faits l’un pour l’autre. C’est plus ou moins le problème auquel les commoneurs de Nidiaci ont été confrontés : ils n’ont pas été en mesure d’acquérir un titre de propriété clair sur la terre ou d’obtenir un véhicule juridique qui reconnaisse leurs pratiques vernaculaires. Mais ils ont eu de la chance : ils ont pu conclure un accord qui leur permet d’utiliser et de gouverner par les pairs l’espace au bénéfice des enfants et des familles. Ils ont obtenu l’autorisation légale du gouvernement municipal et, pour les besoins de la pratique des communs, c’était suffisant, du moins à court terme. Mais ce n’est certainement pas une solution juridique fiable sur le long terme. Confrontés aux cadres existants du droit de la propriété, les commoneurs qui souhaitent légaliser leur Gouvernance par les pairs n’ont guère d’autre choix que d’essayer de modifier la loi de manière créative ou de s’appuyer sur la pression politique, la mobilisation sociale ou la désobéissance civile1.
Cela n’a rien de surprenant. Les gardiens de l’ordre économique et social dominant considèrent naturellement le droit de propriété comme un instrument au service de leurs intérêts. Selon l’historien E. P. Thompson, lorsque le capitalisme naissant a enclos les communs et supplanté les pratiques coutumières, « l’économie politique a aidé et a encouragé la loi2 ». Le droit de propriété a été un outil essentiel de dépossession. Une dynamique similaire est à l’œuvre de nos jours, comme en témoignent les lois sur le droit d’auteur qui verrouillent les résultats de la recherche qui les a produits, les lois sur les brevets qui interdisent aux agriculteurs le partage de leurs semences, ou encore les grandes entreprises qui ravagent les écosystèmes pour extraire des énergies fossiles. Comme l’a écrit le grand politologue et philosophe C. B. Macpherson :
En effet, lorsque le droit de propriété libéral est inscrit dans la loi en tant que droit individuel à l’utilisation et à la disposition exclusives de parcelles de ressources fournies par la nature ou de parcelles de capital créées par le travail consacré à ces ressources, et lorsqu’il est combiné au système libéral d’incitations de marché et aux droits de liberté de contrat, il conduit et participe à une concentration de la propriété et à un système de relations de pouvoir […] qui nie l’objectif éthique d’un développement individuel libre et indépendant3.
En un mot, la combinaison du droit de propriété avec les marchés capitalistes et la garantie étatique de l’exécution des contrats a créé un puissant récit de liberté – mais une liberté principalement réservée aux possesseurs. Si nous voulons vraiment être libres et si nous souhaitons qu’il en aille de même pour tout un chacun, nous devons repenser la propriété.
Il s’agit, bien sûr, d’un sujet très vaste et compliqué. Il n’est pas facile d’imaginer comment nous pourrions subordonner les droits de propriété aux besoins de notre société et de nos écosystèmes en renversant le pouvoir qu’a la propriété négociable de dicter ses conditions à quasiment tout. Les chapitres 7 et 8 sont consacrés à cet ambitieux défi. Nous commencerons par revisiter certaines dimensions fondamentales de la propriété longtemps négligées ou ignorées, mais de grande importance pour la pratique des communs. Puis, au chapitre 8, nous explorerons les possibilités et les moyens de « relationaliser » la propriété. Il ne s’agit pas d’abandonner le droit de la propriété en tant que tel, mais de situer les choses que nous utilisons (que la loi qualifie parfois de « propriété ») dans un réseau de relations riches, diverses et porteuses de sens – sociales, économiques, écologiques, et temporelles4. Les concepts juridiques de possession, de coutume et d’inaliénabilité sont importants pour nous aider à repenser le sens de la propriété.
Pour ce faire, il est essentiel de bien comprendre cette idée fondamentale : la propriété est relationnelle, et non un simple objet. Cette intuition rend possible une discussion plus riche et plus réaliste sur la façon dont la propriété nous affecte réellement, nous et le monde. Nous devons également reconnaître que les formes familières de propriété collective – fiducies, coopératives, partenariats, organisations à but non lucratif – peuvent certes accomplir de grandes choses, mais qu’elles n’arrivent pas à surmonter les préjugés structurels inhérents à la propriété elle-même : le droit d’exclure, la dépendance excessive envers les marchés, l’habitude de confondre valeur et prix, ou encore le pouvoir des propriétaires de dicter la façon dont la nature et les gens seront traités5.
Dans ce chapitre, nous chercherons également à préciser pourquoi la notion de possession est si importante pour les communs. En un sens existentiel, il n’est pas possible de ne pas posséder. Mais quelque chose d’intéressant se produit lorsque nous possédons. En tant qu’utilisateurs directs de l’eau, de la terre, du bois, du sol, des paysages, des graines et de bien d’autres choses, nous développons des connaissances et de l’attachement, un sens de la responsabilité, mais aussi des savoirs situés sur la ressource – suffisamment pour en faire une richesse-soin. De telles attitudes sont moins susceptibles de se développer parmi les propriétaires qui se concentrent sur la valeur d’échange de leur propriété.
Méditant ainsi sur la notion de possession, nous pourrons commencer à envisager des manières d’avoir qui ne sont peut-être pas officiellement sanctionnées par le droit (comme le jardin Nidiaci), mais qui n’en sont pas moins tout à fait fonctionnelles et effectives. De plus, nous pourrons commencer à réfléchir à la manière dont les lois des États pourraient reconnaître ou faciliter ces autres modes de possession, de collaboration, de partage et de pratique des communs. Ces manières d’avoir et d’utiliser sont ce que nous appelons la Propriété relationalisée – un sujet que nous développerons au chapitre 8.
Enfin, nous examinerons en quoi l’inaliénabilité est essentielle à toute vision de gestion responsable par la pratique des communs. L’inaliénabilité renvoie à l’idée qu’il est éthiquement choquant de s’approprier et de vendre certaines choses précieuses. Nous, les modernes, créatures du marché, considérons généralement cette idée comme archaïque. Mais l’histoire juridique de l’inaliénabilité, en particulier sous l’Empire romain, montre comment l’interdiction de l’aliénation permet à toutes sortes de relations vitales de s’épanouir, précisément parce que des limites sont fixées à l’activité de marché.
MOI, MA LIBERTÉ ET MA PROPRIÉTÉ
Il n’est pas exagéré de dire que nos idées sur la propriété expriment aussi une certaine vision de ce qu’est une personne – une vision qui rayonne dans les recoins les plus profonds de la société, affectant nos identités et nos relations sociales, nos transactions commerciales, notre comportement institutionnel et notre traitement de la nature. Margaret Jane Radin, spécialiste du droit de la propriété, écrit : « Le principe qui sous-tend la perspective de la personnalité est que, pour se développer correctement – pour être une personne –, un individu doit avoir un certain contrôle sur les ressources de l’environnement extérieur. Les garanties de contrôle nécessaires prennent la forme de droits de propriété6. » Mais la propriété n’est pas seulement le reflet de notre sens de ce que doit être un être humain, c’est aussi un instrument juridique de nos relations sociales. Un vaste appareil de marché confirme et renforce chaque jour une culture fondée sur des normes de propriété. Ainsi, la façon dont nous pensons juridiquement la propriété détermine largement les relations sociales réelles que nous pouvons imaginer et développer. Bien sûr, cela se produit également dans d’autres domaines de la vie : la façon dont nous pensons l’« économie » détermine également nos relations mutuelles.
Au cours des deux cent cinquante dernières années, les notions modernes libérales de la propriété ont été au fondement même de notre archétype général de la personne. John Locke, Thomas Hobbes et les autres premiers théoriciens de l’État moderne et des droits de propriété libéraux sont partis du présupposé que c’est l’individu qui compte le plus et que chacun est « propriétaire de sa personne et de ses capacités7 ». La majeure partie de la culture occidentale a adopté l’idée selon laquelle la liberté est l’« absence de dépendance à l’égard de la volonté d’autrui » et une « fonction de la possession. La société convient à un ensemble d’individus libres et égaux, liés les uns aux autres en tant que propriétaires de leurs propres capacités et de ce qu’ils ont acquis par leur exercice. La société est constituée par l’échange entre les propriétaires8 ».
Ce catéchisme moderne de la liberté a contribué à enraciner un idéal culturel d’autonomie individuelle et de propriété individuelle. L’être humain est conçu comme un moi-isolé, doté d’une liberté absolue qui s’exprime par la propriété. Il s’agit d’un monde dans lequel nous sommes des individus déconnectés de tout le reste – communauté, tradition, ethnie, religion, nature. Dans un tel monde, la propriété constitue un soutien institutionnel à la liberté de l’individu totalement autonome. Ces trois idées – l’individu, les droits de propriété et la liberté – sont devenues les piliers de l’idéologie du marché libre et de la civilisation occidentale. Le lien entre ces trois idées définit un espace dans lequel les droits de propriété individuelle sont considérés comme déterminant « la liberté réelle et la perspective réelle de réaliser toutes les potentialités » des individus9. Une fois que ce lien a été établi comme la théorie politique dominante – le libéralisme moderne –, il a été ancré dans la nature même de l’individu, comme s’il avait toujours été là et n’avait pas été créé culturellement. Il a été présenté comme un fait évident et universel.
En légitimant cette vision de l’humanité, le droit moderne de la propriété fonctionne comme un système massif d’ingénierie sociale. Il favorise les utilisations instrumentales et commerciales de la nature. Il encourage le traitement des êtres humains comme force de travail marchandisée et l’intériorisation de ces normes en apprenant aux gens à se vendre sur le marché du travail. Il crée des raretés artificielles à travers le droit d’auteur et le droit des brevets pour créer de toutes pièces des marchés qui n’existeraient pas autrement. Le droit de la propriété, tel qu’il existe aujourd’hui, privilégie systématiquement l’individu par rapport au collectif, le contrôle égoïste par rapport aux relations et la valeur d’échange par rapport à la valeur intrinsèque ou d’usage. On pourrait dire que ce sont les prémisses mêmes du droit de la propriété qui dictent ces objectifs. Cela rend d’autant plus difficile d’imaginer des systèmes juridiques qui refléteraient un éventail plus large de valeurs humaines, de pratiques et d’organisations sociales. Comment, dès lors, initier un Ontochangement (tel qu’il est envisagé au chapitre 2) et conceptualiser une propriété fondée sur une nouvelle approche de la valeur plus favorable à la vie ?
LA PROPRIÉTÉ EST RELATIONNELLE
Dès lors que nous reconnaissons notre condition d’êtres humains liés les uns aux autres, il devient évident que le postulat par défaut du droit de propriété – à savoir que chacun est absolument autonome et séparé des autres et de la Terre – est extrêmement problématique, voire absurde. Les trois piliers de la société libérale moderne – 1) l’individu isolé et 2) les droits de propriété comme base de 3) la « liberté contractuelle » – reflètent une vision assez grossière et étroite de l’épanouissement humain et de l’ordre social.
Si nous acceptons notre interconnexion fondamentale et si nous la prenons au sérieux, nous devons donc commencer à imaginer de nouveaux types d’arrangements institutionnels et de propriété. Si nous pensons que l’idéal culturel de l’individu libertarien est un fantasme, il faut repenser les concepts mêmes de « liberté » et de « propriété » tels qu’ils sont compris actuellement. L’idée que l’individualisme sans limites est véritablement libérateur, que les droits de propriété sont le meilleur garant de la liberté et du bien-être social, et que nous pouvons continuer à rechercher la croissance économique dans un monde de limites écologiques – tout cela doit être entièrement réévalué.
Les préjugés de la pensée moderne de la propriété ne datent pas d’hier. Dans son célèbre traité de 1753 sur la propriété, le juriste anglais William Blackstone écrivait : « Il n’y a rien qui frappe si généralement l’imagination, et engage les affections de l’humanité, comme le droit de propriété, cette domination unique et despotique qu’un homme revendique et exerce sur les choses extérieures du monde, à l’exclusion totale du droit de tout autre individu dans l’univers10. » Bien sûr, cette représentation d’un individu comme un propriétaire obsessionnel et égocentrique est quelque peu caricaturale. De plus, Blackstone n’envisage la propriété que sous la forme d’un objet – une idée qui est devenue courante dans les contextes occidentaux modernes. La seule relation pertinente que vise la propriété semble être la relation entre une personne et une chose : « Cette bicyclette m’appartient. Je suis son propriétaire. » Parce que le droit de la propriété privilégie l’idée de l’individu isolé et déconnecté et de la propriété-objet, il a du mal à comprendre les relations qui sont au cœur de la pratique des communs et, de fait, de la vie elle-même.
La citation de Blackstone est intéressante pour une autre raison encore. Le célèbre juriste note sans ambages que l’on est soit propriétaire, soit non propriétaire, ce qui signifie que les droits de propriété créent d’abord une frontière sociale. L’affirmation « Cette bicyclette est à moi. Je suis son propriétaire » est plus précisément comprise comme « Cette bicyclette est à moi, donc je peux décider si tu peux l’utiliser ou non ». Le lien juridique entre moi et la bicyclette privilégie mes droits et nie ceux d’autrui. En d’autres termes, le lien juridique (la propriété) façonne et détermine profondément les relations sociales. Le droit de propriété détermine qui peut décider de l’utilisation de la bicyclette – si celle-ci peut être vendue, détruite, modifiée, utilisée en commun ou gardée dans un garage, et dans quelles conditions. La propriété légale détermine tout, mais surtout le droit d’exclure. La manière dont nous construisons et appliquons les droits de propriété en dit en réalité beaucoup plus sur nous et sur nos relations avec les autres que sur nos relations avec la chose possédée.
Il y a, bien sûr, certaines exceptions importantes à la liberté illimitée de la propriété « unique et despotique ». Les propriétaires de terrains, par exemple, sont soumis à des lois de zonage qui restreignent l’utilisation des parcelles. Les lois sur les nuisances les empêchent de faire trop de bruit ou de brûler des feuilles. Le Code du bâtiment protège la santé et la sécurité. Et ainsi de suite. Malgré ces limitations, la présomption selon laquelle les droits de propriété confèrent une domination absolue reste néanmoins la norme par défaut. Mais il en résulte un casse-tête permanent. Dans la vie réelle, les droits de propriété de chacun ne peuvent pas être absolus, et chacun entre donc inévitablement en conflit avec d’autres à propos de l’étendue effective de ses droits. Ces conflits ne peuvent être résolus par le seul droit, mais uniquement par des décisions politiques. Ce qui est permis et interdit aux propriétaires et à tous les autres est essentiellement une « détermination politique, et non une question de raisonnement déductif neutre » de la part des tribunaux, note un spécialiste du droit11. Le droit reflète l’ordre politique et économique.
La Constitution de la République fédérale d’Allemagne, connue sous le nom de Grundgesetz, contient en fait une disposition (au paragraphe 14.2) qui stipule : « La propriété entraîne des obligations. Son utilisation doit aussi servir le bien public12. » Le philosophe qui a fourni ses principaux arguments au droit contemporain de la propriété, John Locke, reconnaît tacitement les implications sociales de la propriété individuelle quand il stipule qu’un droit de propriété n’est légitime que « s’il y a assez, et d’aussi bonne qualité, laissé en commun pour les autres13 ». Cette « clause lockéenne », comme elle est parfois appelée, admet que les droits de propriété d’une personne peuvent affecter directement la vie d’autres personnes, mais dans la pratique, cette réserve est restée largement ignorée14.
Comme le montre ce rappel historique, souligner le caractère relationnel de la propriété n’a rien de si remarquable en soi. Cette idée simple devient cependant rapidement matière à controverse dès qu’il s’agit de définir des droits spécifiques, leur portée et leur durée, ainsi que leurs limites. C’est alors qu’on entre dans le vif du sujet. C’est alors que le droit de la propriété ne consiste plus simplement en des déclarations générales sur les relations normatives, mais vise surtout à imposer ces relations à l’aide du pouvoir de contrainte de l’État-nation. Il faut être clair sur le fait que le droit de la propriété n’a pas de contenu en soi ; il est un résultat politique – le résultat d’une lutte pour déterminer quelle sorte de signification exécutoire le terme « propriété » aura en droit et quelle sera son expression légale. Le droit, en les reflétant et en les façonnant à la fois, détermine profondément les relations sociales.
Lorsque des États affirment certains types de relations sociales par le biais de lois sur la propriété telles que le droit de posséder des terres, de la musique, de l’eau ou des images, il en découle d’importantes conséquences. Il devient difficile de remettre en question les justifications morales de la possession. De fait, dès lors qu’un État souverain place son autorité derrière certaines catégories de propriété, il exclut toute possibilité de discuter de la légitimité de cette propriété.
Il en résulte souvent un écart inquiétant entre la légalité et la légitimité, selon la distinction utilisée par le juriste français Étienne Le Roy15. Les élites politiques et économiques s’appuient sur le droit formel, les règles bureaucratiques, la jurisprudence – la « légalité » –, tandis que les expériences, les normes et les pratiques vernaculaires des gens ordinaires – la « légitimité » – sont ignorées. Les agriculteurs du monde entier considèrent qu’il est tout à fait légitime de conserver et de partager les semences, et les universitaires et les internautes veulent généralement partager leurs savoirs entre eux. Cependant, pour les gardiens de la légalité, ces activités sont souvent considérées comme criminelles. Les droits de propriété doivent être défendus. La légalité est donc utilisée pour éclipser le droit vernaculaire des communs – les normes, pratiques et coutumes informelles et non officielles utilisées par les communautés de pairs pour gérer leurs affaires16. C’est ainsi que la propriété se voit attribuer un statut juridique plus éminent que la possession, indépendamment de la légitimité des arguments en faveur de cette dernière. Comme la loi a entériné un certain ordre social de la propriété par le biais de processus étatiques formels (législatures, bureaucraties, tribunaux), les pratiques coutumières, les traditions et la possession peuvent être écartées comme illégales, ou du moins suspectes. La propriété est légale, mais la possession ne bénéficie pas du même niveau de protection.
Wesley N. Hohfeld, un juriste du début du xxe siècle, a popularisé l’idée qu’à chaque droit conféré par le droit de la propriété correspond un « non-droit » qui affecte les autres. Chaque fois que la loi reconnaît un droit ou un privilège à une personne, elle nie un droit ou un privilège correspondant à quelqu’un d’autre. Tout pouvoir juridique pour l’un a pour pendant une incapacité juridique imposée aux autres17. Ou, comme le dit un spécialiste du droit de la propriété, « les droits légaux ne sont pas de simples droits, mais des relations juridiques18 ». La propriété étant un ensemble complexe de relations juridiques qui régissent la manière dont les gens peuvent interagir, « personne ne peut jouir d’une liberté totale d’utiliser, de posséder, de jouir ou de transférer des biens considérés comme les siens », écrit Gregory Alexander. Et cela signifie qu’« un certain degré d’interférence sociale avec le droit de propriété d’une personne non seulement n’annule pas la propriété, mais est inévitable19 ».
Cette intuition est plus profonde qu’il n’y paraît. La propriété n’établit pas seulement une relation entre un propriétaire de bicyclette et une bicyclette et entre le propriétaire de la bicyclette et les non-propriétaires. Elle établit indirectement un réseau dense de relations multiples – avec les personnes qui ont extrait le métal utilisé pour la bicyclette ou qui ont produit les pièces, avec le fabricant et le détaillant, avec la personne à qui vous l’avez peut-être prêtée, avec les personnes qui conduisent des voitures et des bicyclettes sur la route, etc. Un objet désigné comme propriété n’est pas seulement impliqué dans un réseau complexe de relations sociales, mais aussi dans une myriade d’autres relations – avec une communauté locale, l’écosystème, la vie non humaine et les générations futures. Le droit de la propriété se concentre sur les droits du propriétaire et parfois sur les effets directs sur les autres ; mais c’est un point de vue fondamentalement borné.
Les limitations sérieuses qu’induit la propriété – l’individualisme du marché et l’ordre sociétal que celui-ci priorise – nous incitent à poser la question suivante : peut-on trouver d’autres manières d’avoir qui consacrent les relations vivantes en dehors du marché – celles que les relations juridiques formelles et le droit de propriété ne reconnaissent pas entièrement ?
C’est un défi difficile à relever car l’économie capitaliste, reposant sur une certaine configuration de relations sociales (concurrence, exclusivité, etc.), possède sa propre logique et son propre pouvoir de propulsion qui marchandise la nature, le travail et l’argent. Le droit de la propriété sanctionne et renforce agressivement cette logique, créant un cycle clos sur lui-même qui se renforce perpétuellement. La loi reflète et fortifie à la fois l’ordre politique et économique. Tel est le cercle vicieux qu’il faut d’une manière ou d’une autre briser et surmonter.
LA PROPRIÉTÉ COLLECTIVE, CONTREPOINT À LA PROPRIÉTÉ INDIVIDUELLE ?
La propriété collective pourrait-elle permettre de reconnaître un éventail plus large de relations ? C’est certainement ce que beaucoup d’acteurs politiques progressistes ont cherché à faire en créant des coopératives, des fiducies foncières, des fiducies publiques, des fondations, des organisations à but non lucratif et d’autres formes juridiques. Dans le cadre du système marché/État et du droit de la propriété, cette approche a naturellement de l’attrait. C’est une façon pour des groupes de gens d’essayer de servir des besoins sociaux collectifs plutôt que des intérêts commerciaux privés. Cette approche a nourri la conviction que la propriété collective était très différente de la propriété individuelle. Mais en réalité, elles se ressemblent bien plus qu’elles ne diffèrent. La propriété individuelle signifie qu’il y a un seul propriétaire20. La propriété collective reconnaît deux ou plusieurs propriétaires, voire des milliers de copropriétaires. Mais dans les deux cas, le caractère des droits de propriété (possibilité d’exclusion, de transfert, etc.) est à peu près le même. La principale différence réside dans le nombre de propriétaires, non dans la nature des droits de propriété.
Ce que nous suggérons, c’est que la propriété collective ne se distingue que très partiellement de la propriété personnelle. Il n’y a pas de différence de fond entre les deux. Nul hasard si « privé », dans l’expression « propriété privée », résonne avec le verbe « priver ». Qu’ils soient individuels ou collectifs, les droits de propriété donnent tous deux le droit de priver ou d’exclure d’autres personnes de l’utilisation de la propriété. Mais attention à la pensée binaire : lorsque nous soulignons ce point commun entre propriété individuelle et propriété collective, notre propos n’est pas de suggérer naïvement que toute propriété devrait être ouverte à tout le monde à tout moment, sans limitation.
Ce que nous suggérons est une reconceptualisation – c’est-àdire qu’il est possible de réimaginer la propriété de manière à limiter les usages, à valoriser les relations sociales et à empêcher la domination. Ce sont là, bien entendu, certaines caractéristiques essentielles des communs. Trouver des moyens de repenser la propriété pourrait nous aider à soutenir les communs et à inverser la dynamique totalisante du capital. Nous reviendrons sur ce sujet au chapitre 8. Pour l’instant, examinons de plus près les différences supposées entre la propriété privée et la propriété collective.
Il existe des différences importantes entre la manière dont les droits de propriété sont exercés par un seul propriétaire ou par plusieurs. La propriété collective nécessite au moins un accord commun entre tous les copropriétaires, qui peut lui-même être assez compliqué. En outre, certaines formes de propriété collective, telles que les coopératives, les fiducies ou trusts et les organismes sans but lucratif, échappent à l’impératif structurel de maximisation des profits, comme c’est le cas des entreprises. Ainsi, certaines formes de propriété collective peuvent générer beaucoup d’avantages sociaux en dépit de l’utilisation de formes juridiques ancrées dans un état d’esprit individualiste.
En fin de compte, cependant, le potentiel de la forme juridique « propriété collective » est limité. Cette forme divise toujours le monde entre « le mien » et « le tien » ou même « seulement pour notre groupe » (un « bien de club », en termes économiques). Par conséquent, même la propriété collective peut être rachetée par ceux qui ont plus d’argent ou vendue par des copropriétaires qui abandonneraient leurs engagements mutuels. Les propriétaires d’une coopérative, par exemple, constatant une augmentation de la valeur marchande de leurs actifs, peuvent décider de tout revendre pour réaliser un juteux bénéfice. Ou ses dirigeants peuvent décider de se détourner de leur mission de soutien mutuel pour devenir un acteur du marché concurrentiel qui fonctionne comme une quasientreprise privée. Ou encore, les administrateurs d’une fondation ou d’un trust peuvent décider unilatéralement de liquider l’entité sans tenir compte des bénéficiaires désignés.
Pour imaginer un ordre post-capitaliste qui dépasse vraiment les présupposés enracinés dans le droit de la propriété et dans la culture capitaliste, il faut chercher ailleurs. Deux approches générales sont possibles : celle d’un régime de pré-propriété qui permet à chacun d’accéder aux ressources et de les utiliser sans restriction ; ou bien celle de manières relationnelles d’avoir qui reconnaissent et soutiennent la pratique des communs. Un régime de pré-propriété est en réalité un régime d’accès ouvert ou de libre circulation. Cette approche est attrayante pour l’utilisation des connaissances, des idées et du code numérique car elle établit des plateformes ouvertes et un échange libre échappant à tout contrôle propriétaire direct. Cependant, dans le cas de ressources limitées comme la terre, un régime de pré-propriété équivaut à une mêlée générale qui peut entraîner la surexploitation.
Le tableau suivant illustre les différences entre propriété personnelle et propriété collective, ainsi que la manière dont elles diffèrent d’un régime de pré-propriété.
| Régimes de propriété privée | Régime de prépropriété | ||
|---|---|---|---|
| Propriété Propriété personnelle d’entreprise | Propriété collective | Ouverture à tous par défaut (même s’il en résulte une surexploitation) | |
| Nombre de possesseurs | 1 personne 1 personne morale « possédée » par de nombreux actionnaires | 1 + n personnes | personne |
Les différences entre propriété personnelle et propriété collective sont graduelles. Toutefois, il existe une différence qualitative entre les régimes de propriété privée (personnelle/d’entreprise/collective) et un régime de non-propriété.
Source : adaptation par les auteurs des classifications de G. G. Stevenson dans Common Property Economics: A General Theory and Land Use Applications (Cambridge University Press, 1991), p. 58.
Les manières relationnelles d’avoir sont un mode d’utilisation des choses qui laisse les participants décider entre eux, de manière flexible, de la façon dont les richesses partagées et les relations sociales seront gérées. Ce régime va au-delà des présupposés du droit de propriété conventionnel et des normes de marché. Aucune partie ou faction n’exerce de contrôle juridique absolu sur la richesse, et absolument personne n’a le pouvoir de la vendre. Elle est protégée à la fois de la captation interne et de l’aliénation externe. Cela signifie également que la ressource est protégée de ce que nous appelons la gouvernance par l’argent, la pratique capitaliste qui permet à ceux qui ont le plus d’argent de gouverner et de contrôler les autres. C’est un défaut intrinsèque du droit de la propriété. Si l’on présuppose que valeur = argent et que, par conséquent, plus de richesse = plus de valeur, alors le principe de l’« argent roi » est inéluctable. C’est un problème non seulement pour les commoneurs, mais aussi pour les entreprises capitalistes elles-mêmes, qui se trouvent obligées de danser au rythme imposé par les propriétaires du capital financier.
Les manières relationnelles d’avoir nous aident à prendre conscience qu’il existe de nombreuses façons de gérer et d’approfondir les multiples relations affectées par la propriété. Cette conceptualisation nous aide à voir comment les droits d’utilisation individuels et les régimes de propriété collective ne s’excluent pas mutuellement. En effet, ils ont besoin l’un de l’autre ! Les droits d’utilisation individuels sont une condition essentielle à l’épanouissement d’un régime de propriété collective. Les individus doivent toujours disposer de sphères à leur discrétion personnelle et d’intimité. Pour mieux comprendre comment les droits d’utilisation individuels et la propriété collective peuvent coexister, il faut faire la distinction entre possession et propriété.
LA POSSESSION EST DISTINCTE DE LA PROPRIÉTÉ
Aussi bien dans les systèmes de droit civil que de common law, la possession est le fait d’avoir personnellement le contrôle de quelque chose en s’« asseyant » (parfois littéralement) dessus. Le mot latin sedere, d’où dérive le mot « possession », signifie précisément « s’asseoir ». Pensez à l’appartement que vous avez loué. Du point de vue du droit de la propriété, vous le possédez peut-être en tant que locataire, mais vous n’en êtes pas propriétaire. Vous ne pouvez pas le donner, le léguer à vos enfants, le transférer ou le vendre, c’est-àdire, en termes juridiques, l’« aliéner ». Vous ne pouvez vendre que ce dont vous êtes propriétaire, pas forcément ce que vous possédez.
Le fait de privilégier la propriété par rapport à la possession a des implications considérables. Cela signifie que l’État, allié aux entreprises et aux investisseurs, devient le champion des propriétaires et impose une hiérarchie de subordination et de rôles sociaux capitalistes. On le voit clairement dans l’histoire des États qui ont balayé les droits des indigènes et les droits d’utilisation traditionnels pour leur substituer des droits de propriété libéraux modernes et le système du marché.
À la fin des années 1880, par exemple, le gouvernement américain a cherché à éradiquer les communs amérindiens en imposant un système de propriété privée. La loi Dawes Severalty, qui a imposé cette dépossession culturelle radicale, n’a accordé la citoyenneté étatsunienne qu’aux Amérindiens ayant pris une « résidence séparée et distincte de toute tribu » – c’est-à-dire ayant renoncé à leur identité tribale et étant devenus des propriétaires privés. Le principal auteur de la loi Dawes Severalty, le sénateur Henry Dawes du Massachusetts, a expliqué que, dans le cadre de la propriété commune, « il n’y a pas d’entreprise pour rendre votre maison meilleure que celle de vos voisins. Il n’y a pas d’égoïsme, qui est au fondement de la civilisation21 ».
Les impérialistes européens et américains ont appliqué le même modèle en d’innombrables autres occasions. Ils ont forcé les cultures indigènes à abandonner la gestion de leurs terres sous forme de communs inaliénables et à les traiter comme des « propriétés privées », les membres des tribus devenant de simples individus. L’historien E. P. Thompson a décrit comment ce modèle a été imposé aux peuples indigènes d’Amérique du Nord, d’Inde et du Pacifique Sud : « La propriété foncière exigeait un propriétaire, l’amélioration de la terre exigeait du travail, et la soumission de la terre exigeait donc aussi la soumission des travailleurs pauvres. » Thompson cite un Lord Goderich qui aurait expliqué en 1831 : « Sans une certaine division du travail, sans une classe de personnes prêtes à travailler pour un salaire, comment empêcher la société de tomber dans un état d’impolitesse presque primitif, et comment peut-on se procurer les conforts et les raffinements de la vie civilisée22 ? »
Une fois de plus, la propriété implique un ordre social et un ensemble de relations à la Terre différents de ceux de la possession. Toutefois, les deux sont similaires en ce sens qu’ils impliquent des droits d’accès et d’utilisation clairs et qu’aucun des deux n’est « ouvert à tous et partageable sans restriction ». Si vous êtes propriétaire d’un appartement, vous avez le droit de le vendre ou de donner la clé à la personne qui le loue. Si vous avez simplement la possession d’un appartement (parce que vous l’avez loué), vous pouvez toujours déterminer les droits d’accès (vous avez la clé), mais vous n’êtes pas autorisé à le vendre.
Comme le suggère cet exemple, la possession renvoie à l’utilisation concrète et à la valeur d’usage (qui sont essentielles à la pratique des communs), tandis que la propriété est orientée vers la valeur d’échange. La coutume, les pratiques vernaculaires, les normes éthiques, les lieux sacrés et les choses historiques sont généralement subordonnés aux droits des propriétaires23. Les pouvoirs de la coutume, ou ce que nous appelons le droit vernaculaire, sont sous-estimés. Pourtant, le droit vernaculaire impose le respect à un grand nombre de personnes et possède donc une autorité morale et un pouvoir politique que les gardiens du droit de la propriété sont réticents à reconnaître. Le droit vernaculaire peut également apporter des solutions participatives et localisées à des problèmes insolubles pour les bureaucraties et les marchés. Tournons-nous donc à présent vers le droit vernaculaire en tant que contre-pouvoir aux revendications abusives des droits de propriété.
LA COUTUME COMME DROIT VERNACULAIRE
Dans les communs traditionnels, les droits d’utilisation ne sont pas mis en œuvre par le biais du droit formel écrit, mais à travers la mémoire sociale et les traditions vivantes. La vie communautaire incluait une « procession annuelle autour des limites du village et des terres qui lui appart[enai]ent, ainsi qu’une beuverie commune après avoir vérifié la boîte commune (les fonds communautaires) », comme l’écrit un historien de la propriété.
Les coutumes populaires étaient inséparables des pratiques communes de pâturage. Pour les paysans, la cloche que le taureau du village portait autour du cou dans le pâturage signalait : « Le préfet arrive, le préfet arrive ! » (Le préfet était le gardien du taureau reproducteur de la communauté.) Le Jour de l’An, les bergers soufflaient dans leurs cornes, allaient de porte en porte et chantaient leur chanson, demandant aux paysans de leur donner quelque chose – par exemple, leurs meilleures saucisses fumées. Ces cadeaux étaient considérés comme l’expression de l’estime des paysans pour le soin que les employés de la communauté apportaient à leur bétail24.
Dans toutes les cultures, très loin des regards du droit étatique et des monarchies, une autre tradition juridique a réussi à faire en sorte que les ressources soient gérées selon ses propres termes. Elle n’était pas guidée par la logique formelle de la jurisprudence étatique, et certains pourraient même ne pas la considérer comme du droit parce qu’elle n’était pas écrite. Il n’en est pas moins certain que les pratiques quotidiennes, les rituels et les normes éthiques des gens ordinaires constituent de fait une forme de droit extrêmement puissante. La coutume est un moyen pour les gens de se gouverner eux-mêmes et de gérer leur richesse de manière durable sans l’appareil centralisé et hiérarchique du pouvoir d’État.
Les exemples sont innombrables. Partout dans le monde, des communautés de pêcheurs organisent des rituels de remerciement pour le retour du poisson. Des festivals célèbrent et mettent en œuvre les récoltes agricoles. Les riziculteurs subak d’Indonésie ont développé des rites religieux élaborés pour déterminer quand irriguer et quand récolter. Les commoneurs des forêts s’accordent sur les moyens de se protéger des braconniers et des vols. Les universitaires de l’International Association for the Study of Commons ont produit des centaines d’études de cas sur ce type de communs.
L’État choisit parfois de reconnaître la coutume par commodité administrative en institutionnalisant les pratiques coutumières dans le droit. Citons les ejidos en Espagne et au Mexique, les acequias pour l’irrigation au Nouveau-Mexique, l’obştea des terres et des forêts communes en Roumanie25, les iriaiken pour la récolte des champignons et autres ressources naturelles au Japon, ou encore leur équivalent en Suisse, l’OberAllmeindkorporation26. Tous ces communs coutumiers existent depuis plus longtemps que n’importe quel État ou État-nation. Les Allmeindkorporationen remontent à 1114 !
Bien que ces formes de Gouvernance par les pairs soient qualifiées d’informelles, d’indigènes, de communes ou de locales, nous préférons utiliser le terme plus général de droit vernaculaire. Nous nous inspirons ici du critique social Ivan Illich, qui a utilisé le terme « vernaculaire » pour désigner le caractère vivant et social de cette forme de droit. Le droit vernaculaire se développe dans « les lieux et les espaces où les gens luttent pour la régénération et la restauration sociale contre les forces de la mondialisation économique », selon un commentateur27. La coutume en tant que forme de droit mérite l’attention car elle peut être un moyen efficace pour les gens ordinaires de faire prévaloir leur sensibilité morale et leur sagesse pratique dans la gestion de leurs biens, indépendamment des logiques morales et politiques du couple marché/État. C’est précisément parce que la coutume défie les notions lockéennes de propriété (fixe, fondée sur les droits individuels, orientée vers le marché) qu’elle célèbre un ensemble plus riche de relations entre les personnes et l’environnement. En donnant aux gens un moyen d’exprimer leurs relations existentielles et affectives avec les rivières, les forêts, les pâturages, le gibier sauvage et les pêcheries qui les nourrissent, la coutume incarne ce qui compte pour les gens. Elle épouse les rythmes naturels. Elle peut donc constituer une manière d’avoir plus douce et davantage fondée sur les relations que celle qui est sanctionnée par le droit de propriété et les marchés modernes. Les pratiques éprouvées et appréciées des gens peuvent être considérées comme une source légitime de droit et de gouvernance. La coutume peut mûrir jusqu’à devenir une forme de droit parfaitement valable, et l’État peut avoir la sagesse de la valider. C’est ce que font depuis des siècles la common law et sa tradition de jurisprudence (tout en subordonnant généralement la coutume aux droits de propriété). Le juriste américain Oliver Wendell Holmes, Jr. a articulé la défense classique de la pratique coutumière dans son célèbre essai The Common Law, publié en1881 : « La première exigence d’un bon corpus juridique est qu’il corresponde aux sentiments et aux exigences véritables de la communauté, qu’ils soient bons ou mauvais28. »
Le droit vernaculaire a de la valeur parce qu’il émerge de la communauté elle-même et qu’il peut évoluer et muter à mesure que de nouvelles conditions se présentent. Il reflète les sentiments des gens ordinaires, et non les priorités de leurs représentants élus, des élites politiques ou de la pensée jurisprudentielle. Comme le dit Holmes : « La force vivante du droit n’est pas la logique ; c’est l’expérience29. »
Le monde moderne dénigre souvent la coutume en la qualifiant d’arriérée, de superstitieuse ou d’inefficace. Il considère les systèmes bureaucratiques – qui prétendent être fondés sur la rationalité scientifique, des règles justes et uniformes et une administration centralisée – comme la meilleure manière de gérer les choses. Pourtant, la coutume, qui mêle célébration et convivialité avec le travail sérieux de gérer et de préserver un milieu de vie, a son efficacité et son autorité morale propres. Le beating the bounds annuel – la procession villageoise autour du périmètre d’un commun, décrite dans l’introduction de la partie III – était à la fois un événement festif avec bières et gâteaux et une affirmation déterminée des droits des commoneurs.
Certes, la coutume peut être inutilement inflexible, mais elle cristallise généralement la sagesse d’années, voire de générations, d’expérience quotidienne d’un environnement singulier. Elle reflète un riche patrimoine d’expérimentations sur ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas et sur la manière dont les gens peuvent obtenir des résultats fructueux et pérennes. Du point de vue de l’évolution, on pourrait dire que les coutumes sont adaptatives car elles tiennent compte d’une multitude de relations subtiles et dynamiques. C’est une autre raison de l’efficacité des coutumes : elles incarnent les savoirs situés, les convictions éthiques et les liens affectifs des gens avec leur terre, leurs forêts, leurs rivières et leurs montagnes30.
La professeure spécialiste de droit de la propriété Carol Rose appelle la coutume un « moyen par lequel un public apparemment «non organisé» peut s’organiser et agir, et même en un sens «parler», avec force de loi31 ». C’est précisément l’une des raisons pour lesquelles l’État se méfie souvent de la coutume : elle incarne une autorité morale et un pouvoir moral que les pouvoirs publics tendent à considérer comme une menace. En 1860, un tribunal américain a rejeté les revendications de droits traditionnels, affirmant qu’il s’agissait de « formes de communauté inconnues dans cet État32 ». Les tribunaux ont généralement refusé de reconnaître la coutume comme contraignante car « si une communauté devait faire valoir des revendications en tant que société, les résidents devraient alors s’organiser légalement dans les formes autorisées par l’État », explique Rose33. Mais même si hommes politiques et hauts fonctionnaires ont cherché de tout temps à supplanter et à marginaliser la coutume, la moitié des terres arables du monde restent aujourd’hui gérées collectivement par quelque 2,5 milliards de personnes, selon Land Rights Now34. Un pourcentage important de ces personnes considèrent clairement la coutume comme un atout dans le cadre de la Gouvernance par les pairs.
La coutume en tant que véhicule d’autorité morale et de sagesse pratique représente d’une certaine manière un casse-tête pour le pouvoir d’État : comment peut-il accorder une reconnaissance formelle et une légitimité à des pratiques sociales si profondément informelles ? Mais la question peut aussi s’inverser : le droit étatique peut-il recueillir soutien et légitimité – et obtenir des résultats effectifs – sans reconnaître la coutume ? Elinor Ostrom répond à ces préoccupations à travers ses septième et huitième principes de conception : les commoneurs doivent avoir le droit de s’auto- organiser et les communs doivent être imbriqués dans les échelles multiples des systèmes de gouvernement35.
L’INALIÉNABILITÉ : UN CONCEPT ESSENTIEL POUR LA PRATIQUE DES COMMUNS
Si les pratiques sociales du droit vernaculaire remettent en cause la logique totalisante de la propriété, l’histoire montre qu’une doctrine juridique peut également être utilisée dans le même sens. Le concept d’inaliénabilité, qui trouve son origine dans le droit romain, est décrit dans les textes originaux latins comme visant des « choses dont l’aliénation est interdite » ou des « choses pour lesquelles il n’y a pas de commerce ». Le principe de base de l’inaliénabilité est l’interdiction de l’échange sur le marché. Ce qui est inaliénable ne peut être acheté ni vendu. Une chose inaliénable ne peut être héritée, hypothéquée, saisie, indemnisée ou imposée.
Aujourd’hui, bien sûr, presque tout est soumis à des droits de propriété quasiment illimités. Pratiquement tout peut être une propriété. L’esprit moderne a jugé bon de rendre appropriables les gènes, les mots, les odeurs ou encore les bribes de sons. Combinés à la sacro-sainte « liberté contractuelle », les droits de propriété favorisent le négoce permanent de presque tout afin de générer une plus grande richesse (privée et monétisée). Le couple marché/État encourage cette dynamique avec enthousiasme car elle favorise la croissance économique et les recettes fiscales. Dans le même temps, cependant, les relations d’échange commercial ont une dimension antisociale : elles retracent constamment une frontière entre vous et moi et dissolvent les liens qui unissent les membres d’une société.
L’une des raisons pour lesquelles le principe d’inaliénabilité s’est révélé une idée si résiliente est certainement qu’il renvoie à un jugement social et éthique – à savoir que certaines choses ne doivent pas pouvoir faire l’objet d’une appropriation. Peindre des graffitis haineux sur la place de la ville ou utiliser des sanctuaires religieux à des fins commerciales est généralement considéré comme une violation de l’éthique ou du respect du sacré. La plupart des sociétés actuelles considèrent la vente de bébés, d’organes corporels, de sexe, de droits juridiques et de votes comme moralement répugnante. Il existe un consensus social suffisamment fort pour affirmer que certaines choses sont si profondément importantes que l’identité morale de la communauté elle-même serait compromise si elles pouvaient être légalement vendues sur le marché. L’inappropriabilité est toujours d’abord un jugement social que les systèmes juridiques élèvent ensuite au rang d’interdiction légale. Le droit romain entérinait le principe selon lequel les lieux anciens, les théâtres, les routes, les rivières, les conduites d’eau, etc., ne pouvaient être appropriables et commercialisables comme l’étaient le pain et le beurre.
Les implications d’un tel principe à notre époque méritent d’être méditées. Et si la société considérait certains artefacts comme inaliénables ? Et si nos droits de propriété n’impliquaient pas une domination absolue, dont le droit de vendre, mais au contraire se trouvaient limités ? Et si nous reconnaissions que la force des communs dépend aussi du fait que, selon les chercheurs français Pierre Dardot et Christian Laval, « le commun définit une norme d’inappropriabilité36 ».
Si l’inaliénabilité devenait la disposition juridique par défaut dans certains domaines de la vie, cela contribuerait à inverser les dommages liés à l’aliénation de tant de biens du fait de leur marchandisation. Comme l’a documenté l’historien de l’économie Karl Polanyi, les apprentis capitalistes des xviiie et xixe siècles ont redéfini par la force la terre, l’argent et le travail comme des marchandises négociables37. Polanyi les appelle « marchandises fictives » car aucun de ces éléments n’est réellement produit pour être vendu. La terre est un don de la nature qui grouille de créatures vivantes. Le travail est la vie humaine elle-même. L’argent n’est qu’un gage de pouvoir d’achat – un moyen d’échange – et non l’objet de l’échange, une marchandise en soi. La conversion de la terre, du travail et de l’argent en propriétés échangeables sur le marché était une condition préalable à la création de la société de marché.
Soulignons-le encore une fois : le problème n’est pas la possession. C’est la « négociabilité » rendue possible par les droits de propriété qui pose problème. Et si nous reconsidérions notre conception de la terre, du travail et de l’argent – ainsi que des savoirs, pourrionsnous ajouter – en tant que marchandises et objets de propriété ? Et si nous les pensions inappropriables ou inaliénables pour un usage commercial ? Et si nous déclarions que le code informatique et les savoirs numériques, par exemple, ne peuvent être réservés à un usage exclusivement individuel, mais doivent être rendus largement disponibles aussi bien individuellement que collectivement ?
Créer des sphères protégées d’inaliénabilité peut sembler utopique dans le cadre du monde contemporain. Après tout, la société moderne idolâtre la propriété. En réalité, ce n’est ni farfelu ni irréalisable. Lorsqu’en 1955 on a demandé au Dr Jonas Salk, co-créateur du vaccin contre la polio, à qui appartenait le brevet, sa réponse est restée célèbre : « Eh bien, aux gens, je dirais. Il n’y a pas de brevet. Pourrait-on mettre un brevet sur le soleil38 ? » Salk jugeait moralement répugnant qu’un vaccin salvateur puisse être utilisé comme une source de profits individuels et devenir inabordable pour les personnes qui en ont besoin. Il a donc confié le vaccin contre la polio à l’Organisation mondiale de la santé afin de s’assurer qu’il bénéficie au plus grand nombre. Bien sûr, une éthique culturelle bien différente a réussi à s’imposer dans les décennies suivantes. Les Étatsnations ont accordé des brevets sur toutes sortes de médicaments essentiels, d’algorithmes mathématiques, de méthodes commerciales ou de savoirs qui auraient dû être accessibles à tous.
En Nouvelle-Zélande, une règle d’inaliénabilité est utilisée pour protéger les populations de truites du lac Taupo. La réglementation de la pêcherie fixe non seulement un plafond pour le nombre de poissons pouvant être pris – un quota de six truites par jour –, mais aussi une règle rendant « illégaux la vente ou l’achat de truites39 » Ainsi, même si le lac Taupo est plein de truites, vous ne pourrez en manger dans les restaurants locaux qu’en les pêchant vous-même, comme le permet la règle de la « prise quotidienne ». Vous pouvez apporter votre poisson au restaurant pour qu’ils vous le préparent – à la manière dont certains restaurants nord-américains sans licence vous autorisent à apporter votre propre bouteille de vin.
REDÉCOUVRIR LE POUVOIR DE LA RES NULLIUS
Dans l’optique de raviver le principe d’inaliénabilité, il est utile d’étudier l’histoire d’une notion importante du droit romain, celle de res nullius. Il est révélateur que la recherche contemporaine ait pratiquement oublié cette catégorie juridique et la conception de la culture partagée qu’elle exprime. Comment cela a-t-il pu se produire ? Est-ce qu’un principe juridique similaire à la res nullius pourrait aujourd’hui servir efficacement une gestion responsable ?
La notion de res nullius est née au début du vie siècle, lorsque l’empereur Justinien ordonna une synthèse systématique de toutes les lois impériales existantes à partir des ouvrages les plus importants de la jurisprudence. Le résultat de cette entreprise, le Code Justinien – ou, plus formellement, le Corpus juris civilis, ou « Corps de droit civil » –, publié entre 528 et 534, a grandement influencé le droit moderne. Le Code divise en classes distinctes l’ensemble de choses pouvant faire l’objet d’une propriété, avec des droits d’accès et d’utilisation différents pour chaque classe de biens. (Voir le tableau ci-dessous.) Aujourd’hui, nous supposons généralement que la propriété se répartit en deux catégories principales, publique ou privée. Les Romains de l’Antiquité nous rappellent qu’il y en a d’autres. Ils disposaient d’une classification juridique pour les droits de propriété personnelle – res privatae. L’État agissait par ailleurs comme protecteur et fiduciaire de la res publicae – terres, bâtiments civils et infrastructures – et reconnaissait des régimes de propriété commune, appelés res communis40. Il déclarait enfin que certaines choses, dites res nullius, ne pouvaient être possédées.
| Propriétaire légal / gardien | Objet de la propriété ou de la gérance | |
|---|---|---|
| Res publicae | L’État détient et gère au nom des citoyens | Parcs nationaux, jardins publics, infrastructures |
| Res privatae | Individu | Maison, objets domestiques |
| Res communis | Communauté ou groupe de personnes liées entre elles | Parcelles de terre |
| Res nullius | Personne | Atmosphère, océans, poissons et autres espèces sauvages fugitives, de même que toute chose considérée comme sacrée |
Tableau d’après les définitions des Institutes de Justinien.
Une question qui devrait nous préoccuper, nous les modernes, est de savoir pourquoi l’idée d’inappropriabilité a pratiquement disparu au fil des siècles. Il est difficile d’y répondre avec certitude et impossible de se plonger dans les détails et les différentes interprétations dans le cadre restreint de ce livre. Mais l’histoire nous apprend qu’en établissant le nouveau Code Justinien, les anciens ont réinterprété les termes latins originaux employés par les juristes précédents.
Nous pouvons nous faire une idée de la manière dont cela s’est passé en examinant une source juridique, un texte de Gaius, célèbre juriste romain du iie siècle. Gaius reconnaissait cinq catégories de biens – le sacré, le religieux et le saint (oui, trois catégories distinctes !) ainsi que le public et le privé –, que le Code Justinien a réduites à quatre (voir le tableau ci-dessus). Il n’est pas aisé de dire avec certitude pourquoi et comment précisément cela s’est fait, mais le point important est l’invention de nouvelles catégories juridiques et la réinterprétation des anciennes au moment de la conception du Code Justinien. Ce sont les prémisses mêmes du droit qui ont ainsi été refondées. Au cours de ce processus, le concept de propriété a connu des changements importants, en particulier en ce qui concerne les distinctions établies auparavant par le droit de la propriété entre les choses régies par le droit divin (jus divinum) ou le droit humain (jus humanum)41. Alors que ce dernier corpus de droit était clairement fondé sur un contrat social, le droit divin faisait référence à toute loi provenant directement, croyaiton, de la volonté des dieux (ou, dans d’autres sociétés, de Dieu ou du Créateur). Ainsi, ce qui était sacré, dans le cadre de la loi divine, ne pouvait être acheté ni vendu.
Pour ajouter à la confusion, certaines sources juridiques préjustiniennes se référaient à une catégorie de choses dites patrimoniales, comme les objets du patrimoine culturel, qui ne pouvaient être vendues – au contraire des choses extrapatrimoniales qui pouvaient justement devenir des objets commerciaux. Le cœur du problème est que les choses de la sphère patrimoniale ou de la loi divine (selon le texte que vous lisez) étaient considérées par définition comme inaliénables, il était donc illégal de les vendre.
Lorsque les juristes ont compilé le Code Justinien à partir de sources diverses, ils ont dû se débrouiller avec deux ensembles coexistants de classification des choses : jus divinum / jus humanum dans certaines sources ; patrimonial/extrapatrimonial dans d’autres. Cela posait évidemment un problème. Non seulement ces classifications se chevauchaient, mais elles étaient incompatibles entre elles. Pour reconstituer le droit sous une forme unique et cohérente, ils devaient soit abandonner l’une des deux catégorisations, soit créer de toutes pièces un nouveau système de classification. C’est un peu comme si des designers essayaient de réconcilier la logique d’un système modulaire de blocs imbriqués – par exemple, celui de Lego – avec celle d’un autre système différent, comme celui de Playmobil. Dans chacun des systèmes, tout s’emboîte parfaitement, mais les deux systèmes ne fonctionnent pas ensemble. Cela explique en partie pourquoi l’idée d’inaliénabilité est tombée dans l’oubli : les auteurs du nouveau code juridique n’ont pas su intégrer l’idée de sacralité qui était rattachée à l’idée d’inaliénabilité. Cette dernière a ainsi perdu ce qui lui donnait antérieurement son poids juridique.
Le processus de synthèse du nouveau Code Justinien a marqué un autre tournant qui nous concerne encore aujourd’hui. Les Romains de l’Antiquité, dans leur grande intelligence, avaient enveloppé le principe d’inaliénabilité d’une « double protection ». L’historien du droit Yan Thomas la qualifie de « double ethos public et sacré » pour signifier que l’inaliénabilité renvoyait au caractère sacré des choses publiques. En d’autres termes, le concept romain de « public » reflétait une vénération pour l’éternel et le sacré tout en signifiant aussi que les choses étaient utilisables par tous et contrôlées publiquement à perpétuité.
Au fil des siècles, l’idée de patrimoine a été plus explicitement préservée dans le droit que l’idée de « sacralité du public ». En fait, l’idée de patrimoine a connu une renaissance en 1982 avec la ratification de la Convention sur le droit de la mer (également connue sous le nom d’UNCLOS III). Selon cette convention, les ressources des eaux situées au-delà des juridictions nationales, telles que les minéraux des grands fonds marins, sont un « patrimoine commun de l’humanité ». Il serait toutefois erroné de supposer que les choses considérées comme faisant partie du patrimoine commun de l’humanité sont automatiquement traitées comme si elles étaient inaliénables et protégées. Les États-nations ont des revendications contradictoires sur les ressources du patrimoine commun. De fait, l’essentiel des négociations tourne autour de la manière dont ces ressources doivent être exploitées, par qui et comment les bénéfices seront distribués. L’inaliénabilité et la protection de notre patrimoine ne sont pas réellement envisagées.
Les océans comme « patrimoine commun de l’humanité »
L’article 136 de la Convention sur le droit de la mer (UNCLOS III) déclare que les ressources des eaux situées au-delà des juridictions nationales sont un « patrimoine commun de l’humanité ». Cela signifie que les minéraux du fond des océans, tels que les nodules de manganèse, ne peuvent être revendiqués, acquis ou possédés par aucun État ou aucune personne. Ces droits appartiennent à l’humanité tout entière, l’Autorité internationale des fonds marins agissant en son nom (art. 137). Malgré l’ambition affichée de ce concept juridique de « patrimoine commun de l’humanité », son impact réel a été décevant. Une lecture attentive du texte du traité montre clairement que les « ressources » des océans ne constituent qu’une « petite partie des communs internationaux », comme le note la spécialiste du droit international Prue Taylor, et que la « liberté des mers », doctrine juridique protégeant la liberté de naviguer dans les eaux extraterritoriales, est restée en vigueur. L’idée du patrimoine commun de l’humanité n’a suscité ni révolution juridique ni soutien fort de la part des Nations unies. Le diplomate Arvid Pardo lui-même, force motrice à l’œuvre derrière la Convention sur le droit de la mer, a sarcastiquement fait remarquer que l’application de la doctrine avait été réduite à la protection de « petits rochers laids qui gisent dans les profondeurs les plus sombres de toute la création ». Mais même cela s’est révélé largement faux, puisque les affreux petits rochers au fond de l’océan peuvent également être exploités. L’idée du patrimoine commun de l’humanité est un concept que nous devrions chérir ; il a été suffisamment révolutionnaire pour que les États-Unis d’Amérique refusent de ratifier l’UNCLOS III. Pour réellement protéger notre patrimoine commun, toutefois, la notion devrait être liée à celle d’inaliénabilité et se voir doter d’une véritable force juridique contraignante.
La Convention du patrimoine mondial de l’Unesco est un traité dont l’objectif premier est de protéger le patrimoine, lequel inclut « des phénomènes naturels ou des zones d’une beauté naturelle et d’une importance esthétique exceptionnelles », ainsi que des « chefs-d’œuvre du génie créatif humain et de grande importance culturelle ». Entre autres exemples, on peut citer le parc national du Serengeti, le cœur historique du Caire, en Égypte, et le sanctuaire antique du Machu Picchu, au Pérou42.
Vous vous demandez peut-être, cher lecteur, en quoi cette histoire juridique ancienne nous importe aujourd’hui. Les catégories juridiques de la Rome antique peuvent-elles nous aider à repenser la propriété ? En premier lieu, elles nous permettent d’identifier et de dépasser les principes juridiques qui détruisent les communs (comme l’idée de la propriété en tant que « domination unique et despotique »). De manière tout aussi importante, cette histoire nous aide à restaurer des catégories juridiques oubliées telles que la possession et l’usufruit, qui privilégient l’usage sur la propriété43. Grâce à ces termes, nous pouvons nommer plus facilement les préoccupations morales et sociales – héritage, inaliénabilité, caractère sacré, res nullius – auxquelles devrait être conférée une valeur juridique plus forte. Certes, l’idée de patrimoine commun de l’humanité a connu un sort décevant en droit international. Néanmoins, elle reste l’un des rares cas où la notion de res nullius a été invoquée par les représentants des États-nations pour autoriser la gestion collective de richesses partagées. La question qui importe est de savoir si la res nullius du Code Justinien peut s’avérer être un concept juridique suffisamment polyvalent et pertinent pour déclarer certaines choses inaliénables, favorisant ainsi la pratique des communs.
LA PROPRIÉTÉ ET L’OBJECTIVATION DES RELATIONS SOCIALES
Tel est le problème fondamental auquel nous sommes confrontés – tout comme le patrimoine commun de l’humanité a été marginalisé en tant que concept juridique, le concept de « public » semble lui aussi avoir perdu son lien au sacré. Il semble, en définitive, que toutes les catégories juridiques permettant d’exprimer l’inaliénabilité ou l’interdiction d’une appropriation inconditionnelle aient été abandonnées. Il y a certainement de nombreuses raisons à cette négligence, mais la plus décisive est l’essor des marchés et de la culture capitalistes. Les sociétés industrielles occidentales, désireuses de stimuler la croissance économique, veulent tout aliéner autant qu’elles le peuvent – et considèrent cela comme un progrès.
Il est une autre tendance que nous devons combattre : la propension à traiter le droit formel lui-même comme une cartographie fiable de la réalité sociale et écologique, alors que les deux sont en fait dynamiques et changeants. Dans son livre ludique Slide Mountain: Or, the Folly of Owning Nature [« Slide Mountain, ou la folie de posséder la nature »], Theodore Steinberg examine certaines formes particulièrement insensées des prétentions du droit de propriété à contrôler la nature44. Les agriculteurs peuvent-ils faire un recours juridique contre une entreprise qui prétend pouvoir faire tomber la pluie et ne le fait pas ? Comment revendiquer des droits de propriété sur des terres au bord d’une rivière dont les berges s’érodent et se reforment constamment ? On pourrait poser le même genre de questions à propos de tout type de droit qui affirme des normes sociales fixes et applique une logique formelle. Le fait est que les gens et les sociétés palpitent et vivent. Les valeurs et les normes changent, comme le montre le large soutien social, aujourd’hui, aux droits des transsexuels et au mariage homosexuel.
Cette propension à recourir au droit pour objectiver et rigidifier les relations sociales semble être spécifique à la modernité. Voyez comment la notion de res nullius s’est transformée au fil du temps. Aujourd’hui, le terme de res nullius est généralement utilisé pour désigner les terres inoccupées ou des richesses naturelles dont l’appropriation est libre en vertu de la loi45. La notion de res nullius a ainsi servi de justification juridique déterminante pour la colonisation et ses violentes saisies de terres « non possédées ». Mais il existe une autre catégorie : la res nullius in bonis. Ce terme désigne des domaines qu’il serait juridiquement et éthiquement abusif de s’approprier. La « loi divine » (jus divinis) établissait des interdictions similaires à propos de l’appropriation de choses sacrées. Res nullius in bonis désigne tout simplement une chose absolument inappropriable et donc inaliénable, pour toujours.
Nous nous sommes donc demandé pourquoi seule la première version de la res nullius avait survécu – c’est-à-dire « les choses qui n’ont pas encore été prises » et qui peuvent donc l’être.
On ignore pourquoi et comment la notion juridique de res nullius in bonis a disparu au fil des siècles. Ce pourrait être lié à une réinterprétation culturelle du terme res lui-même. En lisant les études de l’éminent historien du droit romain Yan Thomas, nous nous sommes rendu compte qu’à notre époque le mot res était généralement traduit par « chose ». Avant le Code Justinien, cependant, la res ne désignait pas simplement un objet ou une chose46, mais aussi une question à traiter ou une affaire juridique. Le terme res se référait toujours à une chose dans le contexte d’une procédure juridique et se rapportait donc davantage à une affaire qu’à un simple objet47. Cette compréhension plus précise de la res nous oblige à tenir compte de réalités sociales et juridiques particulières. En d’autres termes, la res n’était pas seulement une question de « propriété ». Souvenez-vous que l’une des distinctions qualitatives fondamentales avant le Code Justinien opposait le patrimonial et l’extrapatrimonial. Si la res en question relevait du patrimonial (héritage), elle ne pouvait être traitée comme une propriété et être commercialisée. Elle resterait non possédée et protégée, et les procédures judiciaires ne pouvaient porter que sur les droits d’usage appropriés. En revanche, une chose qualifiée d’extrapatrimoniale (commerciale) pouvait être saisie, occupée et possédée. La res était toujours « contextualisée », pour ainsi dire. Elle ne se référait pas à la propriété elle-même comme attribut fixe et essentiel de « la chose ». Elle se référait à la fois à l’objet de propriété contesté et à son statut social et juridique adéquat. Ce n’est pas un détail négligeable. Cela nous aide à comprendre que, bien avant que le droit moderne s’impose dans nos esprits, le réseau de relations dans lequel une res particulière s’inscrivait était une préoccupation primordiale d’un point de vue juridique. La res n’était pas réifiée, pourrait-on dire, mais renvoyait à une affaire juridique.
Qu’il faille comprendre la res ou tout ce qui est soumis à des droits de propriété en termes relationnels, cela signifie qu’il n’y a pas de caractère naturel d’une chose en elle-même qui détermine les droits de propriété appropriés. C’est pourtant encore l’approche prédominante aujourd’hui. Les économistes déclarent régulièrement que certaines catégories de ce qu’ils appellent des « biens » ne peuvent être gérées qu’à travers la propriété publique ou privée48. Cette conception se retrouve dans le tableau économique classique qui distingue quatre types de biens – privés, publics, de club et communs – en fonction des caractéristiques supposées intrinsèques des biens eux-mêmes49.
Cette matrice distinguant quatre types de propriété et quatre régimes de gouvernance correspondants est profondément trompeuse. Elle laisse entendre que ce qui est en réalité un choix social découlerait de la nature des biens eux-mêmes. En d’autres termes, ce tableau repose sur une grave confusion ontologique – une confusion enseignée aux étudiants en économie du monde entier. L’économie standard attribue aux ressources physiques des caractéristiques fixes, alors qu’elles sont en fait entièrement ouvertes au choix social et à la gouvernance. Par exemple, il n’est ni nécessaire ni très efficace qu’un phare soit géré comme un bien public. Les infrastructures civiles peuvent souvent être gérées avec succès comme un commun, ainsi que nous l’avons vu à propos des systèmes Wi-Fi de Guifi.net. Le code numérique ne doit pas être traité comme un bien privé ni même comme un bien de club ; il peut lui aussi être géré en pratique comme un commun. Et ainsi de suite. La monoculture néoclassique de la théorie économique a simplement choisi d’ignorer les choix sociopolitiques qui affectent la création des droits de propriété, préférant attribuer ces droits à quelque chose d’inhérent à la ressource elle-même50. Elle a superposé sa vision objectiviste du monde au domaine des biens, tout comme la profession juridique a transmuté une affaire sociale, la res, en une chose. Mais malgré les efforts du capitalisme moderne pour objectiver les relations sociales à travers la propriété, différentes conceptions de la propriété persistent, qui reflètent différentes manières d’être dans le monde. Chacune de ces conceptions autorise ou contraint différemment la façon dont nous pouvons vivre dans le monde.
* * *
Comme nous l’avons vu jusqu’ici, le droit moderne de la propriété réalise, sous prétexte de principes « naturels et universels », une immense opération d’ingénierie sociale. Il privilégie un répertoire spécifique de relations capitalistes/libérales et il exclut, complique, voire criminalise, d’autres relations, comme le partage. Le droit de la propriété normalise une vision du monde selon laquelle la liberté et l’épanouissement de l’être humain découlent de la propriété individuelle et des échanges marchands. Mais des formes de droit plus conviviales et écoresponsables sont possibles, y compris une « Propriété relationalisée », que nous explorons dans le prochain chapitre.
VIII. Relationaliser La Propriété
Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, la manière dont nous pensons la propriété et ses catégories juridiques contribue à façonner le type d’êtres humains que nous devenons. Elle influence également le type de société que nous décidons de construire. Nous sommes incités à travailler dur, à devenir propriétaires et à nous enrichir. Cela ne nous apporte pas grand-chose en termes de sens ni d’épanouissement, mais c’est une approche tout à fait raisonnable et fonctionnelle dans un monde qui célèbre la compétition, l’acquisition et l’intérêt personnel.
Certes, les comportements non capitalistes dans toute leur variété – partager, coopérer, assumer une coresponsabilité, pratiquer la solidarité sociale – ne disparaissent pas pour autant. Mais ils ne peuvent pas se développer pleinement en étant mesurés à leurs propres critères. Ils sont souvent considérés comme idéalistes, naïfs et quelque peu irréalistes. À moins qu’ils ne soient mobilisés pour servir les intérêts de la propriété, des marchés et du capital (car même les grandes entreprises ont besoin de coopération), ils sont laissés à la marge de l’économie formelle. Dès lors, il n’est pas surprenant que l’idée des communs ait été presque oubliée dans la grande foire d’empoigne du capitalisme, où la « gouvernance par l’argent » demeure le principe par défaut.
Proposer une transformation du droit de la propriété lui-même est au-delà de nos capacités. Notre ambition est plus modeste : démontrer la faisabilité de voies alternatives qui permettent de « relationaliser » la propriété. Nous utilisons cette expression pour désigner des systèmes socio-légaux qui donnent plus d’importance aux droits d’utilisation concrets et aux relations sociales qu’à l’absolutisme propriétaire. Comme le montrent les cinq exemples fascinants qui suivent, il est tout à fait possible de favoriser des modes de possession alternatifs sans tomber dans les situations de domination ou de dépendance généralement associées à la propriété.
Ces exemples donnent à voir comment les commoneurs peuvent astucieusement démarchandiser les droits d’accès et d’utilisation, rendant ainsi possible une gamme de relations plus épanouissantes, habituellement marginalisées ou inconcevables. Comme nous le verrons, les régimes de Propriété relationalisée permettent de faire plus facilement usage des choses pour satisfaire des besoins réels plutôt que de maximiser le rendement des investissements ou d’affirmer son pouvoir sur les autres.
COMMENT DÉMARCHANDISER UN SUPERMARCHÉ
Visiter la Park Slope Food Coop (PSFC), située à Brooklyn, New York, c’est faire l’expérience d’un supermarché qui a été transformé pour vivre, respirer et fonctionner comme une communauté sociale. Comme la plupart des autres supermarchés, la Coop est un établissement très fréquenté, bien organisé et doté de tout le personnel nécessaire. Mais cet endroit, pourtant localisé au cœur de la culture commerciale de New York (Manhattan n’est qu’à 3 kilomètres), a quelque chose de très différent. La Coop n’est pas une entreprise qui cherche à séduire ses clients pour qu’ils consomment de manière compulsive. Il n’y a pas d’affichage promotionnel ni de présentoirs tape-à-l’œil conçus pour stimuler des achats irréfléchis. La Coop a un objectif assez simple et intelligemment mis en œuvre : permettre aux gens de se procurer des aliments de qualité à peu de frais en devenant leurs propres fournisseurs, « en achetant à eux-mêmes ».
On ne se rend pas compte immédiatement que les caissiers ne sont pas en réalité des employés. Tous ceux qui travaillent pour la coopérative en sont membres. Ils sont plus de 17 000 à s’occuper des diverses tâches, depuis le déchargement des camions et le remplissage des rayons jusqu’à la tenue du comptoir de charcuteries ou au nettoyage – sans rémunération. Lorsque nous sommes arrivés à la coopérative, notre guide Paula Segal nous a emmenés à l’étage, au bureau d’accueil, pour obtenir un badge nous permettant d’entrer dans le magasin. (Pour éviter les resquilleurs, seuls les membres peuvent entrer et faire des achats au magasin, mais tout le monde peut devenir membre.)
La Park Slope Food Coop est à la fois un bâtiment physique, une institution sociale et une infrastructure de distribution. Elle sert également de centre communautaire, de lieu de rencontre et d’espace permanent de décision démocratique à la base (sans toutefois toujours réussir à surmonter les écueils de la représentation ou du principe majoritaire). Depuis sa création en 1973, la Coop est devenue une institution communautaire solide et appréciée à Brooklyn, et ce, pas seulement parce que ses produits sont moins chers que ceux des supermarchés classiques. Certes, les coopérateurs possèdent la Coop, mais son dynamisme s’explique surtout parce que les coopérateurs font vivre leur possession en pratique à travers leur engagement social.
L’esprit de gouvernance et d’approvisionnement par les pairs que l’on peut observer au sein de la Park Slope Food Coop provient en grande partie de son organisation sous forme de coopérative de travail, qui la distingue d’une coopérative de consommateurs ou de producteurs (souvent confondue avec les communs). Chaque membre est tenu de fournir exactement deux heures et quarante-cinq minutes de travail non rémunéré toutes les quatre semaines1. C’est un élément clé du succès de la coopérative : 17 000 membres-propriétaires se présentent chaque mois pour travailler à l’heure convenue. Cet arrangement permet à la coopérative de réduire le poste de dépense principal de tout supermarché, à savoir la masse salariale, et de maintenir ainsi les coûts au minimum. Environ 75 % du travail au sein de la coopérative est effectué par les membres (les 25 % restants sont confiés à du personnel salarié, composé d’une soixantaine de personnes). Le temps de travail consacré à la coopérative ne rapporte pas aux membres d’avantages monétaires directs (par exemple, une facture moins élevée en contrepartie du travail non rémunéré), mais se traduit néanmoins en moyenne par des économies de 20 à 40 % sur le prix de détail des produits vendus. Pour une famille qui dépenserait normalement 500 dollars par mois en nourriture, cela représente une économie de 100 à 200 dollars.
Cette organisation par répartition de créneaux horaires fait partie d’une stratégie audacieuse visant à démarchandiser le travail au sein de la coopérative et à y cultiver une éthique communautaire. L’entreprise n’est pas simplement un ensemble de transactions de marché pour les produits, la main-d’œuvre ou l’infrastructure physique, etc. La coopérative ne se contente pas non plus d’offrir à ses membres des prix plus bas. Tout comme Cecosesola au Venezuela (voir p. 216-218), dont les prix inférieurs à ceux du marché constituent une affirmation de souveraineté sur les valeurs, la Coop est en fait fondamentalement un projet visant à « réduire le pouvoir des grandes entreprises » sur le secteur du commerce alimentaire2. Avec des revenus annuels de plus de 49 millions de dollars, la Park Slope Food Coop est de fait l’une des plus importantes coopératives alimentaires et coopératives de travail aux États-Unis.
Cette stratégie de démarchandisation du travail est extrêmement bien organisée. Près du bureau d’accueil, il y a un espace de garde d’enfants géré par des membres, utile pendant que les parents font leurs courses ou lorsqu’ils assurent leur créneau mensuel obligatoire. La plupart des membres remplissent leurs responsabilités dans le cadre d’« équipes » qui se réunissent à heure fixe une fois par mois pour effectuer les tâches assignées : emballer les épices, mettre les olives en sac, couper et emballer le fromage, répondre au téléphone, aider les membres, effectuer des tâches administratives au bureau des membres, recevoir les livraisons, garnir les étagères et les frigidaires, additionner les factures en caisse, mettre les courses en sac, nettoyer, et bien d’autres choses. Les chefs des équipes, également non rémunérés, assument la responsabilité supplémentaire de les gérer.
Le fait de travailler en équipes permet aux membres de se rencontrer régulièrement et de développer un lien d’affinité avec la communauté Coop. Chacun doit s’engager dans la Coop au niveau personnel. Il n’est pas possible, par exemple, de se faire remplacer par un tiers, rémunéré ou non, comme une grand-mère ou un adolescent. Cette décision a été prise par les membres en assemblée générale. C’est là que sont généralement discutées les orientations importantes. L’objectif est d’« éviter que les membres se défaussent de leur engagement et perdent le lien à la coopérative en tant que membres actifs3 ». De même, ceux qui manquent leur session de travail ne peuvent plus faire d’achats avant d’avoir travaillé deux sessions supplémentaires. Les membres qui ne travaillent pas ou ne font pas d’achats à la coopérative pendant un an peuvent obtenir une « amnistie » et recommencer à zéro – mais ce droit ne peut être invoqué qu’une seule et unique fois.
Au retour de notre visite à la coopérative, une question nous taraudait : pourquoi n’y a-t-il pas plus de coopératives de travail ? Pourquoi ce modèle ne s’est-il pas répandu dans le monde comme l’ont fait les coopératives « normales » ? Les raisons sont nombreuses, mais l’une d’elles, et non des moindres, est que la plupart des coopératives existantes ont négligé la possibilité d’inscrire la démarchandisation du travail dans la conception même de leur régime juridique de propriété – c’est-à-dire la possibilité de relationaliser la propriété. Expliquons-nous. Les membres de la PSFC sont des membres-propriétaires, de sorte que les deux rôles sont profondément et indissociablement liés l’un à l’autre. Quiconque rejoint la coopérative ne peut être seulement un membre ou juste un propriétaire ; il doit assumer les deux rôles ensemble. Comme l’indique le manuel d’adhésion de la Coop : « L’adhésion est définie par la participation d’une personne au système dit “des postes de travail”, tandis que la propriété est définie par votre contribution financière. Cette contribution est officiellement appelée investissement en capital des membres. » L’adhésion à la coopérative coûte 25 dollars américains – une cotisation à acquitter une seule fois à l’entrée. Un investissement financier de 100 dollars est également requis, remboursable à la sortie de la coopérative.
La véritable originalité de la Park Slope Food Coop est donc sa redéfinition de la propriété comme ensemble de droits intrinsèquement liés au travail démarchandisé en vue d’objectifs communs. Ce concept est une manière simple mais ingénieuse de mettre en commun et partager (voir chapitre 6) dans le contexte spécifique d’un supermarché. Si vous ne contribuez pas à raison de deux heures et quarante-cinq minutes de travail non rémunéré par mois, vous ne pourrez pas avoir part aux avantages procurés par la coopérative : produits alimentaires locaux, bon marché et de qualité, garde d’enfants gratuite pendant les courses, soutien et solidarité de la communauté, satisfaction de gérer soi-même son environnement et ses conditions de vie. Cet arrangement est à la fois économiquement efficace pour réduire les coûts et juridiquement intelligent – il utilise les statuts de la coopérative pour définir des conditions spécifiques de propriété.
La démarchandisation du travail a aussi une influence sur la vie institutionnelle de la coopérative en créant les conditions pour que les membres développent des liens affectifs entre eux et un esprit communautaire. La propriété est transformée en véhicule social pour créer du sens et construire une culture commune. « Nous avons étudié les raisons pour lesquelles d’autres coopératives ont échoué. Dans la plupart des cas, c’est le fait du surinvestissement et finalement de l’épuisement de membres dont elles étaient devenues trop dépendantes », explique Joe Holtz, cofondateur de la PSFC4. « Un de nos principes était de tenter d’imiter ce que font les détaillants : rester chez nous et nous faire livrer […] Nous avons compris que, pour durer, nous devions fonctionner comme un vrai magasin, avec des heures fixes. » L’exigence de contribuer au travail résout à elle seule trois problèmes à la fois : le risque de surinvestissement et de burn-out, les coûts de main-d’œuvre élevés et l’absence d’une culture communautaire forte.
POURQUOI RELATIONALISER LA PROPRIÉTÉ ?
Qu’entendons-nous exactement par « relationaliser » la propriété » ? Avant de passer aux prochains exemples, prenons un moment pour nous pencher sur les implications sociales étouffantes et répressives des formes conventionnelles de propriété. Cela nous permettra de comprendre comment la relationalisation de la propriété peut nous aider à nous libérer de l’étau du droit existant de la propriété et ouvrir ainsi de nouvelles possibilités plus épanouissantes.
Le droit de la propriété tel que nous le connaissons aujourd’hui a créé un ordre social qui ressemble à un théâtre de marionnettes. Le propriétaire tire les ficelles qui contrôlent les bras, les jambes et la tête de la marionnette – c’est-à-dire du non-propriétaire. Le propriétaire peut secouer les marionnettes de telle ou telle façon, en fonction de ce qu’il estime plus rentable ou plus attrayant. Pas étonnant dans ces conditions que nous désirions tous être des marionnettistes plutôt que des marionnettes ! À mesure que nous nous divisons en deux catégories, celle des nantis et celle des démunis, les propriétaires accumulent toujours plus de capital et de pouvoir, et gagnent les motivations, les moyens et la possibilité d’abuser des non- propriétaires et du monde naturel. L’alliance des droits de propriété et des marchés contribue à déposséder radicalement de larges segments du monde de leurs capacités économiques et politiques.
Relationaliser la propriété signifie organiser la mise en œuvre des droits d’utilisation de manière à cultiver nos relations aux uns et aux autres, au monde non humain et aux générations passées et futures. Par principe, chacun est tenu d’assumer cette responsabilité et encouragé à prendre soin de ces relations et du bien commun. Il est tout simplement impossible que de telles normes culturelles puissent prendre racine et s’épanouir dans le cadre des systèmes de propriété conventionnels fondés sur l’ancienne ontologie des « moi-isolés », de la domination et de l’exclusion. Dans le cadre de la Propriété relationalisée, cela devient possible.
« Relation » vient du latin relatus, participe passé de referre, qui signifie « ramener » ou « rapporter ». Relationaliser inclut donc l’idée de revenir à un rapport – quelque chose qui aurait pu exister avant un acte d’appropriation ou d’aliénation au marché. Cela signifie fondamentalement reconnaître et honorer la variété des relations qui préexistent à celles qu’imposent les marchés et le droit moderne de la propriété. Nous devons concevoir des systèmes susceptibles de renforcer une gamme de relations plus riches et plus ouvertes à travers de nouvelles façons de posséder.
Tout cela nous ramène à l’idée des affordances, ou possibilités. Nos façons de posséder doivent soutenir un éventail plus large de relations, de comportements et de cultures que ce qui est généralement permis par les droits de propriété et les échanges marchands traditionnels. La propriété doit devenir un soutien de la coopération sociale, de la gestion écologique responsable et de dons non réciproques. Si les marionnettistes/propriétaires réussissent à s’affranchir de leur rôle de manipulation des marionnettes/nonpropriétaires, une nouvelle dynamique sociale plus collaborative pourra émerger.
Les régimes de Propriété relationalisée nous permettent d’échapper au piège d’une subordination impuissante à la volonté des autres. Ils sont fondés sur la reconnaissance de nos liens d’interdépendance, bien différents des liens de subordination associés aux droits de propriété modernes. Cependant, il ne faut pas confondre la Propriété relationalisée avec un collectivisme coercitif. Si au xxie siècle les régimes de propriété au sein des communs sont ressentis comme des contraintes ou des prisons, c’est que quelque chose a mal tourné. Au sein de la Park Slope Food Coop, chacun choisit de devenir membre-propriétaire et, ce faisant, d’assumer certaines charges et certains engagements partagés. C’est de la plus haute importance, car il y a une grande différence entre entrer volontairement en relation avec les autres et être contraint de le faire. Dans le cas de la Park Slope Food Coop, les gens adhèrent sur une base entièrement volontaire – puis les dispositions juridiques viennent entretenir ces relations. En fait, cet engagement volontaire est constamment renouvelé à travers un régime de propriété spécifique. Cela n’a rien à voir avec des relations imposées par la nécessité ou la coercition. La Propriété relationalisée vise à élargir l’éventail des choix individuels et à enrichir notre humanité – tout en minimisant la subordination hiérarchique (ou la domination) envers les autres et les sentiments de méfiance et de peur qui en découlent.
Cela ne signifie pas que les individus ne continuent pas de bénéficier de droits d’utilisation individuels, comme nous l’avons vu à propos du Mouvement brésilien des travailleurs ruraux sans terre (MST) au chapitre 5. Mais ces droits individuels sont dépendants de leur contexte spécifique et y sont structurellement intégrés. Il ne s’agit pas de droits décontextualisés, abstraits et déconnectés des obligations envers les autres détenteurs des droits similaires. Les individus ne peuvent pas non plus se soustraire à leurs coresponsabilités en matière de co-possession, de co-utilisation et de gestion responsable. On pourrait appeler cet arrangement l’approche « Moiimbriqué » de la propriété.
La grande vertu de la Propriété relationalisée est sa capacité à faire naître et à cultiver toutes sortes de relations vivantes qui seraient probablement étouffées ou marchandisées dans le cadre des régimes de propriété conventionnels. Au lieu de donner la place centrale à la relation propriétaire/objet (marionnettiste/marionnette), avec les nombreux dommages qui en résultent, la Propriété relationalisée permet aux relations humaines, sociales et écologiques de s’épanouir plus naturellement et plus librement. Il devient possible d’échapper aux logiques de profit et d’instrumentalisation généralement associées aux régimes de propriété5.
La Propriété relationalisée permet d’harmoniser et d’amplifier au moins six types de relations qui sont entravées par la propriété privée. Les relations principales sont (1) le rapport à nous-mêmes, en nous aidant à voir plus clairement le sens de la propriété dans notre vie, et (2) le rapport avec nos pairs, en favorisant des droits et des responsabilités mutuellement acceptables. Au moins quatre autres types de relations en sortent également renforcées : les relations (3) avec les expériences vécues (souvenirs, traditions, sentiments) liées à des lieux et à des choses possédées, qui nous incitent à prendre soin de ce que nous aimons ; (4) avec les autres générations, en honorant les générations précédentes et en cherchant à respecter les générations futures et à leur ménager un terrain propice ; (5) entre les communs et les autres institutions sociétales telles que l’État et les marchés ; (6) avec les mystères de la condition humaine, à travers la réflexion sur les objectifs et le sens ultime de nos efforts. Relationaliser la propriété signifie respecter, protéger et approfondir ces relations à travers notre utilisation de la propriété – ce qui ne peut être réalisé qu’à travers la pratique des communs et la négociation de droits d’accès et d’utilisation consensuels. Six types de relations favorisées par la Propriété relationalisée
| Relation engagée | Question directrice | Outil convivial |
|---|---|---|
| 1 Relation à soi-même | Mes besoins sont-ils satisfaits ? | Réflexion sur la signification de la propriété dans son existence6 |
| 2 Relations entre pairs | Les pairs jouissent-ils de droits égaux à la décision et négocient-ils des droits d’usage et des responsabilités acceptables (même différenciés entre participants) ? | Système des heures de travail de la Park Slope Food Coop et concept de membre-propriétaire |
| 3 Relations entre humains et le monde « au-delà de l’humain » |
Les règles et les droits découlant de la Propriété relationalisée respectentils et nourrissent-ils les relations affectives partagées des gens avec, par exemple, des parcs, des œuvres d’art, des cimetières, des lieux de culte, des lacs et rivières, des montagnes, des forêts ? | Tabous, rituels et célébrations ; res nullius in bonis ; patrimoine commun de l’humanité (culturel ou naturel) |
| 4 Relations entre générations passées, présentes et futures |
Les droits d’usage et les responsabilités reflètent-ils une perspective de « long aujourd’hui7 », et en particulier le principe de la justice intergénérationnelle ? | Mécanismes de redistribution proactive des bénéfices ; constitution de réserves en vue du don dans les cadres traditionnels |
| 5 Relations interinstitutionnelles entre communs, et entre communs et le couple marché/État |
Le régime de Propriété relationalisée reconnaît-il une membrane semi-perméable autour du commun, qui lui évite d’être exploité par des agents extérieurs ? Permet-il aux commoneurs de bénéficier de droits qui n’existent pas dans le cadre de l’échange de marché ? | Licences protégeant les contenus ouverts ou les communs comme la General Public Licence (GPL) (p. 303304) ou les semences open source (p. 310). |
| 6 Relations entre un régime spécifique de propriété et la quête de sens ultime des gens |
L’organisation de la Propriété relationalisée génère-t-elle un sentiment d’appartenance et contribue-t-elle à un monde plus libre, plus juste et plus soutenable ? |
Dans un régime de propriété rationalisée, le lien habituel établi par la propriété – entre le propriétaire et la chose possédée, comme s’il s’agissait seulement d’une relation sujet/objet – continue d’exister. Mais cette relation, bien que certainement importante, n’est plus considérée comme l’essence de la propriété. Relationaliser la propriété consiste à restaurer l’espace juridique permettant à une myriade de relations non marchandes de s’épanouir – soins affectifs et coutumes, vitalité de la terre et des autres systèmes naturels, respect intergénérationnel. À travers un cadre socio-légal de propriété différent, il devient possible de rétablir toutes sortes de relations que la conception moderne et libérale de la propriété (domination, valeur d’échange monétisée) a bannies ou marginalisées.
Il convient de répéter, comme nous l’avons déjà indiqué au chapitre 5, qu’il n’est pas question ici de proposer une nouvelle forme de propriété qui se situe quelque part sur le spectre des formes existantes de propriété entre la propriété individuelle et la propriété collective. L’objectif n’est pas de faire coexister de manière plus harmonieuse la propriété individuelle et la propriété collective, qui subsisteraient en tant que domaines séparés et indépendants. Il s’agit de renoncer à l’argument selon lequel l’une serait supérieure à l’autre. Cela signifie que nous devons nous ouvrir à de nouvelles configurations de droits d’utilisation et à de nouvelles façons d’en bénéficier individuellement et collectivement. Plutôt que de simplement « équilibrer » les avantages respectifs des droits de propriété individuels et collectifs, l’idée est de concevoir un régime de propriété qui intègre et harmonise les deux dans son principe même, minimisant les conflits potentiels. Certes, il y aura des conflits quoi qu’il arrive. Les tensions ne disparaissent pas automatiquement grâce à la Propriété relationalisée. C’est pourquoi les patterns de la pratique des communs identifiés dans les chapitres 4, 5 et 6 sont si utiles : ils fournissent un moyen ou une méthodologie pour aborder ces conflits tout en préservant les relations.
C’est ainsi que la richesse-soin pourra émerger. Des relations animées par des convictions personnelles profondes, par les traditions ou encore par l’amour peuvent transformer la façon dont nous percevons et vivons la propriété. Nous attribuons un certain sens et une certaine importance à ce qui suscite notre attention et notre amour : paysages, objets sacrés, objets de famille ou tout autre objet considéré comme une « propriété ». Les œuvres artisanales portent les signes d’une attention minutieuse et personnelle que n’ont pas les produits industriels de masse. La Park Slope Food Coop est très différente d’un supermarché précisément parce que tous ceux qui y travaillent se soucient du lieu et du cadre de travail d’une manière qui va au-delà des relations que les gens entretiennent en tant que consommateurs ou employés.
En résumé, le concept de Propriété relationalisée nous rappelle que les relations de propriété ne sont jamais seulement bilatérales, entre le propriétaire et la chose possédée. Elles impliquent toujours des relations multiples – économiques, écologiques, sociales, intergénérationnelles, psychiques, spirituelles, etc. Il est important de reconnaître cette idée fondamentale que toute forme de propriété et tout modèle de société se construit en dernière instance dans une relation de dépendance à une Terre vivante et au réseau dense de relations qui la constituent. Rappelez-vous la sage formule de Thomas Berry selon laquelle l’univers « n’est pas une collection d’objets, mais une communion de sujets8 ».
UNE PLATEFORME CONÇUE POUR
LA COLLABORATION : LE WIKI FÉDÉRÉ
Le choix principiel le plus important dans toute pratique des communs est sans doute celui de se reconnaître comme Moiimbriqué doté d’une Rationalité Ubuntu. Cette exigence est particulièrement pertinente pour la nouvelle génération de logiciel wiki, la plateforme des wikis fédérés, fondée sur la technologie que Wikipédia a contribué à populariser. C’est une plateforme étonnante qui permet à des œuvres créatives individuelles de se combiner de manière transparente pour former un contenu disponible collectivement, sans la lourdeur administrative et les conflits éditoriaux d’un wiki traditionnel.
Depuis sa création en 2001, Wikipédia a démontré qu’elle pouvait fournir une plateforme à la fois remarquablement robuste et flexible en rassemblant des connaissances fiables et actualisées sur d’innombrables sujets et en laissant une large place aux controverses et à la diversité des points de vue. Toutefois, en tant que wiki conçu pour permettre à plusieurs personnes (« clients ») d’interagir avec une seule plateforme de wiki (« hôte »), Wikipédia a parfois besoin qu’un modérateur ou un éditeur fasse des choix sur ce qui doit être publié. Cela amène souvent les éditeurs à choisir le contenu le moins controversé, et cela peut entraîner des désaccords, voire des conflits, entre contributeurs. Dans un wiki fédéré, par contraste, chaque utilisateur individuel a son propre site wiki, qui peut librement s’inspirer du contenu d’innombrables autres sites Fedwiki. Cela signifie que toutes les voix peuvent être entendues dans leur riche et véritable diversité. Les participants à un wiki fédéré peuvent décider d’interconnecter leurs pages wiki au sein d’un environnement de contenu neutre et partagé qui rend visibles les points de consensus.
Ce passage du wiki standard à une forme d’écriture fondée sur le principe « à chacun son wiki dans un environnement fédéré » peut apparaître comme un pas en arrière par rapport au style de collaboration ouverte de Wikipédia9. En réalité, c’est le contraire : des espaces individuels articulés dans un environnement partagé engendrent un patrimoine commun plus riche et plus solide. Nous en avons fait l’expérience directe en utilisant nous-mêmes un wiki fédéré pour nos recherches et pour la rédaction de ce livre.
Que signifie avoir et posséder dans un monde Fedwiki ? En quoi cela ressemble-t-il à la propriété conventionnelle ou en diffère-t-il ? Imaginez un immense territoire accueillant divers bâtiments10. Certains sont des habitations de quelques pièces, d’autres des immeubles avec plusieurs appartements. Certains de ces bâtiments sont regroupés en quartiers. D’autres sont plus petits et plus isolés. Ils sont dispersés sur tout le territoire, mais il y a des couloirs, des chemins et des routes, aux tracés irréguliers, qui peuvent potentiellement les interconnecter tous. C’est une bonne description spatiale de l’écosystème Fedwiki. Chacun a sa propre habitation, pouvant être connectée aux autres. Chez moi, j’apprécie certes le fait d’avoir des visiteurs, mais quand ils partent, je retrouve mon intimité et ma zone de confort protégée. En retour, mes visiteurs peuvent eux aussi décider quand et combien de temps ils souhaitent rester dans mon espace Fedwiki. Comme un site n’est pas un espace physique mais plutôt un espace virtuel, n’importe qui peut librement puiser le contenu que j’ai déposé dans mon espace et le copier dans le sien (le logiciel garde une trace de la source et de son auteur). Comme l’explique Ward Cunningham, le développeur du logiciel Fedwiki, « j’apprécie les visiteurs parce que leur présence m’est profitable. Je gagne sans qu’ils y perdent ». (Voir image 40 : Capture d’écran améliorée de la page Federated wiki, téléchargeable sur www.eclm.fr)
Il suffit de quelques clics pour s’approprier un espace dans l’écosystème du wiki fédéré. Vous vous enregistrez et vous connectez avec votre identité numérique à la manière dont vous utiliseriez un appartement que vous auriez loué. « Vous vous connectez à ce site comme si vous déverrouilliez la porte d’entrée de votre maison, poursuit Cunningham. Posséder cette clé est ce qui confère un pouvoir sur ce qui se trouve à l’intérieur. » Cela signifie que, sur ces sites – dans vos « espaces » –, le logiciel est conçu pour vous permettre à vous seul d’ajouter du texte, des images, des vidéos. Vous seul pouvez écrire, supprimer et modifier. Cependant, les autres peuvent facilement sélectionner et intégrer tout élément de votre site en faisant simplement un « glisser et déposer » des pages wiki souhaitées sur leurs propres wikis. Et à l’inverse, vous pouvez vous-même à votre tour extraire des éléments de leurs sites – ou de ceux de n’importe qui d’autre !
En d’autres termes, le logiciel Fedwiki crée des espaces individuels protégés pour la génération de contenus tout en facilitant les diverses permutations propres à la création collaborative à grande échelle. Il ouvre d’innombrables possibilités pour les individus d’organiser leurs propres connaissances tout en les partageant facilement avec d’autres, et qui plus est, il permet l’émergence d’un patrimoine commun de connaissances sans l’intervention d’un éditeur. Pour utiliser une autre métaphore : les personnes qui utilisent les sites Fedwiki sont comme des jardiniers ou des agriculteurs. Ils peuvent cultiver autant de champs ou de jardins qu’ils le souhaitent et récolter les fruits de leur propre Fedwiki, mais n’importe qui d’autre peut également utiliser la récolte de quelqu’un pour améliorer ses propres champs et jardins. Au lieu de travailler sous un régime d’exclusion privée et concurrentielle, le système encourage les avantages coopératifs par la pratique des communs.
Image 41 : Wiki traditionnel / wiki fédéré
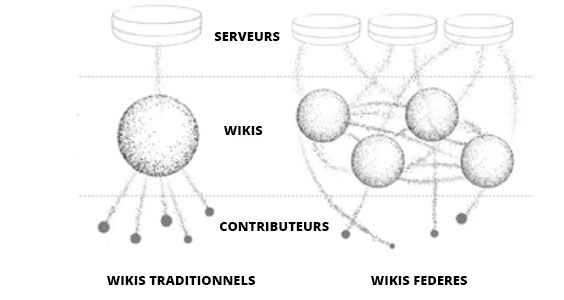
Dans un wiki traditionnel, plusieurs utilisateurs individuels contribuent à un seul wiki sur un seul serveur, comme le montre la figure de gauche. Dans un wiki fédéré, le contenu de plusieurs wikis individuels hébergés sur plusieurs serveurs peut être compilé de manière sélective sur le wiki d’une seule personne, comme le montre la figure de droite.
Que vous travailliez sur votre propre instance de wiki fédéré ou que vous rejoigniez un « quartier » de sites déjà existant, vous gardez le contrôle sur ce qui se passe dans votre espace. Dans les deux cas, le partage entre espaces par le biais de la fédération reste très facile en glissant et en déposant du contenu ou en le transférant sur de nouveaux espaces. C’est ainsi que le wiki fédéré permet la mise en place d’un espace personnel et protégé tout en nourrissant le patrimoine commun de connaissances grâce à un processus de fédération autogéré.
Cette technologie nous aide ainsi, dans sa conception même, à réaliser un Ontochangement. La plateforme Fedwiki brouille la dualité supposée entre individu et collectif. Ces deux dimensions sont structurellement intégrées de sorte qu’elles se stimulent mutuellement. Cultiver mon propre espace n’entre pas en contradiction ou n’interfère pas avec ma contribution aux communs – bien au contraire. C’est un exemple éclatant de Rationalité Ubuntu à l’œuvre et de Moi-imbriqué ! Par principe, une idée devient plus puissante lorsqu’elle est partagée sans l’intervention (ou l’interférence !) d’algorithmes conçus par des entreprises (par exemple, Facebook), des éditeurs (Wikipédia), des données d’audience (Yelp) ou d’autres hébergeurs. Le wiki fédéré crée un environnement numérique dans lequel la contribution de chacun enrichit les autres sans qu’il faille renoncer au contrôle de son propre espace. C’est comme si l’on disait : « Entrez chez moi, la porte est ouverte. Utilisez ce que vous voulez et ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas salir mon espace. » Le logiciel Fedwiki empêche les gens de modifier votre contenu tout en leur permettant de le « prendre ».
Certes, pouvoir mobiliser le contenu de quelqu’un d’autre implique de respecter certaines conditions. « Nous insistons pour que ceux qui prennent un contenu créditent l’espace source », écrit Cunningham. À l’évidence, cela ne doit pas être pris au sens littéral. Il n’est pas question d’envoyer des courriels ou des lettres brandissant la menace de poursuites judiciaires. Le wiki fédéré garantit le lien à la source : lorsqu’un contributeur mobilise un contenu par glisser-déposer ou par bifurcation, le logiciel attache au contenu un petit drapeau coloré d’une teinte spéciale qui vous est associée. « Notre espace, poursuit Cunningham, nous définit tout en accueillant les autres. »
La relation mutuellement nourricière entre un wiki fédéré personnel et le wiki fédéré commun n’est que l’une des manières dont cet univers remarquable réinvente la propriété. Si un utilisateur décide de se connecter à la fédération, les revendications de contrôle privé exclusif sont abandonnées et les fruits de la collaboration sont automatiquement partageables. (Bien entendu, l’utilisateur peut également choisir de conserver le contrôle exclusif de son contenu si son instance de wiki reste déconnectée du réseau Fedwiki.) C’est une transformation spectaculaire de la manière même dont nous imaginons habituellement la propriété d’un contenu. Au lieu de faire du partage un choix individuel au cas par cas (stratégie utilisée par les licences Creative Commons, par exemple), la plateforme Fedwiki inscrit dans sa conception technologique même le partage des contenus par défaut. Une fois qu’un utilisateur choisit d’utiliser le logiciel Fedwiki, il n’est plus possible de s’écarter de cette norme, par exemple en cherchant à garder le contrôle privé absolu sur le contenu ou à lui appliquer des licences particulières.
Tout le contenu publié sur les sites du wiki fédéré est automatiquement soumis à une licence Creative Commons AttributionShareAlike 4.0 – ce qui signifie qu’il est « partageable par défaut » dès sa publication, le mettant ainsi à la disposition de la fédération de sites. Le « journal » du wiki fédéré permet de suivre l’historique des contributions, de sorte que la paternité peut être retracée même si des personnes font des mixages de contenu11.
Dans le monde physique, le droit de la propriété établit souvent des régimes de possession différents pour les minéraux, le pétrole ou le gaz localisés dans le sol que pour l’utilisation de la surface du sol (propriété foncière conventionnelle). Il est courant que les infrastructures soient sujettes à un régime juridique différent de celui qui s’applique à tout ce qui est produit grâce à ces infrastructures. Les droits de propriété d’un bâtiment peuvent être séparés de la propriété du terrain, et la propriété du contenu d’un site web est considérée comme distincte de la propriété du réseau Wi-Fi et des lignes téléphoniques sur lesquels ce contenu circule. La manière dont ces différentes couches de droits de propriété s’interconnectent peut avoir des implications importantes. La Constitution de la plupart des pays d’Amérique latine stipule que les minerais souterrains appartiennent de droit à l’État-nation12. Cette autorité légale permet aux gouvernements d’exploiter ces ressources par l’intermédiaire d’entreprises publiques ou d’accorder des concessions minières à des entités privées, généralement des multinationales. À l’évidence, ce régime de propriété n’empêche pas la surexploitation des minerais et ne garantit en rien une gestion responsable des écosystèmes ; au contraire, il va souvent de pair avec un extractivisme néocolonial hautement destructeur. Quoi qu’il en soit, la possibilité de réglementer les droits de surface, d’une part, et les droits souterrains, d’autre part, montre bien que les systèmes complexes de droits de propriété n’ont rien d’évident ou de « naturel ». Soyons clairs : il n’y a aucune raison impérieuse en soi pour que ceux qui extraient du pétrole ou des minerais aient nécessairement le droit d’en être propriétaires. Ce droit n’est qu’une construction politique qui a été légitimée par la loi.
De même, il fut un temps où les propriétaires fonciers étaient non seulement propriétaires de leurs parcelles de terrain, mais aussi de l’air au-dessus de leur terrain jusqu’au ciel, ce qui signifiait que, d’un point de vue juridique, les avions qui passaient violaient leurs droits de propriété privée13. Ces droits étaient fondés sur la maxime juridique latine Cuius est solum, eius est usque ad coelum et ad infernos – « Quiconque possède la terre, elle lui appartient jusqu’au ciel et jusqu’en enfer14 » –, un principe réaffirmé des siècles plus tard par le juriste anglais William Blackstone, selon qui la propriété foncière s’étendait « à une étendue indéfinie, vers le haut comme vers le bas15 ». Au fil du temps, cependant, ce principe a été radicalement limité, généralement dans l’optique de renforcer le pouvoir des États et des entreprises. En d’autres termes, les interconnexions entre les régimes juridiques sont toujours une zone potentielle de conflit politique.
C’est cette conflictualité que la plateforme du wiki fédéré a largement réussi à surmonter en s’appuyant sur une interconnexion organique entre régimes juridiques et sur des structures distribuées. Elle a procédé à une réorganisation astucieuse de différentes couches de droits de propriété – de fait, elle les a d’une certaine manière transcendées – afin de promouvoir la pratique des communs. « Nous distinguons la possession et l’exploitation d’un serveur16 de la possession et de l’exploitation d’un site », explique Ward Cunningham, notant que le contenu est éparpillé sur de nombreux serveurs web. Le contenu numérique est largement diffusé et échappe donc au contrôle d’un seul propriétaire de serveur. En outre, comme il a déjà été mentionné, le logiciel de la plateforme encourage et facilite le partage de contenu en tant que fonction intégrée du système. Cette caractéristique, ainsi que l’utilisation obligatoire de licences Creative Commons, contribue également à mettre le contenu hors de portée de toute tentative d’appropriation privée17. La plateforme Fedwiki crée un espace de créativité et de culture dans lequel l’enchevêtrement des lois sur les droits d’auteur est structurellement neutralisé. Fedwiki permet aux utilisateurs d’empêcher a priori toute tentative juridique extérieure de prise de contrôle et d’affirmer leur souveraineté selon leurs propres conditions.
Le commun qu’est Fedwiki présente encore toutefois une vulnérabilité, qu’il n’a pas encore pu contourner, face aux tentatives extérieures de contrôle : l’authentification de l’identité numérique. Au vu de la difficulté à développer une alternative favorable aux communs, Cunningham et ses collègues ont dû recourir aux systèmes d’identité développés par Google et Facebook, utilisés par défaut par de nombreux sites sur l’Internet. Ce choix est compréhensible. Il est techniquement compliqué et coûteux de créer des systèmes numériques pour confirmer de manière fiable qu’une personne qui s’identifie est bien cette personne et non un imitateur ou un criminel. Cela rend le wiki fédéré vulnérable à la puissance commerciale des deux géants technologiques, mais cette lacune pourrait être comblée à l’avenir.
Le wiki fédéré n’en représente pas moins un nouveau type de plateforme de réseau qui réussit à contourner les dynamiques de domination et de subordination de la propriété conventionnelle. C’est une expérience pionnière riche de leçons et une source d’inspiration pour de futures innovations fondées sur les communs. Elle démontre qu’il est possible de concevoir des alternatives distribuées, s’appuyant sur les communs, aux plateformes hautement centralisées et capitalisées qui favorisent la polarisation sociale, manipulent les utilisateurs, violent la vie privée et concentrent le pouvoir politique. Le présupposé selon lequel la propriété privée (droits d’auteur, brevets) est le seul moyen d’organiser les comportements en ligne et de stimuler l’innovation est tout simplement faux. Il est intéressant de noter que l’idée centrale de la conception du wiki fédéré est similaire à celle qui régit l’organisation de nombreux monastères, comme nous l’avons vu au chapitre 5 : il s’agit de fournir des environnements favorables à la vie collective tout en protégeant les choix personnels.
Ce n’est pas seulement sur les plateformes numériques qu’il est possible de construire un arrangement juridique qui équilibre les droits personnels avec les besoins de la communauté et le bien commun. C’est également possible dans notre bon vieil environnement physique « analogique », comme nous allons maintenant le voir avec l’exemple du Mietshäuser Syndikat en Allemagne.
NEUTRALISER LE CAPITAL SUR LE MARCHÉ DU LOGEMENT : L’HISTOIRE DU MIETSHÄUSER SYNDIKAT
Le marché immobilier est aujourd’hui un univers impitoyable dominé par des banques d’investissement sans scrupule, des spéculateurs, des propriétaires et des sociétés de gestion d’appartements.
Il semble donc improbable que l’on puisse réussir, dans un tel contexte, à construire et à préserver des communs de logement. Pourtant, c’est précisément ce qu’a fait le Mietshäuser Syndikat. Cette initiative pionnière est née à Fribourg, une jolie ville pittoresque à la lisière sud de la Forêt-Noire, avant de s’étendre à toute l’Allemagne et aux pays voisins. Le Mietshäuser Syndikat est une fédération de communs de logement qui existe depuis 1987. Son nom, qui se traduit approximativement par « syndicat d’immeubles d’appartements locatifs », reflète sa mission de base : contribuer à développer une fédération de biens immobiliers résidentiels gérés en commun par les résidents. Les gens sont propriétaires des immeubles, mais paient en même temps un loyer à eux-mêmes et à la fédération pour faire fonctionner l’ensemble du système.
Dans nos sociétés où presque tous les biens immobiliers sont gérés comme des propriétés privées devant servir à investir des capitaux et à réaliser des bénéfices, une réussite comme celle du Mietshäuser Syndikat est remarquable. « En fait, nous ne devrions même pas exister [selon l’économie standard], déclarent ses animateurs18, parce que notre approche viole les règles du marché. » C’est ce qui rend l’expérience si rafraîchissante : le Mietshäuser Syndikat a fait prospérer des dizaines de projets où les gens aiment vivre, sans que personne craigne que le marché ne les force à vendre leurs appartements ou que le syndicat ne vende les immeubles et n’expulse les gens (il ne le peut pas). Au cours des trente dernières années, le Mietshäuser Syndikat a retiré plus de 130 immeubles locatifs du marché immobilier. Cela a permis de mettre des logements collectifs durablement abordables à la disposition de plus de 2 900 gens ordinaires. Entre 2013 et 2015, la taille du syndicat a presque doublé, passant de 50 à 95 projets de logement affiliés. Fin 2018, 136 projets étaient associés au Mietshäuser Syndikat et 17 autres envisageaient de le rejoindre.
Pour les nouveaux arrivants, le syndicat du logement peut apparaître comme un méli-mélo de projets de logements locatifs très différents. Ses avoirs sont dispersés dans toute l’Allemagne – et désormais au-delà des frontières nationales, en Autriche et aux Pays-Bas – et incluent une structure pour femmes âgées, des immeubles commerciaux, un grand immeuble d’appartements pour parents célibataires et une ancienne caserne militaire reconvertie qui abrite aujourd’hui plus de 200 personnes. Bien que différents par leur forme, leur emplacement et leur taille, ces projets ont en commun une même approche visant à démarchandiser les terrains, les bâtiments et les appartements individuels dont les gens ont besoin.
« L’idée d’organiser des bâtiments et des biens immobiliers comme des communs n’est pas nouvelle, écrit Stefan Rost, un des animateurs du projet de Fribourg, qui cite le rôle historique des grandes coopératives et des associations de logement19. Ce qui rend le syndicat si inhabituel est sa structure socio-légale particulière qui permet de démarchandiser le logement et de le tenir indéfiniment à l’écart du marché. Cette structuration a permis aux locataires d’échapper au marché immobilier, ainsi qu’à sa logique d’exploitation et de spéculation, et d’acquérir de beaux lieux de vie avec des « loyers » raisonnables et un avenir sécurisé. (Les paiements mensuels ne sont pas vraiment des loyers car ils ne reflètent pas les prix ou les pressions du marché. Ils incluent les coûts normaux d’entretien des bâtiments et une contribution au fonds de solidarité.)
Ce ne sont pas des objectifs faciles à atteindre sur la durée, et encore moins sur plusieurs générations. À mesure que les prêts sont remboursés et que les prix de l’immobilier augmentent au fil des ans, même les coopératives et les résidents en habitat partagé peuvent être tentés de vendre et de récolter un pactole. Les sacrifices idéalistes consentis par la génération antérieure, à l’origine de la création d’une coopérative de logement, risquent d’être liquidés par la génération suivante de résidents, si elle décide de monétiser à son propre profit des décennies d’équité sociale – et de faire prévaloir à nouveau les intérêts de marché. C’est une histoire trop familière qui renvoie à un problème de fond : comment empêcher qu’un commun géré par des pairs n’aliène les actifs permanents dont tout le monde dépend ? « Ce n’est pas possible de simplement se surveiller soi-même », explique Jochen Schmidt, membre du syndicat, et cela ne fonctionne pas toujours20. Les membres ne peuvent pas (et ne souhaitent pas) recourir à une forme de supervision externe sans créer un risque pour leur souveraineté. Et à qui abandonneraient-ils leur autorité de toute façon ? Stefan Rost résume bien le défi : « Il faut trouver des règles et des formes – au sein du Syndikat – qui assurent la longévité du projet et empêchent sa reprivatisation et son asservissement au marché des capitaux21. »
Le Mietshäuser Syndikat a relevé ce défi à travers un dispositif juridique ingénieux qui peut sembler contre-intuitif22. Il confère le titre de propriété de chaque bien immobilier non seulement à l’association des résidents, mais aussi à une GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), équivalent d’une société à responsabilité limitée. La GmbH a deux et seulement deux propriétaires : l’association des résidents de chaque ensemble de logements concerné et le Mietshäuser Syndikat. Le but de cet arrangement est de donner au Mietshäuser Syndikat le pouvoir d’agir en tant qu’organe de surveillance. Il dispose de droits de vote limités aux questions fondamentales relatives au bien, telles que le droit de le vendre ou de le convertir en copropriété, ou encore à la modification des règles de gouvernance d’une association de logement. Sur tous les autres points, l’association de résidents conserve ses pleins pouvoirs d’autodétermination. Cette structuration signifie que tout changement fondamental concernant les biens immobiliers nécessite l’accord à la fois de l’association des résidents et du Mietshäuser Syndikat. Chacun dispose d’un droit de veto fonctionnel. Le syndicat intervient comme un contre-pouvoir vis-à-vis de tout groupe de résidents qui souhaiterait vendre sa propriété. Et aucun groupe de résidents ne peut modifier la gouvernance de la société à responsabilité limitée elle-même, car celle-ci ne peut être modifiée ou liquidée unilatéralement par un ayant droit agissant seul. Grâce à ce mécanisme de veto mutuel, le syndicat est en mesure de réaliser ce qu’il appelle une « neutralisation du capital », terme inventé par Matthias Neuling23. Ce mécanisme empêche que les actifs détenus par les communs de logement ne reviennent sur le marché.
Dans les plus de 136 projets associés au Mietshäuser Syndikat, chacun gère ses propres affaires sociales et économiques dans le cadre d’une Gouvernance par les pairs. Chacun est juridiquement indépendant et fonctionne comme n’importe quelle coopérative de logement. Une assemblée des membres prend des décisions démocratiques sur les règles et les pratiques de location et de gestion du bâtiment, sur les rénovations, le financement, etc.
Le régime juridique du syndicat devait apporter une réponse à un autre problème encore : celui de savoir comment fédérer autant de logements communs différents entre eux. Si tous les projets sont gérés par les pairs et juridiquement indépendants (et doivent le rester) et qu’ils partagent un objectif plus large (la démarchandisation de l’immobilier), comment assurer ce dernier objectif alors qu’il peut y avoir des désaccords entre les dizaines de projets ? Le Mietshäuser Syndikat a conçu un moyen efficace de lier entre eux divers types de biens immobiliers communs en créant une nicht eingetragener Verein (n.e.V.), terme juridique allemand se traduisant grosso modo par « association non enregistrée ». La n.e.V. est légalement propriétaire de la société Mietshäuser Syndikat GmbH. Elle est composée de trois catégories de membres : des personnes intéressées par la démarchandisation de terrains et de logements, des groupes qui ne sont pas impliqués dans des projets de logement associés au syndicat, et les associations de résidents de chaque projet de logement.
Image 42 : La structure organisationnelle du Mietshäuser Syndikat
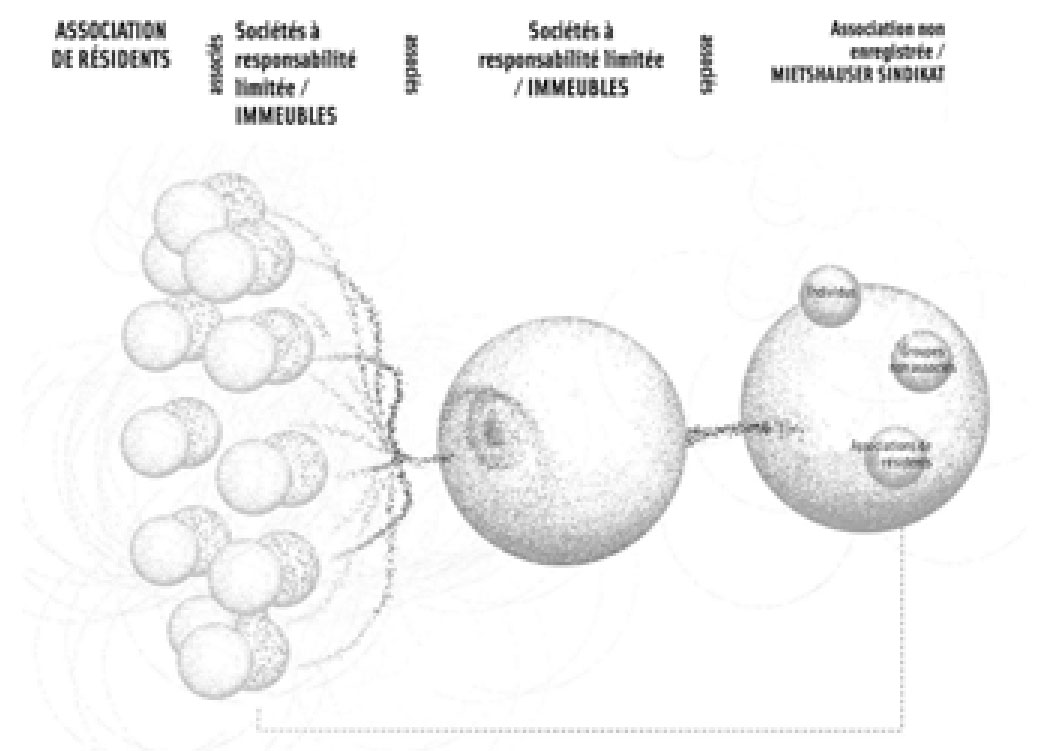
Crédit : Mietshäuser Syndikat 2017 : Das Mietshäuser Syndikat und die Hausprojekte, die Hqüser denen, die drin wohnen, p. 9. https://www. syndikat.org/wp-content/uploads/2017/02/broschuere_nr7.pdf
En utilisant le droit d’une manière aussi créative et inhabituelle, le Syndikat a réussi à redéfinir le sens même de la propriété du logement. Dans les termes de la propriété conventionnelle, les résidents sont des « propriétaires » collectifs de l’immeuble qui, en tant que « locataires » d’unités individuelles, paient également un « loyer ». Mais ces termes impliquent l’existence d’un marché du logement et des mécanismes de prix associés, qui perdent ici toute pertinence. Les résidents d’un immeuble déterminent eux-mêmes combien ils paieront pour vivre dans leur logement, en fonction de ce dont ils ont besoin pour financer l’achat et la rénovation de leur immeuble et soutenir la mission plus large du Mietshäuser Syndikat. Ils affirment une souveraineté des prix similaire à celle que nous avons observée au sein de Cecosesola, la coopérative de solidarité sociale vénézuélienne.
Au cours d’une de nos conversations, un résident nous a fièrement expliqué cette manière spécifique d’avoir : « Bien entendu, je suis propriétaire de ma maison et nous sommes propriétaires de la nôtre24. » Il faut comprendre par là que sa famille est effectivement propriétaire, c’est-à-dire qu’elle a un droit d’usage permanent de son logement (sans droit de la vendre), mais qu’en même temps tous les habitants du complexe ont également un sentiment de propriété collective sur l’immeuble ; ils ne sont pas soumis aux banques ou à des intérêts financiers extérieurs. Ce cercle de propriété collective est en fait encore plus large car tous les biens immobiliers des 136 projets appartiennent également à tous les membres du Mietshäuser Syndikat. Les niveaux des droits d’utilisation sont tellement enchevêtrés que « le mien » signifie toujours « le nôtre » et vice versa. De manière remarquable, tout le travail de gestion du Syndikat est effectué par des bénévoles, à l’exception d’un prestataire rémunéré qui s’occupe vingt heures par semaine de la comptabilité, de la gestion des membres et des tâches administratives de base.
Le syndicat a réussi à relationaliser une vaste quantité de propriétés immobilières. Pendant plus de trente ans, à une exception près, personne n’a pu liquider les actifs collectifs des projets de logement pour en retirer des profits privés25. Il en résulte une attitude à l’égard de la propriété qui relève davantage de la co-possession existentielle que de la domination absolue. En retirant l’immobilier du marché et en partageant la responsabilité de sa gestion et de sa maintenance à long terme, les résidents ont développé une allégeance non seulement envers leur propre commun de logement, mais aussi en même temps envers les autres projets de logement liés au syndicat.
Il ne s’agit pas seulement d’une démarche éthique ou sociale. Les revenus excédentaires du syndicat sont utilisés pour des transferts solidaires vers les projets qui ont besoin de capitaux pour investir dans leurs propres logements communs26. Les projets existants contribuent à un pot commun, le fonds de solidarité, qui sert ensuite à soutenir le lancement de nouveaux projets de logement – un exemple évident de mettre en commun, plafonner et répartir. Les transferts financiers des anciens vers les nouveaux projets aident la fédération à se développer. Dans une copropriété type, les coûts d’investissement initiaux sont élevés, et les bénéfices aussi plus tard, lorsque les investisseurs vendent. En revanche, les communs de logement financent leurs projets en collaboration (souvent avec des prêts bancaires), le but n’étant jamais de générer des profits, mais de rendre plus largement disponibles des logements démarchandisés et gérés par les pairs. Les transferts solidaires sont une manière de « redistribuer par avance » qui montre à quel point l’éthique de coopération entre communs est intégrée à l’ensemble du système.
Ces derniers temps, le succès et la taille du Mietshäuser Syndikat ont incité certains à suggérer qu’il devrait peut-être commencer sa propre « mitose », terme biologique désignant le processus par lequel une cellule se divise elle-même. « Plus nous grandissons, plus le travail à accomplir par l’organe de supervision devient lourd et complexe », reconnaît Jochen Schmidt. Pour certains, cela pourrait impliquer la nécessité de plafonner le nombre de projets pouvant s’affilier au Mietshäuser Syndikat. Quoi qu’on en pense, un tel plafond serait une saine reconnaissance du fait que la poursuite du développement des logements communs nécessitera plusieurs versions du Mietshäuser Syndikat, pas seulement une seule. Les membres du syndicat discutent d’une possible régionalisation de leur fédération, reflétant peut-être l’idée que le modèle du Mietshäuser Syndikat doit s’étendre à travers un processus de type émuler et fédérer.
« HACKER » LA PROPRIÉTÉ POUR AIDER À CONSTRUIRE DES COMMUNS
Dans les trois cas que nous avons étudiés jusqu’ici, nous avons vu comment les commoneurs ont utilisé des moyens ingénieux pour relationaliser la propriété. Dans le cas de la Park Slope Food Coop, ils ont utilisé les statuts de leur coopérative pour définir la propriété non seulement comme un investissement financier des membres, mais aussi comme un droit qui ne peut être garanti que par des heures de travail non payées toutes les quatre semaines. La plateforme du wiki fédéré a créé une architecture logicielle intelligente qui fait du partage de contenu son mode opératoire par défaut. La structure juridique et les normes sociales ingénieuses du Mietshäuser Syndikat lui ont permis de démarchandiser des immeubles résidentiels, d’empêcher leur vente et de faciliter la pratique des communs.
Chacun de ces exemples est au fond une forme de « hacking » de la propriété. Le concept de hacking remonte aux années 1960, dans le cadre du Tech Model Railroad Club du Massachusetts Institute of Technology. Ces passionnés étaient sans cesse à la recherche de solutions techniques créatives pour résoudre les problèmes de leurs trains miniatures – une pratique qu’ils ont fini par appeler hacking, ou « piratage ». Le terme a ensuite été repris par des développeurs amateurs qui assemblaient leurs propres ordinateurs personnels avec des morceaux de code matériel et logiciel qu’ils avaient récupérés, achetés ou improvisés d’une manière ou d’une autre. Dans son livre phare datant de 1984, Hackers: Heroes of the Computer Revolution [« Hackers : héros de la révolution informatique »], le journaliste Steven Levy écrit : « Les hackers informatiques croient qu’il est possible de tirer des leçons fondamentales sur les systèmes – sur le monde – en démontant des choses, en examinant comment elles fonctionnent et en utilisant ces connaissances pour créer des choses nouvelles plus intéressantes. » Les hackers adorent surmonter des problèmes difficiles et complexes en inventant des solutions brillantes et élégantes. Ils se soucient également beaucoup de leurs pairs et du bien public. Comme le dit Eric Raymond dans son Hacker’s Dictionary [« Dictionnaire hacker »], les hackers informatiques estiment qu’ils ont un « devoir éthique […] de partager leur expertise en […] facilitant l’accès à l’information et aux ressources informatiques partout où cela est possible27 ». (Les hackers informatiques distinguent leurs pratiques des activités malveillantes et illégales des « crackers », ou pirates malveillants28.) La pratique et l’éthique du « hack » se sont répandues dans de nombreux domaines, dont le droit. Elle est particulièrement importante pour les commoneurs, qui se trouvent fréquemment obligés de tenter de « hacker » les procédures légales pour décriminaliser et faire progresser leurs pratiques. Réaliser un « hack juridique » signifie essentiellement utiliser et recombiner les outils juridiques existants pour servir un autre objectif que celui pour lequel ils étaient conçus à l’origine. Les avocats et les militants qui imaginent des « hacks juridiques » ont les mêmes ambitions éthiques : subvertir les formes juridiques conventionnelles par des solutions ingénieuses de contournement qui puissent soutenir la pratique des communs. Ces hacks juridiques prennent une multitude de formes, certaines plus audacieuses que d’autres, mais ils exigent généralement une certaine dose de courage, de créativité et d’expertise légale.
Deux de ces « hacks juridiques » ont connu une immense fortune : la General Public License (GPL) pour les logiciels et les licences Creative Commons. La GPL a été développée par Richard Stallman, célèbre hacker de logiciels libres, dans les années 1980 en réponse à la commercialisation et à la privatisation croissantes des logiciels. Dès lors que les logiciels pour ordinateurs personnels devenaient propriétaires, les détenteurs des droits d’auteur – généralement des entreprises – pouvaient empêcher les programmeurs de réutiliser, de modifier ou de partager le code. C’était extrêmement frustrant pour les codeurs comme Stallman qui souhaitaient partager le code et collaborer en vue de son amélioration. Stallman, avec l’aide d’avocats comme Eben Moglen, a donc conçu une licence fondée sur la propriété des droits d’auteur d’un programme. Elle autorise toute personne à copier, partager et modifier le code de quelqu’un d’autre, de quelque manière que ce soit, sans besoin d’autorisation ni de paiement. La seule exigence est que toute version dérivée doit également être disponible aux mêmes conditions. La General Public License, ou GPL, a permis l’essor légal des logiciels libres et open source et a donné naissance à d’innombrables programmes qui ont transformé l’informatique, l’Internet et le commerce29.
Tout comme les bâtiments du Mietshäuser Syndikat ne peuvent pas être remis sur le marché, le code protégé par la GPL ne peut pas redevenir l’objet de propriété privée.
Les licences Creative Commons, inspirées par le succès de la GPL, sont une autre innovation juridique importante qui a facilité le partage. Les licences CC, comme on les appelle, permettent aux détenteurs de droits d’auteur d’autoriser à l’avance que leurs œuvres puissent être librement partagées, copiées et modifiées – ce que la loi sur le droit d’auteur ne prévoit pas. Il s’agit de licences gratuites, standardisées et accessibles que tout détenteur de droits d’auteur peut utiliser pour signaler à l’avance que ses œuvres sont partageables. Tout comme Stallman, le principal créateur des licences CC, le professeur de droit de Harvard Lawrence Lessig, souhaitait trouver un moyen d’utiliser la loi sur le droit d’auteur pour rendre légaux le partage et le remixage des œuvres. Après de longues délibérations avec des juristes et le monde de la création, le groupe à but non lucratif Creative Commons a publié une série de licences permettant de réutiliser les œuvres sous certaines conditions, par exemple uniquement à des fins non commerciales (la licence NonCommercial), ou bien seulement si aucune modification n’est apportée à l’œuvre originale (licence NoDerivatives), ou encore uniquement si une œuvre dérivée est également sous la même licence (licence ShareAlike). Les licences CC sont devenues une infrastructure juridique indispensable pour légaliser le partage dans d’innombrables domaines – édition savante, recherche scientifique, musique, photographie, vidéo, écriture, et bien d’autres encore. Elles sont utilisées dans plus de 175 pays et territoires, et on estime que plus d’un milliard de documents numériques sont disponibles sous licence CC. Il n’est guère surprenant que de nombreux programmeurs ayant une éthique de hacker soient ravis de contribuer à des architectures logicielles qui permettent la pratique des communs. À ce jour, le hack informatique légal a été l’une des rares stratégies efficaces que les commoneurs ont pu adopter pour protéger leurs communs dans un système de marché/État qui poursuit des objectifs très différents. Wikipédia et des milliers de revues scientifiques en libre accès ne seraient pas là si elles n’étaient pas protégées par des licences Creative Commons.
Au début des années 2000, Lessig a eu cette formule mémorable : « Le code est la loi. » Il voulait dire par là que la conception du code des logiciels façonnait si profondément ce que les utilisateurs pouvaient faire sur leur ordinateur et en ligne qu’elle avait le même effet qu’une loi. Le code devient le fondement de nouvelles formes de droit vernaculaire. C’est précisément dans cette optique qu’a été conçue la plateforme du wiki fédéré. Elle va au-delà des moyens du wiki conventionnel en offrant un design plus souple et plus convivial pour le développement de savoirs. Des logiciels similaires sont développés au sein du mouvement des plateformes coopératives, qui construit de nouvelles plateformes web et des applications mobiles pour faciliter l’essor d’alternatives coopératives à Uber, Airbnb et aux douzaines d’autres plateformes propriétaires capitalistes.
Les plateformes coopératives
Le potentiel des réseaux numériques pour encourager le partage et la coopération est immense. Malheureusement, les grandes entreprises technologiques ont capté une grande partie de ces énergies sociales pour leurs propres fins, à savoir la constitution de plateformes puissantes au service du capitalisme. Elles appellent le résultat « économie du partage » ou « économie de la mission ponctuelle » (gig economy), mais il s’agit plutôt en réalité d’une nouvelle espèce de marchés pour la micro-location, le travail à la pièce, l’exploitation de données et le consumérisme.
Des plateformes comme TaskRabbit et Mechanical Turk ont réintroduit le travail à la pièce à grande échelle en offrant quelques centimes pour certaines micro-tâches que les ordinateurs ne peuvent pas effectuer, comme l’indexation d’images, la transcription et le nettoyage des données. D’autres plateformes nous incitent à convertir nos voitures, nos appartements et notre temps libre en actifs louables pour compenser la chute de nos revenus. Des algorithmes informatiques sophistiqués font constamment baisser la rémunération des « entrepreneurs indépendants », ce qui contribue à éroder la possibilité même de continuer à pouvoir jouir d’emplois stables dans des conditions décentes.
C’est pour combattre ces tendances qu’a émergé en 2015 le champ d’expérimentation qu’est le mouvement des plateformes coopératives. Son objectif est d’essayer de développer des sites web et des applications mobiles plus socialement bénéfiques. Si les gens pouvaient posséder et gérer leurs propres plateformes sous forme de coopératives, estime Trebor Scholz, l’un des catalyseurs de ce mouvement, ils seraient en mesure d’en tirer de plus grands bénéfices à long terme et de garder le contrôle face à des géants technologiques bien capitalisés comme Uber et Airbnb. « Et si nous possédions notre propre version de Facebook, Spotify ou Netflix ?, poursuit Scholz. Et si les photographes de Shutterstock.com pouvaient être propriétaires de la plateforme où leurs photos sont vendues30 ? » Plusieurs tentatives allant dans ce sens sont en cours. L’idée est d’aider les producteurs et les utilisateurs à devenir copropriétaires de sites web gérés par leurs membres pour diffuser des archives d’images photographiques, de la musique en streaming et d’autres œuvres d’art.
Les applications co-développées par des administrations municipales et des utilisateurs constituent un autre type de plateforme coopérative. Séoul, en Corée du Sud, a ainsi développé la plateforme Munibnb pour permettre la location d’appartements à de meilleures conditions qu’Airbnb, les revenus étant destinés aux services publics. L’application vise également à empêcher que la conversion de propriétés locatives en logements touristiques ne crée des « quartiers fantômes », un problème qui affecte de nombreuses grandes villes du monde comme Amsterdam, Londres et Barcelone.
Bien qu’il s’agisse encore d’un mouvement émergent, les plateformes coopératives sont une stratégie très prometteuse pour aller à l’encontre de la logique de monopole, d’exploitation et de surveillance des données dans les espaces numériques. Elles peuvent également contribuer à démocratiser la propriété et le contrôle, et assurer une plus grande autodétermination en matière de conditions de travail.
Le hacking juridique est un riche champ d’expérimentation où ne cessent de s’inventer des retouches ingénieuses au droit étatique conventionnel. Les populations indigènes quechuas du Pérou ont créé une zone bioculturelle d’héritage indigène pour protéger des terres d’une grande importance agroécologique et culturelle, et en particulier la biodiversité des variétés indigènes de pommes de terre. En Inde, la Bibliothèque numérique des savoirs traditionnels documente les connaissances traditionnelles, ce qui peut ensuite être utilisé pour bloquer les demandes de brevets visant à privatiser certaines connaissances biomédicales, certaines plantes ou certaines pratiques thérapeutiques31. Le Community Environmental Legal Defense Fund, un groupe basé en Pennsylvanie, aux ÉtatsUnis, a aidé à élaborer une myriade d’ordonnances et de chartes municipales visant à se protéger contre les investissements indésirables d’entreprises et contre les dommages écologiques de techniques comme la fracturation hydraulique32. Il s’agit là de tentatives créatives d’utiliser le droit conventionnel pour protéger l’autonomie des communautés dans un système d’État qui restreint cette autonomie. Le Community Environmental Legal Defense Fund a également travaillé à l’élaboration de statuts types que les États et les localités peuvent adopter pour protéger les droits de la nature contre les abus des industriels – là encore en utilisant des hacks juridiques pour tenter d’établir des principes qui aillent au-delà de ce que la loi reconnaît officiellement, et même au-delà de ce que les législateurs ont envisagé à l’origine. Les droits de propriété étant déterminants en ce qui concerne l’utilisation possible des ressources, nous nous sommes particulièrement intéressés aux hacks juridiques qui permettent de relationaliser la propriété. Nous nous tournons à présent vers une impressionnante initiative qui vise à reconcevoir de fond en comble les droits de propriété sur les semences. Car il est difficile d’imaginer un objet physique qui soit plus profondément immergé dans la toile de la vie et qui fasse en même temps l’objet de tant d’efforts d’appropriation privée à des fins de profit.
SEMENCES OPEN SOURCE
Pendant des millénaires, les gens ont envisagé les semences comme une source mystique et sacrée de fertilité et de nourriture. À travers elles, à partir de rien ou presque, la vie engendrait à nouveau la vie. Depuis son invention il y a dix mille ans, l’agriculture a toujours noué des relations complexes avec les forces naturelles vivantes – le sol, l’eau, les animaux et l’écosystème tout entier – pour produire une nourriture abondante. Cette toile de la vie est aujourd’hui assiégée par de grandes multinationales qui tentent de s’approprier et de contrôler totalement les semences. Depuis le début des années 1980, ces entreprises redoublent d’efforts pour obtenir des droits de propriété intellectuelle de grande ampleur sur les ressources phytogénétiques, et ce, afin de s’attribuer le pouvoir inédit de contrôler la sélection et la production des plantes. La propriété privée des semences a été concentrée entre des mains de moins en moins nombreuses – à l’échelle mondiale, plus de 60 % des semences commerciales sont désormais contrôlées par quatre entreprises agrochimiques/semencières33. Ce processus a réduit la biodiversité du germoplasme (tissu vivant à partir duquel de nouvelles plantes peuvent être cultivées), rendant l’agriculture plus vulnérable aux parasites, aux maladies et au changement climatique. Les grands acteurs industriels entendent contrôler l’ensemble des intrants de base de la production alimentaire – semences, engrais, informations – pour servir les intérêts de l’agriculture industrielle à grande échelle, de la marchandisation et de l’extraction de profits34. Cette stratégie va directement à l’encontre de la préservation d’une agriculture indépendante, de la gestion responsable des ressources naturelles et de la biodiversité des semences.
La concentration de la propriété des semences a réduit les agriculteurs à une situation de dépendance radicale. Des multinationales comme DuPont et Monsanto utilisent leur pouvoir d’oligopole pour imposer des restrictions d’utilisation – essentiellement des barrières juridiques telles que des brevets, des accords de transfert de matériel, des licences et des accords d’utilisation – qui limitent ce que les agriculteurs peuvent faire avec leurs semences. Une « licence d’utilisation limitée », par exemple, signifie qu’il est interdit de conserver les semences, de les replanter, de les sélectionner, de mener des recherches. On ne peut les planter qu’une seule fois. Les licences peuvent également autoriser l’entreprise semencière à accéder aux terres de l’agriculteur et aux registres de récolte en ligne afin de déterminer quelles semences sont utilisées à quel endroit. Ces multinationales ne vendent pas de semences. Elles louent des semences pour un usage unique ! Le fait d’être le propriétaire légal des semences est au cœur de ce modèle commercial. L’industrie des semences traite juridiquement l’agriculteur industriel des États-Unis doté de puissantes machines agricoles comme elle traite le campesino du Guatemala qui ne possède que son âne. Les deux ne peuvent utiliser les semences que dans les conditions spécifiées par les licences octroyées par les entreprises, de la même manière que les utilisateurs de logiciels sont limités par les licences restrictives unilatéralement imposées par l’industrie du logiciel35.
La privatisation à grande échelle des semences a entraîné une défaillance de marché institutionnalisée. Le marché mondial des semences s’est vu accaparer par un oligopole de multinationales qui ont entravé la concurrence, encouragé la monoculture, échoué à développer les innovations nécessaires pour faire face au changement climatique et sapé le développement d’une agriculture biologique locale36. « Les entreprises ont utilisé les droits de propriété intellectuelle sur le matériel génétique non seulement pour accroître leurs rentes de monopole, mais aussi pour saper activement l’indépendance des agriculteurs et pour s’attaquer à l’intégrité et la capacité de la science relative aux plantes », écrit Jack Kloppenburg, militant de premier plan dans le domaine des semences et professeur à l’université du Wisconsin-Madison.
L’appropriation des semences est un défi vital pour les agriculteurs et, en réalité, pour nous tous. Nous avons tous besoin de manger. Comment préserver les dons naturels de vie fournis par les semences et en finir avec l’ingénierie génétique qui les a rendues stériles ou non partageables en vertu du droit des brevets, du droit des contrats, de la réglementation et/ou de décisions de justice ? Comment restaurer l’éthique du partage des semences et la souveraineté populaire sur des semences qui ont été accaparées par les grandes entreprises grâce au pouvoir du marché et avec l’aide de la loi ?
Au cours des trente dernières années, un mouvement composé d’agriculteurs, d’agronomes, d’institutions publiques, de juristes et de défenseurs des systèmes alimentaires durables s’est attaqué à cette question de plusieurs manières. Dans la plupart des cas, il s’agit de libérer les semences des contraintes artificielles du droit de la propriété. Ce combat est souvent associé à des luttes pour la terre, le droit à l’eau, l’égalité des sexes et d’autres préoccupations. C’est un enjeu prioritaire notamment pour deux grandes organisations du sud de la planète, La Via Campesina, un réseau d’organisations paysannes et indigènes, et Navdanya, un groupe indien de défense de la liberté des semences fondé par Vandana Shiva.
Malgré leurs différences de style et de priorité, la plupart des acteurs du mouvement pour la liberté des semences souhaitent établir des communs protégés pour un partage des semences compatible avec les impératifs des écosystèmes vivants. Jack Kloppenburg note qu’il existe un accord général sur la nécessité de quatre droits universels : celui de conserver et de replanter les semences, celui de partager les semences, celui d’utiliser les semences pour créer de nouvelles variétés et enfin celui de participer à l’élaboration des politiques en matière de semences37. Les grandes multinationales semencières s’opposent généralement à ces droits en invoquant des outils juridiques qui privilégient la propriété privée. Les obstacles politiques et juridiques au partage ont conduit de nombreux défenseurs des semences libres à créer leur propre patrimoine semencier protégé par la loi. Inspirés par le succès de la GPL et des logiciels libres et open source, certains acteurs majeurs du mouvement des semences ont décidé de s’unir derrière la bannière des « semences open source ». Avec deux branches basées respectivement en Europe et aux États-Unis, le mouvement des semences open source a adopté une double approche pour restaurer la souveraineté des utilisateurs sur les semences : l’utilisation de nouveaux types de licences similaires à la GPL ; la création et le renforcement de communautés de partage des semences. Cette double stratégie vise à faciliter la sélection végétale et le partage des semences en tant que communs protégés.
Au moment même où les deux grandes multinationales agrochimiques et biotechnologiques Bayer et Monsanto opéraient leur fusion, OpenSourceSeeds, un projet à but non lucratif de l’AGRECOL e.V.38, une association basée en Allemagne, lançait sa réponse juridique à la naissance de ce nouveau géant : une licence open source interdisant aux utilisateurs de breveter toute plante dérivée cultivée à partir de semences sous licence39. La licence Open Source Seed n’accorde pas de droits exclusifs comme le font la plupart des licences conventionnelles. Elle confère le droit de partager la semence et tous les développements ou améliorations sous réserve de respecter une obligation de mise à disposition pour un usage public. Tout utilisateur ultérieur devra accepter les mêmes conditions. La licence s’applique aussi implicitement à l’information génétique contenue dans les semences.
L’Open Source Seed Initiative (OSSI)40 a choisi en revanche de ne pas recourir à des mécanismes juridiques contraignants, pour des raisons à la fois pratiques et de principe. L’OSSI pensait qu’il serait difficile d’imprimer des licences légales denses et complexes sur un paquet de semences et que le langage juridique utile pour les tribunaux ne serait probablement pas compris de la plupart des agriculteurs. En outre, de nombreuses communautés indigènes ou du sud de la planète sont opposées à l’idée même de contrats juridiques définissant les semences comme une propriété.
Elles préfèrent fonder le partage sur une éthique sociale contrôlée par les pairs. Enfin, de nombreux agriculteurs et sélectionneurs de plantes se méfient des licences car, tout en étant désireux de partager leurs semences, ils souhaitent conserver le droit de recevoir un paiement pour toute innovation en matière de sélection qu’ils pourraient réaliser41.
Au vu de la diversité des motivations des producteurs, l’OSSI a décidé de créer un droit vernaculaire sur les semences sous la forme d’un engagement : « Vous avez la liberté d’utiliser ces semences OSSI de la manière que vous voulez. En retour, vous vous engagez à ne pas restreindre l’utilisation de ces semences ou de leurs dérivés par d’autres moyens, notamment par des brevets, et à intégrer cet engagement dans tout transfert de ces semences ou de leurs dérivés. » Cet engagement n’est pas de nature juridique et ne peut pas être imposé par l’État. Il mise plutôt sur les normes éthiques et sociales des sélectionneurs de plantes pour influencer les comportements et faire honte aux transgresseurs. Selon la même philosophie que la GPL pour les logiciels libres, cet engagement signifie que les utilisateurs traiteront les semences comme étant ouvertes et disponibles pour tous, et n’affirmeront aucune forme de contrôle privé sur elles. En d’autres termes, il s’agit d’un engagement à ne pas restreindre l’accès ou l’utilisation. Respecter une telle éthique est au moins aussi important que de concevoir des dispositions juridiques complexes qui ne sont pas forcément comprises par les agriculteurs et qui peuvent ne pas être applicables dans tous les cas. Un paysan peut-il raisonnablement espérer l’emporter dans un procès contre Bayer-Monsanto ? À la mi-2018, Jack Kloppenburg déclarait :
Nous avons plus de 400 variétés, 51 espèces, 38 sélectionneurs, plus de 60 entreprises [qui ont signé l’engagement]. Nous sommes là, nous sommes réels, nous le faisons. Et je ne pensais pas que ces sélectionneurs – les sélectionneurs publics – existaient aux États-Unis. Devinez quoi : ils existent. Ils sont réels. Ils sont là, ils survivent. Nous ne les avons pas créés. Nous nous appuyons sur un réseau préexistant. C’est pourquoi l’OSSI fonctionne […] parce que nous avons créé des connexions avec ce qui existait déjà42.
Ce commentaire de Kloppenburg vient nous rappeler que souvent la Propriété relationalisée existe déjà. Elle n’a pas nécessairement besoin d’être créée, mais elle doit être protégée, que ce soit par la loi ou par des normes et sanctions sociales.
Malgré les différences philosophiques et tactiques entre ces deux projets de semences open source, tous deux partagent le souci de gérer les semences comme un commun – c’est-à-dire comme quelque chose qui n’appartient pas exclusivement à un propriétaire individuel, mais dont la valeur découle précisément du fait qu’il peut circuler librement et être librement partagé. Le mouvement des semences open source cherche à affirmer que les semences entretiennent des relations profondes et symbiotiques avec les autres éléments de l’écosystème et de la vie humaine, ainsi qu’avec les générations passées et futures. Il veut restaurer la place dynamique des semences dans les écosystèmes vivants en les sauvant du destin d’unités stériles contrôlées par la propriété intellectuelle. Ce n’est pas seulement une revendication morale des commoneurs (qui sont responsables de l’amélioration de la sélection) et des institutions publiques (qui financent la recherche agricole) ; c’est une nécessité vitale pour notre écosystème planétaire et pour notre agriculture, surtout à un moment où le changement climatique s’intensifie.
LES CHAMPIGNONS EN COMMUN : LA PHILOSOPHIE IRIAIKEN
Dès lors qu’une communauté s’émancipe des principes conventionnels de la propriété (ou ne les adopte jamais), elle acquiert la capacité de vivre de nouvelles formes de relations, aussi bien au sein d’un commun qu’au-delà de ses frontières immédiates. La gestion des semences en tant que bio-richesse approfondit les interdépendances entre la vie humaine et non humaine. Le droit japonais traditionnel du commun connu sous le nom d’iriaiken en constitue un exemple riche d’enseignements. Sa racine, iriai, signifie littéralement « entrer collectivement ». L’iriaiken est le « droit d’entrer collectivement ». L’iriaiken fait généralement référence à la propriété collective de zones non arables telles que les montagnes, les forêts, les marais, les bambouseraies, les lits de rivières et les pêcheries en mer. Entre les années 1600 et 1868, les villageois japonais autorisaient les gens à ramasser du bois, des plantes comestibles, des herbes médicinales, des champignons et autres, mais seulement s’ils respectaient des règles d’utilisation strictes, appliquées par les pairs.
En pratique, iriaiken renvoie à des formes de propriété collective très diverses selon les contextes. Il y avait, par exemple, le sòyù (droits collectifs) et le gòyù (propriété collective). Le type le plus courant de propriété collective était appelé mura-mura-iriai, ce qui signifie « propriété collective d’une zone au profit des habitants de plusieurs villages avoisinants ». De manière curieuse, contrairement à la plupart des communs européens qui concernent généralement un seul et unique établissement humain et les terres spécifiques qui lui sont liées, les droits d’un iriaiken s’étendent à plusieurs villages, et non à un seul. Les iriaiken étaient considérés comme partie intégrante d’une région et ne pouvaient être répartis entre villages. Les droits liés au commun n’étaient donc pas gérés par les villageois d’un seul village, mais par une fédération de villages !
Au cours de la période Meiji de la fin du xixe siècle, un nouveau code juridique a été adopté, qui a introduit des principes juridiques modernes. Malgré tout, le droit des villageois au commun n’a pas été aboli, mais reconnu comme un droit coutumier. Ainsi, l’iriaiken est resté intégré au droit japonais moderne. Il est défini comme une sorte de possession collective. Sans surprise, ces deux conceptions du droit – le droit moderne et le droit des communs (droit vernaculaire) – sont entrées en conflit, notamment sur des sujets liés aux droits de propriété. À mesure que les principes d’une propriété privée absolutiste des terres et de titres fonciers exclusifs se sont répandus, les régimes de propriété de type iriaiken ont décliné. Mais on peut néanmoins encore trouver aujourd’hui au Japon des usages fondés sur l’iriaiken. L’un des exemples les plus singuliers est celui des pratiques de gestion des cueilleurs de champignons matsutakes.
Les matsutakes sont de délicieux champignons sauvages qui ne poussent qu’en forêt et qui ne peuvent être cultivés. Cela explique en partie leur coût très élevé. Certaines variétés japonaises se vendent régulièrement à plus de 1 000 dollars américains le kilo, et les plus rares à 2 000 dollars le kilo. Les récoltes annuelles de matsutakes ont atteint un sommet dans les années 1950 et n’ont cessé de diminuer depuis43, principalement en raison de deux facteurs : le déclin de leurs habitats (notamment à cause d’une maladie affectant les pins rouges japonais, auxquels le matsutake est associé) et le déclin des pratiques traditionnelles de récolte qui contribuaient autrefois à améliorer les conditions de croissance des champignons, telles que la cueillette collective, le débroussaillage, l’éclaircissement des forêts et la collecte de déchets de feuilles comme combustible ou engrais. Il est intéressant de noter que les forêts les plus propices aux champignons matsutakes sont souvent des forêts abîmées, aux paysages clairsemés et riches en jeunes arbres. Ces forêts sont souvent très fréquentées, surtout pour la cueillette du matsutaké, explique l’anthropologue Anna Lowenhaupt Tsing dans son livre à succès Le Champignon de la fin du monde. La présence de visiteurs humains « maintient les forêts ouvertes, et donc accueillantes pour les pins ; elle maintient l’humus mince et les sols pauvres, permettant ainsi au matsutake d’effectuer son travail vertueux d’enrichissement des arbres », écrit-elle44.
La préfecture de Kyoto au Japon est célèbre pour ses matsutakes. C’est là qu’un système traditionnel unique de vente aux enchères des matsutakes s’est développé au xviie siècle, d’abord au sanctuaire de Kamigamo en 1665, puis dans presque tous les villages de la préfecture. Deux siècles plus tard, en réponse à la privatisation et à la division des forêts communales de la période Meiji, les villages ont adopté des systèmes d’enchères globales, réinterprétant l’esprit iriaiken pour les besoins des temps modernes45.
Le principe de ce système d’enchères globales est difficile à saisir pour l’esprit moderne car les droits de récolte ne sont pas alignés sur les titres de propriété. Comme l’explique l’anthropologue Anna Lowenhaupt Tsing, « même si un villageois possède un matsutakeyama (une forêt ou une montagne où pousse le matsutake), il doit faire une offre pour obtenir le droit d’y récolter le matsutake […] et ceux qui détiennent les droits exclusifs de cueillette et de vente du matsutake […] changent d’année en année au cours du processus d’appel d’offres46 ». Cela signifie que le propriétaire d’une parcelle de terre n’est pas autorisé à récolter les champignons de la parcelle. Dans le même temps, la récolte de champignons ne lui est pas entièrement interdite, puisqu’il peut obtenir ce droit à travers un processus d’appel d’offres lancé par la communauté.
Comment cela est-il possible et qu’est-ce que cela signifie ? La réponse se trouve dans la philosophie de l’iriai et plus concrètement dans la manière dont les villageois conçoivent l’ensemble du système, et notamment les interconnexions profondes entre les rhizomes de matsutakes, pour la plupart invisibles dans le sol, et les champignons qui poussent à la surface, et entre les villageois et les propriétaires de différentes parcelles de terre, entre autres relations.
Examinons comment le processus d’appel d’offres se déroule dans le village d’Oka, dans la préfecture de Kyoto, où la philosophie de l’iriai est restée forte. Le défi principal auquel sont confrontés les villageois est de savoir comment regrouper et partager des champignons répartis de manière inégale sur de nombreuses parcelles de terre privées. Les champignons sont considérés comme une richesse partagée parce qu’ils naissent naturellement, sans que personne les cultive activement, et parce que les racines des champignons constituent un vaste système souterrain qui s’étend sur tout le village, sans tenir compte des limites des propriétés en surface. Le problème est donc de répartir de manière juste et équitable la bio-richesse, considérée comme une propriété collective (dans le sous-sol) et privée (en surface).
La solution des villageois est une vente aux enchères. Ce terme est quelque peu inapproprié car le système d’enchères n’est pas utilisé ici pour récolter des fonds destinés à la culture des champignons, comme le font par exemple les membres d’une AMAP en vue de la récolte suivante. La vente aux enchères permet plutôt de s’assurer que chacun tire un certain bénéfice des champignons, soit par des droits directs de récolte, soit par l’allocation de champignons réservés à un usage collectif, soit enfin à travers le revenu qu’en tire la communauté.
La première étape consiste à diviser l’ensemble du terrain en cinq parcelles sans tenir compte des droits formels de propriété foncière. Ensuite, tout comme les autres villages, Oka met aux enchères les droits de récolte sur trois des cinq parcelles. Les deux autres parcelles sont réservées pour les expéditions dominicales des membres de coopératives créées pour gérer le matsutake. « Tous les participants se rendent ensemble en même temps dans la forêt pour cueillir les matsutakes. En 2003, la plus grande quantité quotidienne récoltée collectivement a été de 28 kilogrammes. Les matsutakes récoltés sont alors centralisés et distribués à tous les participants en quantités égales, sauf lorsqu’ils sont destinés à un festin commun47… » Un bel exemple de mettre en commun, plafonner et répartir. Pour rendre les choses plus justes (et plus compliquées), les deux parcelles réservées à l’usage communautaire ne sont pas les mêmes d’année en année. Ainsi, une parcelle mise aux enchères une année sera destinée à la récolte collective l’année suivante. Seuls les membres de la coopérative sont autorisés à participer aux enchères et à la récolte commune.
Tout villageois peut participer au processus d’enchères, et la communauté attribue les droits de récolte au plus offrant. Le gagnant détient alors des droits exclusifs jusqu’au 15 novembre, date à laquelle la saison de récolte commence. « Pendant cette période, personne, pas même les propriétaires fonciers, ne peut se promener sans autorisation dans la forêt, même s’il ne s’agit pas d’un matsutake-yama, écrivent Saito et Mitsumata. Si l’on tente de s’approcher d’une forêt sans permission, on peut être soupçonné d’être un voleur de matsutakes48. »
L’objectif de l’enchère est de mettre les champignons de chaque terrain privé dans un pot commun qui puisse être réaffecté au profit de la communauté. Fondamentalement, il s’agit de monétiser les trois cinquièmes de la récolte annuelle de champignons en les vendant uniquement à des villageois, puis d’employer les revenus de l’enchère pour des activités et des outils qui améliorent l’habitat des matsutakes. Le processus n’est donc pas une simple vente aux enchères. Puisque les villageois s’accordent sur le fait que les champignons n’appartiennent à personne en exclusivité, la vente aux enchères permet de redistribuer le revenu anticipé de la vente de matsutake au bénéfice de tous les villageois. La monétisation partielle de la récolte annuelle ne dure qu’une saison, et elle est utilisée au profit du village et de l’écosystème des champignons sur le long terme.
Le revenu communal de la récolte de matsutake à Oka fluctue d’une année à l’autre. Mais selon une étude de 2004, le village aurait collecté 329 000 yens en 2003, soit environ 9 087 dollars américains49. Ce revenu n’est pas réparti entre les membres50, mais est utilisé pour payer une partie des coûts d’une célébration annuelle de groupe. Dans d’autres collectivités, ce revenu est utilisé pour améliorer les infrastructures ou l’éducation. À Oka, tous les membres pratiquent depuis 1962 ce qu’on appelle le deyaku, des journées de travail obligatoires, très semblables au célèbre système de minga dans les pays andins ou à l’entretien des canaux d’irrigation dans les acequias du Nouveau-Mexique. Les villageois peuvent choisir un jour parmi les deux jours désignés pour le deyaku. Si un membre ne participe pas, une pénalité de 7 000 yens est imposée, mais la coopérative a rarement besoin de sanctionner qui que ce soit. Les activités communes de récolte et de deyaku permettent de ritualiser l’être-ensemble et de forger un sentiment d’appartenance à la communauté. En 2004, les chercheurs ayant participé aux séances de travail obligatoires déclaraient : « Le travail ce jour-là était facile et une atmosphère de sociabilité régnait. Les participantes en particulier appréciaient de se parler, et une pause était organisée toutes les trente minutes51. »
L’idée centrale de ces enchères globales – le propriétaire d’une parcelle de terre n’a pas automatiquement, en vertu de son titre de propriété, le droit de récolter les matsutakes – se retrouve dans les règles qui régissent de nombreuses propriétés forestières individuelles en Europe, dont les détenteurs ne peuvent pas décider de leur propre chef de couper un arbre sur leur propriété. À l’évidence, les villageois ont leur propre manière de déterminer qui possède quoi à travers un ensemble coloré de protocoles à plusieurs niveaux portant sur les bonnes manières de traiter le monde environnant. Les propriétaires fonciers acceptent ces règles car elles renvoient à un arrangement communautaire traditionnel ; ils sont eux-mêmes, en tant que membres de la communauté, les coconcepteurs et des co-décideurs de ces règles et de ces protocoles. L’accès réglementé par la communauté n’est pas considéré comme une interdiction, mais plutôt comme un accord consensuel raisonnable – on est évidemment très loin de la conception occidentale de la propriété. Selon les mêmes chercheurs, « à un niveau subconscient », la terre appartient à tout le village. (Voir image 43, téléchargeable sur www.eclm.fr)
Cette manière de concevoir les choses reflète une idée plus générale sur la propriété elle-même – à savoir que « les biens privés proviennent le plus souvent de communs non reconnus, comme l’écrit Tsing. Le fait est que la privatisation n’est jamais complète ; elle a besoin d’espaces communs pour créer de la valeur. C’est le secret du vol continu qu’est la propriété […] La joie de la propriété privée est le fruit d’un commun souterrain52 ».
On est en droit de se demander pourquoi cette même éthique ne s’appliquerait pas également à l’extraction du charbon, du gaz et du pétrole des profondeurs du sous-sol. Il y a évidemment une différence entre la valeur de ce qui existe dans le sol, intact et antérieur à toute activité humaine, et les coûts d’exploration, d’extraction, de forage et de raffinage – c’est-à-dire les coûts de mise à disposition pour l’usage humain. C’est une différence de taille. Mais considérons ce que deviendrait notre économie si le pétrole pouvait ne plus être privatisé dans sa totalité par des entreprises ou des Étatsnations simplement parce qu’ils l’extraient du sous-sol. Le rendement économique serait uniquement fonction du travail investi pour extraire le pétrole et le raffiner en carburant utilisable. La justification d’un tel système de propriété est simple : le pétrole et les minéraux s’étant formés sur des millions d’années sans aucune contribution humaine, pour quelle raison une instance privée pourrait-elle donc les posséder53 ? C’est exactement la logique que les commoneurs du matsutake d’Oka ont mise en pratique – une manière équitable et écologique de gérer la richesse générée par leur richesse souterraine partagée54.
Le système iriai s’est trouvé remis en question ces dernières années, en particulier par les jeunes qui ne travaillent pas dans les villages et, sans surprise, par ceux qui possèdent des matsutake-yama où poussent les champignons. Dans les villages de Kanegawachi et de Takatsu, les arguments lockéens classiques ont été avancés, selon lesquels « chaque propriétaire foncier a droit aux fruits de sa terre, d’une part, et doit payer une taxe sur les actifs fixes [propriété], d’autre part ». On a fait valoir que les coutumes ne garantissaient pas « suffisamment de droits aux propriétaires de matsutake-yama » et qu’elles avaient donc « dissuadé les propriétaires terriens de procéder aux améliorations de l’habitat nécessaires pour accroître la production de matsutake55 ».
Ces arguments sont sans fondement. Aucune preuve n’a été présentée en ce sens. En fait, les faits prouvent le contraire : les projets les plus sérieux d’amélioration de l’habitat dans la région de Kyoto sont ceux qui ont été parrainés par l’Association pour la promotion de la production de matsutake de Kyoto, avec l’aide de subventions gouvernementales. Sept ans plus tard, une enquête sur les activités d’amélioration a noté des efforts « sur 405 sites totalisant 310 hectares dans 15 districts, et dans presque tous les cas, les sites étaient des forêts communales et non des terrains privés56 ». Tout ceci est parfaitement logique, car l’amélioration de l’habitat exige des connaissances spécifiques, une activité régulière et de la patience. La plupart des propriétaires fonciers individuels, en revanche, cessent leurs efforts d’amélioration au bout d’un an ou deux. Ainsi, les raisons de traiter le matsutake-yama comme une richesse commune à tout le village sont d’ordre philosophique, mais aussi d’ordre éminemment pratique.
Selon les chercheurs, le déclin du système iriaiken d’utilisation des terres a eu des effets négatifs sur les finances des villages et sur la productivité des matsutakes. Les villages qui ont choisi d’autres systèmes que celui d’Oka – en permettant aux propriétaires, par exemple, de récolter sur les parcelles de leur choix s’ils payent l’équivalent de 60 ou 70 % du revenu attendu des enchères – ont dû introduire des cotisations ou d’autres taxes pour augmenter les revenus du village et entretenir les infrastructures villageoises. Le cas du village de Kanegawachi est emblématique. Depuis que les enchères holistiques ont été transformées en des enchères partielles en 1999, « les revenus des enchères ont diminué de plus de 75 % – de 250 000 yens au début de 1990 à 60 000 yens en 200457 ». Dans le même temps, la motivation des propriétaires de matsutake-yama à travailler à l’amélioration de l’habitat des matsutakes a diminué, laissant place à un cercle vicieux de surexploitation individuelle. Cette situation contraste fortement avec le cercle vertueux créé par les villageois d’Oka qui gèrent le matsutake comme un commun.
L’histoire d’Oka nous en dit long sur la façon dont la propriété, considérée généralement comme un droit de domination absolue sur un objet identifié, peut être repensée de manière à la fois éminemment pratique et socialement responsable. Il ne s’agit pas seulement de promulguer une loi ou une régulation garanties par l’État ; cela suppose une éthique culturelle qui ne peut être cultivée que par la pratique et l’action sociales. Cela implique un engagement en faveur de l’écosystème et de l’infrastructure dont tout le monde dépend, mais aussi un espace pour nourrir les relations sociales et les relations entre les humains et les non humains. Cela n’exclut pas pour autant ni les droits d’usage individuels, ni même le droit de vendre une ressource renouvelable. Les champignons périssables, par exemple, peuvent être traités comme un usufruit – le droit d’utiliser quelque chose qui appartient à quelqu’un d’autre tant que la ressource sous-jacente elle-même n’est pas diminuée.
Plus largement, l’histoire du matsutake démontre les vertus et le caractère pratique de la Propriété relationalisée. Il est tout à fait possible d’utiliser la propriété pour renforcer les relations sociales et écologiques plutôt que pour briser ces relations sous le poids du capitalisme possessif. L’histoire du jardin Nidiaci (p. 243-244) nous a montré comment une même parcelle de terrain urbain pouvait être traitée à la fois comme une propriété privée et une propriété publique, avec des bienfaits différents. De la même manière, le matsutake suggère que la gestion de la terre comme un commun permet l’émergence de différents types de valeurs qualitatives : valeur personnelle, sociale et écologique, mais aussi économique. Les choses peuvent nous appartenir en même temps en tant qu’individus et en tant que membres d’une collectivité. Les dispositions relatives à la propriété peuvent alors être conçues de manière à respecter notre liberté-dans-l’interconnexion d’utiliser ces choses, l’équité en rendant l’accès et l’usage de ces choses les plus larges possible, et les communautés vivantes dynamiques comme forme efficace de Gouvernance par les pairs.
CONSTRUIRE DES COMMUNS ROBUSTES
GRÂCE À LA PROPRIÉTÉ RELATIONALISÉE
L’idée de Propriété relationalisée reste sans doute incompréhensible si l’on s’en tient au prisme conventionnel de la propriété. Imprégnés de la vision du monde dominante, beaucoup refusent obstinément d’envisager d’autres façons de vivre et de représenter le monde. Nous avons tenté de montrer, à travers ces cinq exemples éclatants, comment la propriété pouvait échapper aux logiques d’exclusion et de séparation dont elle est traditionnellement inséparable. La Propriété relationalisée ouvre des espaces permettant de développer de multiples nouvelles relations – avec d’autres commoneurs, avec le monde plus qu’humain, avec les générations passées et futures, avec des institutions extérieures et avec le cosmos. Il est important de souligner que s’il est possible de s’inspirer de ces pratiques de Propriété relationalisée, ces pratiques ne peuvent être reproduites à l’identique. Chacune est singulière, et il n’existe pas d’outil ou de modèle juridiques uniques. La conception d’un régime juridique de Propriété relationalisée pour chaque commun doit être guidée par la question suivante : de quoi avonsnous (en tant que communauté) besoin pour protéger notre commun en tant que commun ?
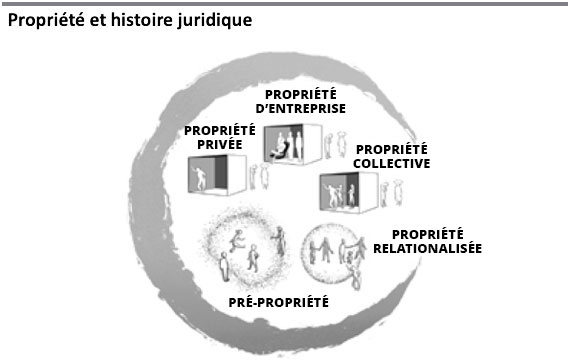
Cette image illustre comment le droit de la propriété favorise certains types spécifiques d’ordre social, notamment en donnant du pouvoir aux propriétaires (qui occupent les cubes dans le dessin) et en marginalisant et en privant de droits les non- propriétaires. Un cercle – un ensõ bouddhiste, souvent utilisé pour symboliser l’illumination absolue et l’univers – regroupe les régimes de propriété familiers.
La propriété privée et la propriété d’entreprise sont deux moyens usuels par lesquels les propriétaires affirment leur domination sur des choses nécessaires à autrui. Le système marché/État en tant que système politique et juridique privilégie ces formes de propriété par rapport à toutes les autres. Même la propriété collective met en œuvre, de façon moins sévère, la même dynamique, puisqu’elle aussi récompense les propriétaires et exclut les non-propriétaires.
La pré-propriété – les relations sociales avant l’établissement de toute règle formelle de propriété – semble moins contraignante, mais l’ordre social qui en résulte peut être coopératif, égalitaire et équitable – ou tout le contraire. Hobbes a soutenu que l’« état de nature » qui aurait précédé la création des États était une guerre barbare de tous contre tous ; les anarchistes et les communautariens ont tendance à en avoir une vision plus optimiste. En tout état de cause, il renvoie à l’absence d’une autorité politique englobante. Nous avons mentionné comment la doctrine juridique de la res nullius in bonis servait autrefois à protéger la terre et les autres bio-richesses indispensables à chacun et aux générations futures. Mais nous ne sommes pas naïfs au point d’espérer que cela suffira dans le monde d’aujourd’hui. C’est pourquoi il est nécessaire de trouver des innovations juridiques pour protéger les communs.
La Propriété relationalisée est une tentative de gérer les ressources au profit des commoneurs (ou de toute autre personne) à travers des structures de Gouvernance par les pairs tout en respectant les limites inhérentes à la bio-richesse. Il faut noter que la ligne entourant les communs n’est pas une limite stricte de propriété ou de séparation ; les pointillés suggèrent au contraire une membrane semi-perméable rendant possible une interaction sélective avec le monde extérieur.
Nous entourons les différents régimes de propriété par un ensõ, un cercle dessiné à la main utilisé par les bouddhistes zen pour symboliser « l’illumination absolue, la force, l’élégance, l’univers et le mu (le vide) » (Wikipédia). Nous utilisons ce symbole pour suggérer qu’en réalité nous faisons partie d’un tout plus grand et intégré, auquel tout est connecté. Le cosmos vivant englobe tous les régimes de propriété. Cependant, seule la Propriété relationalisée reconnaît cette réalité dans sa structuration même.
Les descriptions de manières relationelles d’avoir que nous proposons dans ce chapitre peuvent sembler quelque peu compliquées et alambiquées. C’est en partie parce que l’idée même en est très peu familière. De plus, décrire quelque chose de nouveau peut être beaucoup plus difficile que de vivre cette chose, tout comme expliquer à quelqu’un comment faire du vélo s’avère beaucoup plus difficile que d’en faire la démonstration. Nous ne disposons pas encore non plus d’un ensemble de formes juridiques pour organiser par défaut la Propriété relationalisée. Nous souhaitons donc conclure en proposant une définition conceptuelle de la Propriété relationalisée, afin qu’elle soit reconnue comme une classe distincte « au-delà de la propriété » gérée comme un commun.
Tous les exemples de Propriété relationalisée sont dissemblables. Chacun représente une superposition et un chevauchement uniques de différentes formes de propriété, finement interconnectées. Chaque Propriété relationalisée est ainsi fondé sur une éthique des communs et provient de pratiques sociales vivantes. L’un des principaux objectifs de ces formes de propriété est d’aménager un espace protégé pour la pratique des communs. Il s’agit de neutraliser les relations de pouvoir habituelles associées à la propriété, en particulier l’inégalité entre propriétaires et nonpropriétaires, ainsi que la domination propre à la gouvernance par l’argent. On ne peut laisser les droits de propriété – aujourd’hui si souvent alignés sur le capital et la rationalité calculatrice – dicter de manière préemptive les conditions de l’ordre social. Dans le contexte du capitalisme et des démocraties libérales, la Propriété relationalisée tend à créer une forme moderne de res nullius in bonis qui rend la richesse partagée – un immeuble d’appartements, une plateforme logicielle, un supermarché, des semences, des champignons – quasi inaliénable.
Essayons de décrire quelques patterns basiques de la Propriété relationalisée et d’en tirer des généralisations sur la bonne manière de sécuriser les possibilités spécifiques qu’elle ouvre :
Redéfinir la frontière séparant propriétaires et non-propriétaires. À la place de frontières strictes, la limite autour des communs est traitée comme une membrane semi-perméable. Il est ainsi plus facile de prendre en compte et d’intégrer les besoins de chacun.
Adopter comme norme par défaut l’articulation de droits d’usage individuels avec une possession collective. Une conflictualité excessive est le résultat d’un problème de conception. Lorsque des droits d’usage individuels sont créés en conjonction avec une forme collective de possession (ce qui est toujours un acquis relatif), il en découle un cercle vertueux de coopération et de confiance. Celui-ci peut supplanter l’éthique de la concurrence individuelle qu’exige le capitalisme. Un wiki fédéré permet, par exemple, d’éviter les guerres éditoriales qui affligent tant de wikis conventionnels. Le Mietshäuser Syndikat permet aux gens d’échapper à la spéculation, à la hausse des prix et à l’insécurité des marchés du logement fondés sur la propriété individuelle ou collective. L’association des droits d’usage individuels et de la possession collective crée des situations plus stables et plus équitables, ce qui est en soi un moyen de minimiser les conflits.
Éviter la gouvernance par l’argent et par le contrôle venant des parties prenantes ayant des intérêts d’investisseurs. Il s’agit là d’un défaut central de la propriété conventionnelle, car elle privilégie ceux qui ont de l’argent au détriment de la capacité du plus grand nombre de se gouverner eux-mêmes et de protéger leurs intérêts. La gouvernance par l’argent est un problème, même dans les organisations à but non lucratif et les coopératives, car les membres les plus fortunés des conseils d’administration et les financeurs y jouissent généralement d’une influence disproportionnée sur la gouvernance, voire d’un droit de veto.
Contourner les catégories conventionnelles de la propriété et l’ordre social du marché/État qu’elles sous-tendent. Au lieu d’opposer la propriété privée aux intérêts collectifs et les propriétaires aux non-propriétaires, la Propriété relationalisée ouvre un espace sûr pour la pratique des communs. Elle évite également que les gens ne soient expulsés ou exclus de la bio-richesse qui les entoure.
Donner un statut juridique plus clair à ce qui a le caractère d’une possession ou d’une utilisation existentielles pour la satisfaction des besoins plutôt que pour la domination. En lieu et place d’une entreprise de production opérant avec des actifs (une usine, un produit, une marque) et sur la base des choix d’un ou de plusieurs propriétaires, les commoneurs s’appuyant sur la Propriété relationalisée sont libres de concevoir leur propre système de gouvernance. Ils sont en mesure de construire une culture engagée de gestion responsable collective, de Gouvernance par les pairs et d’interaction consciente avec le monde plus qu’humain. La Park Slope Food Coop fonctionne comme une non-propriété au sens où personne ne peut s’approprier les actifs de la coopérative ni les vendre à titre privé. Il en va de même pour les semences open source : tout le monde peut les utiliser et personne ne peut les monétiser aux dépens des autres. Il est essentiel de noter que, dans chacun de ces cas, ce sont la pratique et la culture sociales qui maintiennent le système en vie. Les chartes ou les règlements officiels ne suffisent pas.
Reconnaître la valeur des droits d’usage négociés par les pairs. Certains arrangements existants de propriété, tels que le droit coutumier ou les pratiques vernaculaires, peuvent devenir des régimes de Propriété relationalisée. C’est important car c’est de la pratique des communs que découlent la légitimité morale et l’efficacité, pas uniquement du droit étatique. Si la Propriété relationalisée peut fonctionner aussi bien, c’est qu’elle s’appuie sur un grand nombre des patterns de commoning décrits dans les chapitres 4 à 6, tels que mettre en commun et partager, mettre en commun, plafonner et répartir, faire confiance aux savoirs situés, diffuser les savoirs généreusement, ritualiser l’être-ensemble et approfondir notre communion avec la nature. Tout cela renforce la sécurité et la liberté des gens. La pratique des communs précède et renforce la possibilité de relationaliser la propriété. Il ne peut y avoir de Propriété relationalisée sans commoning.
Tisser la propriété dans la grande toile de la vie. Les biens profondément enracinés dans des systèmes vivants et interconnectés ont moins besoin des marchés ou de l’État pour se maintenir. C’est ainsi que le Mietshäuser Syndikat permet à chacun de ses affiliés de conserver un haut degré de liberté et d’autonomie. Lorsque les commoneurs peuvent déterminer localement leurs propres droits d’accès et d’usage, le système devient distribué, diversifié et stable. Il lui est alors plus facile de s’autorépliquer, de s’autoguérir et de se développer à des échelles appropriées. Cela réduit les risques de défaillance systémique et le besoin de supervision externe. Ces qualités empêchent en même temps la concentration de pouvoir et la monoculture, tout en réduisant notre dépendance au couple État/marché – ce qui constitue un grand pas vers la résilience.
Maintenir autant que possible les conflits sur les droits d’usage au niveau local. Cela permet une résolution des conflits moins coûteuse et plus accessible aux gens ordinaires. Les systèmes formels de droit étatique mettent en avant des principes aussi nobles qu’universels. Mais les coûts réels et la complexité liés à la revendication des droits censés en découler sont souvent énormes (imaginez un paysan défiant une grande entreprise), ce qui réduit la régulation étatique à une mascarade de justice et d’égalité. Par contraste, la Gouvernance par les pairs dans les communs tend à mettre en place des systèmes accessibles pour résoudre les problèmes.
Reconnaître le besoin éventuel d’émulation et de « forks » pour éviter les problèmes de taille.À un certain moment de la croissance d’un commun, la complexité devient si grande et la Gouvernance par les pairs si mince qu’une forme de « fork », ou bifurcation des énergies, devient nécessaire. La Park Slope Food Coop fonctionne parce qu’elle est profondément enracinée dans sa communauté locale, Brooklyn. C’est une énorme organisation, mais qui n’a pas besoin de grandir davantage, tout comme le Mietshäuser Syndikat n’a pas besoin de nouveaux projets de logement. Aucune contrainte interne ni aucun mécanisme systémique n’exige une croissance constante, comme c’est le cas pour les entreprises dans l’économie de marché capitaliste. En revanche, la Park Slope Food Coop et le Mietshäuser Syndikat accueilleraient volontiers d’autres entreprises désireuses de les imiter. Dans le Communivers, il est plus logique de maintenir les régimes de propriété à une échelle gérable pour conserver des systèmes plus simples, plus modulaires et plus fonctionnels, et aux coûts généraux moins importants.
RÉINTRODUIRE LA POSSIBILITÉ DE CRÉER DU SENS DANS LE DROIT MODERNE
Les ramifications de la Propriété relationalisée vont bien au-delà du droit de la propriété ; elles reflètent l’influence considérable que la pratique des communs peut avoir sur le droit en général. En tant que forme de fabrique du monde, le commoning permet aux gens de jouer un rôle authentique et formateur dans la fabrique de la loi. Il offre un moyen de lutter contre l’aliénation systématique qui caractérise l’époque moderne. Tel est le véritable enjeu des débats sur la pratique des communs et la propriété – et sur le droit en général.
Historiquement, le droit était ancré dans la communauté, ce qui permettait aux relations et aux normes des gens dans leur ensemble de s’exprimer par le biais du droit lui-même. Aujourd’hui encore, dans d’innombrables communautés de subsistance à travers le monde, les commoneurs savent identifier le surpâturage ou la surexploitation des réserves halieutiques. La pratique des communs leur apporte des solutions adéquates. Même si ce processus n’a souvent rien de facile, il contribue à créer et à entretenir un sens profond de connexion sociale et de mission. Il relie les gens à leurs paysages et aux générations précédentes, devenant ainsi un vecteur de création de sens.
Cependant, avec l’essor de l’État moderne et de la bureaucratie, les formes et les procédures du droit ont tendu à devenir des fins en soi, et non plus un moyen d’exprimer la raison d’être et l’identité d’une société. Le droit moderne est aujourd’hui entièrement focalisé sur sa propre logique et son propre processus autoréférentiels, plutôt que sur la pertinence de ses résultats. Si votre (coûteux) avocat commet une erreur de procédure, ou si une obscure subtilité juridique élaborée résultant d’un compromis datant d’il y a quelques décennies vous échappe, vous avez perdu ! Il ne s’agit pas de « justice », comme l’a expliqué un célèbre professeur de procédure civile à l’un d’entre nous, alors qu’il était étudiant en première année de droit. Il s’agit de savoir s’il y a « suffisamment de preuves et d’intégrité procédurale pour administrer la justice ». Ou, ainsi que l’a dit de façon plus acerbe le romancier Anatole France : « La loi, dans sa majestueuse égalité, interdit aux riches comme aux pauvres de dormir sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain58. »
Le droit moderne est étrangement et fondamentalement déconnecté de la réalité sociale et individuelle. C’est un système abstrait de règles qui se conçoit comme un processus neutre et impersonnel – « la justice est aveugle » –, but que les praticiens s’efforcent d’atteindre en ne considérant le monde qu’à travers les catégories du droit. En tant que créature de l’État et reflet de ses priorités, le droit a de plus en plus perdu le contact avec la vie des gens, en particulier leur vie intérieure, sans doute parce qu’il est administré selon des processus laborieux et faciles à manipuler. Même si les formes juridiques dominantes offrent aux gens une modeste marge de manœuvre pour utiliser le droit à leurs propres fins (droit des contrats, gouvernance d’entreprise, etc.), le droit n’est pas réellement un vecteur fiable de création de sens. En effet, peu de gens peuvent aujourd’hui participer pleinement au droit ou en influencer la teneur. Il est plutôt vu comme une expression du pouvoir d’État qui doit être respectée.
C’est l’une des raisons pour lesquelles tant de monde se sent aliéné par l’État-nation moderne et par ses systèmes de législation. Certes, cette séparation entre les procédures juridiques et la création de sens nous a permis de surmonter de nombreuses obligations communautaires oppressives et d’accroître notre liberté, tout du moins en un sens étroit et individualiste. Le droit moderne et libéral a dissipé de nombreuses formes de domination et de contrôle étouffantes et injustes – féodales, patriarcales, autoritaires. Mais cette libération a souvent entraîné une déconnexion des gens d’avec les mondes qu’ils chérissaient – parfois par la force et au nom de la liberté. Tout au long de l’histoire, d’innombrables peuples indigènes ont appris à leurs dépens que la liberté d’être traité comme un individu, dépouillé de son identité collective, de son paysage, de ses traditions et de son patrimoine culturel était est un acte radical de dépossession. Encore aujourd’hui, même parmi nous, les modernes, la loi emprisonne souvent les gens ordinaires dans des catégories formelles abstraites qui ne tiennent pas suffisamment compte de l’ensemble du contexte de leurs vies et de leurs besoins intérieurs. La loi peut garantir aux sans-abri et aux malades mentaux la liberté de vivre dans la rue sans être harcelés, voire leur accorder un logement. Mais elle ne peut pas leur fournir des relations, un but et une dignité.
Aujourd’hui, le lien entre le droit et les aspirations profondes des gens ou leur quête de sens est au mieux ténu. Souvent, ce lien est rompu, ce qui entraîne de sérieuses frustrations par rapport à l’incapacité du droit à répondre au besoin de sens et d’identité. Cela ne devrait pas être une surprise dès lors que le droit s’est mis au service du marché/État, qu’il est contrôlé par une caste inaccessible de juristes et de législateurs et qu’il impose des catégories juridiques universelles qui ne tiennent pas compte de l’inconstance des réalités et des désirs.
Lorsque le droit échoue à répondre efficacement aux besoins et qu’il ne sait pas évoluer en réponse aux changements de circonstances ou à de nouvelles conceptions de la justice, il perd sa légitimité. La « communauté imaginée » que l’État-nation prétend représenter, et que le droit cherche à constituer, commence à s’effondrer59.
Les droits de propriété communs et relationalisés sont des antidotes à ces phénomènes contemporains. Ils peuvent nous aider à repenser la nature même du droit comme un vecteur de création de sens. Au lieu de laisser cette tâche à l’État et à des Parlements distants et insensibles, la pratique des communs réintègre la démocratie et l’élaboration du droit de manière substantielle dans la vie quotidienne des gens. Elle peut être un moyen de retrouver et de construire des relations qui resteraient autrement paralysées ou exclues de la vie moderne – des relations entre personnes, avec le monde plus qu’humain, avec nos ancêtres et avec notre postérité. Les communs peuvent contribuer à créer des passerelles entre le droit moderne et les formes juridiques vernaculaires plus anciennes. Les gardiens du droit étatique doivent apprendre à reconnaître la nature dynamique et contextualisée du droit vernaculaire – en gardant à l’esprit la manière dont les normes sociales évoluent et mutent rapidement dans les communautés en ligne et les réseaux sociaux. Les communs, quant à eux, peuvent tenter de « hacker » le droit afin d’ouvrir de nouveaux espaces protégés pour explorer leur pratique. Ils peuvent humaniser le droit de l’Étatnation moderne, aujourd’hui incroyablement distant et aligné sur les exigences du capital.
Nous voici donc face à un dilemme incontournable : comment faire progresser les communs à l’aide de quelque chose qui leur est aussi étranger que l’État avec ses lois et tout son appareil ? Comment la pratique des communs peut-elle s’épanouir au sein de systèmes de pouvoir étatique étroitement liés au capital et aux marchés – déterminés à imposer leur organisation du monde pour accroître leur pouvoir ? Nous abordons ces questions dans les chapitres 9 et 10.
IX. Pouvoir D’état Et Pratique Des Communs
Nous avons vu comment certaines formes socio-légales ingénieuses et l’éclairage de certaines doctrines juridiques antiques pouvaient nous aider à neutraliser les revendications de la propriété conventionnelle, limitant ainsi le pouvoir du couple marché/ État moderne. Mais que pourrait-on accomplir si le pouvoir d’État était utilisé pour soutenir la Propriété relationalisée et les communs ? De quelle manière les États pourraient-ils encourager la Gouvernance par les pairs et l’approvisionnement fondés sur les communs ? La législation étatique pourrait-elle établir une doctrine plus robuste d’inaliénabilité des richesses partagées ? Est-il possible de concevoir des régimes juridiques, des infrastructures et des programmes visant à libérer et à renforcer la pratique des communs ? Ces questions n’ont pas de réponses faciles, mais il est impossible de les ignorer. Impossible de ne pas interagir avec le pouvoir d’État. De quelle manière le faire, c’est toute la question.
La plupart des hommes politiques, autocrates et législateurs des 195 États du monde s’accordent pour faire de la croissance économique leur priorité absolue. Ils sont convaincus que la seule manière de répondre aux besoins des gens est l’accumulation sans fin du capital. C’est pourquoi ils sont toujours désireux d’étendre l’emprise des marchés, d’extraire davantage de ressources naturelles, de promouvoir la consommation et d’inventer de nouveaux besoins. Tout ceci permet à la machine capitaliste de fonctionner et aux recettes fiscales d’affluer. Le système marché/État a un intérêt évident à s’opposer aux menaces systémiques comme les communs, ou au moins à les coopter. Il tente de les marginaliser au moyen des mystifications habituelles (« entreprise socialement responsable », « économie verte ») ou nous encourage à les ignorer.
Il faut donc rester réaliste quant à la nature du pouvoir d’État et son alliance avec le capital et les marchés. Ceux qui sont au pouvoir et prennent les décisions dans les institutions étatiques modernes auront toujours, dans le meilleur des cas, une position très ambivalente sur l’inaliénabilité de la richesse partagée. Ils ont généralement du mal à laisser passer une opportunité de stimuler l’investissement et l’activité de marché. Comme nous l’avons vu au chapitre 7, la communauté internationale a adopté la doctrine juridique du patrimoine commun de l’humanité dans un accord des Nations unies de 1979 régissant la Lune « et les autres corps célestes » et un traité international de 1980 visant à protéger les océans. L’idée était que certains éléments importants de notre planète – les minéraux des grands fonds marins, l’Antarctique, l’atmosphère, la Lune – devaient être traités comme des biens communs, aujourd’hui et à l’avenir. Mais peu d’États ont montré de l’enthousiasme à respecter ou à étendre ces principes, et surtout pas les États-Unis. Cette résistance est due à l’affirmation selon laquelle une chose considérée comme patrimoine commun de l’humanité ne peut être la propriété exclusive d’un État-nation individuel ou d’un autre acteur. Cela signifie qu’aucun État n’est autorisé à revendiquer une souveraineté nationale sur cette ressource, ni à tenter de l’utiliser à des fins militaires ou commerciales1. Chacun d’eux doit en partager les bénéfices. De fait, le principe du « partage de l’accès et des bénéfices2 » est devenu un point de friction crucial dans tous les débats sur le patrimoine commun de l’humanité. Cette notion peut sembler utile au premier abord parce qu’elle permet d’éviter un système du type « premier arrivé, premier servi ». Malheureusement, ce n’est pas si simple. Pour dire les choses crûment, ce principe limite le débat politique concret sur le patrimoine commun de l’humanité à une discussion portant essentiellement sur des intérêts économiques. Le présupposé est que si nous exploitons les quelques zones de la Terre qui ne sont pas encore entièrement ouvertes au commerce, par exemple à travers l’exploitation de mines sous-marines, les bénéfices qui en découlent devraient être partagés de manière équitable. Or les seules choses considérées comme des « bénéfices » sont celles que les gens peuvent utiliser et exprimer sous forme de chiffres et d’argent – ce qui favorise naturellement l’exploitation commerciale. Après des décennies de débat sur le patrimoine commun de l’humanité, l’idée d’une inaliénabilité de ce qui est commun s’est complètement perdue.
Cela vaut pour l’espace au-delà de l’atmosphère aussi bien que pour le fond des océans. Aujourd’hui, de multiples projets d’exploration spatiale financés par des fonds privés menacent de passer outre aux principes du Traité sur l’espace extra-atmosphérique ratifié en 1967. En 2018, le secrétaire au Commerce du président Trump, Wilbur Ross, a proposé de « transformer la Lune en une sorte de station-service pour le transport spatial ». Selon lui, les surfaces sombres de la lune sont en fait des masses énormes de glace solide, « donc le projet est de décomposer la glace en hydrogène et en oxygène, [et] de les utiliser comme carburant3 ». L’administration Trump a également étudié la faisabilité d’un « développement économique de grande envergure de l’espace », y compris des « atterrisseurs lunaires privés qui revendiqueraient des “droits de propriété” de fait pour les Américains sur la Lune, d’ici à 2020 », ainsi que le droit d’extraire des métaux précieux du sous-sol des astéroïdes4.
La triste histoire de ces quarante dernières années (au moins) montre à quel point les déclarations apparemment nobles comme la doctrine du patrimoine commun de l’humanité sont plus symboliques que sérieuses. L’explication en est très simple : le système marché/État est structurellement défavorable à la protection des richesses partagées en tant que communs. En effet, cette protection tend à interférer avec l’investissement privé et avec l’impératif du rendement5.
L’accaparement des richesses célestes n’est qu’une extension de l’exploitation commerciale de la Terre en cours depuis des siècles. Il illustre la même dynamique fondamentale : les marchés et les États contemporains se co-constituent mutuellement et sont profondément interdépendants, même si chacun conserve une sphère d’autonomie relative. Les acteurs du marché ont besoin de la légitimité politique et de la prévisibilité juridique qu’offrent les États, et les États ont besoin des recettes fiscales, de l’influence géopolitique et des infrastructures qui découlent d’une économie engagée dans une croissance sans fin. Ce n’est que dans le cadre délimité par leur dépendance réciproque que les acteurs du marché et les décideurs politiques disposent d’une certaine marge d’autonomie où ils peuvent exercer un pouvoir discrétionnaire.
Établi sur cette base, le système marché/État entraîne des dilemmes stratégiques pour les décideurs politiques. En fin de compte, ils ne pourront que rester ambivalents face à tout ce qui pourrait empêcher les investisseurs et les entreprises de monétiser les richesses de la Terre (et au-delà !). Il n’est pas étonnant que les gouvernements des principaux pays industrialisés du monde n’aient pris aucune mesure sérieuse contre les émissions de carbone ces trente dernières années, malgré les preuves de plus en plus évidentes du dérèglement climatique. Lorsqu’il y a eu effectivement une tentative pour garder le pétrole dans le sol – comme l’a proposé le gouvernement de l’Équateur avec un plan visant à séquestrer 20 % de ses gisements de pétrole, avec l’aide financière des pays du Nord –, la communauté politique internationale a tout simplement ignoré la proposition6.
Dès lors, dans l’optique d’enraciner les communs dans le droit, il ne faut se faire aucune illusion sur les possibilités d’amélioration via le pouvoir d’État. Au vu de la manière dont les États sont constitués aujourd’hui, il n’est pas seulement difficile pour les gardiens du pouvoir étatique de soutenir les communs. Ils peuvent à peine en concevoir l’idée ! Le pouvoir étatique, du moins dans les démocraties libérales alignées sur le capitalisme de marché, est attaché à une vision du monde statique et individualiste. La politique des démocraties libérales capitalistes met les droits individuels et la liberté économique au-dessus de tout le reste – mis à part, peut-être, l’idée du pouvoir étatique souverain lui-même.
Si l’on prend les communs au sérieux, il faut donc revoir en profondeur nos idées sur la manière dont le pouvoir d’État pourrait être utilisé stratégiquement pour promouvoir les intérêts des commoneurs. Il va sans dire qu’il s’agit là d’une tâche immense, à laquelle nous ne pouvons que commencer à nous atteler dans ce livre. Une chose est claire cependant : les formes dominantes du pouvoir d’État en tant que système de gouvernance – l’État-nation – devront certainement changer.
L’« ÉTAT » ET LE « PEUPLE »
Avant d’aller plus loin, il est nécessaire d’apporter deux précisions conceptuelles importantes sur ce que nous entendons par l’« État ». Premièrement, l’État n’est pas vraiment un sujet ou une entité, comme le laisse entendre l’usage populaire du terme. Le concept d’État est relationnel. Tout comme la notion de « je » ne peut exister sans « tu » – les deux sont définis l’un par l’autre et existent en relation l’un avec l’autre –, l’État est une notion relationnelle (tels les communs). Vu sous cet angle, l’État doit être compris en contrepoint à ce qu’il n’est pas. « L’État, explique le théoricien politique Bob Jessop, est constitué comme une division entre lui-même et son autre7. » Cela signifie que l’État n’existe qu’en se distinguant du marché, de la société civile, de la religion et de la famille, même si aucun État n’est concevable sans ces systèmes sociaux. L’État s’articule avec ces systèmes sociaux.
Il est donc plus exact de considérer l’État comme le pouvoir qui façonne ces relations. C’est pourquoi nous préférons parler du pouvoir d’État – ou, plus précisément, des pouvoirs d’État – pour nous rappeler que l’État en tant que tel n’existe pas vraiment. Ce n’est pas un monolithe, mais une configuration de relations de pouvoir constamment (re)produites. Dès lors, l’État n’agit jamais en tant que tel ; seuls agissent des groupes spécifiques ayant des intérêts et des positions de pouvoir spécifiques et s’appuyant sur divers instruments tels que le droit, la police, les bureaucraties, etc.
Et pourtant, l’État est bien réel, au sens d’un ensemble d’institutions – bureaucraties, armée, tribunaux, etc. – qui affectent directement la vie des gens. Ces institutions ont leur propre façon de contribuer à l’individuation, notamment en accordant des titres (permis de conduire, permis de travail) et en nous définissant comme « citoyens », ce qui nous confère certaines responsabilités et certains droits. Être un commoneur, c’est comprendre l’individu – avec ses responsabilités et ses droits – en un tout autre sens. La notion de commoneur est à la fois ancrée localement, mais aussi transculturelle, universelle et au-delà de toute forme d’État. Il ne s’agit pas simplement d’une identité qui se situerait quelque part entre le citoyen et l’individu. Être un commoneur, c’est comprendre la réalité sociale d’une manière différente. C’est voir que le moi en tant qu’individu est toujours relié aux autres, et ce, en un sens prépolitique. La question non résolue est de savoir comment modifier les pouvoirs d’État pour reconnaître et soutenir des modes d’individuation favorables aux communs, autrement dit pour renforcer le commoneur en chacun d’entre nous.
Pour comprendre le pouvoir d’État, il faut reconnaître qu’« Étatnation » est un terme trompeur. Il réunit l’idée d’appartenance à un peuple (un concept anthropologique) avec un système de pouvoir, l’État (un concept issu de la science politique et de la théorie de l’État). Le terme « nation », du latin natio, est dérivé de nasci, « naître ». Le terme natio signifie simplement « peuple, parenté, type de peuple » et désigne une communauté de personnes de même origine et partageant une langue et des coutumes communes. Aujourd’hui encore, le terme « nation » est souvent considéré comme synonyme de « peuple ». Le peuple d’une nation est défini comme ethniquement homogène – souvent pour des raisons politiques –, ce qui contribue à en faire un concept très chargé. Le terme « nation » est apparu en France au xvie siècle ; les gens l’utilisaient alors pour se désigner comme un peuple doté d’une unité politique et étatique ; il n’a été utilisé plus largement dans le reste de l’Europe qu’après la Révolution française. Aujourd’hui, deux siècles plus tard, le terme « nation » est utilisé très fréquemment pour désigner le peuple d’un État – si fréquemment que nous oublions que les citoyens d’un État ne sont pas nécessairement un peuple au sens anthropologique du terme.
L’amalgame entre le peuple et l’État est si familier et si profondément enraciné dans nos esprits et notre langage que ces distinctions peuvent sembler byzantines. Si l’on y réfléchit, cependant, aucun État-nation territorial au monde n’est fondé sur un passé partagé unique ni sur un seul peuple (au sens originel de natio) – ni l’Irak, ni le Mexique, ni l’Inde, ni la Bolivie, ni non plus aucun autre des États-nations territoriaux modernes. Ils sont tous composés d’ethnies, de traditions sociales et de cultures diverses. La Bolivie est le seul État au monde à avoir reconnu officiellement cette diversité dans sa Constitution de 2009, où il se définit comme un État plurinational unitaire.
Aujourd’hui, les États et de nombreux acteurs politiques cultivent activement le sentiment d’identité nationale et de patriotisme. Il n’est pas rare que le pouvoir d’État moderne soit fondé sur ce sentiment et cherche à se renforcer à travers lui. Après des années de débat, Israël a élevé en 2018 cette confusion entre le pouvoir d’État et l’identité nationale à un statut quasi constitutionnel8. Dans le texte de loi généralement connu sous le nom de « loi sur l’État-nation », Israël est défini comme l’« État-nation du peuple juif9 ».
La fusion de la nation et de l’État est une source intarissable de conflits et de traumatismes politiques car elle fait fi des réalités vécues de l’identité ethnique et de la culture. Elle alimente aussi des mouvements sociaux racistes, nationalistes et fascistes, comme on peut le voir actuellement au Brésil. La philosophe Hannah Arendt le soulignait en 1963 ; « L’incapacité de cette forme d’État précisément à survivre dans le monde moderne a été prouvée il y a longtemps, et plus longtemps elle sera maintenue, plus les perversions non seulement de l’État national, mais aussi du nationalisme, prévaudront de manière vicieuse et impitoyable10. »
Il faut faire un effort de pensée particulier pour séparer la nation de l’État parce que c’est devenu comme une seconde nature pour les citoyens, de même que pour ceux qui exercent le pouvoir d’État, d’adhérer au grand récit de l’identité partagée d’un seul peuple. Les communs offrent un moyen de sortir de ce piège en reconnaissant la diversité réelle des identités sociales, ethniques, culturelles et religieuses. Dans la pratique des communs, les processus de construction identitaire émergent de manière autonome, sans obligation de s’intégrer dans une configuration politique unique telle que la citoyenneté d’un État-nation. La pratique des communs sert ainsi en quelque sorte de zone intermédiaire pour co-créer des identités transnationales, post-étatiques, qui puissent dépasser les dérives du patriotisme et du nationalisme.
Égaux en droit, inégaux en pratique
Même si les États modernes reconnaissent tous les citoyens comme égaux du point de vue du droit, dans la pratique, l’exercice des libertés civiles et des droits est souvent fonction de la richesse, de la réputation, des connexions politiques, et ainsi de suite. Les discriminations sociétales jouent également un rôle. La discrimination peut être si profondément ancrée dans notre pensée, notre langage et nos institutions que les gens ne perçoivent même pas les points de vue différents, ou les considèrent comme hors de propos. Dès lors, aucun individu en particulier n’est directement responsable de la discrimination. C’est « la faute de personne ». Mais en fin de compte, ce sont quand même des personnes originaires d’Afrique qui nettoient nos bureaux la nuit et des femmes (souvent d’Europe de l’Est) qui occupent les emplois mal payés dans le secteur du soin et des services à la personne.
L’égalité devant la loi peut même devenir un moyen retors d’accorder un traitement préférentiel à certains acteurs. Elle peut servir de déguisement idéal à des privilèges accordés de manière détournée. Les politiques publiques et les réglementations peuvent, par exemple, maintenir une apparence de neutralité tout en favorisant dans les faits une certaine catégorie de grandes entreprises par rapport à d’autres. Les secteurs de la finance, de l’automobile et de l’agriculture sont devenus « trop grands pour faire faillite » et trop importants pour le PIB pour être réellement tenus responsables de leurs pratiques antisociales. Cela conduit à ce que des acteurs économiques privilégiés dictent en grande partie les termes de la loi, aux dépens des individus non organisés et du bien commun. Comme l’a écrit un auteur inconnu à propos des enclosures de terres en Angleterre ratifiées par le
Parlement au xviie siècle :
La loi enferme l’homme ou la femme qui a volé l’oie au commun, mais laisse en liberté le bien pire malfrat
qui vole le commun à l’oie.
Nous poursuivons deux ambitions dans ces deux derniers chapitres : imaginer comment la pratique des communs peut aider à catalyser un Ontochangement et comment utiliser à cette fin, en le changeant en profondeur, le pouvoir d’État (ce chapitre-ci) ; suggérer de nouvelles formes juridiques et politiques utilisables par les commoneurs pour transformer certaines actions spécifiques de l’État et soutenir ainsi la pratique des communs (chapitre 10). Si l’on applique la vision du monde décrite dans le chapitre 2 pour comprendre le fonctionnement du pouvoir d’État, on voit bien que l’État n’existe pas. Cette réorientation du regard peut nous aider à identifier de nouvelles opportunités stratégiques dans nos relations avec les institutions étatiques. Elle nous aide à focaliser notre attention sur certains dispositifs institutionnels et certains processus bureaucratiques spécifiques, qui privilégient certains groupes par rapport à d’autres malgré leur égalité formelle devant la loi.
Une approche relationnelle du pouvoir d’État nous aide aussi à envisager toutes sortes de moyens pour faire progresser, morceau par morceau, les communs. Ces moyens peuvent tous contribuer à un programme de transformation plus important visant à reconfigurer les relations de pouvoir 1) au sein des institutions de l’État et 2) entre ces dernières et les commoneurs. Si nous dirigeons notre attention vers les différents agents et les différentes strates du pouvoir d’État, au lieu de ce monolithe fictif qu’on appelle l’« État », il devient possible d’imaginer d’autres manières d’impliquer le public dans les activités quotidiennes de la gouvernance. Plateformes ouvertes invitant les citoyens à aider les municipalités en matière de planification urbaine, sites web gouvernementaux encourageant les citoyens à donner leur avis sur les services publics, programmes de budget participatif permettant aux citoyens de prendre des décisions en matière de dépenses, soutien gouvernemental à l’habitat participatif et aux réseaux de soutien bénévole pour les personnes âgées… Tout ceci nous fait entrevoir l’étendue du possible. Une collaboration fructueuse entre communs et État peut naître de ce que les commoneurs parviennent à fournir des services que ni les entreprises commerciales ni les agences gouvernementales ne peuvent ou ne veulent assurer.
Le fournisseur d’accès Internet barcelonais Guifi.net, que nous avons présenté au chapitre 1, a pu nouer une relation constructive avec l’administration municipale parce qu’il apportait une solution d’infrastructure à un problème que les politiques avaient du mal à résoudre – comment fournir une connexion de haute qualité dans les zones rurales ou reculées à faible densité. Guifi.net a commencé par « connecter un élevage de porcs à un élevage de vaches ». Quelques années plus tard, ce réseau fonctionnant comme un commun desservait des dizaines de milliers de personnes11. « Et si le gouvernement faisait confiance aux gens pour partager le travail de gouverner ? », se demandait Geoff Mulgan dans un rapport publié par le think tank britannique Nesta en 201212. Un dialogue plus riche entre gouvernement et citoyens dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’État contribuerait certainement à renforcer la confiance et la légitimité des gouvernants.
De manière plus générale, on peut se demander à quoi pourrait ressembler en pratique dans nos démocraties libérales une approche relationnelle stratégique du pouvoir d’État. Conduiraitelle vraiment à une situation dans laquelle, comme l’écrit la députée travailliste britannique Tessa Jovells, les agents de l’État « donnent la priorité à l’attribution de pouvoir aux individus et aux communautés […] en permettant aux résidents locaux d’avoir recours à leurs propres services, en accordant aux communautés la possibilité de fixer les priorités en matière de dépenses locales, ou en mettant les gens en contact avec des habitants ayant des compétences et du temps à donner » ? C’est certainement possible, mais seulement « si les hommes politiques sont prêts à faire confiance au personnel local et à la population locale pour prendre des décisions13 ».
Tout est une question de confiance ! Le constat est basique, mais pointe en même temps des difficultés concrètes. Les agents de l’État cherchent généralement à affirmer leur contrôle en brandissant à cette fin des chiffres, des unités standards et des procédures bureaucratiques – alors que nous vivons tous dans des paysages singuliers tissés par des histoires, des personnalités et des réseaux d’appartenance sociale uniques.
Il y a une inadéquation structurelle entre le pouvoir d’État et les systèmes vivants. Pour être efficace et gagner la confiance des commoneurs, le pouvoir d’État ne peut se contenter d’imposer des plans directeurs bureaucratiques ; il doit apprendre à favoriser les relations entre personnes réelles dotées de leur propre capacité d’action créative. Pour cela, il faut abandonner l’idée que l’on pourrait réduire les êtres humains à des unités de besoins que des « fournisseurs de services » doivent satisfaire. C’est précisément là la mentalité qui a produit l’institutionnalisation déshumanisante et déresponsabilisante qu’a si vivement critiquée Ivan Illich14. Concentrés sur l’administration de services, les organismes d’État et les professionnels tendent à ignorer les talents créatifs des gens, leur désir de contribuer et leur capacité de commoning. Bref, ils ne reconnaissent pas les capacités d’action autonome des gens et ne cherchent pas à renforcer ces capacités. Par effet de miroir, la plupart des gens ont intériorisé cette identité de consommateurs passifs de services professionnels et gouvernementaux, et ne se considèrent pas eux-mêmes comme des participants potentiels à la Gouvernance par les pairs ou à la vie politique.
Ainsi, le principal défi auquel nous sommes confrontés est de réimaginer le pouvoir d’État de manière à soutenir la pratique des communs. Nous devons faire en sorte que les pouvoirs d’État fournissent le temps, l’espace, l’assistance, l’autorité juridique et les systèmes d’organisation nécessaires pour que les gens puissent trouver leurs propres solutions à leurs problèmes15.
QUELQUES NOTES DE TRAVAIL SUR LE POUVOIR D’ÉTAT
Selon un présupposé très répandu, l’humanité aurait connu une progression linéaire, passant des groupes de chasseurs-cueilleurs aux tribus et clans nomades, puis aux petits établissements agricoles et aux premiers États, monarchies et sociétés féodales, pour finalement atteindre le sommet de la civilisation dont nous jouissons aujourd’hui, l’État-nation moderne. Ce récit est un exercice d’autosatisfaction visant à célébrer la démocratie libérale, organisée en États, comme la forme de gouvernance la plus accomplie et la plus civilisée de l’histoire humaine. À l’inverse, quiconque critique ce récit ou met en cause la gouvernance d’État est considéré comme ignorant, primitif et rétrograde, sinon préhistorique.
Et si, cependant, l’État moderne, dans son alliance intime avec le capital, représentait une impasse du point de vue de l’évolution ? Et si ce système de pouvoir centralisé et hiérarchique était devenu trop fragile et inefficient pour gérer la complexité explosive des réalités locales et de la diversité humaine, en dépit des aménagements visant à l’adapter aux réalités des sociétés en réseaux et de l’hybridation des institutions de gouvernance ? Et s’il était devenu trop étranger à un monde qui dépasse la seule sphère de l’humain et à ses impératifs ? Certains critiques estiment que notre civilisation n’est pas seulement confrontée au défi du pic pétrolier – le déclin des sources fossiles d’énergie bon marché –, mais aussi à celui du « pic hiérarchique », c’est-à-dire au déclin de l’efficacité des structures administratives centralisées et hiérarchiques. Michel Bauwens affirme : « L’horizontalité [des relations sociales et économiques] commence à l’emporter sur la verticalité ; il devient plus compétitif d’être distribué que d’être (dé)centralisé. Les deux forces combinées du pic pétrolier et du pic hiérarchique vont changer radicalement le monde dans lequel nous vivrons16. »
Les fondements traditionnels du pouvoir d’État étant ainsi sous forte pression, nous sommes persuadés qu’il est temps de réfléchir à de nouveaux possibles qui reposeraient sur une relation constructive et salutaire avec les communs. Le théoricien qui a probablement été le plus loin dans le développement d’une théorie historique cohérente de l’État du point de vue des commoneurs est l’anthropologue de Yale James C. Scott. Scott soutient que d’innombrables populations ont cherché historiquement à éviter le pouvoir d’État en raison de son agressivité militaire, de ses impôts, de ses mandats autocratiques et de sa propension à réduire les gens en esclavage. Elles ont également cherché à éviter des conditions de vie et de travail qui entraînaient des maladies et même des pandémies17. Quand bien même le Léviathan18 prétend garantir de nombreux droits et libertés à ses citoyens, l’essor du couple marché/État s’explique au moins autant par une quête de contrôle des populations. La Grande Muraille de Chine a été construite certes pour empêcher les envahisseurs « barbares » d’entrer, mais aussi pour retenir les citoyens chinois. À notre époque, des nations comme l’Inde, la Chine et les États-Unis déploient des technologies numériques omniprésentes pour assurer une surveillance panoptique et constante de leurs citoyens comme des étrangers19.
Trop souvent, le pouvoir d’État régularise la gouvernance de la vie et consolide le pouvoir au moyen de systèmes centralisés et bureaucratiques, comme l’explique Scott dans son ouvrage Seeing Like a State [« Voir comme un État »] :
L’État moderne, par l’intermédiaire de ses fonctionnaires, tente avec un succès variable de créer un terrain et une population présentant précisément les caractéristiques standardisées qui seront les plus faciles à surveiller, à compter, à évaluer et à gérer. L’objectif utopique, immanent et continuellement contrecarré de l’État moderne est de réduire la réalité sociale chaotique, désordonnée et en constante évolution qui se trouve sous lui à quelque chose qui ressemble de plus près à sa propre grille administrative d’observation20.
Les nombreuses tentatives de l’État pour imposer un ordre universel ne sont pas toutes à rejeter. Une société gagne à ce que l’État émette sa propre monnaie, identifie tout le monde afin de percevoir des impôts et de contrôler les frontières territoriales, établisse des poids et mesures pour rendre lisibles les terres et la production agricole, et ainsi de suite. Cependant, l’obsession de l’État à normaliser ses moyens de contrôle et sa capacité à contraindre les gens à s’y conformer peut également prendre un tour très répressif. Le pouvoir d’État s’appuie souvent sur le droit positif et l’action de la police pour imposer des comportements et des normes qui lui soient favorables. Les bureaucraties sont particulièrement utiles dans cette optique, car leurs systèmes centralisés peuvent passer outre aux nombreuses différences naturelles entre les gens. Au fil du temps, les États incitent leurs citoyens à intérioriser des valeurs et des objectifs afin d’instaurer un ordre unifié et réglementé qui émerge de ce qu’ils considèrent comme le chaos et la barbarie pré-étatiques. Ainsi, quand bien même les États libéraux modernes parviennent effectivement à élargir le champ de liberté des gens ordinaires, ces gains ont un prix : l’attribution de privilèges spéciaux à l’autorité politique de l’État et au pouvoir de marché du capital.
Le drame de l’État-nation libéral moderne, toutefois, tient précisément à son incapacité à contrôler réellement tout ce qui se trouve à l’intérieur de ses frontières territoriales. Il ne peut pas véritablement contrôler ni les innombrables sous-cultures ethniques et l’activité sociale, ni les flux transfrontaliers d’informations, de codes de logiciels et de drogues, ni les systèmes de crédit quasi indépendants que les capitalistes et le crime organisé ont créés, ni la stabilité des écosystèmes.
L’État, qui se présente comme une institution stable et durable exerçant de manière fiable son autorité et son pouvoir, ne peut échapper au fait qu’il est immergé dans un flux et un reflux incessant de relations. L’État est constitué d’une horde de bureaucraties, chacune dirigée par des fonctionnaires enchevêtrés dans de multiples réseaux politiques et professionnels et obéissant à divers codes politiques et techniques. Même si tous les États modernes cherchent à normaliser la vie, chacun le fait de manière différente. On peut dire qu’il y a des variations entre les États – avec une variante de gauche qui se concentre sur la justice et l’égalité matérielle, par exemple, et une variante de droite qui met l’accent sur la liberté économique, les termes juridiques des contrats et autres préoccupations commerciales. En d’autres termes, les résultats sociaux visés peuvent varier d’un pays à l’autre, mais les fonctions politiques essentielles restent substantiellement les mêmes.
Cela signifie que, dès qu’il s’agit de reconnaître des formes diverses d’autodétermination ou de délégation de pouvoir, les États se révèlent inadaptés. Marc Stears écrit :
Les États fonctionnent au mieux quand un problème a une solution technique, mécanique, qui peut être appliquée partout au sein d’un espace géographique partagé. Ils montrent leur pire visage lorsqu’ils doivent répondre avec souplesse aux particularités locales, lorsqu’ils doivent agir avec agilité ou avec nuance et, surtout, lorsqu’ils s’attaquent à des problèmes liés à l’esprit de la nation ou au cœur humain. Tout ce qui est essentiellement fait de différences, de contingence et d’imprévisibilité ne montrera pas l’État sous son meilleur jour21.
On pourrait dire que les États sont affligés d’un nationalisme méthodologique, que ce soit pour répandre « la civilisation et la démocratie » ou dans une perspective de conquête coloniale ou impérialiste. Fétichiser la souveraineté de l’État nous rend aveugles aux mondes pluriversels et autogérés dans lesquels tout un chacun vit effectivement, jour après jour. Il n’est pas surprenant que la création de mondes et la Gouvernance par les pairs dans lesquelles sont engagés au quotidien les commoneurs restent généralement invisibles pour les bureaucraties étatiques. C’est bien pourquoi il est utile de voir le monde à travers le prisme des communs : cela met en évidence une pléthore de solutions et élargit nos possibilités d’action.
Dès lors que nous choisissons de voir l’État non comme un monolithe omnipotent mais comme une configuration de pouvoir très variable, et même bornée et vulnérable à certains égards, il devient possible d’imaginer les moyens de transformer le pouvoir d’État pièce par pièce, au fur et à mesure que les occasions se présentent. On comprend comment les pratiques et les relations sociales peuvent nous aider à transformer le pouvoir d’État, au moins de manière progressive. Certes, les formes de la gouvernance et de l’autorité de l’État varient énormément ; mais les personnes vivant dans des contextes locaux plus intimes perçoivent généralement la politique comme plus accessible, plus adaptable et plus responsable.
C’est l’une des raisons pour lesquelles les villes et les communes joueront probablement un rôle majeur dans la transformation du pouvoir d’État. Leur échelle réduite offre davantage de possibilités de changement. Le politologue Benjamin Barber considère les maires comme des figures essentielles de la transformation sociale22 et le théoricien Murray Bookchin affirme que le « municipalisme libertaire » offre les meilleures opportunités de changement social en donnant le pouvoir à des assemblées démocratiques et à des confédérations de municipalités libres23. Il n’est pas surprenant que l’une des forces de changement les plus vigoureuses en Europe actuellement soit le mouvement du « nouveau municipalisme » qui tente de décentraliser le pouvoir d’État et de le refonder depuis le terrain24.
Dans la conception standard de l’économie et de la politique, l’action locale est souvent jugée avec condescendance, considérée comme trop petite pour être significative. Mais en réalité, dans le monde d’aujourd’hui, tout est « PLOC » – petit et local, mais ouvert et connecté25 –, ce qui signifie que même des actions discrètes et singulières peuvent catalyser des changements importants. Une obscure manifestation d’Occupy Wall Street dans le parc Zuccotti de Manhattan en 2011 a déclenché des dizaines de manifestations d’Occupy dans le monde entier et a fait de l’inégalité des richesses un sujet central du débat public. De même, la Convention mondiale des maires pour le climat et l’énergie a eu une grande influence en attirant l’attention des décideurs politiques internationaux sur des initiatives importantes26. Lorsque des militants de São Paulo se battent pour des logements abordables comme une autre manière de réduire les émissions de CO2, ou lorsque des activistes de Barcelone transforment des appartements Airbnb en logements sociaux, les répercussions s’en font sentir dans de nombreuses autres villes, territoires et forums internationaux. « Ce que certains qualifient de “localisme” est en fait le fondement même du changement transformateur », affirme le Symbiosis Research Collective27.
Cela est tout à fait plausible, non seulement parce que les sphères politiques sont plus accessibles quand elles sont à plus petite échelle, mais aussi parce que le localisme rend possibles de nouvelles formes d’organisation politique à la base et en réseau qui dépassent les capacités des partis politiques. On le voit en Espagne, par exemple, où le mouvement 15-M a réussi à influencer le pouvoir municipal. Il a donné de la visibilité à l’idée que « le personnel est politique » et l’a rendue facile à saisir. Ce concept signifie que l’expérience individuelle concrète – plutôt que les considérations théoriques ou stratégiques – doit être prise au sérieux et utilisée comme point de départ de la politique. Cela est fondamentalement différent, pour reprendre les termes du journaliste et écrivain Amador FernándezSavater, de la « conception de la politique comme une gestion “techniquement correcte” des nécessités “inévitables” du capitalisme mondial28 ».
Lorsque les militants font l’expérience de la démocratie radicale – fondée sur des choses aussi simples que « les formes procédurales du 15-M, les assemblées de démocratie directe, les méthodes de facilitation, les groupes de travail, les votes à main levée ou la prise de décision par consensus29 » –, ils sont en mesure d’apporter aussi cette expérience au niveau des municipalités. L’activisme municipal radical, lorsqu’il se fédère avec des initiatives similaires ailleurs, aide à ménager des espaces protégés où la pratique des communs puisse s’épanouir et s’étendre, sanctionnée par une autorité légale formelle et soutenue par l’administration.
AU-DELÀ DE LA RÉFORME ET DE LA RÉVOLUTION
L’objectif premier de la pratique des communs n’est pas de s’emparer du pouvoir d’État à travers une révolution ou des élections. Il est de développer des espaces indépendants stables dotés d’une liberté relative pour établir leurs propres systèmes de gouvernance et d’approvisionnement par les pairs. L’histoire a montré que même lorsque des forces de gauche conquièrent le pouvoir d’État par des moyens démocratiques, cela ne mène généralement pas à un changement de système. En 2015, la coalition politique grecque dirigée par Syriza s’est rendu compte que sa victoire électorale éclatante, qui lui donnait nominalement le contrôle d’un État souverain, n’était pas suffisante. L’État grec restait en réalité subordonné au pouvoir du capital international et aux intérêts géopolitiques d’autres États. Une leçon similaire peut être tirée de l’ascension du dirigeant indigène Evo Morales à la présidence de la Bolivie : même des mouvements électoraux intelligents et bien intentionnés ont du mal à dépasser les impératifs profonds du pouvoir d’État, car celui-ci reste étroitement lié à un système international de finance capitaliste et d’extraction des ressources. Pablo Solón Romero, militant de longue date et ancien ambassadeur de l’État plurinational de Bolivie auprès des Nations unies (2009-2011), en fait un récit édifiant :
Il y a quinze ans [au début des années 2000], nous avions beaucoup de communs en Bolivie – pour les forêts, l’eau, la justice, etc. Afin de préserver tout cela, dès lors que notre ennemi était l’État et sa politique de privatisation à tout va, nous avons décidé de conquérir l’État. Et nous avons réussi ! Et nous avons été en mesure de faire de bonnes choses. Maintenant, nous avons un État plurinational. C’est positif. Mais… dix ans plus tard, nos communautés sont-elles plus fortes ou plus faibles ? Elles sont plus faibles ! On ne peut pas faire tout ce que nous voulions faire via l’État. L’État et ses structures ont leur logique propre. Nous avons été naïfs. Nous ne nous sommes pas rendu compte que ces structures allaient nous changer30.
Ce que tout ceci suggère, c’est que même si la politique électorale permet d’accomplir certaines choses importantes, elle a également des limites structurelles évidentes. Les gardiens du pouvoir d’État font tout pour maintenir et étendre la culture qui soutient ce pouvoir : un mythos patriotique et civique, des infrastructures et des institutions, de l’argent et du commerce, et, bien sûr, une vigilance constante face aux défis potentiels et à la subversion. Les réformateurs se contentent de rechercher des transformations progressives par le biais de l’appareil de pouvoir étatique lui-même. Les révolutionnaires pourraient sembler vouloir le contraire – renverser d’un coup le pouvoir d’État. Et pourtant, « la substance des théories révolutionnaires modernes est malheureusement très mince », écrivent les théoriciens politiques allemands Sutterlütti et Meretz31. Les révolutionnaires se concentrent sur les anciennes structures. Ils doivent s’y situer pour chercher à les renverser ou à les abolir. Mais ils n’ont généralement pas grand-chose à dire sur ce à quoi devrait ressembler le nouvel ordre. Ils ne parlent pas non plus des transformations intérieures nécessaires à l’avènement d’une nouvelle politique et d’une nouvelle culture. Sutterlütti et Meretz concluent : « La réforme et la révolution s’avèrent des enfants du marxisme conventionnel : elles sont capables d’imaginer comment s’emparer du pouvoir politique et réaménager l’État, mais pas comment mettre en place une société libre32. »
Il faut donc dépasser le dilemme « réforme ou révolution ». Peutêtre en allant vers quelque chose que le politologue allemand Joachim Hirsch qualifie de « réformisme radical ». Le réformisme radical évite la fixation sur l’État. La notion fait référence au rôle des changements culturels et sociétaux, dont l’importance ne peut être sous-estimée. Il y a d’abord eu la révolte de 1968 et ensuite des changements dans la loi – non l’inverse. Le réformisme radical reste un « réformisme » car, selon Hirsch, « il ne s’agit pas de prendre le pouvoir par la révolution », mais il est « radical » parce qu’il cible « les relations sociétales qui engendrent les rapports établis de pouvoir et de domination33 ». Il est également radical au sens où il englobe la manière dont les gens peuvent se changer eux-mêmes. Ce qui n’est possible, selon Hirsch, que « si les gens parviennent à créer des formes d’auto-organisation politique et sociale au-delà et indépendamment des appareils de gouvernement existants, de l’État et des partis politiques, et à mettre en pratique un concept de politique qui s’attaque à ce qu’il y a de “politique” dans le “privé”34 ».
Nous sommes ramenés à notre impasse actuelle. Pouvons-nous imaginer une transformation du monde qui évite les pièges de la réforme comme de la révolution ? Pouvons-nous concevoir un monde qui ne soit pas utopique – au sens d’être « nulle part » (la signification littérale du mot utopie) –, mais construit sur des expériences réussies, habité et dirigé par de vraies gens ? C’est ce que nous avons tenté de faire dans les chapitres 4 à 6 : esquisser la dynamique réelle de la vie sociale, de la gouvernance et de l’approvisionnement dans le cadre d’un ordre nouveau. Il faut des voies pratiques pour que cette vision se réalise et que personne ne soit laissé pour compte. Comme l’a écrit Murray Bookchin, « le plus grand défaut des mouvements pour la reconstruction sociale – je me réfère particulièrement à la gauche, aux groupes écologistes radicaux et aux organisations qui parlent au nom des opprimés – est peut-être l’absence d’une politique qui porte les gens au-delà des limites établies par le statu quo35 ».
Dès lors, les questions auxquelles nous avons à répondre sont les suivantes. La pratique des communs telle que nous l’avons décrite peut-elle potentiellement instaurer un ordre social plus humain à une échelle significative, en dépit du pouvoir d’État ? Le commoning peut-il engendrer de nouvelles formes de gouvernance et d’approvisionnement qui fassent progresser la liberté, l’équité et l’éco- responsabilité pour tous ? Tout cela peut-il advenir dans des formes qui nous fassent nous sentir plus vivants, et non comme des marionnettes aux ordres d’une mégamachine totalisante36 ? La pratique des communs peut-elle nous aider à reconquérir notre souveraineté que le pouvoir systémique de la mégamachine a étouffée ? Nous pensons immodestement que la réponse est oui. Oui, de fait, c’est possible !
Tel est le pouvoir de la pratique des communs. Et nous sommes convaincus qu’il faut commencer par apprendre à être la révolution plutôt que de seulement la faire – ce que l’on appelle souvent la « politique préfigurative ». Cela signifie essayer des choses. Vivre avec elles pendant un certain temps. Y réfléchir. Faire des corrections et des ajustements. Nous n’avons pas besoin de nous focaliser sur les politiques d’État en tant que telles, même si, bien sûr, nous ne pouvons pas les éviter entièrement. Nous devons nous concentrer sur la construction d’un nouvel ordre social.
Derrière cette approche, il y a une explication toute simple : on ne peut engendrer une société véritablement libre et équitable à travers un processus politique ou étatique qui resterait fondé sur l’« ordre normal des choses » et dépendant de lui. Cela rend impossible de changer les fondements culturels de la société et son paysage mental. Une véritable transformation doit s’appuyer sur les fondements que nous avons esquissés dans les premiers chapitres de ce livre. Elle doit développer sa propre vision et s’actualiser à travers ses propres structures. Elle doit mettre en œuvre un processus social capable de constituer au fil du temps un ordre alternatif à tous les niveaux – individuel, collectif, sociétal – pour répondre de manière indépendante aux aspirations des gens au changement. Rappelons à nouveau le conseil de J. K. Gibson-Graham : « Si nous changer nous-mêmes, c’est changer nos mondes, et si la relation est réciproque, alors le projet d’écrire l’histoire n’est jamais éloigné mais toujours ici même, au bord de nos corps qui sentent, pensent, ressentent et bougent37. » Faire face au pouvoir d’État est un formidable défi. Mais le moyen le plus puissant et le plus durable de relever ce défi est peut-être de nous réorienter nous-mêmes et de construire des communs protégeables. Seule cette approche ouvre une voie pour aller de l’avant en dépit du pouvoir d’État, car elle transforme aussi bien nous-mêmes que les structures politiques et institutionnelles extérieures. Les deux doivent aller ensemble, de manière dynamique et pas véritablement prévisible.
L’importance du pouvoir d’État est indéniable, mais l’ambition de s’en emparer ne peut que mener à la désillusion. L’État capitaliste est trop profondément subordonné à la propriété, à l’individualisme et à la culture de marchandisation. Même les dirigeants politiques qui souhaiteraient explorer des futurs possibles post-capitalistes se retrouveront enfermés dans un système mondial d’États eux-mêmes enfermés dans un marché mondial. C’est pourquoi, au bout du compte, l’argument le plus puissant que n’importe quel dirigeant politique dans le monde pourra jamais présenter pour défendre ses choix politiques est : « Cela créera des emplois. » En d’autres termes, chacun doit constamment réaffirmer sa soumission au modèle économique dominant et en accepter les dommages collatéraux. Divers mouvements sociaux ont proposé d’autres voies – d’autres modes de vie moins dépendants de la mégamachine marché/État –, mais ces voies sont restées bloquées parce que les dirigeants de l’État, en accord avec les grandes entreprises, réussissent généralement à coopter ou à subvertir toute menace perçue contre le système.
LE POUVOIR DU COMMONING
Que conclure de tout cela ? Comment les commoneurs peuventils développer le Communivers tout en vivant dans un système de marché/État qui ne pourra que l’ignorer ou le combattre ? Répondre à cette question implique de se confronter à un paradoxe : le pouvoir de l’État est trop redoutable et trop coercitif pour être ignoré, mais les efforts conventionnels pour le transformer risquent fort d’être insatisfaisants. D’une manière ou d’une autre, les termes mêmes de la politique, de la gouvernance et du droit doivent être réimaginés et transformés. Les manifestes audacieux ou les postures rhétoriques ne suffiront pas. Seules la pratique sociale réelle et la culture vivante pourront faire avancer les choses. Si cela vous semble quelque peu fantaisiste, rappelez-vous l’idée de Hannah Arendt selon laquelle le pouvoir est quelque chose qui « naît entre les hommes lorsqu’ils agissent ensemble et disparaît dès qu’ils se dispersent », comme elle l’a écrit dans Condition de l’homme moderne38. Si le pouvoir naît lorsque des gens se rassemblent, il pourra toujours être créé. Il n’est pas inhérent aux institutions étatiques ; ce n’est pas une capacité figée, inhérente, qui puisse être stockée. Le pouvoir n’est pas nécessairement un pouvoir sur quelque chose ou quelqu’un ; il peut – pourvu qu’il soit créé par des structures favorables, dans le dialogue et la responsabilité – permettre aux gens de prendre leur vie en main, plutôt que de les rendre impuissants face à l’omnipotence de ceux qui sont au pouvoir.
Vue sous cet angle, la pratique des communs est aussi une manière de créer du pouvoir. Peut-être qu’avec le temps elle peut aussi devenir un moyen de défier petit à petit l’omnipotence de l’État et du marché en lui retirant son carburant et en privant la mégamachine de sa subsistance – nous-mêmes. C’est notre participation qui nourrit le couple marché/État. Bien sûr, si nous participons, c’est qu’il y a de bonnes raisons à cela. D’un point de vue individuel, il est commode, voire essentiel, de jouer le jeu selon les règles en vigueur. Sinon, nous perdrons nos revenus et notre statut social, les formes de sécurité auxquelles nous sommes habitués, notre emploi. C’est précisément pourquoi un si grand nombre de stratégies habituelles de poursuite d’une transformation sociale de long terme sont, structurellement parlant, des impasses.
La caractéristique la plus remarquable de la pratique des communs est sans doute sa capacité à rediriger l’énergie des gens pour qu’ils cessent d’alimenter les moteurs de pouvoir des marchés et des États-nations modernes. C’est possible parce que les communs proposent des moyens alternatifs de satisfaire les besoins et construisent des formes de pouvoir quasi autonomes. Bien sûr, l’État moderne conserve de nombreux atouts non négligeables – son alliance avec le capital, son allégeance à la croissance économique, le contrôle consolidé qu’il exerce sur le pouvoir. Ces avantages le prémunissent en apparence contre le besoin de négocier avec les citoyens au sujet de leurs aspirations au changement. Mais cette apparence d’omnipotence est une tromperie dont on ne sait s’il faut rire ou pleurer : à l’heure du dérèglement climatique, de l’effondrement des écosystèmes, de la désertification, etc., même le pouvoir d’État ne peut défier les (dés)équilibres planétaires qui sont devenus, comme le note Bruno Latour39, des acteurs politiques à part entière. La quantité d’énergie et de matériaux nécessaire pour soutenir la croissance économique atteint ses limites physiques, épuisant les gens et la planète. La croissance mine l’émancipation sociale et le progrès, qui sont censés être la justification de cette croissance. Et tout cela se produit avant même que les gouvernements puissent envisager une redistribution plus équitable des richesses – ce qu’en pratique ils envisagent de moins en moins, dès lors que les riches utilisent leur argent pour saper les fondements de la démocratie libérale40.
Si la plupart des commoneurs n’aspirent ni à s’emparer frontalement du pouvoir d’État, ni à jouer le jeu de la compétition sur les marchés, leurs activités n’en ont pas moins d’importantes ramifications à long terme. Elles contribuent à redistribuer le pouvoir. La pratique des communs crée des terreaux de pouvoir non étatique simplement en réunissant les gens pour qu’ils collaborent. On peut le voir à la manière dont GNU/Linux et d’autres programmes open source ont profondément, bien qu’indirectement, transformé le marché et la puissante industrie des logiciels. Aujourd’hui, il serait stupide de produire une encyclopédie à l’ancienne, en sélectionnant d’en haut des experts pour produire un objet coûteux, alors que l’alternative coopérative d’en bas, Wikipédia, avec sa structuration flexible et décentralisée, sa multiplicité de langues, sa diversité et son actualité, présente tant d’avantages. De même, on voit bien comment l’agriculture biologique locale et les mouvements associés autour de l’alimentation, en construisant un univers alternatif d’agriculture bonne pour tous, ont incité l’industrie à produire davantage d’aliments biologiques et à réduire le niveau de transformation des denrées alimentaires. Plus il y aura de communs alimentaires pour « nourrir participativement le monde41 », plus il y aura d’AMAP qui fourniront des aliments frais, locaux et abordables, moins les gens dépendront de l’agriculture industrielle ou de la charité. Les pratiques au fondement des mouvements féministes du monde entier ont également changé les modes d’exercice du pouvoir d’État sur toutes sortes de questions liées à la reproduction, au genre et au lieu de travail, comme l’a montré le mouvement #MeToo.
Ces histoires suggèrent de manière convaincante que les mouvements sociaux ont plus de chances d’être transformateurs s’ils développent des économies parallèles dans le cadre d’une indépendance structurelle vis-à-vis du couple marché/État conventionnel. Cela signifie aussi que les communs auront d’autant plus de chances de survivre et de conserver leur indépendance qu’ils seront moins imbriqués dans l’économie et le pouvoir d’État conventionnels, et qu’ils pourront compter sur des systèmes internes (Gouvernance par les pairs, partage des savoirs, soutien fédéré d’autres communs) pour assurer leur résilience. Dans le même temps, il est impératif de trouver le juste rapport avec le pouvoir étatique à travers les élections et le plaidoyer traditionnel, ne serait-ce que parce que cette sphère d’action peut créer les conditions d’un élargissement des espaces de communalité. Cela est trop important pour être ignoré.
Les commoneurs ont donc besoin d’adopter une double attitude vis-à-vis du pouvoir d’État : se concentrer prioritairement sur la construction du nouveau – en gardant à l’esprit les concepts évoqués ci-dessus – tout en s’efforçant de neutraliser l’ancien.
RÉORGANISER LE POUVOIR D’ÉTAT POUR SOUTENIR LA PRATIQUE DES COMMUNS
Nous avons esquissé un positionnement général vis-à-vis de l’État pour aller de l’avant, mais nous n’avons pas encore approfondi d’autres questions. Comment, plus spécifiquement, le pouvoir d’État lui-même peut-il être changé pour soutenir la pratique des communs ? Quelles ouvertures dans le droit, la bureaucratie, la politique et l’action locale pourraient être mises à profit afin d’assurer des têtes de pont stables pour la pratique des communs ?
La première des priorités est de convaincre les institutions étatiques de se tenir en retrait. Souvenez-vous de la sagesse d’Elinor Ostrom dans son septième principe de conception pour des communs florissants. Elle y affirme que les autorités d’État doivent reconnaître le droit des commoneurs à se gouverner eux-mêmes42. Les autorités gouvernementales extérieures ne doivent pas contester le droit des utilisateurs des ressources communes (ou « appropriateurs », dans le langage d’Ostrom) à élaborer leurs propres règles et régimes de gouvernance. C’est notre point de départ et une exigence minimale. On peut en déduire un principe de non-ingérence. L’État doit s’effacer pour que les commoneurs puissent s’engager dans les activités génératrices de valeur qu’ils sont les seuls à pouvoir mener.
Dans la réalité, cependant, il peut s’avérer que les communs ont besoin d’une reconnaissance juridique pour se développer et s’épanouir. Dans les cas où les institutions étatiques considèrent le partage comme un crime – par exemple, le partage de semences, les collaborations logicielles, le partage d’informations –, la pratique des communs doit être dépénalisée. C’est une étape indispensable de la normalisation des communs et de la reconnaissance de leur légitimité morale et politique, avant les États modernes et indépendamment d’eux43.
Le pouvoir d’État a été utilisé pour permettre à des investisseurs de constituer des sociétés et de limiter leur responsabilité juridique sous prétexte que ces formes d’organisation concouraient au bien public. Les monarques et, plus tard, les Parlements ont vu dans la fondation de sociétés privées un moyen d’encourager certaines activités que l’État ne pouvait ou ne voulait pas entreprendre lui-même. Les premières multinationales, comme la Compagnie britannique des Indes orientales, détenue par des investisseurs privés, ont été les pionnières des régimes commerciaux coloniaux, de l’extraction des ressources naturelles, de l’exploitation d’une main-d’œuvre bon marché et de la construction de chemins de fer et des voies navigables. Pourquoi le pouvoir étatique ne reconnaîtrait-il pas également l’immense valeur générée par les commoneurs en accordant à leurs institutions un statut juridique similaire ?
À l’évidence, cette reconnaissance ne se fera pas facilement. Les dirigeants politiques et les bureaucrates qui ont prêté allégeance au récit économique dominant ont du mal à envisager d’autres formes de valeur. En outre, certaines institutions étatiques ont été conçues de telle sorte qu’elles dépendent structurellement des revenus du marché. Par exemple, l’Office européen des brevets – un organe de gouvernance interétatique qui délivre des brevets en vertu de la Convention sur le brevet européen – dépend pour la majeure partie de son budget d’un milliard d’euros de taxes perçues auprès des demandeurs de brevets. Dès lors que plus il accorde de brevets, plus il perçoit d’argent, l’Office européen des brevets est fortement incité à placer toujours plus de savoirs scientifiques et techniques sous le régime de la propriété privée. S’il est compréhensible de faire payer les détenteurs de brevets – plutôt, par exemple, que le contribuable – pour le service fourni, ce mode de financement est contradictoire avec l’idéal d’un monde où l’on diffuse les savoirs généreusement. Ce genre d’idéal sociétal finit par être considéré comme aberrant, si ce n’est quelque peu ridicule. Il en va de même pour toute ambition de parvenir à l’harmonie sociale et à la continuité intergénérationnelle ou de protéger le patrimoine culturel. Les communautés de subsistance et les tribus nomades, qui pourraient apporter une contribution importante à la formulation de choix écologiques appropriés, continuent à être considérées par de nombreux modernes comme primitives, barbares et irréparablement arriérées44.
Nous nous trouvons ainsi emprisonnés dans un récit de progrès entériné et reproduit par les institutions étatiques. On nous dit que l’économie doit croître (pour atteindre les objectifs fixés par les grandes entreprises) afin que nous soyons compétitifs sur le marché mondial. Les leaders mondiaux nous exhortent à ne pas nous laisser dépasser. Être dépassé par l’innovation technologique, c’est, pour les milieux d’affaires et politiques, le pire des destins. Chaque innovation après l’autre – voitures autonomes, biologie synthétique, nanotechnologies – est rapidement validée par les régulateurs, parfois avec trop peu de temps pour comprendre l’ensemble de ses coûts et avantages pour la société. Tout cela rend plus difficile pour les gens d’adhérer à l’objectif d’une reconversion vers les communs. De leur côté, les gardiens du pouvoir d’État se demandent à juste titre pourquoi l’État devrait accorder une quelconque forme de sanction juridique à des activités non marchandes et décentralisées ou apporter un soutien financier à des choses qui n’ont aucune valeur marchande. Cela ne pourrait que mécontenter les élites et perturber les arrangements politiques établis. En outre, estimentils, laisser les gens se retirer des circuits du système marché/État ne peut qu’exacerber leur désir d’autodétermination… et cela pourrait devenir dangereux. Cela ne ferait qu’encourager l’activité non régulée, l’expérimentation amateur et, peut-être, des revendications de plus grande autonomie. Les gardiens du pouvoir d’État craignent à juste titre que si les gens démarchandisaient leur vie quotidienne et se libéraient de leur dépendance à l’égard du système marché/État, cela affecterait la position morale de l’État, son autorité politique et ses recettes fiscales.
D’où le défi : pour que les communs puissent évoluer jusqu’à devenir une matrice alternative de gouvernance et d’approvisionnement, ils doivent, d’une manière ou d’une autre, surmonter le scepticisme profondément ancré de nombreux bureaucrates, dirigeants politiques et gouvernements à leur égard. Cela ne signifie pas que cet obstacle ne puisse pas être contourné. Comme il a été rappelé précédemment, l’État n’est pas une institution monolithique. Les décideurs étatiques, malgré leur zèle à défendre leur autorité, peuvent trouver avantageux dans certaines circonstances d’autoriser et de soutenir la pratique des communs. Au niveau local, cela signifie : allouer des terres pour des jardins communautaires et de l’habitat participatif ; faciliter la formation de banques et de fiducies foncières citoyennes ; encourager les systèmes agroalimentaires locaux ; recourir à des logiciels libres dans l’administration publique ; fournir un accès Wi-Fi local gratuit partout ; utiliser des ressources éducatives libres dans les salles de classe ; donner un espace et un soutien aux banques de temps, aux Repair cafés, aux hackerspaces, etc.
Ce n’est pas forcément un programme chimérique. Ceux qui exercent le pouvoir d’État sont conscients d’avoir besoin de soutien public et de légitimité. De nombreux hommes politiques, sensibles aux vigoureuses résistances sociales contre l’extractivisme et l’ordre commercial international, cherchent des moyens crédibles d’échapper à la cage de fer du capitalisme néolibéral. Certains dirigeants sont même prêts à admettre l’échec du grand récit du marché et du progrès à lutter effectivement contre la dégradation du climat, les inégalités, la pauvreté et la faim, mais par ailleurs, ils craignent de rompre avec les dogmes du marché libre et de l’identité nationale.
De par le monde, des dirigeants autoritaires ont su exploiter les nombreux échecs du système marché/État pour promouvoir diverses formes de nationalisme. Au-delà de la diversité des situations, elles-mêmes toujours complexes, ce phénomène politique est en grande partie alimenté par une quête de sens et d’appartenance que le couple marché/État est incapable de satisfaire. La gauche et le centre politiques, quant à eux, continuent à placer leurs espoirs de changement dans des outils conventionnels : nouvelles lois et politiques publiques, programmes et réformes procédurales. Ces démarches peuvent être importantes, mais elles sont généralement mises en œuvre dans des lieux officiels distants (tribunaux, assemblées législatives, agences gouvernementales) et ne parviennent pas à impliquer les gens à un niveau personnel. En fin de compte, de nombreux progressistes et sociaux-démocrates restent attachés au récit dominant du progrès, et la possibilité d’une autonomisation ou d’une transformation sociale depuis la base ne les intéresse pas vraiment. En conséquence, les initiatives fondées sur les communs comme l’agroécologie, les fiducies foncières communautaires, les plateformes coopératives et la production cosmolocale restent généralement ignorées ou considérées comme trop petites et trop marginales pour être prises au sérieux. Quant aux grandes entreprises, elles les considèrent surtout comme une menace pour leurs parts de marché et leurs profits.
C’est pour cette raison que la classe politique dominante laisse la politique du local et du vernaculaire entre les mains des courants autoritaires de droite. Elle se focalise plutôt sur l’État lointain, le partage du pouvoir et les formes habituelles de la loi et de la politique – et non pas sur les moyens par lesquels les gens ordinaires peuvent trouver un sens et du lien social dans ce qu’ils font. Selon l’anthropologue David Graeber, le problème de la gauche est qu’elle n’a pas d’alternative crédible à la bureaucratie45. Il a raison, et c’est pourquoi il faut s’occuper plus sérieusement de donner aux gens les moyens de répondre plus directement à leurs besoins d’une manière qui engage leur sentiment d’identité locale (sans créer des tribus de bienpensants pleins de ressentiment). Les communs peuvent relever ce défi de façon constructive et démocratique – une raison impérieuse qui devrait pousser les dirigeants politiques à les soutenir. Un véritable soutien de l’État aux communs impliquerait de faire passer les modestes programmes existants à une échelle totalement nouvelle. Il s’agit de dépasser une logique de contrôle bureaucratique pour aller vers une délégation pure et simple d’autorité aux commoneurs.
Dans le même temps, un simple transfert d’autorité légale ne suffira pas. Le soutien de l’État aux communs exigera de nombreuses formes nouvelles de coordination administrative, de soutien juridique, de développement d’infrastructures et d’éducation publique. Quatre formes générales de soutien sont nécessaires.
Catalyser et propager
Imaginez une ville où les supermarchés seraient gérés comme des coopératives où les habitants acheteraient des aliments locaux de meilleure qualité, produits dans des conditions équitables et écoresponsables. Le service de taxi local et les hébergements touristiques seraient gérés par des plateformes coopératives dont les ménages et la communauté partageraient les bénéfices. Les services de soins infirmiers seraient gérés par une entreprise de soins à domicile de quartier comme Buurtzorg (chapitre 1). L’électricité produite par les panneaux solaires installés sur les toits serait mise en commun et partagée grâce à un logiciel fondé sur une technologie de registre distribué46, ce qui permettrait au public de réduire ses factures d’électricité élevées tout en se désengageant des énergies fossiles et du nucléaire. L’État à tous les niveaux fournirait des infrastructures, des conseils techniques et des financements pour aider les gens à lancer leurs propres « Makerspaces » ou ateliers collaboratifs, AMAP, coopératives d’énergie, communs de partage d’outils, Repair cafés et banques de temps47. (Voir image 45 : Catalyser et propager, téléchargeable sur www.eclm.fr)
Cette description peut sembler ridiculement utopique, mais c’est uniquement parce que l’État est déjà profondément engagé, de manière souvent invisible, dans un soutien massif au système du marché. À rebours de ses postures idéologiques, le système du marché dépend en réalité d’innombrables dépenses et interventions de la part de l’État : subventions accordées à des industries entières, allégements fiscaux ciblés, privilèges juridiques, financement de la recherche, réglementation pour renforcer la confiance des consommateurs, traités commerciaux pour faciliter les exportations, soutien militaire au besoin pour protéger les actifs des entreprises à l’étranger, et bien d’autres encore. Afin de stimuler l’activité des marchés et la croissance, l’État utilise au quotidien ses pouvoirs conventionnels pour construire et financer des infrastructures, créer et superviser des systèmes de financement, établir des corps de loi visant à favoriser le commerce.
Pourtant, les bénéfices de ce modèle de développement économique vont principalement à une petite classe d’investisseurs et d’entreprises, et non aux contribuables et aux gens ordinaires, sauf par effet de ruissellement. Au vu des coûts et des inégalités énormes générés par ce modèle – et au vu de ses rendements décroissants –, les gestionnaires du pouvoir d’État, ou du moins les plus clairvoyants d’entre eux, pourraient trouver un véritable attrait aux communs. Les communs leur permettraient de tirer parti des passions et de l’imagination d’innombrables personnes tout en satisfaisant leurs besoins de manière plus équitable, plus efficace et moins coûteuse. Pourquoi la capacité de l’État à construire des infrastructures, à établir des systèmes de financement et à rédiger de nouveaux textes de loi – capacité aujourd’hui principalement utilisée pour soutenir les marchés – ne pourrait-elle pas être déployée de manière analogue pour soutenir les communs ? On pourrait utiliser la loi pour encourager les licences libres et ouvertes, les droits de propriété relationnels en matière foncière, les régimes d’accréditation pour les communs, le financement coopératif et les programmes d’assistance technique. Bref, les institutions étatiques pourraient jouer un rôle déterminant pour catalyser et propager les communs.
Des fonctionnaires des communs ?
Imaginez qu’un commun obligé de traiter avec diverses administrations municipales puisse se tourner vers un guichet unique plutôt que de devoir s’adresser à de multiples agences publiques ! Pour beaucoup de porteurs de projets, ce serait comme gagner à la loterie. Les personnes recevant les commoneurs devraient être très bien informées afin de les aider à trouver leur chemin dans le maquis de règles et de dispositifs auxquels ils sont confrontés. Ces personnes devraient également être habilitées à agir de manière indépendante, par exemple en tant que branche opérationnelle du bureau du maire, et avoir les compétences nécessaires pour accorder des permis et des financements.
Amsterdam a fait un pas dans cette direction avec ses agents de liaison locaux connus sous le nom de gebieds-makelaars. Ces « courtiers locaux » entretiennent des relations continues avec les groupes de citoyens et partagent avec eux savoirs et informations sur les organismes publics. Cependant, ils ne jouissent pas d’un statut indépendant au sein de la bureaucratie municipale, ni du pouvoir et du personnel qui en feraient de véritables centres de ressources pour les communs 48.
Rendre les communs plus visibles dans l’espace public et développer un récit plus convaincant sur la coopération et le partage représente un défi énorme, qui est en grande partie culturel. Des institutions soutenues par l’État pourraient servir de centres de ressources pour apporter des conseils techniques, juridiques et financiers sur la Gouvernance par les pairs et l’approvisionnement fondés sur les communs dans divers secteurs (agriculture, services sociaux, énergie, monnaies alternatives, etc.) Un bureau national pour les banques de temps pourrait considérablement développer ce système social qui permet de répondre concrètement aux besoins des gens. Le gouvernement pourrait apporter un soutien inestimable à la mise en place d’AMAP, à l’acquisition de terrains pour l’habitat participatif, au financement de services de proximité, à la fourniture de conseils techniques pour le lancement de Fab Labs et au développement d’innovations peu connues en marge de la société.
Établir des communs à l’échelle macro
L’une des raisons qui rend les institutions étatiques si indispensables à la promotion des communs est l’ampleur de leur capacité de coordination en vue de la gestion de ressources à grande échelle. Les forêts, les voies navigables, les pâturages et les gisements minéraux souterrains enjambent souvent les écosystèmes et traversent les frontières politiques. Une coordination juridique et administrative à grande échelle est donc requise pour parvenir à concilier les multiples revendications sur un paysage ou une ressource donnés et à définir et délimiter de manière adéquate les différents communs. Un projet néerlandais appelé King of the Meadows en fournit un bon exemple49. Plusieurs personnes s’alarmaient de la disparition de la barge à queue noire, une espèce d’oiseau autrefois commune, du fait des pratiques agricoles qui avient anéanti son habitat de prairie. Le projet King of the Meadows a réuni des citoyens, des agriculteurs, des musiciens, des artistes, des scientifiques, des producteurs laitiers et d’autres acteurs pour reconnecter les gens au paysage et promouvoir une « agriculture respectueuse de la nature » afin de contribuer à la restauration des populations de barges à queue noire et de célébrer le lien entre la diversité biologique et culturelle. L’initiative a donné naissance à une dynamique collaborative en réseau bien établie dans la région. (Voir image 46 : Établir des communs à l’échelle macro, téléchargeable sur www.eclm.fr)
Dans les cas comme celui-ci, le pouvoir d’État peut s’avérer utile en fournissant des « macro-plateformes » pour faciliter des actions qui dépassent les capacités des communs individuels. Les agents de l’État ont un rôle évident d’arbitres impartiaux entre les parties prenantes dans la résolution des conflits et dans les négociations transfrontalières. Bien sûr, l’alchimie politique qui leur permet d’exercer leur fonction efficacement dépend de nombreux facteurs circonstanciels. Mais l’État peut jouer un rôle important – cette option ne doit pas être écartée. Le soutien manifeste du public peut encourager l’État à s’engager dans de nouvelles approches de ce type.
Dans les années 1990, à la suite d’une longue controverse sur la gestion de la forêt nationale de Siuslaw dans l’Oregon, l’US Forest Service a décidé de renoncer aux processus bureaucratiques habituels, dictés par les dynamiques politiques au sein du Congrès et par le lobbying de l’industrie. Au lieu de cela, il a invité toutes les personnes intéressées par la forêt à participer à des tables rondes ouvertes pour discuter de la manière dont pourraient être conciliés les intérêts divergents des entreprises forestières, des écologistes, des pêcheurs de loisirs, des communautés locales, des randonneurs et autres. L’agence a créé un conseil de bassin-versant qui a aidé les parties en conflit à surmonter leur méfiance mutuelle et à trouver des solutions consensuelles durables aux conflits juridictionnels (par exemple, le saumon fraye dans une certaine zone du bassin-versant et nage ensuite sur des centaines de kilomètres jusqu’à l’océan). La médiation de l’État a également encouragé les gens à envisager des plans flexibles sur le long terme qui n’auraient jamais pu voir le jour si l’on s’en était remis à la bureaucratie et aux contentieux juridiques50.
Un nombre remarquable de mécanismes juridiques innovants ont été inventés ces dernières années pour protéger la pratique des communs. Le gouvernement néo-zélandais a accordé la personnalité juridique au fleuve Whanganui, comme le souhaitaient les Maoris, en le reconnaissant comme « un tout vivant et organique […] des montagnes à la mer, incorporant tous ses éléments physiques et métaphysiques51 ». La législation étatique autorise officiellement l’iwi (peuple) Whanganui, en tant que gardien du fleuve, à poursuivre ses anciennes pratiques de commoning. Au Pérou, le peuple quechua a créé une aire de patrimoine bioculturel autochtone, ou Parc de la pomme de terre, afin de protéger la biodiversité des pommes de terre qu’il cultive52. Grâce à cette entité juridique reconnue par les tribunaux péruviens, les Quechuas sont davantage assurés de pouvoir continuer à vivre dans une relation réciproque intime avec la terre, les uns avec les autres et avec le monde des esprits. Plus particulièrement, ces garanties juridiques les aident à protéger leurs communs contre les tentatives de biopiraterie, lorsque des entreprises de biotechnologie essaient de breveter les informations génétiques de variétés rares de pommes de terre.
Fournir des infrastructures pour les communs
Les États ont une capacité unique à aider des entreprises disparates à se développer plus rapidement en construisant des infrastructures et en exigeant des normes techniques favorables à l’interopérabilité et à la sécurité. Des infrastructures conçues dans l’optique de la pratique des communs – ou, mieux encore, conçues pour être gérées par les commoneurs eux-mêmes – permettent aux gens de lancer plus facilement et à moindre coût leurs propres systèmes auto-organisés. L’exemple classique est le développement par le gouvernement américain de protocoles techniques connus sous le nom de TCP/IP, qui permettent à divers réseaux informatiques de s’interconnecter pour former un Internet unique et intégré. L’État pourrait jouer un rôle similaire aujourd’hui en reconnaissant les normes techniques ouvertes qui limitent le contrôle propriétaire, tout en prenant les mesures nécessaires pour s’assurer que les entreprises les plus grandes et les plus riches n’utilisent pas simplement les normes ouvertes pour accaparer l’espace d’innovation. Nous avons besoin de communs ouverts mais protégés pour garantir l’interopérabilité et un accès non discriminatoire (comme en matière de neutralité des plateformes). (Voir image 47 : Fournir des infrastructures pour les communs, téléchargeable sur www.eclm.fr)
Des normes techniques ouvertes pour les marchés publics pourraient être édictées afin que les logiciels libres et open source deviennent l’infrastructure par défaut pour les institutions publiques, et notamment les écoles. Au lieu d’être familiarisés avec les logiciels propriétaires, les étudiants sortiraient de l’école avec des compétences solides en matière d’utilisation de GNU/Linux et d’autres logiciels libres. Les écoles n’auraient plus à jouer le rôle déshonorant de clientèles quasi captives des départements marketing des grandes entreprises de logiciel. Il en découlerait de nombreuses retombées positives pour l’enseignement général, l’enseignement supérieur, les administrations municipales et le grand public. Des protocoles approuvés par l’État pour les logiciels de traitement de texte, de base de données et de courrier électronique, ainsi que pour les API (interfaces de protocole d’application, qui sont les liens techniques entre les logiciels et les systèmes d’exploitation), pourraient favoriser une innovation plus vaste et plus libre qui ne serait plus enfermée dans les jardins clos d’Apple et Google. Les villes pourraient plus facilement développer des plateformes coopératives pour le logement, les services de covoiturage et d’information, dont les bénéfices iraient aux habitants plutôt qu’aux investisseurs de la Silicon Valley. Des protocoles de conception ouverts pour les réseaux d’énergie pourraient répliquer le succès de l’Internet, en encourageant l’innovation depuis la base par des acteurs plus petits et plus créatifs, et empêcher le verrouillage propriétaire d’une poignée de grandes multinationales.
L’intérêt d’un soutien étatique aux infrastructures fondées sur les communs est de neutraliser les concentrations privées de pouvoir et de transférer ce pouvoir aux commoneurs. S’agissant d’infrastructures utilisées par la société dans son ensemble, il est essentiel qu’elles soient exemptes de toute forme de discrimination afin qu’aucune catégorie d’utilisateurs ne puisse être arbitrairement privée d’accès53. C’est l’une des raisons pour lesquelles les instituts nationaux de santé des États-Unis requièrent désormais des protocoles de publication en libre accès pour les recherches financées par les contribuables ; cela garantit que les fonds publics sont utilisés de manière ouverte et responsable54. Le principe directeur est simple : tout ce qui a été financé par le public doit rester entre les mains du public.
Les investissements directs dans les infrastructures pour soutenir la pratique des communs sont clairement une option attrayante. Les collectivités locales peuvent directement installer un réseau Wi-Fi sur les places publiques, comme l’ont fait de nombreuses villes dans le monde telles que Tel-Aviv ou Mexico. D’autres fournissent même un espace serveur gratuit pour les sites web, le courrier électronique et les données. C’est ce qu’a fait la ville de Linz en Autriche à travers son initiative Open Commons Linz55. Les États peuvent également soutenir des initiatives fondées sur les communs comme Freifunk, un réseau de commoneurs allemands qui a construit un réseau Wi-Fi gratuit englobant environ 400 communautés locales et plus de 41 000 points d’accès56.
Créer de nouveaux modes de financement pour les communs
Les organismes d’État pourraient apporter un soutien crucial à la pratique des communs dans toute sa diversité en mettant en place des systèmes de financement favorables. Quand bien même la plupart des communs sont des systèmes d’approvisionnement non marchands, ils opèrent dans un monde plus vaste de capitalisme de marché. Ils ont souvent besoin de crédit pour construire leurs propres installations et infrastructures, payer leur personnel et acheter des biens et des services. Mais contrairement aux entreprises ou aux organisations à but non lucratif, les communs cherchent à éviter le type d’endettement qui les aspirerait dans la spirale de la concurrence, de la croissance et de la subordination aux banques. Ils préfèrent rejeter les aides financières assorties de conditions qui outrepassent le cadre et la mission des communs, car l’endettement signifie une perte de liberté. Les communs refusent également les mécanismes de financement qui permettent à des acteurs privés de s’approprier la valeur créée (par exemple, par le biais d’une participation au capital qui donnerait aux investisseurs ou aux banques le droit de prélever des bénéfices ou de contrôler les actifs partagés). Ici aussi, c’est la même logique que pour le secteur public qui doit s’appliquer : ce qui a été créé dans le commun doit rester dans le commun. (Voir image 48 : Créer de nouveaux modes de financement pour les communs, téléchargeable sur www.eclm.fr)
Il s’agit encore pour l’instant d’un domaine d’expérimentation et d’innovation. Il existe des formes progressistes de crédit bien connues, comme les banques publiques, les banques coopératives, le financement du développement communautaire ou les banques sociales et éthiques, qui soutiennent des entreprises sociales tout à fait honorables. Cependant, la plupart de ces systèmes de financement visent à offrir des conditions de crédit moins contraignantes (taux d’intérêt plus bas, approbation plus facile, etc.) pour des entreprises appelées à participer au marché. Ils ne cherchent pas à échapper au champ de force des marchés et du crédit conventionnel lui-même (concurrence, profit, croissance), ni à soutenir les communs en tant que communs.
Pourquoi ne pas établir des formes de crédit qui permettraient aux communs d’opérer selon leurs propres termes, et non comme une catégorie subordonnée d’acteurs à dimension éthique dans le grand système du marché ? Et à quoi cela pourrait-il ressembler ? Les obstacles administratifs à l’accès au crédit devraient être réduits au minimum, en commençant par l’instauration d’une approche non concurrentielle de l’octroi des fonds. L’octroi de fonds publics et de crédits privés ne doit pas seulement consister à vérifier des indicateurs financiers. Cela devrait prendre la forme d’une conversation ouverte, fondée sur la confiance, conçue comme un processus d’apprentissage pour tous les acteurs impliqués, et non pas d’un rituel lugubre où des candidats dans le besoin supplient un comité d’examen impérieux de les approuver ou s’efforcent de satisfaire des critères vides de sens et des indicateurs superficiels de « succès ».
Il y a même une meilleure option encore : les commoneurs euxmêmes pourraient être la source du crédit – autrement dit, se prêter les uns aux autres ou prêter au collectif – comme dans les anciennes sociétés de crédit mutuel du xixe siècle. Le contrôle du remboursement des fonds pourrait être effectué par les commoneurs euxmêmes, sur le modèle des systèmes de microcrédit, mais sans avoir à verser des intérêts onéreux à des sources extérieures de capital. Bien sûr, dans tous les systèmes de ce type, il doit y avoir des outils internes efficaces de contrôle et de transparence.
Ces formes d’autofinancement et de mutualisation proactive sont d’autant plus prometteuses qu’elles donnent aux commoneurs une plus grande indépendance à long terme vis-à-vis du couple marché/État. Nous en avons vu un exemple avec la manière dont les membres du Mietshäuser Syndikat mettent en commun des fonds qui sont ensuite utilisés pour acheter des logements locatifs supplémentaires. Une autre illustration est l’initiative Médicaments contre les maladies négligées, dans le cadre de laquelle des gouvernements donateurs et des organisations internationales financent conjointement la recherche fondamentale et le développement de nouveaux médicaments pour soigner les maladies négligées (pour en savoir plus sur cette initiative, voir le chapitre 10).
COMMUNS ET SUBSIDIARITÉ
Pour faire avancer ce type d’initiatives, il est essentiel de se doter d’un soutien politique et de veiller à ce que le pouvoir d’État ne submerge pas ou ne dénature pas les communs par ses interventions. C’est un défi délicat. Une certaine forme d’implication de l’État dans les communs est inévitable, ne serait-ce que pour les décriminaliser et assurer leur stabilité juridique. Cependant, l’implication active de l’État peut entraîner toute une série de dilemmes politiques complexes. La frontière est mince entre la facilitation et l’ingérence.
Pour cette raison, il est important que le rôle de l’État soit à la fois minimal et général. Cela permettra aux commoneurs d’avoir un maximum d’autonomie et d’autorité pour concevoir leurs propres règles et leur propre gouvernance, conformément au principe de subsidiarité. Ce principe est largement mentionné dans les travaux d’Ostrom, dans la pensée sociale catholique et même dans le traité de Lisbonne, fondement constitutionnel de l’Union européenne. Dans les faits, pourtant, la subsidiarité est plus souvent célébrée que pratiquée. Dans la plupart des cas, la gouvernance par l’argent et la gestion hiérarchique finissent par prendre le pas sur l’autonomie locale. L’histoire décevante de la subsidiarité, grande aspiration rarement traduite dans la réalité, nous incite à conclure qu’il ne peut y avoir de véritable subsidiarité sans communs ! Les deux ont la même portée, les mêmes limites ; ils sont coextensifs parce que la pratique des communs est par nature une forme de gouvernance distribuée et d’approvisionnement indépendant de sources extérieures de pouvoir. On ne peut pas en dire autant des échelons hiérarchiques traditionnels de gouvernement (fédéral, provincial ou étatique, et local).
Si nous la prenons véritablement au sérieux, la subsidiarité implique que les commoneurs disposent d’une autorité juridique et d’un espace protégé pour élaborer leurs propres règles, en cohérence avec les principes généraux d’un État. Il en découle que les commoneurs s’organisent d’abord eux-mêmes, puis se fédèrent au niveau méso (les espaces entre les communs individuels) pour se soutenir mutuellement dans la construction de leurs communs, malgré la menace du pouvoir étatique et de ses ingérences. C’est ainsi qu’ils pourront devenir une force politique capable de défendre une véritable subsidiarité. Si un tel programme ne peut être perçu au départ que comme politiquement marqué, parce qu’il remet en cause le statu quo, l’objectif est qu’avec le temps les pratiques des communs deviennent éminemment normales.
QUID DES DROITS FONDAMENTAUX GARANTIS PAR L’ÉTAT ?
Parler de droits, c’est considérer le pouvoir d’État comme le garant ultime de ces droits. Alors que la sanctuarisation des droits humains, de l’état de droit et des droits civils représente un énorme progrès dans l’histoire de l’humanité, la manière dont ces droits sont effectivement appliqués, et donc leur réalité vécue, reste une question plus compliquée.
Si les juristes ont dû concevoir une deuxième génération de droits humains (accès à la nourriture, au logement, aux soins et à l’éducation)57, puis une troisième génération (droit à un environnement sain, droit de jouir de son patrimoine culturel et équité intergénérationnelle)58, c’était pour pousser les États et les organismes internationaux à respecter effectivement ces idéaux. Si admirable qu’elle soit, cette approche élude la question de savoir si les bureaucraties étatiques sont structurellement capables de satisfaire ces droits, non seulement formellement dans un cas donné, mais aussi en tant que réalité sociale globale. Il n’est pas rare que le droit soit utilisé comme vecteur d’aspirations et pour sa valeur d’emblème, de la même manière que les Objectifs de développement durable des Nations unies et l’accord de Paris sur le climat fixent certains objectifs à appliquer au niveau national. Toutefois, compte tenu de la capacité et de l’intérêt limités des États à se transformer eux-mêmes, il ne faut pas trop de se fier à l’efficacité des traités ou des législations nationales. Ces textes peuvent n’être que des gestes symboliques vides, leur application effective peut se révéler problématique et, dans la pratique, les industriels et les investisseurs savent généralement s’organiser pour disposer d’un droit de veto.
Les commoneurs ne parlent généralement pas de « droits » parce que les droits dépendent d’une institution externe qui les garantit. Les droits impliquent un ordre politique et social aliéné, celui d’un moiisolé adressant une revendication à un Léviathan distant et puissant. Et pourtant, en assurant l’accès aux moyens de subsistance de base, de nombreux communs accomplissent sans doute bien davantage que les objectifs nobles formellement adoptés par les États et entérinés par des textes juridiques59. Les droits fondamentaux n’offrent pas vraiment à chaque individu des moyens de subsistance, alors que la plupart des communs considèrent précisément la subsistance comme leur principale priorité. En outre, il est évident que de nombreux communs traditionnels dans les zones rurales d’Inde ou d’Asie n’adhèrent pas à une vision du monde fondée sur les droits individuels, n’aspirent pas à l’équité de genre ou ethnique et ne s’intéressent même pas à l’autorité juridictionnelle de l’État libéral moderne. Bref, il y a un conflit non résolu de visions du monde et de systèmes de gouvernance entre les communs et l’État moderne. Il n’est pas dans nos capacités ici de prescrire une grande réconciliation de ces différentes approches philosophiques. Il suffit de dire que l’État conserve pour l’instant l’avantage, ne serait-ce qu’en raison de son pouvoir coercitif.
Pourtant, comme le découvrent aujourd’hui de nombreux États, il existe bien des moyens juridiques opératoires qui permettent de combiner la souveraineté de l’État avec la souveraineté des communs. Certains États intègrent (du moins en partie) les revendications des peuples indigènes – les Maoris, les Premières Nations du Canada, les Amérindiens. D’autres reconnaissent le pouvoir des communautés open source et des réseaux sociaux. D’autres encore, comme l’Inde ou certains États africains, reconnaissent les bénéfices écologiques et sociaux des communs traditionnels de subsistance. De nombreuses possibilités existent ; beaucoup n’ont tout simplement pas encore été activement explorées.
* * *
Nous avons désormais une idée beaucoup plus claire de la relation entre le pouvoir d’État et les communs. Nous avons aussi une meilleure idée des possibilités qui s’offrent aux institutions étatiques pour renforcer les communs. Des opportunités peuvent survenir de manière fortuite, à travers les aléas de la vie culturelle, lorsqu’une initiative singulière libère parmi les gens de nouvelles énergies de changement.
Bien qu’il ne puisse évidemment pas y avoir de stratégie directrice globale unique pour gagner le soutien de l’État à la pratique des communs, il existe des moyens très prometteurs pour les commoneurs de renforcer leurs capacités et leur pouvoir et, ce faisant, de devenir des forces qui comptent dans l’économie politique générale. Le chapitre 10 en explore quelques-uns.
X. Faire Passer La Pratique Des Communs À Une Nouvelle Échelle
Les communs sont généralement associés à l’idée d’approvisionnement et de gouvernance à petite échelle, et les sceptiques s’interrogent souvent sur la possibilité qu’ils puissent aussi fonctionner à de plus grandes échelles et engager ainsi des transformations au niveau de toute la société. C’est la question que nous examinons dans ce chapitre. L’impression qui prévaut est que les communs ne peuvent pas jouer de rôle significatif dans la lutte contre la dégradation du climat, les problèmes écologiques, la crise de l’énergie, la pauvreté, les inégalités et d’innombrables autres problèmes, car ils sont trop petits. Selon cette vision des choses, des problèmes mondiaux massifs requièrent des solutions massives, et c’est donc aux États-nations de trouver des solutions. Dans cette logique, les communs ont très peu à offrir.
En réalité, ce raisonnement fait partie du problème, car il ne tient pas compte du fait que toutes sortes de solutions, grandes ou petites, peuvent échouer précisément parce que leurs fondements sont fragiles. Un bâtiment dont les fondations ne sont pas adaptées à la taille finira par s’écrouler. Une société fondée sur une liberté individuelle sans entrave ne devrait pas s’étonner que ses membres finissent par surexploiter la Terre et détruire les normes sociales qui lui sont indispensables. La vérité est que parfois les grands systèmes ne peuvent pas être réparés à leur propre échelle ; pour les réparer, il faut parfois revoir et réinventer les plus petits éléments et sous-ensembles de ce système. Telle est notre théorie du changement social et politique dès lors qu’il s’agit d’aborder les pathologies du marché et de l’État modernes.
Certes, de nombreuses réformes peuvent être tentées à l’échelle du système. C’est en substance l’approche adoptée par la plupart des sociaux-démocrates et des progressistes. Ils se concentrent sur la création de nouvelles institutions comme les coopératives, les sociétés à mission, les fiducies foncières et les banques publiques, ou bien encore sur l’élaboration de programmes originaux tels que le revenu de base universel, les réglementations environnementales et les systèmes de redistribution des revenus. Ces réformes peuvent ou non conduire à une transformation plus large – tel est précisément notre propos. Nous voulons suggérer que la pratique des communs peut avoir une portée transformatrice positive et durable tant que l’on protège son intégrité structurelle et culturelle à mesure qu’ils se développent.
Trop souvent, des initiatives progressistes ont été captées ou cooptées par des investisseurs et des entreprises, entre autres forces, les empêchant de générer un changement systémique. On a vu, par exemple, comment le site web Couchsurfing, fondé sur une économie de don d’hébergement pour les voyageurs, s’est transformé, en quelques années, de communauté d’hospitalité en service commercial de voyage. Ses gestionnaires ont considéré que le site avait besoin de plus de fonds pour se développer et ont donc accepté un financement par capital-risque et les changements de priorités que cela induit. De même, nous avons vu comment la Silicon Valley a coopté des plateformes web dédiés au partage et à la collaboration, les transformant en marchés lucratifs de microlocation (pour l’hébergement, le transport et le travail à la pièce, notamment). L’État lui-même, en collaboration avec des industries influentes, a souvent rendu plus difficile le développement de systèmes respectueux des communs. C’est ce qui s’est passé, par exemple, pour l’agriculture biologique, les logiciels libres et l’édition savante en libre accès.
L’avenir exige que nous rompions avec ces logiques de cooptation et de résistance. Les communs doivent avoir les moyens de se développer, individuellement et en tant que fédérations, selon leurs propres termes, et de s’épanouir même au sein de l’économie dominante. Pour cela, ils doivent disposer d’une culture et d’une gouvernance internes robustes, capables de fonctionner comme un système immunitaire sans faille pour les protéger des envahisseurs extérieurs (virus, bactéries et parasites au sens figuré). Imaginez que les communautés bénéficient du soutien de l’État pour relever ce défi – financement, assistance technique, sensibilisation du public et soutien politique. Imaginez que les communs bénéficient d’une reconnaissance juridique complète et de ressources financières pour leur travail.
Trois stratégies distinctes nous paraissent très prometteuses pour développer les communs en tant que forme sociale dans des sociétés conçues pour le marché/État. Il est crucial : premièrement, d’élaborer des chartes communautaires en tant qu’outils de constitution des communs; deuxièmement, de construire et d’utiliser des plateformes de coopération distribuée qui peuvent ouvrir de nouvelles possibilités remarquables de coopération sur les réseaux numériques ; troisièmement, de concevoir des partenariats publiccommuns qui mettent le pouvoir d’État au service des communs. Notre perspective de construction du Communivers par ces moyens est inévitablement théorique. De nombreuses approches sont encore relativement nouvelles, il n’existe donc pas d’expérience approfondie que l’on pourrait étudier pour tirer des enseignements. Néanmoins, nous pensons que les chartes des communs, les technologies distribuées et les partenariats public-communs offrent un fort potentiel pour aider les communs à prospérer malgré leur immersion dans la culture politique dominante.
CHARTES POUR LA PRATIQUE DES COMMUNS
La charte des communs est l’un des outils les plus puissants pour s’assembler dans la diversité autour d’objectifs partagés et constituer une communauté de commoneurs. Parfois connus sous le nom de chartes sociales ou communautaires, ces documents décrivent les objectifs, les pratiques et les principes fondateurs singuliers de leur communauté. En un sens, les chartes font fonction de Constitutions. Préparée à travers des discussions, des réflexions et des négociations prolongées, une charte formule des engagements fondamentaux. Elle sert de pierre angulaire au groupe lorsqu’il rencontre de nouvelles opportunités, de nouveaux choix ou, au contraire, des difficultés. Une charte est également une déclaration institutionnelle ambitieuse qui affirme comment les commoneurs souhaitent s’autogouverner et quel genre de culture ils veulent créer.
Les chartes ne doivent pas être des énoncés de mission flous à la rhétorique grandiose. Elles doivent être précises sur l’identité et sur les pratiques opérationnelles du collectif. La communauté de design ouvert WikiHouse (voir p. 34-35) déclare dans sa charte que ses participants partagent leurs designs à l’échelle mondiale et fabriquent à l’échelle locale, utilisent des normes ouvertes et une conception modulaire, et se donnent pour mission de concevoir l’ensemble du cycle de vie d’une maison, y compris la réalisation de réparation1. Le monde de la permaculture a adopté un ensemble de douze principes qui définissent à la fois une éthique et des principes de conception comme « ne produire aucun déchet », « favoriser des solutions lentes à petite échelle » et « utiliser et valoriser la diversité2 ». Les membres de l’organisation française Terre de Liens, qui acquiert des terres agricoles pour les préserver, s’engage à « démarchandiser la terre à perpétuité », à « favoriser le développement de l’agriculture de proximité » et à « encourager la collaboration autour de l’utilisation de la terre ainsi que la mise en commun d’outils, de financements et d’expériences3 ».
« Étant donné le caractère singulier de chaque commun, écrit James Quilligan, il n’existe pas de modèle universel de charte sociale, mais une base de référence est en train d’émerger. » Selon lui, une charte « devrait inclure, au minimum, un résumé des revendications de légitimité coutumières ou émergentes ; une déclaration des droits des usagers et des producteurs ; un code éthique ; la description de valeurs et de normes communes ; une déclaration des avantages ; une information sur les procédures de réparation ou de redéfinition des limites territoriales et des frontières ; et un cadre pratique de coopération ». Bien sûr, cette liste peut varier d’une charte à l’autre, ainsi que la nature des éléments (un code éthique doit-il formuler des valeurs ou des modèles opérationnels particuliers ?), mais le but d’une charte est d’aider les pairs à s’accorder et à faire face ensemble aux problèmes récurrents. La plupart des chartes indiquent que la Gouvernance par les pairs est une forme de participation démocratique et de prise de décision transparente pour la communauté concernée. Il y a souvent une tentative de garantir la décentralisation du pouvoir d’administration, ce qui aide la communauté à garantir son accès aux richesses partagées et sa souveraineté sur elles4.
La charte pour la création d’un commun des données, élaborée par un groupe de cartographes numériques des économies alternatives, conseille, entre autres, aux membres de son réseau de « réfléchir ensemble à leur ambition », de « séparer les communs du commerce », d’« intégrer l’interopérabilité dans la conception » et de « documenter [les processus de travail] de manière transparente5 ». On peut contester que les principes directeurs du rassemblement annuel Burning Man constituent une charte des communs, mais ses dix principes fonctionnent à peu près de la même manière. Les 60 000 participants qui se rendent dans le désert du Nevada chaque mois d’août définissent leur éthique et leur culture par un engagement en faveur de l’« inclusion radicale », du don, de la démarchandisation de la culture, de l’expression radicale de soi et de l’immédiateté de l’expérience comme valeurs fondamentales. Non seulement la charte clarifie l’identité de l’énorme communauté spontanée qu’est Burning Man, mais elle guide également le travail du réseau des « Burners » de la région de San Francisco tout au long de l’année.
Les commoneurs ne cherchent généralement pas à faire reconnaître leurs chartes par la puissance publique car, en vérité, la plupart des États n’offrent aucun moyen légal de le faire. (Un organisme à but non lucratif peut ressembler à un commun dans son fonctionnement réel et son éthique, tout en étant très différent sur le plan juridique et organisationnel.) Dans tous les cas, les commoneurs ne souhaitent généralement pas qu’il revienne à des tribunaux ou à des agences gouvernementales de faire respecter les termes d’une charte. Cela leur revient à eux. La charte fonctionne comme un pacte social. Son autorité découle de la déclaration explicite d’intention mutuelle des membres et de leur engagement continu à en respecter les termes. Son pouvoir vient de l’ampleur et de la profondeur du soutien qu’elle suscite dans les pratiques quotidiennes. Lorsque ces pratiques vernaculaires et ces loyautés sociales atteignent une intensité suffisante, elles donnent naissance à ce que James Quilligan appelle les « droits des communs » fondés sur le droit naturel :
Les droits des communs diffèrent des droits humains et des droits civils en ce qu’ils découlent non pas de la législation d’un État, mais d’une identification coutumière ou émergente avec une écologie, une zone de ressources culturelles, un besoin social ou une forme de travail collectif… Les chartes des communs génèrent un contexte entièrement nouveau pour l’action collective. Au lieu de chercher à obtenir des droits individuels et humains octroyés par l’État, les gens peuvent revendiquer une autorité à long terme sur des ressources, leur gouvernance et la reconnaissance de la valeur sociale comme un droit de naissance universel – que ce soit au niveau communautaire ou mondial6.
Les droits des communs peuvent indirectement remettre en question la souveraineté de l’État et le « droit divin du capital », selon les termes de Marjorie Kelly, et donc être considérés comme politiquement controversés. Lorsque les gens se mobilisent pour prendre la responsabilité directe d’un lopin de terre, d’une rivière ou d’espaces urbains, cela ne manque pas d’agacer les autorités publiques et les entreprises. Ainsi, même si une charte est un outil important d’auto-organisation consciente, elle peut s’avérer tout aussi utile pour attirer l’attention d’organes gouvernementaux peu réactifs et les forcer à entamer un dialogue politique plus sérieux.
Dans cet esprit, les commoneurs adoptent des chartes afin d’agir sur des problèmes que le marché ou l’État ignorent, comme le note la militante écossaise Isabel Carlisle. Un certain nombre de mouvements – notamment ceux qui luttent contre l’exploitation minière et le gaz de schiste – utilisent les chartes comme point de référence pour leur action politique. C’est le cas du Community Chartering Network de Carlisle au Royaume-Uni, de Lock the Gate en Australie, de la Community Bill of Rights aux États-Unis, du réseau mondial paysan La Via Campesina et du mouvement des Villes en transition. Les mouvements de chartes des communs tentent généralement de s’inscrire dans une vision positive de long terme. Carlisle écrit :
Ce qui manque aux communautés, c’est un moyen de s’accorder autour d’une vision fondée sur les droits de ce qu’elles veulent [en termes de] systèmes agricoles durables, de systèmes énergétiques durables, d’économies durables, de protection réelle de l’environnement et d’amélioration de la santé, de la sécurité et du bien-être de la communauté. Les gens sur le terrain sont toujours les mieux placés pour comprendre ce qui est bénéfique pour leur économie et leur écologie locales7.
Lorsque, en 2013, les intérêts pétroliers ont ciblé Falkirk et les villes environnantes, en Écosse, pour extraire le méthane des gisements de charbon (par un procédé similaire à la fracturation hydraulique), les habitants de la région se sont réunis pour élaborer la première charte communautaire. Le document stipule : « Nous déclarons que notre patrimoine culturel est la somme totale des ressources locales tangibles et intangibles dont nous avons collectivement convenu qu’elles sont fondamentales pour la santé et le bien-être de nos générations actuelles et futures8. » Les gens y font référence à un environnement sain, à la sécurité alimentaire et à ce qu’ils appellent une « économie saine » comme priorités clés pour leur communauté. La charte de Falkirk a contribué à convaincre le gouvernement écossais de déclarer un moratoire sur les forages de gaz non conventionnel. D’autres communautés britanniques – Glasgow, Édimbourg, la paroisse de Dartington dans le Devon, St Ives en Cornouailles – ont également élaboré des chartes en vue d’organiser un véritable dialogue communautaire, de mobiliser les citoyens et de formuler une vision d’autodétermination locale.
Mais les municipalités ne seraient-elles pas les plus indiquées pour établir des chartes communautaires ? N’est-ce pas là, après tout, le rôle d’une collectivité locale ? En théorie, oui. Cependant, même si les administrations municipales sont plus petites et plus proches de leurs citoyens que, par exemple, les gouvernements régionaux ou nationaux, elles aussi sont sujettes aux écueils de la centralisation administrative et des comportements politiciens. Les chartes communautaires introduisent une énergie sociale indépendante, venue « de la rue », qui peut favoriser une prise de décision distribuée. Les initiatives se développent selon leurs propres termes, avec un engagement et un leadership populaire bien établis – c’està-dire comme des communs.
On peut observer quelques expériences intéressantes d’utilisation des chartes pour redynamiser la gouvernance municipale. Après avoir contribué à l’élection d’une maire activiste en mai 2015, l’organisation Barcelona en Comú (Barcelone en commun) a réalisé une série de documents proposant une vision nouvelle de la politique, de la gouvernance et de l’éthique municipales. Bien qu’il ne s’agisse pas formellement d’une charte, les quatre documents – un code d’éthique, un « plan d’urgence » (pour garantir les droits sociaux fondamentaux), un programme administratif et un processus de participation des citoyens9 – manifestent l’ambition de « faire de la politique autrement ». Ces documents ont été conçus pour avoir un impact similaire à celui des chartes communautaires : ouvrir un nouvel espace pour une « coproduction de la politique » entre participants – dans ce cas, entre le gouvernement de la ville et les habitants.
Un certain nombre de grands organismes gouvernementaux ont développé ce qu’ils appellent des chartes sociales. Des blocs régionaux tels que l’Union européenne, l’Association sud-asiatique pour la coopération régionale et l’Association des nations d’Asie du SudEst ont effectivement élaboré de telles chartes au nom des citoyens des pays membres. Cependant, comme le note James Quilligan, ce type de chartes pose plusieurs problèmes :
[Les chartes nationales ou régionales] sont généralement générées par des groupements gouvernementaux sur la base d’une consultation d’un échantillon restreint de groupes d’intérêt. Les chartes sociales élaborées par des États tendent à retirer le pouvoir à ceux qui utilisent et gèrent les communs à l’échelle locale. Les chartes rédigées par l’État placent le gouvernement au centre et fonctionnent davantage comme un mécanisme de recours ou une procédure de contrôle de qualité que comme un moyen d’honorer les droits des personnes sur leurs communs10.
La rédaction de chartes par l’État signifie également que le système judiciaire devient le lieu privilégié de résolution des conflits concernant les communs – et donc que les juges et les experts juridiques de l’État ont une autorité supérieure à celle des commoneurs.
LES REGISTRES DISTRIBUÉS COMME PLATEFORMES POUR LA PRATIQUE DES COMMUNS
Dans l’histoire récente, ce sont fréquemment des amateurs et des bricoleurs qui ont été les premiers à développer de nouvelles technologies de l’information. Une fois leur potentiel démontré, les grandes entreprises sont intervenues et ont pris le contrôle de ces systèmes pour les transformer en sources de profit sur le marché. Le juriste Tim Wu a appelé cela le « cycle »11. Des visionnaires passionnés tentent de contribuer à une vague d’émancipation sociale par le biais d’une nouvelle technologie – la radio, la télévision, la télévision par câble, le web, les logiciels libres, la blogosphère, le Wi-Fi, les wikis –, mais chaque fois ou presque, les capitalistes réussissent à domestiquer la technologie en question pour la mettre au service de leurs intérêts commerciaux. Cette technologie est remaniée de façon que les entreprises puissent attirer et retenir un large public, la monétiser via la publicité ou l’exploitation des données, puis verrouiller le flux de bénéfices. Selon Wu, les entreprises conservent le « contrôle exclusif de l’interrupteur principal12 ». À notre époque, cela signifie qu’une poignée d’entreprises Léviathans – Google, Facebook, YouTube, Twitter, Amazon – utilisent leurs plateformes commerciales centralisées pour manipuler les informations, favoriser la diffusion de mensonges et de désinformation, injecter de force davantage de publicité dans la sphère publique et nous rendre plus vulnérables au vol d’identité.
Nous sommes aujourd’hui à l’aube d’une nouvelle itération du « cycle », centrée cette fois sur un puissant logiciel de mise en réseau connu sous le nom de blockchain. La blockchain et le bitcoin sont étroitement associés, voire confondus, dans l’esprit du public. Pourtant, la blockchain n’est en fait qu’une version de ce que l’on appelle parfois la technologie des « registres distribués ». Les registres distribués sont essentiels pour les communs car ils sont capables de fournir une architecture logicielle puissante pour soutenir la pratique des communs sur des réseaux ouverts, bien au-delà des niveaux limités de coopération et de sécurité actuellement possibles sur le web. Les registres distribués pourraient constituer de formidables véhicules d’émancipation sociale.
Première application significative de cette technologie, la blockchain est considérée comme une véritable rupture qui a démontré la faisabilité d’échanges de pair à pair sécurisés sur l’Internet. Cette avancée majeure a permis l’invention d’une monnaie sécurisée, entièrement numérique, pouvant être échangée sur des réseaux ouverts et exposés sans que le soutien d’un État ou d’une banque soit nécessaire. Dans le jargon du monde de la technologie, le bitcoin est « autosouverain » car il vérifie de manière autonome l’intégrité de chaque bitcoin utilisé dans une transaction. Lorsqu’une personne utilise un bitcoin pour effectuer un achat, le bitcoin spécifique utilisé est enregistré sur un seul et même registre comptable numérique (la blockchain), qui existe en même temps sur des milliers d’ordinateurs. Cette méthodologie de pair à pair est remarquablement efficace car, s’il est possible pour un faussaire ou un voleur d’attaquer l’ordinateur d’une banque, il lui est impossible d’attaquer et de modifier le même registre comptable sur des milliers d’ordinateurs en même temps. Le réseau luimême devient un système d’authentification robuste pour toute transaction en bitcoins, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à la garantie d’un tiers.
Fin 2018, dix ans après l’introduction du bitcoin, la valeur globale de tous les bitcoins était supérieure à 65 milliards de dollars, et personne n’avait réussi à pirater le code du bitcoin – ce qui est en soi une preuve de la puissance de la blockchain. (Il y a bien eu des piratages de courtiers qui échangeaient des bitcoins contre des dollars, des euros ou d’autres devises, mais le bitcoin lui-même n’a jamais pu être contrefait.) Curieusement, alors que le bitcoin est totalement sûr en tant que réserve de valeur, sa réputation est surtout attachée à sa valeur en tant qu’objet de spéculation. Le prix du bitcoin a connu d’énormes fluctuations au fil des années, les investisseurs gagnant ou perdant d’énormes sommes d’argent en peu de temps. Cela a naturellement découragé la plupart des gens d’utiliser les bitcoins comme monnaie pour acheter ou vendre des objets de valeur, sans parler de les utiliser comme moyen de constituer une nouvelle communauté autour de buts communs.
Inspirés par le succès du bitcoin, des développeurs de logiciels ont essayé tout au long des années 2010 d’adapter les systèmes de registres numériques à une variété d’autres usages, le plus souvent dans une optique commerciale. Certaines entreprises vendent leurs propres « jetons » par le biais d’un processus dit ICO, ou Initial Coin Offering(« offre initiale de jetons », expression imitant l’expression anglaise pour « introduction en Bourse »), pour financer de nouvelles activités et de nouveaux produits. D’autres tentent de développer des « contrats intelligents » qui puissent être automatiquement mis en œuvre sur les réseaux numériques afin de rendre les transactions de marché plus fluides et plus efficaces que les transactions conventionnelles13. Le principe général des registres distribués est d’utiliser les réseaux de pair à pair pour vérifier l’authenticité d’un objet numérique unique. Les membres de la communauté peuvent ensuite se fier à cet objet comme gage de valeur (argent) ou de réputation personnelle, comme preuve d’un accord juridique reconnu entre des parties ou au sein d’un groupe, ou comme instrument de vote ou de prise de décision.
Pourquoi les technologies de registres distribués sont-elles importantes pour les commoneurs ? Parce qu’elles leur offrent la possibilité de reprendre au capital le contrôle de l’« interrupteur principal » des technologies numériques, et donc de renforcer et de protéger l’action collective. La technologie crée de nouvelles possibilités qui peuvent, si elles sont bien conçues, faciliter grandement la pratique des communs à l’ère numérique. Les technologies de registres distribués permettent de créer des monnaies communautaires qui facilitent la coordination et la coopération à une échelle plus large sans être menacées d’enclosure. La technologie à elle seule ne peut ni automatiser ni faire disparaître le besoin d’un groupe engagé dans le commoning, mais elle permet aux gens de coopérer de manière plus créative et avec plus de flexibilité que ne l’autorisent les systèmes conventionnels de droit de propriété, de monnaies et les structures organisationnelles classiques (organisations à but non lucratif, fiducies, coopératives). Au lieu de prendre des décisions par le biais de hiérarchies rigides organisées autour d’une direction centralisée et de s’appuyer sur des droits de propriété détenus par un petit nombre de personnes, une plateforme de pair à pair (P2P) facilite la coopération entre les gens et l’évolution de leur système social.
Le bitcoin a tellement attiré l’attention sur ses aspects capitalistes et spéculatifs que cela a occulté le plus important : le rôle que les technologies de registres distribués pourraient jouer à l’avenir. Les plateformes logicielles et les institutions construites autour d’un nouvel ensemble de protocoles de mise en réseau appelé Holochain pourraient être considérées comme l’une des expressions les plus ambitieuses et potentiellement transformatrices de cette nouvelle technologie. Les détails techniques pouvant rapidement submerger le profane, nous ne nous y attarderons pas outre mesure. Ils sont néanmoins importants car ils affectent les affordances et l’évolutivité de ces plateformes. Par comparaison avec Bitcoin et Ethereum (les deux technologies de registres numériques les plus en vue), Holochain est beaucoup plus économe en énergie et plus flexible dans sa façon d’authentifier les objets numériques sur les réseaux. Plutôt que de s’appuyer sur un seul registre – une solution « lourde » qui nécessite le travail d’innombrables ordinateurs sur le réseau –, Holochain repose sur une approche plus simple et plus légère qui permet à chaque utilisateur de disposer de son propre grand livre sécurisé et de son propre système de stockage pour conserver ses données personnelles et ses identités numériques. Son architecture P2P rappelle la plateforme du wiki fédéré que nous avons décrite au chapitre 8 ; toutes deux sont fondées sur une ontologie relationnelle, mais Holochain est beaucoup plus polyvalent. Comme avec Bitcoin, l’utilisateur de Holochain n’a pas besoin d’une source centralisée d’authentification des données ni d’une identité numérique, à l’instar d’un compte Facebook ou Google. Cette approche signifie que les utilisateurs sont beaucoup moins vulnérables à l’usurpation d’identité, car leurs données sont éparpillées (sharded dans le jargon technique) sur plusieurs serveurs d’un réseau, et non regroupées sur une seule base de données centralisée qui serait une cible tentante pour des hackers. La gestion des données à travers une architecture distribuée sur les réseaux Holochain empêche les géants de la technologie et les tiers comme Cambridge Analytica de prendre le contrôle de nos données.
De manière tout aussi importante, Holochain vise à fournir un cadre pour le développement d’une nouvelle génération d’applications et de services fondés sur une architecture distribuée et respectueuse de la vie privée. Il s’agit d’un ensemble de protocoles logiciels moins lourds et plus polyvalents que la blockchain. En empêchant par défaut toute entreprise de posséder vos données, les protocoles Holochain sont conçus pour permettre l’émergence et la coexistence de plusieurs types de fournisseurs de services au sein d’une même économie. Il est essentiel de disposer d’une infrastructure open source qui permette des personnalisations de l’Holochain. Sur le web, la domination de quelques protocoles propriétaires favorise la domination du marché par une poignée de grandes entreprises comme Amazon, Uber et Airbnb. Par contraste, les protocoles Holochain s’appuient sur une architecture ouverte de données qui permet à des acteurs différents de l’adapter à leurs objectifs particuliers.
Hash et hashchain, blockchain et Holochain : une brève explication
Pour encrypter des données, les développeurs inventent souvent un hash (« hachage » en français), qui renvoie à la valeur (« valeur de hachage ») créée lorsque de grandes quantités de données sont envoyées à un système informatique et passées à travers une « fonction de hachage » qui rend le tout lisible numériquement et considérablement raccourci. Les données de différentes formes telles que les noms complets sont en quelque sorte hachées et « cuites », c’est-à-dire réduites à une valeur courte et à un format uniforme. Il en résulte une sorte d’empreinte digitale numérique, une source d’identification quasi infaillible qui rend un objet numérique facilement identifiable. Une bonne fonction de hachage garantit que deux entrées différentes produisent de manière fiable deux valeurs de sortie différentes et qu’aucun résultat ne peut être inversé pour revenir aux données d’origine.
Une chaîne de hachage (hashchain) est un processus de calcul séquentiel qui applique une fonction de hachage cryptographique aux données de manière répétée afin de générer des clés à usage unique. Celles-ci permettent de déverrouiller les données cryptées et de les valider rapidement. Après plusieurs passages, une sorte d’empreinte digitale numérique est créée pour chaque entrée spécifique.
Une blockchain est un processus informatique qui crypte les données en créant une série de « blocs » contenant les hachages cryptographiques des blocs précédents avec un horodatage de chaque transaction entre les parties. Une longue chaîne de blocs contient l’enregistrement des transactions antérieures et fournit un moyen très sûr de vérifier l’identité d’un objet numérique (tel qu’un bitcoin). C’est pourquoi la technologie blockchain a été popularisée comme moyen de développer des monnaies qui peuvent être échangées en toute sécurité sur des réseaux ouverts.
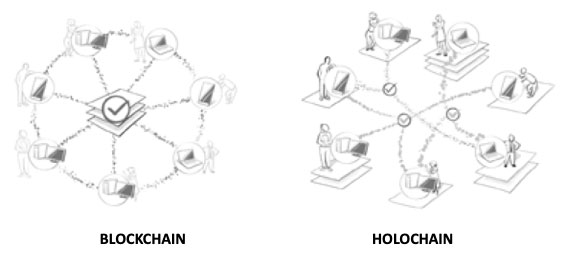
Holochain est un ensemble de protocoles informatiques en réseau qui permet à chacun de créer son propre registre distribué pour conserver la trace de la valeur. Comme il n’y a pas de registre unique (comme dans les blockchains), Holochain rend possible une plus grande diversité de systèmes de représentation de la valeur. Holochain a la particularité de permettre à chaque utilisateur d’exprimer la valeur de manière singulière lorsqu’il interagit avec d’autres personnes car il est fondé sur une ontologie relationnelle différenciée, tandis que la blockchain, en tant qu’outil, reflète en dernière instance une ontologie indifférenciée (chaque utilisateur doit accepter la norme dominante du système). (Voir chapitre 2.)
Holochain pourrait donc être utilisé par les gens pour créer des monnaies convertibles ou non pouvant matérialiser de nouvelles formes de coordination. Au lieu de privilégier l’évaluation par le marché à travers les prix et les salaires, par exemple, Holochain pourrait rendre visibles la réputation, les compétences, les niveaux de performance ou d’autres flux de valeur au sein d’une communauté. Cela permettrait à ces communautés de générer et de partager la valeur productive selon leurs propres termes, tel le modèle pair à pair, y compris à travers des modèles qui relationalisent la propriété et limitent l’accumulation de capital. Arthur Brock, l’un des cofondateurs du MetaCurrency Project, qui a développé Holochain, explique que le véritable objectif d’une monnaie devrait être de rendre visibles les flux de valeur, comme dans un circuit lumineux. Le fait que la monnaie conventionnelle, telle qu’elle est conçue et utilisée, est incapable d’exprimer une grande partie des flux économiques effectifs est, selon Brock et ses associés, un problème majeur de l’ère moderne. Les dollars, les euros et les autres monnaies nationales ne nous permettent pas de voir les flux de valeur qui comptent le plus – les flux écologiques, les interactions sociales de l’économie du don, les contributions des gens aux communs. Les monnaies s’appuyant sur Holochain pourraient, par exemple, être utilisées par les communautés pour rendre visibles les actions solidaires ou pour créer des systèmes de crédit mutuel non spéculatif et à but non lucratif. L’accumulation de capital et la gouvernance par l’argent, typiques de l’économie capitaliste, pourraient être remises en cause à travers la fixation de limites communautaires à l’accumulation privée et l’imposition d’un certain niveau basique d’équité dans les échanges économiques. Les monnaies fondées sur Holochain sont plus à même de générer des systèmes respectueux des communs car elles s’appuient sur un principe de souveraineté mutualiste – un contrôle partagé entre l’individu et la communauté à laquelle il appartient. Cela signifie que les idées mêmes de Moi-imbriqué et de Rationalité Ubuntu, d’interdépendance et de responsabilité mutuelle peuvent être intégrées au système.
Depuis plus de dix ans, Brock et l’équipe de développement de Holochain imaginent et élaborent des protocoles ouverts destinés à servir d’infrastructure sur laquelle construire une économie et des monnaies sociales alternatives et autonomes. Il s’agit évidemment d’un projet formidable, complexe et incertain, puisque Holochain n’est pas conçu comme une entreprise commerciale, mais comme un véhicule pour la transformation sociale. Pourtant, à ce jour, les concepteurs de Holochain ont su convaincre un nombre impressionnant de développeurs, d’investisseurs et d’autres partenaires de créer non seulement des applications Holochain, mais aussi un ensemble d’initiatives, c’est-à-dire un groupe d’acteurs différents utilisant les mêmes protocoles logiciels pour interagir.
Une version 2019 du code Holochain visait à démontrer la faisabilité d’un contrôle des données et de l’identité centré sur l’agent, ce qui signifie que les individus géreraient directement la sécurité et l’authenticité de leurs données personnelles sans avoir besoin de tiers intermédiaire. Les codeurs de Holochain ont également pour objectif de permettre aux développeurs d’applications de créer leurs propres ensembles de protocoles, afin de ne pas dépendre d’un ensemble unique de protocoles contrôlé de manière centralisée par une seule entreprise technologique. Ainsi, les communautés P2P pourraient contrôler leurs propres applications et données sans s’en remettre aux géants Google, Apple et Facebook et à leur appétit insatiable de données.
Un acteur clé dans le développement du système Holochain est une entreprise appelée Holo. C’est une coopérative d’hébergement distribué dont le rôle est de superviser la première utilisation à grande échelle de Holochain. L’objectif de Holo est de permettre à toute personne possédant un ordinateur de « louer » sa capacité de calcul inutilisée à l’aide d’un logiciel fondé sur Holochain et de recevoir en contrepartie une monnaie baptisée Holo Fuel (« carburant Holo »). Le Holo Fuel, en retour, permettra à ces gens d’effectuer des transactions avec d’autres personnes au sein du réseau et de lancer une nouvelle économie parallèle de services s’appuyant exclusivement sur cette monnaie. (Les gens pourront également acheter des Holo Ports spéciaux qui facilitent la location de capacité informatique à d’autres utilisateurs – en d’autres termes, un appareil expressément conçu pour faire gagner du Holo Fuel à son propriétaire).
Contrairement à de nombreuses monnaies, le Holo Fuel est adossé à un actif productif, à savoir la puissance de calcul et d’hébergement des ordinateurs participants. La quantité de Holo Fuel que l’on acquiert est liée à la participation à la communauté, de sorte qu’il tient lieu de « preuve de service » – une confirmation que l’on a contribué à un certain niveau de puissance de calcul au réseau. Techniquement, le Holo Fuel est un système de crédit mutuel14 où débiteurs et créanciers sont effectivement les mêmes personnes, en tant que participants à un vaste système multilatéral. Bien que le Holo Fuel puisse en théorie être échangé contre des dollars, des euros ou d’autres devises conventionnelles – et donc devenir un objet de spéculation comme le bitcoin –, cette monnaie adossée à un actif (la puissance de calcul apportée à la communauté) a plus de chances d’être traitée comme une valeur stable dans le temps, et donc d’être effectivement utilisée pour l’échange et comme réserve de valeur.
L’équipe de Holochain espère que des monnaies de crédit mutuel similaires seront créées sur la base d’autres capacités de production, par exemple de nourriture (comme les fermes en AMAP), de transport (covoiturage entre pairs), d’énergie (solaire) ou bien de services aux personnes âgées. Au fur et à mesure que de plus en plus d’entreprises utiliseront le Holo Fuel et en garantiront la valeur par des actifs et des services réels, une économie fondée sur les communs pourra émerger. Pour faciliter ce processus, le groupe Holochain développe un Commons Engine (« moteur de communs ») qui vise à contribuer à l’essor d’une culture fondée sur les communs et d’une économie prospère. L’objectif est d’aider les communautés et les organisations à développer des applications fondées sur Holochain (« hApps »), à concevoir des monnaies, à entreprendre des projets open source et cryptoéconomiques, et à faire progresser les normes sociales de la pratique des communs. Le Commons Engine se concentre tout particulièrement sur des projets relatifs à l’eau, à l’énergie, à l’alimentation, à la terre, aux savoirs et au développement communautaire.
Dans ce contexte, Holochain pourrait être utilisé pour construire des applications décentralisées pour divers types de coopération – « gouvernance, collaboration, outils organisationnels, réseaux sociaux, médias sociaux, gestion des relations avec les fournisseurs, plateformes coopératives, applications d’économie collaborative, solutions de gestion de chaînes d’approvisionnement, ressources communautaires, ainsi que cryptomonnaies de crédit mutuel et systèmes de réputation sans jetons15 ». Chaque élément de cette économie alternative reposerait sur des monnaies partagées et fonctionnerait en synergie, tout en restant indépendant des banques et des investisseurs conventionnels. Comme le suggère ce rapide tour d’horizon du futur Holochain, un système de registre distribué de ce type pourrait avoir des applications bien plus polyvalentes que la blockchain de Bitcoin ou d’Ethereum.
Pour Eric Harris-Braun, ingénieur de Holochain, l’objectif ultime du Holo Fuel et des monnaies s’appuyant sur Holochain est d’aider les gens « à voir et à représenter les différents types de valeur dans une perspective de promotion des communs, et à disposer d’un langage stable pour les développer et les faire passer à grande échelle16 ». En d’autres termes, les protocoles Holochain fonctionneraient comme un système ou un langage permettant de construire des applications qui identifient les flux de valeur au sein d’une communauté, tels que les contributions sociales, la réputation, le travail effectué, le travail de soin et même le sentiment communautaire. Harris-Braun affirme aussi que le Holo Fuel ne deviendra pas une forme de monnaie de substitution qui finira par reproduire le capitalisme, mais propagera au contraire une « grammaire différente de la valeur ». Tout comme une structure grammaticale différente dans une langue humaine nous aide à articuler des idées et des réalités différentes, la grammaire Holochain se veut un outil pour exprimer des formes sociales de valeur – des flux – que les prix de marché sont incapables de représenter. Au lieu que l’échange marchand soit la forme de valeur dominante, il est prévu que les applications à partir de Holochain permettent d’exprimer et de faire circuler d’autres formes de valeur au sein de communautés en réseau – pas seulement les valeurs monétaires représentées par les prix de marché. Plutôt que de considérer l’individu isolé comme la seule source de pouvoir et de richesse, Holochain repose sur l’Ontochangement et embrasse en pratique le Moi-imbriqué. HarrisBraun explique :
Notre modèle est construit sur une « souveraineté mutuelle » où la mutualité est entre l’individu et le collectif. Aucun des deux n’est privilégié par rapport à l’autre. L’acteur ou l’agent peut dire ce qu’il veut, mais le collectif [qui utilise la « grammaire » Holochain] vérifie ce qui est transmis ou que le « coup » a bien été joué dans le respect des règles collectives. Ce sont donc toutes ces interactions entre l’individu et le collectif qui vont assurer la cohérence sociale du groupe.
Dans le monde réel dans lequel nous vivons, tout est en réalité « centré sur l’agent », en ce sens que la réalité est toujours documentée par la perspective que l’on adopte. Ce que nous faisons, c’est rendre possible une réalité partagée en adoptant une grammaire commune avec laquelle nous interprétons la réalité – puis nous nous contrôlons mutuellement et nous nous demandons des comptes à la lumière de cette grammaire commune. C’est ce pour quoi est conçu Holochain.
En reconnaissant la souveraineté mutuelle des agents au sein d’un système, les promoteurs de Holochain aspirent à mettre en place un modèle de « système vivant de richesses » qui s’engage à respecter l’« intégrité des flux ». « En tant que société, nous avons une assez bonne compréhension des objets et de la façon de les manipuler, mais nous ne sommes pas aussi bons avec les flux », note Arthur Brock, fondateur du projet MetaCurrency17. Holochain consiste à utiliser différents « modèles, principes et protocoles d’utilisation de monnaies (pensez aux “circuits lumineux”) pour partager, mesurer et activer toutes sortes de courants ». Leurs caractéristiques principales sont « la distribution, l’équité et la régénération ». Harris-Braun nous a déclaré : « Je ne suis pas du tout intéressé par la monétisation de la valeur ! Je souhaite participer à la construction d’un monde post-monétaire. Je suis surtout intéressé par la formalisation de systèmes physiques qui nous permettent de “voir la valeur”. Ce n’est pas la même chose que la monétisation. » L’objectif est d’essayer d’utiliser des « circuits lumineux » alternatifs pour éviter les pathologies de l’extractivisme, de l’accumulation privée et de la destruction des écosystèmes.
Cet engagement à donner à voir la valeur sous de nouveaux angles se reflète dans la stratégie d’autocapitalisation de Holo. Le lancement de l’entreprise a été financé via une souscription communautaire compensée sous la forme de Holo Fuel pour les investisseurs, tous les retours sur investissement se faisant également en Holo Fuel. L’idée sous-jacente est que la valeur des retours sur investissement augmente en parallèle de la capacité d’hébergement de l’écosystème Holo au sens large. « Il s’agit de faire croître ce modèle d’autoréplication de la capacité productive pour donner naissance à des communs », analyse Harris-Braun – ce qui signifie que la communauté investira dans sa propre infrastructure et sa propre économie, et remettra en circulation la valeur créée. Cette vision d’un monde où l’autocapitalisation et le développement de communs à grande échelle se feraient hors des exigences extractives du couple État/marché est enthousiasmante. Des éléments probants – un code fonctionnel, de solides investissements de départ, un intérêt des développeurs d’applications pour Holochain et des participants potentiels à l’économie Holo Fuel tels que les agriculteurs en AMAP et les coopératives – montrent que cette vision pourrait bien se concrétiser sans être entravée par les pressions capitalistes habituelles.
Bien sûr, beaucoup de problèmes peuvent survenir et faire dérailler le développement de Holochain. Rien ne dit que le projet se déroulera comme l’espèrent ses promoteurs. L’un des risques est que la technologie Holochain soit utilisée par le capitalisme pour assouvir sa soif de contrôle et de profit privé, comme le fait remarquer Fernanda Ibarra, codirectrice du Commons Engine chez Holo18. L’invention de la presse à imprimer a permis une large diffusion de la Bible et de la grande littérature, mais elle a également donné naissance au journalisme à sensation et à la propagande. Ce qui importe dans la technologie de registre distribué, ce sont les possibilités nouvelles et variées qu’elle offre. La question reste ouverte de savoir qui sera le premier à tirer parti de ces possibilités et qui aura le plus d’influence sur leur développement.
Une chose est certaine néanmoins : le monde se dirige inexorablement vers les systèmes de registres distribués parce qu’ils permettent de surmonter de nombreux problèmes associés aux systèmes centralisés de production de données des entreprises – le manque de liberté des utilisateurs, les violations graves de la vie privée, les risques liés à la sécurité et le dépérissement de la créativité parce que les gens n’ont pas de capacité d’action individuelle ou collective. Il est donc impératif que les commoneurs développent ce type d’architecture technologique qui facilite l’atteinte de leurs objectifs – la création de communs et leur protection – et limite la capacité du capital à marginaliser la pratique des communs sur ces systèmes, comme il a réussi à le faire en détournant les logiciels libres, le web et les réseaux sociaux pour les mettre au service des grandes multinationales.
Même s’il est inévitable qu’il en soit fait des usages moins nobles, Holochain offre la possibilité de consolider une dimension importante des communs. L’attrait des technologies de registres distribués, qu’il s’agisse de Holochain ou d’autres initiatives à venir, réside dans leur potentiel à créer de nouvelles possibilités durables de pratique des communs.
PARTENARIATS PUBLIC-COMMUNS
L’État et le monde des grandes entreprises étant étroitement liés, il n’y a rien de surprenant à ce qu’ils soient souvent amenés à nouer ce qu’on appelle des partenariats public-privé (PPP). Le concept de partenariat public-privé part en apparence d’une bonne intention. Il s’agit de résoudre des problèmes sociaux urgents par le biais d’une collaboration contractuelle entre des entreprises et le gouvernement. Les PPP sont généralement un moyen de construire des infrastructures pour l’approvisionnement en eau ou la gestion des eaux usées, des routes, des ponts, des écoles, des hôpitaux, des prisons ou des équipements publics tels que des piscines ou des terrains de sport. Par l’intermédiaire d’une entité juridique distincte (qui peut prendre différentes formes juridiques), les organismes étatiques et les entreprises négocient les conditions de financement, de construction et/ou de gestion d’un projet sur une période donnée.
Les partenariats public-privé sont généralement présentés comme des solutions gagnant-gagnant qui permettent à la fois de satisfaire des besoins sociaux, de renforcer l’économie et de réduire les dépenses de l’État. Les entreprises sont supposées fournir des services à des coûts inférieurs à ceux du secteur public en raison de règles de travail plus souples et de gains de productivité, de sorte qu’en définitive l’État économise de l’argent. Cependant, ce scénario se vérifie rarement dans la pratique, car les PPP reposent sur des objectifs fondamentalement incompatibles : l’obligation de l’État de protéger l’intérêt général s’oppose à l’intérêt des entreprises privées de maximiser leurs profits. De nombreuses collaborations publicprivé fonctionnent en réalité moins comme des partenariats que comme des cadeaux déguisés aux entreprises.
De fait, un PPP permet à une entreprise d’acquérir une participation dans des infrastructures publiques telles que des routes, des ponts et des équipements publics pour une longue période – quinze, trente, voire quatre-vingt-dix-neuf ans – et de les gérer ensuite comme un actif commercial. À Chicago, par exemple, le gouvernement municipal a cédé la gestion de ses milliers de parcmètres à une société privée. Cela s’est traduit par une augmentation des frais de stationnement, une détérioration du service et une vague d’indignation dans le grand public. Dans de nombreux PPP, l’autorité publique reçoit un paiement unique substantiel, ce qui permet aux politiciens de faire bonne figure en limitant les dépenses et en évitant d’augmenter la dette publique. Mais les coûts cachés à long terme font de nombreux PPP une bien mauvaise affaire. Les entreprises augmentent généralement les prix ou font payer ce qui était auparavant financé plus efficacement par les impôts. Elles sacrifient la sécurité et la qualité du service public en rognant sur l’entretien et la maintenance19. L’État et le secteur privé prétendent tous deux que les PPP sont un arrangement sain et équilibré qui profite à tous et apporte une solution au manque de fonds publics. Un grand nombre de PPP ne sont en réalité qu’une marchandisation du secteur public, dont le résultat est d’extraire encore plus d’argent des poches des citoyens, de céder le patrimoine public à des entreprises et de neutraliser les mécanismes de contrôle démocratique.
Les PPP ne sont pas la seule manière envisageable de construire des infrastructures et de gérer des projets. Cependant, avant d’envisager des alternatives et d’esquisser une vision différente, il faut se poser quelques questions comme, par exemple : qui a besoin de quels services et de quelles infrastructures en premier lieu ? Et pour quel usage ? Est-il réellement indispensable de créer de nouvelles infrastructures pour stimuler la croissance économique et le commerce international, infrastructures qui profitent principalement aux actionnaires ? Ces partenariats sont-ils un moyen pour les entreprises de minimiser les risques et de maximiser les revenus sans concurrence ? Avant d’examiner tout partenariat, on devrait toujours commencer par poser se demander : qu’est-ce qui est vraiment nécessaire sur le terrain ? Qu’est-ce qui garantit réellement un service de qualité et une vie meilleure sans avoir à céder le contrôle aux investisseurs et à des marchés mondiaux volatils ? Ne pourraiton pas créer une infrastructure respectueuse des communs qui échappe aux pièges de la croissance économique, à l’emprise des capitaux internationaux et de l’administration centralisée ?
La réponse est oui ! Il est tout à fait possible de satisfaire nos besoins essentiels par le biais d’une constellation de partenariats public-communs localisés et distribués. Considérez la façon dont la lutte contre les incendies est organisée en Allemagne : pas moins de 97 % des pompiers sont des volontaires, non des professionnels. Près d’un million de gens ordinaires – enseignants, agriculteurs, commerçants, artisans, chauffeurs (principalement des hommes) – sont prêts à intervenir, si le besoin s’en fait sentir, et à se joindre à d’autres membres de la communauté pour combattre les incendies. Dans toute l’Allemagne, il n’existe que 107 Berufsfeuerwehren – brigades de pompiers professionnels –, exclusivement dans les villes moyennes ou grandes. Partout ailleurs, en Allemagne comme en Autriche et en Pologne, les brigades de volontaires sont la norme. Même dans le bastion de la culture du marché mondial, les États-Unis, 77 % des 1,1 million de pompiers du pays, soit environ 815 000 personnes, sont des volontaires.
La lutte contre les incendies relève bien sûr des obligations fondamentales de l’État en matière de sûreté publique. Mais contrairement à ce qui se passe dans tant d’autres domaines, l’État allemand n’engage pas de fonctionnaires ou ne passe pas de contrat avec des sociétés privées pour remplir cette mission. Il a organisé un système pour que les citoyens fassent le travail eux-mêmes. En vérité, le terme « volontaire » est un peu trompeur, car ce n’est pas tout à fait volontairement que les gens se regroupent en brigades de pompiers. C’est une obligation légale fédérale pour chaque communauté de les mettre en place. Si elle ne réussit pas à le faire sur une base volontaire, une administration municipale peut réquisitionner des citoyens, de la même manière que la participation à un jury lors d’un procès est obligatoire aux États-Unis comme en France. Mais tout le système est structuré pour que les citoyens prennent la responsabilité de s’organiser. Rôle de l’État et gestion par les pairs sont ingénieusement associés. « Chaque communauté ou municipalité est tenue de fournir, d’entretenir et de financer un service d’incendie qui répond aux besoins de la situation locale », comme le stipule la loi sur la lutte contre les incendies dans l’État du Bade-Wurtemberg. L’État fournit, entre autres, l’équipement de lutte contre les incendies, la mousse pour extincteur, des formations, l’infrastructure de communication, l’éducation, l’espace de travail, l’assurance pour les pompiers et le soutien financier – mais les membres de la communauté gèrent eux-mêmes le service d’incendie.
On pourrait appeler cela un contrat ou un partenariat « publiccivique ». L’État crée un cadre juridique et administratif pour donner naissance à un vaste corps de pompiers volontaires. En plus de fournir des ressources, il rend le volontariat possible en interdisant aux employeurs de priver un employé de son salaire lorsqu’il travaille pour un service d’incendie. Une fois constitués, les services de pompiers s’auto-organisent pour enseigner les techniques de lutte contre l’incendie et les connaissances médicales de base, se répartir les tâches et, de toutes les manières possibles, répondre efficacement aux urgences.
Notons qu’il ne s’agit pas vraiment là d’un partenariat avec un commun, mais d’une délégation limitée du pouvoir et de la responsabilité de l’État aux citoyens, que ces derniers ne peuvent pas refuser. Ce type de volontariat pour la lutte contre les incendies a des ressemblances avec les communs, mais dans certaines limites. L’appel au volontariat est différent de la pratique des communs. Si les deux impliquent des individus qui choisissent de participer, les volontaires travaillent dans les conditions fixées par une organisation de tutelle, tandis que les commoneurs initient et gèrent leurs projets eux-mêmes, selon leurs propres conditions. Ce que nous appelons « volontariat » a généralement lieu après le temps de travail et a souvent un caractère humanitaire, alors que les commoneurs choisissent généralement de faire une chose pour elle-même ou pour satisfaire des besoins en dehors du marché, dans le cadre d’un processus qu’ils contrôlent eux-mêmes.
Le succès des services de pompiers volontaires permet d’imaginer d’autres manières de répondre à nos besoins, si le soutien structurel et la délégation de pouvoir de l’État étaient encore plus larges et moins soumis à conditions. Si, en outre, les commoneurs avaient la possibilité d’initier, d’organiser et de réellement piloter les projets, le résultat seraient des partenariats public-communs. Cela vous semble utopique ? C’est ce qu’on aurait dit il y a cent cinquante ans de l’organisation moderne de la lutte contre les incendies.
Lors de sa création à Berlin en 1851, le service allemand de lutte contre les incendies ne comptait dans ses rangs que des professionnels. Mais dès les années 1920, la tradition des brigades de volontaires avait pris racine. Un siècle plus tard, l’Allemagne compte plus de 22 000 corps de pompiers volontaires. Collectivement, ils assurent la protection contre les incendies de la quasi-totalité du pays. En 2017 – c’est plus que remarquable –, il n’y a eu que quatre endroits dans toute l’Allemagne où il n’a pas été possible de recruter suffisamment de volontaires. Dans de tels cas, le gouvernement du district crée des « services obligatoires de lutte contre les incendies ». Il en va de même dans d’autres pays que l’Allemagne. En France, 79 % des sapeurs-pompiers sont des volontaires. De même, la Société nationale de sauvetage en mer, qui assure chaque année près des deux tiers des interventions de secours au large des côtes françaises, est une association qui repose sur l’engagement volontaire de ses 8 800 bénévoles.
La culture contemporaine tend à considérer les termes « obligatoire » et « volontaire » comme opposés. En pratique, cette opposition s’estompe dès lors qu’il s’agit d’une préoccupation intrinsèque et de questions existentielles, comme dans le cas présent. L’État peut exiger des communautés locales qu’elles aient des services d’incendie, mais en même temps, les communautés locales disposent d’une autonomie importante pour s’organiser. En fait, les citoyens se portent librement volontaires ; ils ne se sentent généralement pas contraints de s’engager. Lorsque les gens font l’expérience de la liberté dans la communauté, l’opposition entre « libre choix » et « obligation » n’est pas pertinente. Les parents responsables ne « choisissent » pas de s’occuper ou non de leurs enfants ; c’est à la fois un plaisir et une responsabilité. De même, les membres valides de la communauté ne considèrent pas le « volontariat » comme une contrainte qui s’impose à eux. C’est simplement ce qui doit être fait. Les participants sont souvent fiers d’accomplir ce qui est important pour le bien-être de leur communauté – et une reconnaissance explicite est toujours la bienvenue. Les gens apprécient généralement d’appartenir au service de pompiers, tout comme les commoneurs apprécient le sentiment d’appartenance qui découle de la pratique des communs. Ils ritualisent l’être-ensemble par des dîners et font des démonstrations de leurs équipements de lutte contre les incendies lors de journées portes ouvertes. Les services de pompiers volontaires sont une telle tradition communautaire en Allemagne que quelque 250 000 jeunes appartiennent à des brigades de jeunes pompiers, qui servent de force d’appoint aux services de pompiers et constituent une réserve de futurs participants.
C’est précisément cette polyvalence, découlant de son caractère auto-organisé, qui rend le rôle de pompier volontaire si efficace et si appréciable. Les approches fondées sur le marché ne peuvent pas susciter un tel engagement ni procurer une telle satisfaction. Cette organisation présente aussi l’avantage d’introduire plus de souplesse dans la définition des tâches, qui ne font pas l’objet de descriptions de postes rigides et contraignantes. Les tâches peuvent être adaptées aux circonstances. Et même si les bénévoles n’ont pas les mêmes compétences et la même expérience que les professionnels, il serait impensable d’engager des professionnels pour l’ensemble du pays car cela coûterait environ 24 milliards d’euros par an en référence au salaire de base d’un soldat de l’armée allemande. Une force entièrement professionnelle serait nécessairement plus coûteuse : d’une part, les pompiers seraient payés à plein temps pour leur disponibilité, alors qu’ils passent heureusement une grande partie de leur temps à attendre que les incendies se produisent ; d’autre part, leurs compétences seraient excessivement spécialisées (et donc plus coûteuses), alors que la plupart des tâches requises sont assez basiques.
Ce qui nous intéresse ici est le potentiel des partenariats publiccommuns comme alternative aux partenariats public-privé. Un partenariat public-communs ne consiste pas à commander à des gens de faire ceci ou cela. Il s’agit de créer les conditions pour qu’ils aient envie de contribuer par leur énergie et leurs talents personnels. Cela est essentiel pour développer les communs à grande échelle. Les gouvernements doivent faire coïncider les besoins collectifs, l’intérêt général et les intérêts individuels pour répondre aux préoccupations du terrain. La clé n’est pas d’offrir les « bonnes incitations » ou les meilleurs salaires. C’est de donner aux gens une véritable autorité pour gérer leurs propres actions – et de les soutenir par les infrastructures, les équipements et les financements appropriés. Si les gens sont prêts à participer aussi généreusement en tant que pompiers volontaires, c’est parce qu’on leur donne la liberté de s’organiser et les outils adaptés pour relever un défi collectif qui leur tient à cœur.
L’approche conventionnelle consiste à traiter les services publics comme des lignes budgétaires pour le gouvernement et les personnes qui fournissent des services comme des employés. Cette manière de voir les choses passe à côté de l’essentiel. Elle ignore qu’un service d’incendie volontaire peut susciter beaucoup d’énergie et de talents précisément parce qu’il n’y a pas ici de relation employeur-employé. S’appuyer sur le pouvoir de l’auto-organisation pour combattre les incendies ne satisfait pas seulement un besoin public essentiel, cela produit de surcroît de la cohésion sociale. C’est un processus qui lie ensemble les pompiers, les parents, les amis, les victimes d’incendie secourues et les autres membres de la communauté. Bien sûr, les pompiers volontaires doivent accepter de sérieuses contraintes – se mobiliser à toute heure du jour ou de la nuit, dégager les arbres tombés sur les routes après les tempêtes, gérer des urgences médicales. Mais ces sacrifices sont supportables et même gratifiants dans le cadre de camaraderie que procure un travail aussi essentiel. C’est de plus un motif de fierté lorsque les médias et les concitoyens expriment leur gratitude.
Soyons clairs : les brigades de pompiers volontaires ne relèvent pas entièrement de la pratique des communs. L’État reste l’acteur principal, facilitant la participation et fournissant les ressources. Par ailleurs, il ne s’agit pas non plus d’un cas classique de « participation citoyenne » dans le fonctionnement du gouvernement. L’État ne réclame pas des citoyens qu’ils se manifestent pour participer à ses procédures et rendre les décisions qui en résultent plus légitimes. Il délègue une part importante de son autorité et affecte des ressources – sans imposer beaucoup de contraintes – pour renforcer la capacité des citoyens à lutter contre les incendies et à se gérer euxmêmes, comme des commoneurs.
Le succès des services de pompiers volontaires démontre le potentiel des partenariats public-communs qui accordent la priorité aux besoins des populations plutôt qu’aux intérêts commerciaux. Un partenariat public-communs (PPC) est un accord de coopération à long terme entre les commoneurs et les institutions publiques autour de missions spécifiques. Il s’agit de fournir des moyens stables et sûrs aux gens pour qu’ils travaillent ensemble, souvent à l’échelle locale, afin de se fournir des services les uns aux autres, ainsi qu’au grand public à travers la pratique des communs. Un PPC consiste également à créer les infrastructures, les espaces et les conditions nécessaires à l’auto-organisation. Avec un soutien modeste, les gens peuvent être habilités à prendre leurs propres décisions et à adapter les solutions à leurs besoins et aux circonstances. Par exemple, Guifi.net, le réseau Wi-Fi régional fondé sur les communs, ne cherche pas à répondre aux besoins d’investisseurs extérieurs, ni à maximiser les retours sur investissement. En tant que commun, le réseau peut rester concentré sur sa stabilité à long terme et sur le service apporté à ses utilisateurs plutôt que de se perdre dans les jeux financiers (fusions et acquisitions, instruments financiers créatifs, etc.) souvent privilégiés par les investisseurs. Les PPC ont donc tout pour séduire les collectivités locales. Ils sont assurément plus à même de satisfaire leurs exigences que les acteurs économiques à la recherche de rendements financiers et peu intéressés par le bien-être des populations, et dont la loyauté est par nature superficielle.
En d’autres termes, le PPC rompt avec l’approche des PPP, qui consiste à alimenter les entreprises et les marchés en liquidités, en crédits, en subventions et en privilèges juridiques. Le PPC cultive au contraire les collaborations créatives entre l’État et les commoneurs pour fournir des services essentiels et construire des infrastructures ouvertes et non discriminantes. Les solutions fondées sur le PPC ont tendance à être moins coûteuses que les PPP car, libérées de la recherche du profit, elles rendent possibles une logique institutionnelle flexible et une participation sociale distribuée. Un PPC permet d’éviter les coûts et les complexités immenses liés à l’administration d’un système centralisé car il tire parti des contributions et de la créativité provenant des parties prenantes, à la manière de l’open source. Il existe toutes sortes de manières de s’auto-organiser en communautés de pairs afin de satisfaire les besoins humains essentiels, pour une fraction des coûts des systèmes bureaucratiques conventionnels et avec beaucoup de soin et d’attention. Imaginez, par exemple, que les autorités publiques fournissent une infrastructure et un soutien de base au système d’assurance communautaire Artabana, où des petits groupes créent des fonds monétaires pour assurer le bien-être social et médical des autres. Ou bien encore que des réseaux gérés par les pairs tels que Vipassana, dont l’activité consiste à permettre à des milliers de personnes de se soigner de manière très efficace, sur la base d’une contribution sans contrainte et non marchandisée, bénéficient d’un soutien infrastructurel, même minimal. Cela permettrait non seulement de réduire les coûts globaux des soins de santé, mais aussi de créer des communautés et un sentiment d’appartenance.
L’un des principaux défis à relever pour tout partenariat publiccommuns est d’amener l’État à reconnaître un groupe de commoneurs comme partenaire légitime. Les administrations ont l’habitude de traiter avec des entités juridiques conventionnelles – sociétés, organisations à but non lucratif, universités –, avec des présidents et des structures de gouvernance hiérarchiques. Un groupe de commoneurs sera considéré a priori comme instable et trop peu organisé pour constituer un partenaire digne de confiance. Mais comme nous l’avons vu à propos de Buurtzorg, fournisseur de soins infirmiers à domicile gérés par des pairs à l’échelle d’un quartier (p. 33-34), il est tout à fait possible pour les autorités de conclure des accords contraignants avec des groupes de commoneurs autoorganisés. Le règlement de Bologne pour l’entretien et la régénération des communs urbains est un autre exemple de PPC innovant. Il établit un système par lequel la municipalité fournit un soutien juridique, financier et technique à des projets spécifiques lancés par des commoneurs. Cette innovation a été prolongée et généralisée à travers les protocoles de co-administration, une méthode élaborée par le groupe de réflexion italien LabGov pour accompagner les initiatives de co-gouvernance20. Cette approche s’appuie sur cinq principes : « la gouvernance collective, l’État facilitateur, une économie fondée sur la mutualisation, l’expérimentation et la justice technologique ».
Selon Frédéric Laloux, expert en développement des organisations, chaque nouvelle étape de la conscience humaine s’est accompagnée de nouvelles avancées dans nos capacités à collaborer, qui se traduisent par de nouvelles formes d’organisation. Lorsque les sociétés humaines sont passées de la cueillette à l’agriculture puis à l’industrialisation, que les tribus sont devenues des royaumes puis des États-nations, nos visions du monde ont évolué pour donner naissance à des paradigmes organisationnels nouveaux et imprévus. Dans son livre Reinventing Organizations [« Réinventer les organisations »], Laloux affirme que l’étape de la conscience humaine actuellement émergente – avec donc ses nouveaux genres d’organisation – est fondée sur la recherche de la plénitude et de l’« autoorganisation évolutive ». Cela signifie que, contrairement aux organisations figées et hiérarchiques du passé, les organisations à venir fonctionneront comme des entités vivantes, avec un leadership distribué et avec la « justesse et la motivation internes comme moteurs et mesures primaires » de l’organisation. Sur la base de sa classification par couleurs des degrés de conscience des collectifs, Laloux appelle ce stade des organisations en émergence « Opale ». Il existe des parallèles frappants entre les organisations de type Opale et celles fondées sur les communs. Les organisations Opale sont caractérisées par une autogestion qui « opère efficacement, même à grande échelle, à travers un système de relations entre pairs, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la hiérarchie ou au consensus ». De telles organisations s’efforcent d’atteindre leur « plénitude » par le biais de « pratiques qui nous invitent à restaurer notre plénitude personnelle et à apporter au travail tout ce que nous sommes, au lieu de nous limiter à un moi “professionnel” trop étroit ». Les organisations de type Opale ont également « une vie et un sentiment de direction qui leur sont propres. Au lieu d’essayer de prédire et de contrôler l’avenir, les membres de l’organisation sont invités à écouter et à comprendre ce que l’organisation veut devenir, quel objectif elle veut servir ». Leurs pratiques d’autoorganisation se traduisent par l’attribution de rôles de travail fluctuants et différenciés, une coordination et des réunions adaptées aux circonstances à mesure que le besoin s’en fait sentir, un partage transparent des informations en temps réel, une gestion de projet radicalement simplifiée avec des plans et des budgets minimaux, et des processus formels de résolution de conflit en plusieurs étapes. Parmi les organisations qui incarnent les principes Opale, citons Buurtzorg, l’entreprise de soins infirmiers de proximité, la marque d’équipements sportifs Patagonia, le média Sounds True ou encore les hôpitaux psychiatriques de Heiligenfeld en Allemagne.
Les pratiques des organisations de type Opale sont également au cœur des partenariats public-communs. Le seul véritable obstacle est le manque de considération pour les PPC, qui ne correspondent pas aux structures et aux protocoles conventionnels. Si les agents de l’État avaient plus d’imagination, ils prendraient conscience que la gouvernance interne et la vie sociale des communs ne sont pas des handicaps, mais une source potentielle d’énergie créative émanant du terrain. Pour en savoir plus, la ville de Gand en Belgique a commandité en 2017 une série d’études sur des dizaines de projets fondés sur les communs sur son territoire. Elle souhaitait comprendre comment accompagner les efforts des habitants engagés dans la gestion commune d’un bâtiment religieux, d’une coopérative d’énergie renouvelable et d’un laboratoire temporaire de communs urbains qui fournissait une base à de nombreux projets communautaires21.
Pour mettre en place un PPC, il ne suffit pas que l’État reconnaisse explicitement les communs ; les administrations publiques doivent véritablement s’engager à encourager la pratique des communs. Le gouvernement indien s’est ainsi lancé dans un effort audacieux pour soutenir les communs forestiers ruraux à travers sa loi sur les droits forestiers de 2006. Cette loi a explicitement restauré l’autonomie traditionnelle des communautés des forêts en matière de gouvernance de leurs forêts communautaires, avec une approche participative, décentralisée et démocratique22. Même si sa mise en œuvre a été compliquée, ce changement de politique a en général contribué à améliorer la vie des populations, la sécurité alimentaire locale et la protection de l’environnement. Malheureusement, l’administration s’est retranchée derrière ses pratiques bureaucratiques et a plus souvent résisté à la loi qu’elle n’a aidé les communautés locales.
Même si les PPC semblent particulièrement indiqués pour des actions à l’échelle locale ou municipale, il ne faut pas les cantonner à cette dimension « micro » ou à petite échelle. Des PPC pourraient être mis en place au niveau mondial par les États en interaction avec des fédérations ou des organismes de coordination des communs. L’initiative Médicaments contre les maladies négligées (Drugs for Neglected Diseases initiative, DNDi) en est un bon exemple. Il s’agit d’une organisation à but non lucratif qui travaille en coopération avec divers États, instituts de recherche et donateurs afin de surmonter les défaillances du système de production de médicaments23. Techniquement, l’initiative Médicaments contre les maladies négligées est un partenariat public-privé-commun (PPPC) car elle opère en étroite collaboration avec divers acteurs – gouvernements, recherche privée, communautés affectées par les maladies et donateurs. Le bon fonctionnement du partenariat tient au fait qu’il assemble dans la diversité autour d’objectifs partagés et garantit la participation de chacun à toutes les étapes du processus de recherche et de développement (R&D). Cet « objectif partagé » empêche les intérêts commerciaux de contrôler le processus de recherche et de production de médicaments et contribue à aligner les priorités de recherche sur les besoins humains.
Cette approche est vitale pour soigner les plus pauvres. Les maladies tropicales, par exemple, touchent principalement des personnes à faibles revenus. Les multinationales pharmaceutiques considèrent que la « demande de consommation » potentielle est trop faible pour justifier des investissements de recherche significatifs destinés à lutter contre des pathologies telles que la maladie du sommeil, le mycétome (une maladie défigurante qui entraîne des déformations et des amputations), la leishmaniose (une maladie parasitaire des tropiques), le paludisme (une maladie infectieuse transmise par les moustiques), ou encore le VIH pédiatrique.
Cependant, axer la R&D pharmaceutique sur les besoins humains n’est pas seulement important en matière de lutte contre les maladies les plus courantes dans les pays du Sud. Des initiatives de recherche comme DNDi pour le cancer, les maladies cardiaques et le diabète permettraient de nous affranchir de la propension de « Big Pharma » à privilégier les adaptations de médicaments existants plutôt qu’une recherche fondamentale plus risquée mais plus déterminante sur le plan médical. DNDi a fait remarquer qu’entre 2000 et 2011, sur les 850 nouveaux produits thérapeutiques approuvés dans le monde, seuls 4 % ciblaient des maladies négligées et 1 % seulement étaient de « nouvelles entités moléculaires » offrant de nouvelles possibilités de traitement24. DNDi remédie à ce type de problèmes en parrainant la recherche et le développement de médicaments que l’industrie pharmaceutique a renoncé à fabriquer.
Basée à Genève, en Suisse, et disposant de neuf bureaux dans le monde, DNDi a noué des partenariats créatifs avec des gouvernements, des instituts de recherche, des organisations de santé et l’industrie pharmaceutique pour lever des fonds, mener des recherches médicales et organiser des essais cliniques de nouveaux médicaments. En 2015, DNDi a livré six nouveaux traitements et a collecté 350 millions d’euros. D’ici à 2023, les promoteurs de cette initiative espèrent développer seize à dix-huit traitements avec un budget total de 650 millions d’euros25. Le travail de R&D mené avec plus de 160 partenaires dans le monde permettra à une mère séropositive en Afrique du Sud, une jeune femme atteinte de la maladie de Chagas en Bolivie ou un ouvrier souffrant du paludisme d’obtenir un traitement abordable. Comme le dit si bien le titre d’un documentaire sur l’initiative26, DNDi peut sauver une vie pour 1 dollar en empêchant qu’une entreprise ou un organisme de recherche n’ait de monopole sur un médicament qu’il ou elle a développé. Les médicaments peuvent ainsi être produits à un coût minimal dans les régions où les maladies sont répandues, ce qui permet d’en proposer un plus grand nombre aux personnes qui en ont besoin.
En tant que partenariat public-privé-communs, DNDi permet aux États de faire l’économie de subventions inutiles et d’« incitations » pour amener les entreprises à produire ce qui est nécessaire. En partageant les risques et le développement des infrastructures, les partenariats public-privé-commun réduisent radicalement les frais généraux tout en répondant à des besoins que les marchés auraient sinon ignorés. C’est ainsi que, par exemple, sur la base d’une recommandation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et en collaboration avec de nombreux partenaires, DNDi a mis au point un traitement abordable à dose unique qui simplifie le traitement du paludisme. Elle a travaillé avec le groupe Sanofi pour combiner deux principes actifs, l’artésunate et l’amodiaquine, dans une seule pilule appelée l’ASAQ. En collaboration avec Médecins sans frontières et d’autres acteurs, DNDi a ensuite supervisé le développement pharmacologique et clinique de l’ASAQ en Europe, en Afrique et en Asie, en testant son efficacité et sa tolérance chez les enfants. En 2010, l’OMS a homologué l’ASAQ, ouvrant la porte à sa production et à sa distribution à grande échelle. Les coûts de développement et de mise en œuvre sur huit ans, de l’ordre de 12 millions d’euros, sont relativement faibles. Les coûts de distribution sont considérablement réduits du fait que l’ASAQ ne peut pas être breveté. Le traitement est disponible au coût de production, soit moins de 1 dollar américain par adulte et moins de 50 cents américains par enfant. Au cours des quatre années suivant sa mise à disposition, quelque 500 millions de doses d’ASAQ ont été administrées à plus de 250 millions de personnes dans plus de trente pays africains.
Si DNDi est en mesure de réaliser des gains d’efficacité aussi radicaux, c’est parce qu’elle garantit que les traitements qu’elle développe et concède sous licence resteront perpétuellement exempts de redevance et non exclusifs. (Ces médicaments sont disponibles simultanément pour de nombreux producteurs, avec la possibilité d’accorder des sous-licences spécifiques pour des zones où une maladie est prévalente.) Les droits relatifs à la recherche et à la fabrication sont garantis dans le monde entier. Ces dispositions contribuent à rendre le transfert de technologie et la production moins coûteux. Au lieu de dépendre d’une seule usine, il peut y avoir autant de sources de production que nécessaire, ce qui contribue à rendre les médicaments plus accessibles. Les partenaires s’engagent à rendre le produit final disponible au prix coûtant, plus une marge minimale, dans tous les pays endémiques, quelles que soient leurs ressources.
Pour tirer parti des avantages d’un PPC (ou d’un PPPC), il est nécessaire de repenser la philosophie et la structure des procédures politiques et administratives. Cela requiert avant tout de comprendre la dynamique et les valeurs de la pratique des communs, et d’apprécier à sa juste valeur la puissance potentielle qu’il y a à fédérer et à faire coopérer des partenaires très différents. Dans la vie réelle, nous faisons face à des besoins souvent spécifiques et locaux. Un mécanisme national qui cherche à imposer une solution standardisée aura inévitablement une part de lourdeur, d’inefficacité et de rigidité. Un PPC satisfera les besoins de manière plus humaine en s’adaptant au contexte local et de manière distribuée, tout en respectant le caractère génératif des communs. Un PPC répond en priorité aux besoins élémentaires plutôt qu’aux contraintes institutionnelles ou politiques. Il laissera aux communs le temps de croître organiquement et encouragera le recours à des infrastructures distribuées qui se prêtent à de multiples usages. L’adaptation est plus facile lorsque la production et la fabrication reposent sur des éléments modulaires. Pour soutenir les PPC, l’État a pour rôle d’aider à réunir les partenaires potentiels et de les fédérer au sein des PPC en accélérant le co-apprentissage et la collaboration translocale.
Pour les institutions étatiques, cela engendre évidemment de nouveaux défis. Les bureaucraties sont habituées à diriger les activités des gens, et non à s’en remettre à eux. S’il peut être difficile pour les institutions étatiques d’accepter la valeur de la pratique des communs, cette reconnaissance a surtout des avantages. Les institutions y gagneront une plus grande confiance de la part de la population. Elles seront en mesure de répondre aux besoins par le biais de projets à moindre coût. Et elles sauront mobiliser les énergies créatives, la motivation et les savoirs situés et intégrés des citoyens qui, sinon, resteraient dormants.
Conclusion
Pratiquer les communs à grande échelle
Nous sommes face à une nouvelle frontière, celle du passage à l’échelle des pratiques sociales des communs. La tâche n’a rien d’impossible. Il existe de nombreux exemples concrets de communs, bien sûr, mais aucun modèle standard pour les développer systématiquement à grande échelle. Un tel modèle ne peut pas exister car chaque commun est toujours organiquement connecté à son contexte spécifique. L’adoption d’une nouvelle loi ou la mise en œuvre d’une nouvelle réglementation peut parfois être utile, mais cela ne suffira pas à opérer le « passage à l’échelle » des communs. Les solutions politiques ont un impact très limité si elles n’impliquent pas réellement les personnes dans leur vie réelle et n’encouragent pas leurs motivations intrinsèques et leur capacité d’autodétermination. Si elles veulent réellement encourager les communs, les politiques publiques ne peuvent être dissociées de la pratique des communs elle-même.
Une révision audacieuse de la conception et des structures des politiques publiques est donc indispensable. Les postulats de la politique majoritaire doivent être remis en cause. Tel qu’il est structuré actuellement, le système des partis repose sur une lutte concurrentielle pour obtenir 51 % des voix afin d’exercer ensuite tout le pouvoir. Cela signifie qu’une fois la majorité acquise, on peut largement ignorer ou minimiser les préoccupations des 49 % de la minorité, dont les droits politiques sont effectivement déniés jusqu’à l’élection suivante. La pratique des communs renvoie à une éthique politique différente, où les postures idéologiques et les jeux de pouvoir politique sont remplacés par le dialogue et la négociation autour de solutions pratiques. Les commoneurs cherchent à développer de nouvelles formes institutionnelles qui puissent reconnaître et soutenir les pratiques de commoning – un changement qui, avec le temps, peut créer un nouveau cadre politique général. L’objectif devrait être de réorienter la nature de l’activité politique afin qu’elle nourrisse de nouveaux types d’institutions et des dynamiques de coopération et de fédération entre communs (intercommoning). Des structures organiques intégrant le micro, le méso et le macro (plutôt que de les opposer) pourraient être construites, sur la base des idées exposées dans la première partie de notre livre. C’est ce qu’illustre notre image de l’Ontosemence (p. 70), qui tente de montrer comment notre compréhension de l’être lui-même affecte la façon dont nous imaginons et construisons le monde. Cette idée est au cœur de notre sujet. À partir d’un noyau d’ethos et de sensibilité puissants, l’éthique des communs se déploie en ramifications imprédictibles et adaptatives. Ce processus vivant de la pratique des communs apporte sa logique opérationnelle et son éthique à toutes les échelles où il se développe.
Après de nombreuses recherches, nous sommes arrivés à la conclusion qu’il y a vraiment très peu de choses qui ne peuvent pas être réimaginées, repensées et reconstruites du point de vue des communs. Beaucoup des communs que nous avons examinés dans ce livre ont été des rencontres totalement inattendues ! Buurtzorg pour les soins de proximité. Cecosesola, Park Slope Food Coop ou les AMAP pour des aliments frais locaux. Mietshäuser Syndikat pour le logement. Terre de Liens pour la protection intergénérationnelle des terres agricoles. WikiHouse pour la construction de nouvelles maisons. Open Source Ecology et Atelier Paysan pour les machines. Open Educational Resources pour les manuels et le matériel pédagogique. Goteo pour le financement de projets. Holochain comme alternative à la blockchain respectueuse des communs. Et ainsi de suite.
Comment tous ces communs ont-ils été rendus possibles ? Parce que des personnes ont pris au sérieux l’idée que leurs collaborations devaient être libres, équitables et vivantes. Plutôt que de s’en remettre à une idéologie ou à des modèles simplistes de ce qui était censé être fait, elles ont eu le courage de faire face à la complexité de situations réelles et de prendre en compte les opinions de chacun. Plutôt que d’adopter aveuglément des systèmes centralisés de pouvoir et d’organisation ou de s’accrocher à une « rationalité » et à une efficacité illusoires, les organisateurs de ces communs ont su voir comment chacun pouvait potentiellement contribuer à la résolution d’un problème, y compris sur la durée. Ils ont instauré une culture des communs qui ne se réduit pas à de simples mots ou intentions.
Nous avons essayé de distiller les dimensions essentielles du commoning dans notre triade de la vie sociale, de la Gouvernance par les pairs et de l’approvisionnement – l’univers de patterns qui structurent la culture des communs et la rendent vivante, même à grande échelle. Si le droit, les protocoles technologiques, les infrastructures et autres dispositifs peuvent jouer leur rôle pour canaliser l’énergie des communs, leur véritable limite est celle de notre imagination et de l’expérience collective. C’est pourquoi, lorsque l’on pense comme un commoneur, il peut être difficile de se rallier à un parti politique, surtout si ce dernier conçoit la politique comme une compétition. Les partis politiques sont trop profondément attachés à leurs principes programmatiques et idéologiques (appliqués sélectivement et parfois abandonnés, bien sûr !) pour comprendre les communs. Dans le monde actuel, les dirigeants politiques et les partis sont généralement focalisés sur l’accession au pouvoir et sur les préoccupations de la classe politique professionnelle, et peu enclins à questionner la capacité de la démocratie représentative et majoritaire à apporter des changements réels.
Après avoir lu cet ouvrage, il se peut que vous continuiez à considérer les communs comme peu susceptibles de nous aider à atteindre nos plus grandes ambitions de changement. Peut-être pensez-vous encore que les communs sont trop petits, trop fragmentés, trop peu orthodoxes ou trop marginaux pour faire la différence. Ou peut-être pensez-vous qu’un commun en exige trop de nous pour être vraiment opérationnel, ou bien qu’il faut trop de temps pour qu’il donne des résultats. Cependant, le pouvoir rebelle des communs – le désir d’un monde libre, équitable et vivant – n’est pas un rêve chimérique, comme nous l’avons montré dans les pages précédentes. Ce pouvoir est bien réel. Ses réalisations sont substantielles. Mais le monde politique et la société en général ont encore d’autres priorités pour l’instant, se cramponnant à des chimères en train de disparaître. Pour faire le saut vers le Communivers, nous devons apprendre à voir le monde à travers de nouvelles lentilles et à décrire cette réalité avec de nouveaux termes. C’est ainsi que nous commencerons à entrer dans la pratique des communs, c’est ainsi que nous construirons une culture Ubuntu. Le chemin à parcourir peut impliquer de renoncer à nos repères politiques familiers. Mais il signifie aussi rejoindre un mouvement de construction d’un nouveau monde et d’une nouvelle vision du monde réellement bénéfiques sur le long terme.
Remerciements
Ce texte reprend la section « Remerciements » de l’édition originale anglaise et allemande de 2019, avant le décès de Silke Helfrich en novembre 2021.
Aucun livre n’est un accomplissement solitaire. Un livre ne peut se développer qu’à l’intérieur d’un riche réseau d’amis et de collègues, de bienfaiteurs, de critiques, de conseillers, de relecteurs, de sources de recherche et de proches bienveillants.
Tout ce réseau forme comme un commun virtuel, rendant pos-
sibles la recherche, la réflexion, le débat, l’écriture et la révision qui ont donné naissance à cet ouvrage. L’une des joies d’achever un livre est l’opportunité de saluer les nombreuses personnes qui ont été indispensables à sa production.
La Fondation Heinrich-Böll (HBS) est à l’évidence notre partenaire le plus proche et le plus fidèle. Barbara Unmussig, présidente de HBS, et Heike Löschmann, alors directrice du département de politique internationale, ont été les premières, dès 2009, à affirmer leur engagement à travailler sur la thématique des communs. Toutes deux ont été des championnes indéfectibles des communs et de notre travail. Depuis que nous avons commencé à travailler à ce livre en 2016, l’attention et le soutien intenses de Joanna Barelkowska, qui a su garder le projet et nos esprits sur les bons rails, ont été une bénédiction. Jörg Haas, le nouveau directeur du département de politique internationale, a été un ardent défenseur de ce livre.
David Bollier exprime sa gratitude envers Peter Buffett et Jennifer Buffett, coprésidents de la Fondation NoVo, pour leur soutien indéfectible à ses travaux sur les communs, dont ce livre. Il souhaite également remercier Susan Witt, directrice du Schumacher Center for a New Economics, pour sa camaraderie, ses conseils et son engagement enthousiaste dans la réinvention des communs. Enfin, David souhaite remercier une fois de plus Norman Lear pour le soutien inébranlable et stimulant apporté à ses recherches et à son activisme sur les communs.
Silke Helfrich exprime sa profonde reconnaissance envers ses collègues de l’Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) de Potsdam, pour lui avoir offert un environnement de bienveillance et de créativité collective pendant plusieurs semaines en 2018. Elle souhaite remercier en particulier l’équipe AMA (A Mindset for the Anthropocene), Jessica Böhme, Man Fang, Carolin Fraude, Zachary Walsh et Thomas Bruhn, qui ont ouvert un espace pour discuter du rôle des communs dans la création d’un meilleur état d’esprit pour l’anthropocène et ont suggéré des améliorations à la version allemande du manuscrit.
Dès lors qu’une grande partie de notre réflexion sur les communs s’engageait dans des directions nouvelles, nous nous sommes appuyés sur les idées et la sagesse d’un large éventail de relecteurs – praticiens, universitaires, activistes ou autres – ayant une connaissance approfondie des diverses dimensions de la pratique des communs. Trois lecteurs particulièrement dévoués et consciencieux – Joanna Barelkowska, Julia Petzold et Wolfgang Sachs – ont lu la majeure partie du manuscrit à l’avance, identifiant certaines erreurs ou nous incitant gentiment à reconsidérer telle ou telle pensée ou formulation. Nous avons également bénéficié des commentaires avisés de Saki Bailey, Adelheid Biesecker, Bruce Caron, Jonathan Dawson, Gustavo Esteva Figueroa, Sheila Foster, Claudia Gómez-Portugal M., Samar Hassan, Bob Jessop, Alexandros Kioupkiolis, Kris Krois, Miguel Martinez, Silvia Maria Díaz Molina, Janelle Orsi, Jorge Rath, David Rozas, Neera Singh, Johann Steudle, Orsan Senalp, Simon Sutterlütti, John Thackara, Stacco Troncoso, Carlos Uriona, Ann Marie Utratel et Andreas Weber.
Comme de nombreux aspects des communs restaient sousexplorés dans la littérature universitaire, nous nous sommes souvent tournés vers des personnes ayant une expérience personnelle des sujets, des contextes ou des communs spécifiques que nous abordions. Nous sommes reconnaissants envers Laura Valentukeviciute et Katrin Kusche d’avoir partagé leurs savoirs sur les partenariats public-privé et de nous avoir aidés à imaginer des alternatives. La visite guidée que nous a offerte Paula Segal à la coopérative alimentaire de Park Slope, et à son assemblée générale, nous a permis de mieux comprendre cette entreprise. Dina Hestad a partagé avec nous de nombreuses pépites de sagesse durement acquises sur les mouvements de transformation. Nous avons également appris beaucoup de choses sur la réalité désordonnée des pratiques et les solutions trouvées par les gens ordinaires en interrogeant Rainer Kippe sur l’organisation SSM à Cologne ; Peter Kolbe sur Klimaschutz+ ; Amanda Huron, Sara Mewes, Johannes Euler et Jochen Schmidt sur les communs de logement ; Siri et Oscar Kjellberg sur Baskemölla Ekoby ; Natalia-Rozalia Avlona sur le réseau communautaire de Sarantoporo ; Bettina Weber et Tom Hansing sur les Offene Werkstätten (ateliers ouverts) ; et Izabela Glowinska et Paul Adrian Schulz sur Vivihouse.
À de nombreuses reprises, notre auto-éducation sur les communs a été grandement favorisée par la simple fréquentation de communautés de pratique. Ward Cunningham, Jon Richter et la communauté du wiki fédéré nous ont ouvert les yeux sur les énormes possibilités de cette plateforme technologique. De même, Eric Harris-Braun, Ferananda Ibarra et Jean Russell ont été aussi patients que brillants pour nous expliquer les protocoles Holochain. Au fil des ans, le Commons Strategies Group (dont nous sommes cofondateurs) a organisé un certain nombre d’ateliers Deep Dive qui nous ont permis de découvrir des penseurs, des militants et des champs d’expérimentation remarquables. Nous sommes reconnaissants à Michel Bauwens pour sa précieuse collaboration et pour les nombreuses idées qu’il a partagées lors de ces discussions. Nous remercions également les dizaines de participants à ces rencontres pour avoir partagé si librement leurs savoirs et nous avoir aidés à réfléchir à bien des questions épineuses concernant les communs.
L’école d’été sur les communs en Allemagne, et en particulier Heike Pourian, a réagi très vite aux premières ébauches de nos « patterns » de la pratique des communs. Ses membres nous ont aidés à confirmer que nous étions sur la bonne voie, nous ont incités à clarifier la problématique de chaque pattern et ont contribué à affiner leur formulation en allemand (en particulier Julia Petzold et Sandra Lustig). Il va sans dire qu’aucun d’entre eux n’est responsable des erreurs ou des mauvaises interprétations qui ont pu se glisser dans le texte.
Silke vivant en Allemagne et David aux États-Unis, nous avons dû imaginer des moyens créatifs pour organiser des rencontres physiques afin de donner tout leur sens à nos recherches et de développer nos idées. Heureusement, un certain nombre d’amis et de collègues nous ont aidés à trouver, ou nous ont offert, de merveilleux espaces de travail. À un stade critique de notre réflexion, Tilman Santarius et sa famille nous ont proposé leur élégante maison de Berlin, qui nous a servi d’incubateur pour une semaine de discussions. À Florence, Jason Nardi a organisé une charmante retraite à flanc de colline pour que nous puissions travailler, tout en nous accueillant lors de plusieurs repas merveilleux. Carlos Uriona et Matthew Glassman ont offert un espace et de riches discussions au Double Edge Theatre à Ashfield, Massachusetts.
La belle apparence de ce livre et ses illustrations téléchargeables sur le site Internet de la maison d’édition sont à mettre au crédit d’une petite équipe d’artistes et de designers talentueux. Deux étudiantes en design de l’université de Bolzano – Chiara Rovescala et Federica di Pietro, guidées par leurs professeurs, Kris Krois et Lisa Borgenheimer – ont conçu quelques illustrations graphiques de nos premiers patterns. Certaines de ces idées ont ensuite germé et ont été développées et enrichies dans les illustrations de Mercè M. Tarrés, qui a donné aux différents patterns des interprétations étonnamment intuitives. La conception de la couverture, par Mireia Juan Cuco, traduit également l’esprit de notre livre avec beaucoup d’élégance et d’énergie. Stacco Troncoso et Ann Marie Utratel, du collectif Guerrilla Media, ont supervisé l’ensemble du travail de conception et s’occuperont également de la traduction espagnole à venir. Leur présence et leur soutien constants ont été d’une grande importance pour nous au cours des années !
Les lecteurs de l’édition anglaise de Free, Fair, and Alive ne savent peut-être pas qu’une traduction allemande en a été produite immédiatement après la fin de chaque chapitre du livre. Nous en sommes redevables à notre dévouée traductrice Sandra Lustig, dont la transposition minutieuse de notre manuscrit, compte tenu des nombreux termes nouveaux que nous avons inventés, constitue un véritable exploit. Les idées tirées de la traduction ont souvent permis d’améliorer le manuscrit anglais. (La traduction allemande a été publiée par Verlag au printemps 2019.)
Il est difficile de trouver un éditeur qui comprenne les communs et qui soit prêt à joindre le geste à la parole en utilisant une licence Creative Commons. Nous nous estimons chanceux d’avoir trouvé transcript Verlag en Allemagne et New Society Publishers en Colombie-Britannique, au Canada, tous deux engagés en faveur d’un plus grand partage des savoirs malgré un contexte commercial difficile.
Pour finir, nous devons chacun reconnaître notre dette envers ceux qui nous sont chers.
Silke : Jacques, tout au long du long marathon de ce livre, lorsque je plongeais dans des eaux intellectuelles profondes ou que j’étais épuisée par trop d’heures passées devant mon écran d’ordinateur, tu as toujours été là avec patience et encouragement pour me remettre sur les rails, comme toi seul peux le faire. Tu m’as permis d’observer ce qui se passe lorsqu’une personne découvre « le commoneur en lui ».
David : Merci encore, chère Ellen, pour ton soutien indéfectible pendant mes nombreux voyages, mes recherches et le marathon d’écriture prolongé qui a été nécessaire pour produire ce livre !
David Bollier, Amherst, Massachusetts, États-Unis
Silke Helfrich, Neudenau, Bade-Wurtemberg, Allemagne Janvier 2019
Annexe A. Notes Sur La Méthodologie D’identification Des Patterns Du Commoning
Nous menons nos recherches sur les communs depuis de nombreuses années en dehors du cadre universitaire. Dans cette section, nous expliquons comment nous avons développé la triade du commoning comme cadre d’analyse1. Rappelez-vous que notre objectif n’est pas de définir les communs. Cela ne rendrait pas justice à notre sujet ni à notre propos. Étant donné que les communs sont des systèmes vivants, ce ne sont pas des entités figées qui pourraient simplement être définies une fois pour toutes. Nous nous sommes donné comme objectif de décrire plus précisément la dynamique des communs en tant que forme spécifique de comportement, et comme un moyen de satisfaire ses besoins et de façonner son environnement et sa société. Pour ce faire, nous avons cherché à identifier quels éléments récurrents caractérisaient les comportements dans le contexte de communs différents. En d’autres termes, nous nous sommes demandé s’il existait des logiques d’action qui soient typiques des communs.
L’idée que l’ordre du monde se reflète dans des patterns est un concept philosophique et empirique développé par le mathématicien, architecte et philosophe Christopher Alexander dans le cadre de sa célèbre théorie et méthodologie des patterns. Il l’a décrite en détail dans son ouvrage en quatre volumes intitulé The Nature of Order2. Nous avons appliqué cette approche aux communs dans notre anthologie de 2015 Patterns of Commoning3. Ces motifs récurrents ou patterns doivent être identifiés, et non pas inventés. Leur identification a pour objectif de rendre visible quelque chose de latent. Il s’agit là d’un élément important de la recherche sur les patterns. Les explorer requiert une observation patiente de la pratique et se fait en plusieurs étapes. D’un point de vue méthodologique, afin de rendre compréhensible le caractère vivant des processus, il ne faut pas séparer la rationalité de l’émotion ou des intuitions fondées sur l’expérience pratique4. La recherche de patterns évite ces problèmes en appréhendant les phénomènes de manière holistique. Elle reconnaît que l’abstraction pure ne rend pas justice à la riche complexité de la vie. L’identification de patterns est également précieuse parce qu’elle permet de prendre la pleine mesure des connaissances tacites5 d’un profane, qui sont souvent traitées avec condescendance ou ignorées par les « experts ». Pour élaborer nos patterns du commoning, nous avons donc fait confiance aux savoirs situés.
Pour identifier un pattern, il faut se concentrer sur ce qui relie, sur ce que les choses ont en commun, plutôt que sur ce qui les distingue. Dans cette perspective, les phénomènes ou les problèmes ne sont pas observés de manière délimitée et isolée, mais au contraire dans l’intégralité de leur contexte. Un pattern ne s’applique en effet que dans un contexte donné ou dans des circonstances similaires. Il n’existe pas de pattern décontextualisé6. En ce qui concerne les patterns de phénomènes sociaux, l’objectif est d’identifier les comportements (ou, en termes plus abstraits, les « logiques d’action ») qui peuvent contribuer à la réussite des interactions et au renforcement des relations. Comme les relations sont multidirectionnelles – c’est-à-dire qu’elles peuvent avoir à la fois des effets positifs sur un aspect d’une situation et des effets négatifs sur un autre –, la notation formelle d’un pattern exige de spécifier les autres patterns qui lui sont connexes. Cela rend les liens entre les patterns plus clairs, mais nous avons choisi de ne pas utiliser la notation formelle des patterns dans ce livre ; nous ne pouvons qu’y faire allusion. De toute façon, le lecteur pourra facilement imaginer comment les différents patterns individuels sont connectés entre eux. L’ensemble de ces interconnexions forme un langage de patterns (qui reste à élaborer).
Au niveau épistémologique, une approche fondée sur le langage des patterns garantit que l’esprit et le corps sont tous deux engagés dans la cognition. Dans le processus de formulation d’un nom pour les patterns, à mesure que nous parvenons à comprendre les concepts à travers l’échange par le biais du langage – à mesure que nous percevons ce qui était obscur et pas encore mis en mots –, nous expérimentons simultanément des moments de résonance dans nos corps7. Nous faisons cette expérience de la résonance lorsqu’une énergie singulière émerge et que nous sentons de manière réfléchie une congruence entre notre expérience, notre sensation et notre discernement. Lorsqu’un nombre suffisant de personnes interrogées, de participants à des ateliers, de lecteurs ou d’autres personnes ressentent cette même résonance à propos d’un pattern, et que leurs réactions s’alignent pour ainsi dire les unes sur les autres, on peut être certain de tenir là un pattern bien formulé. Et pourtant, le pattern qui en résulte reste par principe ouvert et adaptable, ne serait-ce que parce que les systèmes vivants sont toujours en train de changer et d’évoluer. (Voir la section sur la validation ci-dessous.) Aucun pattern n’est une vérité « une fois pour toutes ».
Au-delà de la méthodologie générale d’exploration de patterns, nous devons aussi aborder les méthodes utilisées pour construire la triade du commoning. Elle aussi ne peut être présentée ici que très brièvement. Entre juin 2014 et décembre 2017, neuf ateliers de prospection de patterns ont été organisés avec des participants âgés de 20 à 70 ans, issus de contextes et de cultures variés. Les ateliers eux-mêmes étaient structurés de manière à présenter aux participants la logique de l’approche par les patterns en les invitant à poser des questions à propos de chacun d’eux :
-
- Quel est le contexte?
- Quelle est exactement, dans ce contexte, l’essence du problème récurrent?
- Quelles solutions existent à ce problème?
- Qu’est-ce qui est commun aux solutions qui réussissent?
- Comment cette essence commune peut-elle être mise en paroles afin de former le nom d’un pattern?
Un nom de pattern robuste (c’est-à-dire qui offre une description précise d’un motif récurrent de pratiques sociales) est avant tout court et succinct. Il est exempt de ponctuation. Il peut user d’abréviations faciles à comprendre (par exemple, FAQ) et de néologismes. Il s’appuie sur un verbe pour souligner le processus (ou la pratique) et évite les clichés flous. Un bon nom de patterns est également adaptable, ce qui signifie qu’il peut être modifié ultérieurement. Les noms qui s’écartent de ces caractéristiques sont donc monnaie courante.
En complément des ateliers, douze entretiens semi-structurés ont été menés avec des groupes d’une à quatre personnes. La plupart d’entre elles étaient des diplômés universitaires actifs engagés depuis longtemps dans des projets de communs – certains depuis cinquante ans. Deux entretiens ont été particulièrement approfondis. Comme pour les ateliers, l’objectif était de rendre visibles des pratiques utilisées dans différents contextes pour résoudre des problèmes similaires, et de vérifier si ces patterns de pratique pouvaient être identifiés dans les solutions efficaces. La structure et le caractère des entretiens ainsi que le type de questions posées sont décrits en détail dans le mémoire de master de Silke Helfrich (voir note 1). Les personnes ont été interrogées sur ce qui était réellement fait dans les initiatives de commoning, et non sur ce qu’elles pensaient. L’objectif était en effet d’identifier et de documenter des descriptions d’actions, et non de recueillir des opinions. Les entretiens ont été structurés à l’avance en fonction des trois domaines de notre recherche de patterns – vie sociale, Gouvernance par les pairs et approvisionnement (chapitres 4-6). Les questions se concentraient sur les problèmes typiques de chacun de ces domaines et étaient affinées à chaque itération. Lorsque nous avons commencé à tester les patterns déjà identifiés, nous avons également demandé aux personnes interrogées si ces patterns leur semblaient justes (test de résonance).
Questions posées lors des entretiens
Comme le but était d’enquêter sur des comportements, et non sur des attitudes, il était important d’éviter de poser des questions simples auxquelles il est facile de répondre par oui ou non, ainsi que des questions qui obligeraient les répondants à rationaliser leurs comportements8. La plupart des questions concernaient les manières de faire. Elles cherchaient à circonscrire le domaine du problème, à être aussi concrètes que possible et à ne pas suggérer des réponses particulières. Elles faisaient référence à des problèmes souvent observés lors d’interactions sociales dans un contexte de communs. Les questions concernant la Gouvernance par les pairs étaient dérivées des huit principes de conception développés par Elinor Ostrom, ainsi que de nos propres observations. Lorsque nous avons développé les questions concernant l’approvisionnement par les communs, nous sommes partis des éléments de base nécessaires à tout processus créatif/productif (par exemple, les ressources naturelles, les savoirs, les informations, les activités humaines, le travail, etc.).
Questions concernant les interactions sociales
-
- Comment réussir à trouver un objectif commun ? Quel est le rôle des valeurs ?
- Comment obtenez-vous les contributions nécessaires ?
- Comment est conçue la relation entre donner et recevoir ?
- Comment maintenez-vous la qualité des relations sociales ? Existe-t-il certains usages, des pratiques ou des conventions ?
- Sur quels types de savoirs vous appuyez-vous ?
- Comment vivez-vous votre relation à la nature ?
- Comment gérez-vous les conflits ?
- Par quels mécanismes les règles et les structures restent-elles appropriées et adaptées ?
Questions concernant la gouvernance
-
- Comment se négocie la tension entre la pression pour l’exploitation commerciale de toutes sortes de ressources, d’une part, et la pratique des communs, d’autre part ? Comment éviter que les communs ne soient entièrement gouvernés ou dirigés par l’argent ?
- Comment reliez-vous les objectifs et les valeurs ?
- Fixez-vous des frontières ? Dans quelle mesure sont-elles incontournables ?
- Comment vos décisions sont-elles prises ?
- Comment gérez-vous l’information, les savoirs, le code et le design ?
- Comment vos structures organisationnelles sont-elles agencées ? Offrent-elles une protection contre les abus de pouvoir ?
- Comment les biens dont vous êtes propriétaires sont-ils régis ?
- Comment faites-vous pour que vos actions soient transparentes ?
- Quelles formes de financement utilisez-vous ? Est-ce qu’elles relèvent elles-mêmes des communs ? Les flux d’argent renforcent-ils les communs ?
- Comment contrôlez-vous le respect des règles ?
- Comment gérez-vous les violations des règles ?
Questions concernant la production en commun
-
- Qui supporte le risque de la production ?
- Y a-t-il une séparation entre les producteurs et les utilisateurs ? Comment les rôles sont-ils définis et remplis ?
- Comment ce qui est disponible est-il réparti ?
-
- selon qu’il s’agit de choses qui augmentent à mesure que de plus en plus de gens les utilisent (par exemple, les savoirs, les logiciels) ?
- selon qu’il s’agit de choses qui s’épuisent à mesure que de plus en plus de gens les utilisent (par exemple, la terre, la nourriture, l’argent) ?
-
- Comment ce qui est disponible est-il réparti ?
-
- dans un contexte social interpersonnel où il est facile d’avoir une vue d’ensemble de la situation ?
- dans un contexte où les relations sont anonymes et où il est difficile d’avoir une vision d’ensemble de la situation ?
-
- Qui détermine le prix, et sur quelle base, dans des transactions de type commercial ?
- Comment concevez-vous votre travail ? Comment répartissez-vous les tâches et comment valorisez-vous et évaluez-vous toutes les activités ?
- Qui sont les bénéficiaires de vos outils et instruments? À quels objectifs répondent-ils ?
- Parmi les infrastructures existantes, lesquelles utilisez-vous et pourquoi ? Est-ce qu’elles servent vos objectifs ?
- Comment créez-vous des choses matérielles ou immatérielles nouvelles ?
En nous appuyant sur ces entretiens, sur nos connaissances préalables, sur la littérature relative aux communs et sur les ateliers, nous avons pu commencer à « verbaliser » – c’est-à-dire à nommer des patterns de manière adéquate. Ensuite a commencé un processus de boucle rétroactive. Même si le processus a été quelque peu différent d’un pattern à l’autre9, nous avons réalisé au moins six cycles pour chaque pattern. Les profils des personnes consultées étaient différents – depuis un spécialiste de la durabilité jusqu’à un étudiant travaillant avec des patterns, en passant pat un éducateur luimême force motrice derrière une communauté de commoneurs et par les participants à la sixième université d’été des communs en langue allemande. Nous avons également discuté entre nous des noms de patterns à maintes reprises. Chaque boucle a fait émerger de nouvelles idées de corrections, de déplacements, d’ajouts et de suppressions, ce qui a conduit à un grand nombre d’adaptations. Nous sommes persuadés que ces itérations ainsi que la combinaison de méthodes utilisées ont permis de générer des résultats robustes.
On trouvera ci-dessous un exemple typique de la procédure suivie. Cet exemple montre comment nous avons combiné les méthodes, de manière quelque peu différente dans chaque cas, selon le nombre et le type de situations de décision critiques. Afin d’illustrer notre processus de travail, nous avons choisi le pattern s’assembler dans la diversité autour d’objectifs partagés (Bring Diversity into Shared Purpose en anglais), qui se situe dans la sphère de la Gouvernance par les pairs. Cet exemple n’est pas seulement représentatif des nombreuses itérations par lesquelles chaque nomination de pattern doit passer. Il souligne également l’importance relative des valeurs que sont supposés partager les commoneurs avant de pratiquer les communs. Lorsque nous avons commencé à explorer ce sujet, nous avons préféré nous intéresser au rôle que les objectifs et les valeurs jouent véritablement dans les communs qui fonctionnent bien, plutôt que de chercher à savoir comment des personnes diverses finissent, en agissant ensemble, par partager des finalités pratiques.
Brève description des étapes
Cette description reconstitue le processus de recherche utilisé pour inventer le nom du pattern en allemand. Ce processus était similaire mais pas identique à celui qui était suivi pour formuler le nom anglais. On trouvera donc les noms allemands du pattern dans plusieurs itérations à côté de leur traduction anglaise respective. Le point de départ des processus allemand et anglais était toutefois le même. En tant qu’auteurs, nous avons déduit que le pattern serait :
GEMEINSAMEN ZWECK & GEMEINSAME WERTE ERKLÄREN / DECLARE SHARED PURPOSE & VALUES / DÉCLARER LES OBJECTIFS ET LES VALEURS PARTAGÉS
Sur cette base, nous nous sommes lancés dans de nombreux cycles de test, de correction et d’adaptation. 1. Décrire le problème : identifier le rôle des objectifs et des valeurs communes.
-
- S’orienter vers un nom de pattern (première itération, dans ce cas par déduction). Le but est que le nom exprime l’idée que les objectifs et les valeurs doivent être clairs lorsque les gens agissent en commun : DÉCLARER LES OBJECTIFS ET LES VALEURS PARTAGÉS
- Intégrer le nom du pattern dans son contexte ; le justifier à l’aide d’exemples afin d’en faire ressortir la pertinence pratique ; préparer une description textuelle et l’envoyer à des experts (lecteurs tests) et à des personnes interviewées. Être attentif à tout retour dissonant parmi les participants au processus et rechercher un consensus sur le nom du pattern.
- Réaliser un entretien téléphonique semi-structuré avec un spécialiste des sciences sociales et un praticien des communs, George E., le 4 décembre 2017. Selon l’expérience de cette personne, lorsqu’un conflit survient, l’existence de buts et de valeurs ne peut être prise pour un acquis. De même, l’existence de buts partagés n’est pas décisive pour qu’une action commune fonctionne. C’est un fait social que tout commun doit faire face à une diversité de perspectives et de valeurs en son sein. Les gens peuvent partager des motivations et des raisons de se réunir, mais on ne peut pas présumer de l’existence de buts et de valeurs communs à long terme. Comme l’a dit la personne interrogée : « On peut présupposer qu’il y a des objectifs ou des buts spécifiques à court terme. Par exemple, la collecte de signatures pour une pétition […] avant la deuxième semaine de février. Mais ces “objectifs” ou “buts” ne sont pas des fins en soi. Des motifs, des forces contraignantes nous poussent dans une certaine direction et nous pouvons exprimer ces “motifs” sous forme de raisons.
Au lieu de demander : “Pour quoi faire ?”, nous demandons : “Pourquoi ?” » 5. Faire évoluer le nom du pattern (deuxième itération).
VIELFALT FÜR COMMONS-ZWECKE AUFGREIFEN / BRING DIVERSITY INTO SHARED PURPOSE / ALIGNER LA DIVERSITÉ SUR DES OBJECTIFS COMMUNS
- Discuter avec un expert et faire évoluer la rédaction (troisième itération de la dénomination du pattern).
VIELFALT ZU COMMONS-ZWECKEN NUTZEN / USING DIVERSITY FOR COMMONS PURPOSES / UTILISER LA DIVERSITÉ POUR DES BUTS COMMUNS
- Discuter avec un autre expert (15 juin 2018) et tester la résonance de cet intitulé. Un conflit émerge. Cette version du nom de pattern ne « sonne pas bien » ou bien ne va au cœur de ce qui doit être exprimé (quatrième itération de la dénomination du pattern).
VIELFALT ZUM GEMEINSAMEN VERWEBEN / INTERWEAVE DIVERSITY TO FORM WHAT IS COMMON / ENTRELACER LA DIVERSITÉ POUR FORMER CE QUI EST COMMUN
-
- Réviser tous les noms des patterns par un expert/chercheur en sciences sociales (26 mars 2018) Il y a des retours sur d’autres patterns, mais pas sur celui-ci. Pourtant, l’étape 7 pointe le fait qu’une nouvelle révision est nécessaire.
- À la fin juin 2018, les participants à l’université d’été réfléchissent collectivement à la résonance du nom du pattern. Discussion de groupe incluant des praticiens et des théoriciens ; les éléments inductifs sont renforcés (cinquième itération du nom du pattern).
SICH IN VIELFALT GEMEINSAM AUSRICHTEN / BRINGDIVERSITY INTO SHARED PURPOSE / S’ASSEMBLER DANS LA DIVERSITÉ AUTOUR D’OBJECTIFS PARTAGÉS
Cette cinquième version du nom du pattern correspond aux savoirs et aux expériences apportées au cours des différentes étapes et boucles de rétroaction et sonne bien. Le nom du pattern est publié (cf. chapitre 5).
Dans tous les cas, les processus d’identification des patterns ont été similaires. Les étapes et les procédures d’acquisition de connaissance sont illustrées dans le diagramme suivant. Examinons, à titre d’exemple, la procédure pour le pattern s’assembler dans la diversité autour d’objectifs partagés.
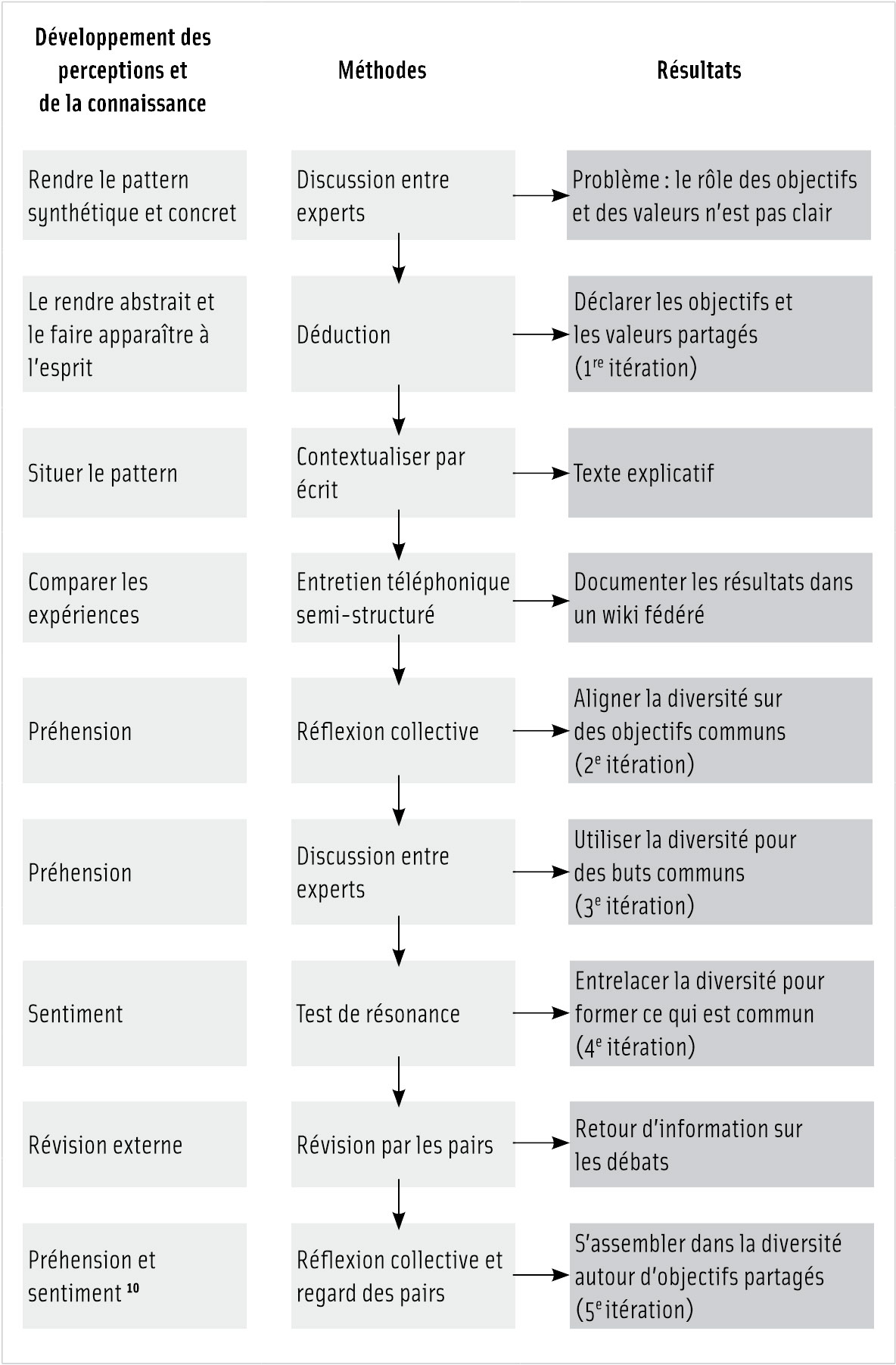
Validation et procédure de dérivation du pattern
Dans le cadre de ce processus, les gens évaluent généralement l’exactitude et la validité du nom donné au pattern de manière subjective, car, comme le disent Christopher Alexander et ses collègues, « certains sont plus vrais, plus profonds, plus certains que d’autres11 ». Ils ont donc proposé de distinguer les patterns qui paraissent « plus vrais » en leur attribuant deux, un ou aucun astérisque. Le nombre d’astérisque est un indicateur de la probabilité que le choix du nom corresponde à « un véritable invariant ». Nous avons appliqué cette méthode pour évaluer les noms de patterns identifiés dans les chapitres 4 à 6 de cet ouvrage. Les résultats sont dans le tableau suivant. Dans le cas d’un nom de pattern sans astérisque (voir première colonne), nous pensons avoir trouvé une formulation qui, comme le dit Alexander, « incarne une propriété commune à toutes les manières possibles de résoudre le problème énoncé ». Cela signifie qu’il est fondamentalement impossible de résoudre correctement le problème énoncé sans « façonner l’environnement d’une manière ou d’une autre » selon le pattern correspondant (ibid.).
Dans le cas des noms de patterns avec un seul astérisque, nous supposons, avec Alexander, « avoir fait une partie du chemin en vue de l’identification d’un tel invariant » et « qu’avec un travail minutieux, il sera certainement possible d’améliorer la solution ». (ibid., XIV). Les patterns avec deux astérisques nécessitent un examen plus approfondi en vue de les améliorer.
Dans la deuxième colonne, on trouvera les procédures les plus importantes utilisées pour dériver les patterns ainsi que les concepts abstraits à partir desquels ils ont été déduits (dans les cas où la déduction a été notre méthodologie principale).
| Interaction sociale | Procédure de dérivation des patterns (dans l’ordre de leur prédominance) |
| Contribuer à des objectifs et à des valeurs partagés | Inductive et déductive |
| Caontribuer sans contrainte | Inductive |
| Pratiquer une réciprocité accommodante | Inductive et déductive (à partir du concept de réciprocité) |
| Ritualiser l’être-ensemble | Inductive |
| Faire confiance aux savoirs situés | Déductive (à partir du concept de connaissance de la situation) et inductive |
| Approfondir sa communion avec la nature** | Déductive (à partir de la compréhension de base de la relation entre l’homme et la nature) et inductive |
| Aborder les conflits en prenant soin des relations* | Inductive |
| Réfléchir à sa propre gouvernance* | Inductive |
| Gouvernance par les pairs | |
| Distinguer communs et commerce | Inductive |
| S’assembler dans la diversité autour d’objectifs communs | Inductive et déductive (à partir des hypothèses du participant sur la « nature humaine ») |
| Créer des membranes semi-perméables* | Déductive (à partir du premier principe de conception d’Elinor Ostrom) et inductive |
| Décider par consentement* | Inductive et déductive (à partir du troisième principe de conception d’Ostrom) |
| Diffuser les savoirs généreusement | Inductive |
| Miser sur l’hétérarchie* | Déductive (à partir de la théorie de la gouvernance, critique de la hiérarchie) et inductive |
| Gouvernance par les pairs (suite) | |
| Relationaliser la propriété | Inductive |
| Pratiquer la transparence dans un espace de confiance | Inductive |
| (Se) financer en harmonie avec les communs* | Déductive et inductive |
| Co-veiller au respect des règles et appliquer des sanctions graduelles | Inductive et déductive (à partir des quatrième et cinquième principes de conception d’Ostrom) |
Créer les communs | |
| Partager les risques de l’approvisionnement | Inductive |
| Fabriquer et utiliser conjointement | Inductive |
| Mettre en commun et partager | Inductive |
| Mettre en commun, plafonner et répartir | Inductive |
| Mettre en commun, plafonner et mutualiser | Inductive |
| Nouer des échanges marchands en préservant sa souveraineté* | Inductive |
| Reconnaître la dignité égale de toutes les tâches* | Déductive (à partir du concept de soins, critique du travail salarié) et inductive |
| Utiliser des outils conviviaux | Déductive (à partir du concept de convivialité 12 et des outils conviviaux selon Ivan Illich et Andrea Vetter 13) et inductive |
| S’appuyer sur des structures distribuées | Inductive |
| Produire de manière cosmo-locale* 14 | Inductive et déductive (à partir du concept de la production cosmo-locale) |
| Adapter et renouveler de manière créative | Inductive |
Le processus de recherche
Pour finir, on peut présenter les décisions qui ont dû être prises au cours du processus de recherche sous la forme d’un diagramme de flux. Il commence par l’identification d’un problème récurrent dans le contexte d’un commun et se termine par une évaluation telle que celle qui est décrite ci-dessus. Ce diagramme a été préparé, une fois de plus, à partir de l’exemple s’assembler dans la diversité autour d’objectifs partagés, mais son approche s’applique à tous les patterns.
Chaque étape a été documentée rapidement et sous des formes diverses : documentation complète des discussions de l’atelier, documentation individuelle des résultats de l’atelier, y compris la notation formelle des patterns, documentation des entretiens (dans les archives des auteurs), notes des ateliers, des discussions d’experts et des discussions éditoriales.
De l’ontologie à la méthodologie
Comme on peut le voir, l’ensemble de la procédure de recherche de patterns a un fondement théorique qui incorpore et reflète une ontologie relationnelle et procédurale. La méthodologie prend donc en compte la relation d’un phénomène avec son contexte et son existence concrète dans des mondes vécus réels. La méthodologie est également ouverte et adaptable, ce qui permet une autoréflexion individuelle et collective sur son exactitude et sa révision ultérieure.
-
- Onto-épistémologie : processus relationnels différenciés, épistémologie évolutive du vivant, processus génératifs.
- Théories : communs / théorie des patterns.
- Méthodologie : exploration de patterns / holisme méthodologique.
- Méthodes : ateliers de patterns, entretiens semi-structurés, révision par les pairs, « test de résonance », conversations avec des experts, réflexion collective.
- Résultats : patterns du commoning.
Cette méthodologie suggère également que les patterns ne fonctionnent pas comme des briques de Lego qui s’assemblent seulement de manière prédéterminée. Les façons de combiner les éléments individuels en solutions réussies ne sont pas préconçues. C’est pourquoi des combinaisons créatives d’idées peuvent donner lieu à des résultats originaux qui ne faisaient pas partie des solutions individuelles.
Processus de décision au cours de la recherche
Zone de problème 1 → Détection du problème → Atelier → Induction / déduction / abduction → n = 1
Nom → Description et justification → Vérification (révision par les pairs, discussion technique, structure partielle, entretien, discussion collective) => zone de problème 2
Le miroir du soi (test) → Conflit – oui / non → Nom → Révision → Nom / nom* / nom**
Travailler avec les patterns
Le processus de formulation de patterns permet de discerner un ordre dans la diversité des processus de commoning : il constitue la dynamique essentielle du commoning. Il fournit également un vocabulaire et une méthodologie partagés, permettant ainsi aux commoneurs de créer délibérément cet ordre. C’est la raison pour laquelle l’établissement d’un lien entre les patterns et les communs est si fructueux pour les chercheurs et les personnes qui souhaitent faire progresser la théorie et la pratique des communs. Les praticiens peuvent utiliser les modèles pour :
-
- trouver un vocabulaire et une justification philosophique aux collaborations qu’ils ont menées tout au long de leur parcours ;
- structurer des processus d’autoréflexion et identifier leurs forces et leurs faiblesses ;
- reprendre les bonnes idées et les utiliser pour résoudre leurs propres problèmes – en d’autres termes, appliquer des patterns sous une forme adaptée à leur propre contexte ;
- développer des patterns spécifiques adaptés à leur propre contexte.
Les chercheurs peuvent aussi utiliser les patterns pour :
-
- les examiner, puis les approfondir, afin de contribuer à la conceptualisation du commoning ;
- concevoir des entretiens et des questions de recherche ;
- mettre en application tous les patterns génériques ensemble en tant que recherche.
Le résultat peut permettre aux chercheurs d’identifier et d’analyser les processus sociaux, institutionnels et économiques dans un contexte concret du point de vue des communs, de la même manière que les principes de conception d’Elinor Ostrom ont été utilisés pour comparer les règles institutionnelles.
Silke Helfrich
Neudenau, 4 février 2019
Annexe B. Communs Et Outils De Commoning Mentionnés Dans Ce Livre
Acequias (Mexique, Sud-Ouest américain). Systèmes d’irrigation communautaires au Mexique, Nouveau-Mexique et au Colorado, p. 133 et 157.
Agriculture soutenue par la communauté ou AMAP (dans le monde entier). Forme d’agriculture collective dans laquelle des familles partagent les risques de la production avec les agriculteurs en achetant des parts de la récolte au début de la saison de culture, p. 206. Voir aussi Solidarische Landwirtschaft (Allemagne), p. 202, et teikei, p. 37.
Artabana (Suisse, Allemagne, Autriche). Fédération de projets communautaires d’assurance-maladie, sorte de partenariat public-communs, p. 191.
Atelier Paysan (France, monde). Groupe francophone d’ingénieurs, d’agriculteurs et d’autres acteurs qui construisent des outils conviviaux et des machines libres pour l’agriculture à petite échelle, p. 133. Bangla Pesa (Kenya). Banque de quartier au Kenya qui fait partie du système de crédit Sarafu, p. 191. Banque du temps d’Helsinki (Finlande). Banque du temps qui permet à plus de 3 000 membres d’échanger des compétences et des services, p. 12.
Bisses du Valais (Suisse). Réseau séculaire de canaux dans les Alpes suisses, géré comme un commun, qui amène l’eau des montagnes aux champs des agriculteurs.
Buurtzorg (Pays-Bas et monde entier). Organisation gérée par des pairs qui fournit des soins infirmiers à domicile à l’échelle d’un quartier, p. 33-34.
Cecosesola (Venezuela). Fédération « omni-commun » d’une trentaine de coopératives urbaines et rurales dans l’État de Lara qui fournissent de la nourriture, des soins, des transports et des services d’enterrement communaux à des centaines de milliers de personnes, p. 216-218.
Chartes des communs. Documents créés par des personnes pour constituer un commun en définissant les objectifs, les pratiques et les principes fondamentaux qui guideront le groupe, p. 374.
CoBudget (Internet). Plateforme collaborative grâce à laquelle les membres d’un groupe peuvent suivre un budget partagé et répartir les fonds entre les propositions, p. 158.
Community Land Trust (Fiducie Foncière communautaire) (États-Unis, Canada). Forme d’organisation qui permet à une fiducie d’acquérir des terres et de les retirer du marché à perpétuité, réduisant ainsi les coûts du logement et des petites entreprises, p. 255.
Crowdfunding. Forme populaire de financement collaboratif de projets de communs, comme Goteo, p. 103.
Data Commons for a Free, Fair, and Sustainable World (« Communs de données pour un monde libre, équitable et durable »). Charte commune pour les programmeurs qui se consacrent à la création de bases de données cartographiques partageables, p. 363.
EnCommuns (France). Réseau de producteurs de bases de données fondées sur les communs, p. 183. Enspiral (Nouvelle-Zélande et monde entier). Guilde en réseau de centaines d’entrepreneurs sociaux et d’activistes qui ont construit des plateformes open source telles que Loomio et CoBudget et expérimentent de nouvelles formes de Gouvernance par les pairs, p. 133.
Fab Labs (monde entier). Ateliers ouverts dans lesquels des scientifiques, des ingénieurs, des artistes numériques et des amateurs utilisent des outils informatiques pour expérimenter et réaliser des prototypes de processus et de machines, p. 193.
Freifunk (Allemagne). Réseau de points d’accès Wi-Fi gratuits dans plus de 400 communautés, p. 363. General Public License (GPL). Licence standard que les détenteurs de droits d’auteur sur des logiciels peuvent utiliser pour autoriser le partage, la copie et la modification de leurs programmes, p. 303-304. GNU/Linux (Internet). Système d’exploitation informatique développé par un groupe de programmeurs associés à l’adaptation d’Unix par Linux Torvalds et aux programmes GNU du pionnier du logiciel libre Richard Stallman, p. 106.
Goteo (Espagne, Europe et Amérique latine). Plateforme de crowdfunding dédiée aux communs qui a levé plus de 7,3 millions d’euros pour plus de 900 projets de communs (2018), p. 103.
Guerrilla Media Collective (monde entier). Groupe engagé de traducteurs, de designers et de travailleurs des médias, p. 184.
guifi.net (Catalogne). Infrastructure Wi-Fi fondée sur les communs qui fournit un accès Internet à des dizaines de milliers de personnes, p. 38.
Hackerspaces (monde entier). Espaces physiques dans lesquels des hackers de tous types se rencontrent, co-apprennent et travaillent ensemble sur divers projets dans le cadre d’un réseau souple organisé par les pairs.
Haenyeo (Corée du Sud). Communauté intergénérationnelle de femmes plongeuses qui combinent des compétences en plongée, des traditions spirituelles et un engagement communautaire dans la récolte de coquillages au large de l’île de Jeju, p. 157.
Industrie soutenue par la communauté. Extension du modèle des AMAP qui vise à renforcer l’économie régionale en remplaçant les produits importés par des produits fabriqués par des entreprises locales offrant des salaires décents et utilisant des processus de fabrication durables.
Initiative Drugs for Neglected Diseases (initiative Médicaments contre les maladies négligées, DNDi) (échelle mondiale). Projet collaboratif pour la recherche et le développement de médicaments fondé sur les besoins effectifs et collaborant avec des gouvernements, des instituts de recherche et des communautés affectées par la maladie, p. 399.
Iriaiken (Japon). Philosophie (iriai) et pratique traditionnelles du commerce au Japon qui font référence à la propriété collective de zones non arables telles que les montagnes, les forêts, les marais et les pêcheries en mer, p. 312.
Jardin communautaire Niciaci (Italie). Jardin et aire de jeux gérés par le voisinage au cœur du centreville de Florence, p. 243.
King of the Meadows (Pays-Bas et pays limitrophes). Projet néerlandais de gestion commune de la biodiversité liée au patrimoine culturel, p. 360.
Lake District (Écosse/Royaume-Uni). Commun de droits de pâturage pour les moutons qui repose sur des parcelles de prairies en haute altitude partagées par de nombreux agriculteurs, p. 176.
Licence de production par les pairs (Peer Production License). Licence qui accorde la libre utilisation du matériel sous licence à tout participant au commun, à l’exception des utilisateurs commerciaux, qui doivent payer, p. 112.
Licences Creative Commons (monde entier). Ensemble de licences gratuites que les détenteurs de droits d’auteur peuvent utiliser pour rendre leurs œuvres créatives et leurs informations légalement disponibles pour la copie, le partage et la réutilisation sans frais, p. 93.
Lida Pesa (Kenya). Monnaie détenue et contrôlée par les habitants au Kenya, qui fait partie du système de crédit Sarafu, p. 191.
Logiciels libres et open source (FLOSS). Logiciels qui peuvent être librement partagés, copiés et modifiés grâce à des licences telles que la GPL (voir ci-dessous). Le terme « libres » ne fait pas référence au prix, mais à un engagement philosophique en faveur de la liberté. L’open source est axé sur les avantages pratiques, p. 105.
Loomio (Internet). Plateforme logicielle conçue par la communauté Enspiral pour faciliter la délibération et la prise de décision en ligne, p. 158.
Mietshäuser Syndikat (Allemagne et Autriche). Fédération d’environ 140 immeubles de logements locatifs retirés du marché immobilier, chacun d’entre eux restant abordable à long terme et géré par des pairs, p. 295.
Minga (pays andins). Mobilisations bien organisées d’amis et de voisins pour relever des défis communs tels que la récolte de nourriture ou la réparation d’une route, p. 317.
Monnaies communautaires (monde). Le Bangla Pesa et le Lida Pesa, deux monnaies de quartier au Kenya, font partie des 6 000 monnaies alternatives dans le monde, p. 191.
Movimento Sem Terra (Mouvement brésilien des travailleurs ruraux sans terre, MST) (Brésil). Mouvement visant à redistribuer des terres aux travailleurs ruraux pour une agriculture à petite échelle, qui a créé des colonies de terres occupées pour des centaines de milliers de familles, p. 179.
NextCloud (Internet). Communauté mondiale ouverte de programmeurs développant un logiciel d’hébergement de fichiers partageables, p. 187.
Oberallmeindkorporationen (Suisse). Sociétés indépendantes autorisées par la loi cantonale suisse depuis plus de mille cent ans à gérer les terres communes ; similaires aux iriaiken au Japon, p. 261.
Obştea (Roumanie). Forêts traditionnelles appartenant à la communauté et gérées par elle.
Open Commons Linz (Autriche). Projet qui fournit des hotspots Wi-Fi gratuits, un « nuage municipal » accessible à tous les citoyens, des données ouvertes produites par les agences gouvernementales, entre autres ressources numériques, p. 363.
Open Prosthetics Project (États-Unis). Réseau d’utilisateurs, de concepteurs et de bailleurs de fonds qui mettent à disposition de tous des prothèses relevant du domaine public, p. 208.
Open Source Ecology (États-Unis, monde entier). Communauté mondiale d’agriculteurs qui conçoivent et construisent des équipements agricoles non propriétaires, modulaires et pouvant être obtenus localement en utilisant les principes de l’open source.
Open Source Seed (Allemagne, Suisse, international). Licence qui accorde aux utilisateurs de semences le droit de partager les améliorations de sélection si elles sont mises à la disposition du public et si les utilisateurs suivants sont tenus de faire de même, p. 310.
Open Source Seed Initiative (États-Unis, monde entier). Communauté d’agriculteurs et de sélectionneurs de semences qui s’engagent à partager les semences et les améliorations dérivées comme alternatives aux semences propriétaires, p. 310.
OpenSPIM. Collaboration open source entre scientifiques et ingénieurs pour construire une microscopie à illumination plane sélective (Selective Plane Illumination Microscopy, SPIM), technologie spécialisée utilisée dans la recherche biologique, p. 228.
Parc de la pomme de terre (Pérou). Système socio-juridique de gestion durable de la biodiversité des pommes de terre dans les terres au nord de Cusco, supervisé par les indigènes quechuas, p. 133.
Park Slope Food Coop (Brooklyn, New York). Grande coopérative alimentaire créée en 1973 qui s’appuie sur une main-d’œuvre non rémunérée et démarchandisée pour mettre en commun et partager les avantages d’un supermarché avec plus de 17 000 membres, p. 278.
Partenariats public-communs. Accords initiés par des commoneurs en coopération avec des organismes publics pour travailler ensemble sur des problèmes spécifiques à long terme.
Permaculture (monde entier). Ensemble intégré de principes de conception pour les pratiques agriculturelles qui reflètent la dynamique holistique des écosystèmes.
Production cosmo-locale (monde entier). Collaboration fondée sur la philosophie de l’open source en vue de partager les conceptions et les connaissances à l’échelle mondiale et de produire localement. Exemples : Open Desk, Open Building Institute, OpenSPIM, p. 196, Wikispeed.
Public Library of Science (Internet). Ensemble de journaux de haute qualité, évalués par des pairs et en libre accès, sur une variété de sujets scientifiques, tous disponibles gratuitement sous des licences Creative Commons.
Ressources éducatives libres (REL). Livres, essais, programmes d’études, programmes, plans de cours, ensembles de données et autres matériels qui peuvent être librement utilisés, partagés et modifiés. Sarafu Credit System (Kenya). Réseau de monnaies de quartier au Kenya, p. 191. Voir aussi Bangla Pesa, Lida Pesa.
Sociocratie. Système de Gouvernance par les pairs qui cherche à garantir une participation et une transparence maximales dans les délibérations et les prises de décision du groupe, principalement en recherchant le consentement, et non le consensus, pour les décisions du groupe, p. 169.
Sozialistische Selbsthilfe Mühlheim (SSM) (Allemagne). Projet auto-organisé de travail et de résidence qui vise à rendre la vie plus digne pour tous, y compris les personnes non qualifiées et les malades mentaux.
Subak (Bali). Système efficace d’irrigation des cultures de riz géré par les paysans et synchronisant les pratiques sociales et religieuses avec les périodes de plantation et de récolte, p. 133.
Teikei (Japon). Système d’agriculture soutenue par la communauté du Japon, p. 37.
Terre de Liens (France). Organisation qui achète des terres arables pour les retirer définitivement du marché, les conserver en fiducie et les mettre à la disposition des agriculteurs, p. 190.
Traditional Knowledge Digital Library (Inde, Internet). Base de données constituée pour documenter les connaissances médicinales traditionnelles et ainsi contrecarrer les brevets internationaux inappropriés. Unitierra, ou Universidad de la Tierra en Oaxaca (Mexique). Université désinstitutionnalisée créée par des communs pour des communs.
Villes en transition (monde entier). Mouvement de personnes à l’esprit pragmatique qui cherchent à construire des systèmes d’approvisionnement locaux plus résilients en prévision des problèmes que le pic pétrolier et l’effondrement du climat vont entraîner.
Water Management Commons (Zimbabwe). Système coopératif de gestion de l’eau dans le district de Nkayi, dans l’ouest du Zimbabwe.
Wiki fédéré (Internet). Réseau de créateurs dont le contenu sur des wikis personnels peut être facilement et légalement partagé avec d’autres utilisateurs de wikis fédérés, évitant ainsi les problèmes éditoriaux et interpersonnels de la gestion de wikis centralisés, p. 228.
WikiHouse (Royaume-Uni, monde entier). Communauté d’architectes, de designers et d’autres personnes qui partagent des plans de maisons et les moyens de les construire, avec l’aide de onze chapitres dans le monde, p. 34.
Wikipédia (Internet). Encyclopédie web collaborative qui compte environ 72 000 contributeurs actifs travaillant sur plus de 4 millions d’articles dans 302 langues, p. 246.
Wikispeed (Internet, sites distribués). Communauté mondiale d’ingénieurs qui conçoivent des véhicules à moteur open source tels que des voitures de course, des taxis et des véhicules de distribution du courrier, p. 208.
Zanjera (Philippines). Système d’irrigation fondé sur les communs qui utilise des moyens sociaux pour assurer une répartition équitable de l’eau et le respect des règles communautaires, p. 176.
Les lecteurs trouveront d’autres descriptions de communs dans David Bollier et Silke Helfrich (dir.),
Patterns of Commoning, Levellers Press, 2015. www.patternsofcommoning.org
Annexe C. Les Huit Principes De Conception D’elinor Ostrom Pour Des Communs Viables
La regrettée professeure Elinor Ostrom a identifié huit principes de conception clés pour la réussite des communs, qu’elle a énoncés dans son livre Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action (1990).
- Des limites clairement définies
Les individus ou les ménages qui ont le droit de prélever des unités de ressources sur la ressource commune doivent être clairement définis, tout comme les limites de la ressource commune elle-même. - Congruence entre les règles d’appropriation et d’approvisionnement et les conditions locales
Les règles d’appropriation limitant le temps, le lieu, la technologie et/ou la quantité d’unités de ressources sont fonction des conditions locales et des règles d’approvisionnement liées aux besoins de main-d’œuvre, de matériaux et/ou d’argent. - Formes de choix collectif
La plupart des individus concernés par les règles opérationnelles peuvent participer à la modification de ces règles. - Surveillance
Les contrôleurs, qui vérifient activement les conditions de la ressource commune et le comportement des appropriateurs, sont responsables devant les appropriateurs ou sont les appropriateurs euxmêmes. - Sanctions graduelles
Les appropriateurs qui enfreignent les règles opérationnelles sont susceptibles de se voir infliger des sanctions graduelles (en fonction de la gravité et du contexte de l’infraction) par d’autres appropriateurs, par des fonctionnaires responsables devant ces appropriateurs, ou par les deux. - Mécanismes de résolution des conflits
Les appropriateurs et leurs représentants ont un accès rapide à des instances locales peu coûteuses pour résoudre les conflits entre appropriateurs ou entre les appropriateurs et leurs représentants. - Reconnaissance minimale du droit à s’organiser
Les droits des appropriateurs à concevoir leurs propres institutions ne sont pas remis en cause par des autorités gouvernementales externes. Pour les ressources communes qui font partie de systèmes plus vastes : - Entreprises imbriquées
Les activités d’appropriation, d’approvisionnement, de surveillance, de sanction, de résolution des conflits et de gouvernance sont organisées en plusieurs couches d’entreprises imbriquées.
NOTE DE L’INTRODUCTION
- George Monbiot, “Don’t Let the Rich Get Even Richer on the Assets We All Share”, The Guardian, 27 septembre 2017. https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/sep/27/rich-assets-resourcesprosperity-commons-george-monbiot
NOTES DU CHAPITRE 1
- Michael Tomasello, Why We Cooperate, MIT Press, 2009, p. 4. Voir aussi les conférences de Tomasello, “What Makes Us Human?” (https://www.youtube.com/watch?v=9vuI34zyjqU) et “What Makes Human Beings Unique?” (https://www.youtube.com/watch?v=RQiINQiAn4o).
- Samuel Bowles et Herbert Gintis, The Cooperative Species: Human Reciprocity and Its Evolution, Princeton University Press, 2011. Un autre ouvrage utile sur la coopération sociale : Richard Sennett, Together: The Rituals, Pleasures and Politics of Cooperation, Yale University Press, 2012.
- Garrett Hardin, “The Tragedy of the Commons”. Science, vol. 162, n° 3859, décembre 1968, p. 12431245.
- Lewis Hyde, Common as Air: Revolution, Art, and Ownership, Farrar, Straus and Giroux, 2010, p. 44.
- Michael Kimmelman, “Refugee Camp for Syrians in Jordan Evolves as a Do-It-Yourself City”, New York Times, 4 juillet 2014. https://www.nytimes.com/2014/07/05/world/middleeast/zaatari-refugeecamp-in-jordan-evolves-as-a-do-it-yourself-city.html
- www.buurtzorg.com
- Ernst & Young, “Business Case, Buurtzorg Nederland”, 2009. transitiepraktijk.nl/files/maatschappelijke %20business%20case%20buurtzorg.pdf
- “Home Care by Self-Governing Nursing Teams: The Netherlands’ Buurtzorg Model”, The Commonwealth Fund, 29 mai 2015. https://www.commonwealthfund.org/publications/case-study/ 2015/may/home-care-self-governing-nursing-teams-netherlands-buurtzorg-model
- Un bon aperçu de la littérature scientifique sur Buurtzorg est donné par Harri Kaloudis, “A first attenpt at a systematic overview of the public record in English on Buurtzorg Nederland (Part A – Buurtzorg’s performance)”, 25 août 2016. https://medium.com/@Harri_Kaloudis/a-first-attempt-ata-systematic-overview-of-the-public-record-on-buurtzorg-nederland-part-a-ff92e06e673d
- KPMG International, “Value walks: Successful habits for improving workforce motivation and productivity”, 2012. http://www.publicworld.org/wp-content/uploads/2015/10/kpmg-buurtzorg.pdf
- transitiepraktijk.nl/files/maatschappelijke%20business%20case%20buurtzorg.pdf
- Alastair Parvin, “Architecture for the People by the People”, TED Talk, 23 mai 2013. https://www.youtube.com/watch?v=Mlt6kaNjoeI
- Ivan Illich, Tools for Conviviality, Harper & Row, 1973, p. 23.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Teikei
- Dan Gillmor, “Forget Comcast. Here’s the DIY Approach to Internet Access”, Wired, 20 juillet 2016. https://www.wired.com/2016/07/forget-comcast-heres-the-diy-approach-to-internet-access/
- 16. Cité dans ibid.
- Andreas Weber, Enlivenment: Towards a fundamental shift in the concepts of nature, culture and politics, Fondation Heinrich-Böll, 2013. https://www.boell.de/en/2013/02/01/enlivenment-towardsfundamental-shift-concepts-nature-culture-and-politics
- Christopher Alexander, The Nature of Order: An Essay on the Art of Building and the Nature of the Universe, 4 vol., Center for Environmental Structure, 2002-2004.
NOTES DU CHAPITRE 2
- Nancy Pick, Curious Footprints: Professor Hitchcock’s Dinosaur Tracks & Other Natural History Treasures at Amherst College, Amherst College Press, 2006, p. 2.
- Cette citation est souvent attribuée au juge Oliver Wendell Holmes, Jr., mais aussi à d’autres : https:// quoteinvestigator.com/2012/04/13/taxes-civilize/
- Thurman Arnold, The Folklore of Capitalism, Yale University Press, 1937, p. 118.
- Voir, par exemple, Elisabeth Wehling, Politisches Framing. Wie eine Nation sich ihr Denken einredet— und daraus Politik macht, Cologne, 2016, p. 191 : « Frames haben einen ideologisch selektiven Charakter. » Voir aussi George Lakoff, Moral Politics: How Liberals and Conservatives Think, University of Chicago Press, 2002, et Don’t Think of an Elephant: Know Your Values and Frame the Debate, Chelsea Green Publishing, 2014.
- John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money (1936), Prometheus Books, 1997, p. viii.
- E. P. Thompson, Customs in Common, Penguin Books, 1993, p. 159.
- Uskali Mäki, The Economic World View: Studies in the Ontology of Economics, Cambridge University Press, 2001.
- Margaret Stout, “Competing Ontologies: A Primer for Public Administration”, Public Administration Review, vol. 72, n° 3, mai-juin 2012, p. 388-398.
- Des théoriciennes féministes de la politique, telles que Carole Pateman dans son livre The Sexual Contract (1988), ont souligné que l’idée même de contrat social reflétait des normes patriarcales, comme l’autonomie de l’individu, l’égalité supposée de tous de négocier un contrat équitable, la notion de contrat comme moyen de faire progresser la liberté, le caractère supposément séparé et inférieur de la sphère privée.
- On peut trouver un excellent résumé de l’évolution de la pensée scientifique et juridique occidentale et de ses implications pour les communs dans Fritjof Capra et Ugo Mattei, The Ecology of Law: Toward a Legal System in Tune with Nature and Community, Berrett-Koehler, 2015.
- Carl Schmitt, Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty (1921), MIT Press, 1985, p. 36 : “All significant concepts of the modern theory of the state are secularized theological concepts, not only because of their historical development, in which they were transferred from theology to the theory of the state, whereby, for example, the omnipotent God became the omnipotent law-giver, but also because of their systematic structure.”
- Stout, “Competing Ontologies”, art. cité, p. 393.
- James Buchanan, The Economics and the Ethics of Constitutional Order, University of Michigan Press, 1991, p. 14.
- Andreas Karitzis, “The Decline of Liberal Politics”, in Anna Grear et David Bollier (dir.), The Great Awakening, Punctum Press, 2019.
- Arturo Escobar, Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds, Duke University Press, 2018.
- Stout, “Competing Ontologies”, art. cité, p. 389.
- Sam Lavigne, “Taxonomy of Humans According to Twitter”, The New Inquiry, 5 juillet 2017. https:// thenewinquiry.com/taxonomy-of-humans-according-to-twitter/
- Cathy O’Neil, Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy, Crown, 2016.
- Brian Massumi, Ontopower: War, Powers and the State of Perception, Duke University Press, 2015.
- Anne Salmond, “The Fountain of Fish: Ontological Collisions at Sea”, in David Bollier et Silke Helfrich (dir.), Patterns of Commoning,Levellers Press, 2015, p. 309-329. https://patternsofcommoning. org/the-fountain-of-fish-ontological-collisions-at-sea/
- Andrea J. Nightingale, “Commons and Alternative Rationalities: Subjectivity, Emotion and the (Non) rational Commons”, in Bollier et Helfrich (dir.), Patterns of Commoning, op. cit., p. 297-308. https:// patternsofcommoning.org/uncategorized/commons-and-alternative-rationalities-subjectivityemotion-and-the-nonrational-commons/
- Métaphore utilisée par Ludwig Wittgenstein pour se référer aux ontologies.
- Voir, par exemple, Vijaya Nagarajan, “On the Multiple Languages of the Commons: A Theoretical View”, Worldviews,vol. 21, n° 1, janvier 2017, p. 41-60.
- Marilyn Strathern, The Gender of the Gift, University of California Press, 1988, p. 13. Nous sommes redevables à Lewis Hyde d’avoir attiré notre attention sur l’œuvre de Strathern, Marriott et LiPuma.
- Ibid., p. 340.
- Ibid., p. 165.
- Cf. Martha Woodmansee et Peter Jaszi, “The Law of Texts: Copyright and the Academia”, College English, vol. 57, n° 7, novembre 1995, p. 769, cité dans Lewis Hyde, Common as Air: Revolution, Art, and Ownership, Farrar, Straus Giroux, 2010, p. 177-178.
- John Swansburg, “The Self-Made Man: The story of America’s most pliable, pernicious, irrepressible myth”, Slate, 29 septembre 2014. https://www.slate.com/articles/news_and_politics/history/2014/09/ the_self_made_man_history_of_a_myth_from_ben_franklin_to_andrew_carnegie.html
- Thomas Widlok, Anthropology and the Economic of Sharing, Routledge, 2016, p. 24.
- Les philosophes écoféministes comme Donna Haraway et Val Plumwood, entre autres, ont contesté l’idée de l’individu autonome en mettant l’accent sur les profondes interdépendances entre les humains et la nature ainsi que sur les communautés situées. Plumwood écrit (Environmental Culture: The Ecological Crisis of Reason, Routledge, 2002, p. 9) : “To the extent that we hyper-separate ourselves from nature and reduce it conceptually in order to justify domination, we not only lose the ability to empathize and to see the non-human sphere in ethical terms, but also get a false sense of our own character and location that includes an illusory sense of autonomy.”
- Voir aussi Mike Telschow, Townships and the Spirit of Ubuntu, Clifton Publications, 2003.
- John Mbeti, African Religions and Philosophies, Doubleday, 1970, p. 141.
- L’auteur Pagan Kennedy écrit : “According to Dr. Thomas Frieden, the former director of the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, ‘since 1900, the average life span in the United States has increased by more than 30 years; 25 years of this gain have been attributed to public health advances.’ That’s why we should all fight for other people’s health. Your decisions can affect when I die, and vice versa” New York Times, 11 mars 2018. https://www.nytimes.com/2018/03/09/opinion/sunday/ longevity-pritikin-atkins.html
- Rabindranath Tagore, The Religion of Man, Martino Fine Books, 2013, p. 1.
- Martin Buber, I and Thou (1923), Touchstone, 1971.
- Martin Luther King, Jr., “Letter from a Birmingham Jail”, 16 avril 1963. https://www.csuchico.edu/ iege/_assets/documents/susi-letter-from-birmingham-jail.pdf
- Rachel Louise Carson, “Undersea”, Atlantic Monthly, septembre 1937, p. 55-67. https://www. researchgate.net/publication/309354897_Undersea_-_Rachel_Carson
- Voir, par exemple, Massimo De Angelis, Omnia Sunt Communia, Zed Books, 2017 ; Daniel Christian Wahl, Designing Regenerative Cultures, Triarchy Press, 2016 ; Wolfgang Hoeschele, Wirtschaft neu erfinden: Grundlegung für ein Ökonomie der Lebensfülle, Oekom Verlag, 2017.
- Wesley J. Wildman, “An Introduction to Relational Ontology”, 15 mai 2006. https://wesleywildman. com/wordpress/wp-content/uploads/docs/2010-Wildman-Introduction-to-Relational-Ontologyfinal-author-version-Polkinghorne-ed.pdf
- Eric D. Beinhocker, The Origin of Wealth: Evolution, Complexity and the Radical Remaking of Economics, Harvard University Press, 2006, p. 167-168.
- Cette idée est très proche du concept de « patterns » élaboré par Christopher Alexander, comme nous l’expliquons dans le chapitre 1.
- Stuart Kauffman, The Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution, Oxford University Press, 1993. Voir aussi l’entrée Wikipédia : https://en.wikipedia.org/wiki/Stuart_Kauffman
- Les termes « auto-organisation » et « autopoiesis » sont sans doute problématiques parce qu’ils supposent l’action autonome d’individus, alors qu’en réalité tout est imbriqué dans des contextes plus vastes d’interconnexion et d’interdépendance. C’est pourquoi nous utilisons le terme de « Gouvernance par les pairs » plutôt qu’« autogouvernance ». Cependant, si l’on suit la philosophe Donna Haraway dans son livre Staying with the Trouble, l’autopoiesis est complétée par la sympoiesis (« deveniravec »). Il en résulte une friction générative entre êtres interactifs et intra-actifs.
- Voir, par exemple, Terrence W. Deacon, Incomplete Nature: How Mind Emerged from Matter, W. W. Norton, 2012. Résumé ici : https://en.wikipedia.org/wiki/Incomplete_Nature. Voir aussi Andreas Weber, Biology of Wonder: Aliveness, Feeling and the Metamorphosis of Science, New Society Publishing, 2016.
- Deacon, Incomplete Nature, op. cit., p. 310.
- Kate Raworth, Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st Century Economist, Chelsea Green Publishing, 2017.
- Andreas Weber, Matter and Desire: An Erotic Ecology, Chelsea Green Publishing, 2017, p. 22.
- Ibid., p. 29.
- Stacey Kerr, “Three-Minute Theory: What is Intra-Action?”, 19 novembre 2014. https://www. youtube.com/watch?v=v0SnstJoEec
NOTES DU CHAPITRE 3
- Frank Seifart, “The Structure and Use of Shape-Based Noun Classes in Miraña [Northwest Amazon]”, thèse de doctorat, 2005. https://pure.mpg.de/rest/items/item_402010_3/component/file_402009/ content
- David Bollier, “The Rise of Netpolitik: How the Internet is Changing International Politics and Diplomacy”, Aspen Institute, Communications and Society Program, 2003, p. 27-28. http://www. bollier.org/rise-netpolitik-how-internet-changing-international-politics-and-diplomacy-2003
- 3. Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (1962), University of Chicago Press, 4e éd., 2012.
- Ludwik Fleck, Genesis and Development of a Scientific Fact (1935), University of Chicago Press, 1979, p. 28.
- Ibid., p. 27.
- Ibid., p. 38-39.
- Voir l’œuvre séminale de Gary Becker, Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education (1964), 3e éd., University of Chicago Press, 1993.
- Wibke Bergemann, « Letzte worte Was wir verlieren, wenn eine Sprache stirbt », 1er mai 2018. https:// www.deutschlandfunk.de/letzte-worte-was-wir-verlieren-wenn-eine-sprache-stirbt-100.html
- Robert Macfarlane, Landmarks, Penguin Books, 2015, p. 39.
- Ibid., p. 311.
- Ibid., p. 18.
- Ibid., p. 20.
- Jonathan Rowe, “It’s All in a Name”, 26 janvier 2006. http://jonathanrowe.org/its-all-in-a-name
- 14. Daniel Nettle et Suzanne Romaine, Vanishing Voices: The Extinction of the World’s Languages, Oxford University Press, 2000.
- Tim Dee, “Naming Names”, Caught by the River, 24 juin 2014. https://www.caughtbytheriver.net/ 2014/06/naming-names-tim-dee-robert-macfarlane/
- Voir, par exemple, George Lakoff, Moral Politics: How Liberals and Conservatives Think, 3e éd., University of Chicago Press, 2016 ; Lakoff et Mark Johnson, Metaphors We Live By, University of Chicago Press, 2003 ; Lakoff, The All New Don’t Think of an Elephant: Know Your Values and Frame the Debate, Chelsea Green Publishing, 2014.
- 1eremy Lent, The Patterning Instinct: A Cultural History of Humanity’s Search for Meaning, Prometheus Books, 2017, p. 277-292.
- Elisabeth Wehling, Politisches Framing. Wie eine Nation sich ihr Denken einredet—und daraus Politik macht, Cologne, 2016, p. 84-85.
- Fleck, Genesis and Development of a Scientific Fact, op. cit., p. 84.
- Raymond Williams, Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, Fontana, 1976.
- John Patrick Leary, “Keywords for the Age of Austerity: Innovation”, 27 février 2014. https://jpleary. tumblr.com/post/78022307136/keywords-for-the-age-of-austerity-innovation
- Kate Reed Petty, “Is It Time to Retire the Word ’Citizen’? », Los Angeles Review of Books, 22 avril 2017. https://blog.lareviewofbooks.org/essays/time-retire-word-citizen/
- Wolfgang Sachs, “Development: The Rise and Decline of an Ideal” (article pour l’Encyclopedia of Global Environmental Change), Wuppertal Paper n° 108, Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, août 2000. https://epub.wupperinst.org/frontdoor/deliver/index/docId/1078/file/WP108.pdf
- 24. Miki Kashtan, Reweaving Our Human Fabric: Working Together to Create a Nonviolent Future, Fearless Heart Publications, 2015, p. 379.
- Ibid., p. 181.
- https://www.sociocracyforall.org/sociocracy/
- Entrée Wikipédia ”Holacracy”. https://en.wikipedia.org/wiki/Holacracy
- C. Otto Scharmer, The Essentials of Theory U: Core Principles and Applications, Berrett-Koehler, 2018.
- 29. Voir l’entrée “Scale” dans David Fleming, Lean Logic: A Dictionary for the Future and How to Survive It, Chelsea Green Publishers, 2017, p. 412-414.
- Voir les entrées “Intermediate Economy”, “Regrettable Necessities” et “Intensification Paradox” dans ibid., p. 224-227, p. 389-391 et p. 219-220.
- Phrase inscrit sur la façade de l’université de Gand en solidarité avec la Conférence de Paris sur les changements climatiques, décembre 2015. http://arthistoryteachingresources.org
- Arturo Escobar, “Commons in the Pluriverse”, in David Bollier et Silke Helfrich (dir.), Patterns of Commoning, Levellers Press, 2015, p. 348-360. https://patternsofcommoning.org/commons-in-thepluriverse/. Voir aussi Escobar, Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds, Duke University Press, 2018.
- Alan Rosenblith, “Scarcity Is an Illusion, No Reality”, 30 septembre 2010. http://alanrosenblith. blogspot.com/2010/09/scarcity-is-illusion-no-really.html
- James Suzman, Affluence Without Abundance: The Disappearing World of the Bushmen, Bloomsbury, 2017.
- Le Directory of Open Access Journals incluait 13 154 revues en accès ouvert à la date du 9 mai 2019, contenant plus de 3,9 millions d’articles. https://doaj.org
- https://creativecommons.org/use-remix
- Les stratégies commerciales astucieuses de certains éditeurs académiques comme Elsevier et Sage illustrent le danger de se focaliser sur le caractère ouvert plutôt que sur une véritable pratique des communs. Ils autorisent souvent la publication d’articles scientifiques sous licence Creative Commons, mais seulement après avoir fait payer aux auteurs des frais exorbitants. C’est une forme dégradée d’accès ouvert qui exploite les chercheurs dans l’optique de maximiser les profits plutôt que de les reconnaître comme des commoneurs. Les publications fondées sur les communs, par contraste, cherchent à minimiser les coûts pour tous les participants, à maximiser les avantages du partage gratuit ou à faible coût, et donc à rendre l’information plus largement disponible.
- Un livre de 2017 de Paul Stacey et Sarah Hinchliff Pearson, Made With Creative Commons, examine divers types d’œuvres créatives soumises à des licences Creative Commons licenses qui n’en sont pas moins des réussites commerciales. https://creativecommons.org/use-remix/made-with-cc/
- Pierre Dardot et Christian Laval, Commun. Essai sur la révolution au xxie siècle, La Découverte, 2015, p. 23.
- James C. Scott, Against the Grain: A Deep History of the Earliest States, Yale University Press, 2017.
- https://openstreetmap.org
- Cité par John M. Culkin dans ”A Schoolman’s Guide to Marshall McLuhan”, The Saturday Review, 18 mars 1967, p. 53 et 70.
- Peter Barnes, Capitalism 3.0: Guide to Reclaiming the Commons, Berrett-Koehler, 2006.
- “The pure cost-based process is […] implicitly a life-destroying process”, écrit Christopher Alexander, car “it interferes with our freedom to do what is right”. Alexander, The Nature of Order, vol. II : The Process of Creating Life, Center for Environmental Structure, 2002, p. 501-502.
- Voir, par exemple, https://www.cosmolocalism.eu
- Lewis Hyde, Common as Air: Revolution, Art, and Ownership, Farrar Straus Giroux, 2010, p. 35.
- Lynn Margulis, “Symbiogenesis and Symbionticism”, in Lynn Margulis et René Fester (dir.), Symbiosis as a Source of Evolutionary Innovation: Speculation and Morphogenesis, MIT Press, 1991, p. 1-14.
NOTES DE L’INTRODUCTION DE LA PARTIE II
- John C. Thomas, “A Socio-Technical Pattern Language for Sustainability”, IBM T.C. Watson Research, Vancouver, 2011.
- Christopher Alexander, The Nature of Order, vol. II : The Process of Creating Life, Center for Environmental Structure, 2002, p. 176.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Axiom
- Pour en savoir plus sur les patterns universels de l’interaction sociale, voir David West, “Patterns of Humanity”, intervention à la conférence PurplSoc, Krems (Autriche), 2017.
- Un pattern a une description formelle structurée – que nous n’utilisons pas dans ce livre – consistant en plusieurs éléments : notamment le nom du pattern, une description du contexte et du problème, une illustration, un exemple, les forces positives et négatives, et les patterns qui lui sont liés. Ces descriptions structurées varient énormément selon le domaine concerné. Mais le premier élément de toute véritable description d’un pattern est toujours le même. C’est son nom : l’expression succincte de bonnes solutions à un problème récurrent. Dans ce livre, nous utilisons souvent le mot « pattern » comme raccourci pour le pattern formel, alors qu’en fait nous faisons référence au nom du pattern.
- Par exemple (comme nous le verrons dans les chapitres suivants), les trois patterns mettre en commun et partager, mettre en commun, plafonner et répartir et mettre en commun, plafonner et mutualiser que nous décrivons dans le chapitre 6 se réfèrent les uns aux autres et en sont une extension. Certains patterns rendent les tensions existantes explicites, comme distinguer communs et commerce et nouer des échanges marchands en préservant sa souveraineté. D’autres patterns se complètent les uns les autres. Ce que nous voulons souligner ici, c’est qu’il n’y a pas de pattern isolé des autres.
- International Journal of the Commons. https://www.thecommonsjournal.org
NOTES DU CHAPITRE 4
- Pascal Gielen, “Introduction: There’s a Solution to the Crisis”, in Gielen (dir.), No Culture, No Europe— On the Foundations of Politics, Valiz, p. 22.
- J. K. Gibson-Graham, The End of Capitalism (As We Knew It): A Feminist Critique of Political Economy (1996), University of Minnesota Press, 2006, p. xvi.
- Gielen, “Introduction: There’s a Solution to the Crisis”, art. cité, p. 14.
- Lewis Hyde, The Gift: Imagination and the Erotic Life of Property, Vintage Books, 1979, p. 16.
- Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, 1990, p. 44.
- Michael Polanyi, Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy, University of Chicago Press, 1958 ; The Tacit Dimension, University of Chicago Press, 1966. Voir aussi https://en.wikipedia. org/wiki/Tacit_knowledge
- Frank Fischer, Citizens, Experts and the Environment: The Politics of Local Knowledge, Duke University Press, 2000, quatrième de couverture.
- David Holmgren, Permaculture: Principles and Pathways to Sustainability, Holmgren Design Services, 2002.
- James Suzman, Affluence Without Abundance: The Disappearing World of the Bushmen, Bloomsbury, 2017, p. 121.
- M. Kat Anderson, Taming the Wild: Native American Knowledge and the Management of California’s Natural Resources, University of California Press, 2002, p. xvi.
- Donna Haraway, “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective”, Feminist Studies, vol. 14, n° 3, août 1988, p. 575-599.
- Anderson, Taming the Wild, op. cit., p. xvi. Ce point est développé à travers une série d’essais dans James K. Boyce, Sunita Narain et Elizabeth A Stanton (dir.), Reclaiming Nature: Environmental Justice and Ecological Restoration, Anthem Press, 2007.
- Elizabeth Malkin, “In Guatemala, People Living Off Forests Are Tasked with Protecting Them”, New York Times, 25 novembre 2015. https://www.nytimes.com/2015/11/26/world/americas/inguatemala-people-living-off-forests-are-tasked-with-protecting-them.html
- Shrikrishna Upadhyay, “Community Based Forest and Livelihood Management in Nepal”, in David Bollier et Silke Helfrich (dir.), The Wealth of the Commons, Levellers Press, 2012, p. 265-270. http:// wealthofthecommons.org/essay/community-based-forest-and-livelihood-management-nepal
- Sim van der Ryn et Stuart Cowan, Ecological Design, Island Press, 1996.
- David Abram, The Spell of the Sensuous: Perception and Language in a More-than-Human World, Vintage, 1997.
- Andreas Weber, The Biology of Wonder: Aliveness, Feeling and the Metamorphosis of Science, New Society Publishers, 2016.
- Siddhartha Mukherjee, “The Invasion Equation”, The New Yorker, 11 septembre 2017, p. 40-49. https://www.newyorker.com/magazine/2017/09/11/cancers-invasion-equation
- Dans son livre Lean Logic, imaginant une culture post-capitaliste, David Fleming souligne l’importance du carnaval : “Celebrations of music, dance, torchlight, mime, games, feast and folly have been central to the life of community for all times other than those when the pretensions of largescale civilization descended like a frost on public joy.” Il note l’importance d’accomplir une rupture radicale avec “the normality of the working day”, le besoin d’exprimer “the animal spirit of the heart of the tamed, domesticated citizen” et de pratiquer des rituels de “sacrifice-and-succession” pour symboliser la naissance et le renouvellement de la communauté malgré les décès individuels. David Fleming, Lean Logic, Chelsea Green Publishing, 2016, p. 30.
NOTES DU CHAPITRE 5
- Robert C. Ellickson, Order Without Law: How Neighbors Settle Disputes, Harvard University Press, 1994.
- Dans la version du conte des frères Grimm, Boucle d’or, la petite fille qui est entrée dans la maison des trois ours, rejette un premier bol parce qu’il est « trop chaud », un deuxième parce qu’il est « trop froid », mais le troisième est « juste comme il faut ».
- Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions of Collective Action, Cambridge University Press, 1990, p. 90.
- Christopher Alexander, The Nature of Order, vol. II : The Process of Creating Life, Center for Environmental Structure, 2002, p.176-177.
- C’est ce que rapporte le journaliste Christian Schubert du Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26 septembre 2013. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftswissen/3-prozent-defizitgrenze-wie-dasmaastricht-kriterium-im-louvre-entstand-12591473.html
- Le Luxembourg, l’Estonie et la Suède, cette dernière n’appartenant pas àla zone euro. https:// www.nzz.ch/wirtschaft/europaeische-waehrungsunion-fuenf-antworten-zum-maastricht-vertragld.133407?reduced=true
- Concepteur de plateformes numériques, Simone Cicero estime qu’elles n’auront pas de succès à moins d’offrir aux gens des “expanded opportunities to leverage their available potential (the assets and capabilities they have access to); respond to the continuous pressures they experience (in a technosocially disrupted world); achieve their strategic goals; and provide them with relevant experience gains (easier, cheaper, faster ways to achieve their objectives…)”. Simone Cicero, “Stories of Platform Design” https://stories.platformdesigntoolkit.com
- Le nom officiel d’Unitierra (université de la Terre) est Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales, A.C.
- Entretien avec Gustavo Esteva, 4 décembre 2017.
- Jukka Peltokoski, Niklas Toivakainen, Tero Toivanen, et Ruby van der Wekken, “Helsinki Timebank: Currency as a Commons”, in David Bollier et Silke Helfrich (dir.), Patterns of Commoning, Levellers Press, 2015, p. 195-198. https://patternsofcommoning.org/helsinki-timebank-currency-as-a-commons/
- 11. Eric Nanchen et Muriel Borgeat, “Bisse de Savièse: A Journey Through Time to the Irrigation System in Valais, Switzerland”, in Bollier et Helfrich (dir.), Patterns of Commoning, op. cit., p. 61-64. https:// patternsofcommoning.org/bisse-de-saviese-a-journey-through-time-to-the-irrigation-system-invalais-switzerland/
- https://ich.unesco.org/en/RL/culture-of-jeju-haenyeo-women-divers-01068
- https://cobudget.com
- Arthur Brock, “Cryptocurrencies are Dead”, Medium, 15 septembre 2016. https://medium.com/ metacurrency-project/cryptocurrencies-are-dead-d4223154d783. Voir aussi Mike Hearn, “Why is Bitcoin Forking?”, Medium, 15 août 2015. https://medium.com/faith-and-future/why-is-bitcoinforking-d647312d22c1
- Joline Blais, “Indigenous Domain: Pilgrim, Permaculture and Perl”, Intelligent Agent, vol. 6, n° 2, septembre 2006. https://www.researchgate.net/publication/299460968_Indigenous_Domain_Pilgrim_ Permaculture_and_Perl
- Stefan Brunnhuber, Die Kunst der Transformation. Wie wir lernen, die Welt zu verändern, Verlag Herder, 2016, p. 56.
- Ibid. En allemand : « Komplexität müssen wir emotional aushalten können. »
- Ostrom, Governing the Commons, op. cit., p. 93-94.
- Christopher M. Kelty, Two Bits: The Cultural Significance of Free Software, Duke University Press, 2008, p. 118.
- Ibid., p. 142.
- Lewis Thomas, The Lives of a Cell: Notes of a Biology Watcher, Penguin, 1974, p. 133-134.
- Kate Chapman, “Commoning in Times of Disaster: The Humanitarian OpenStreetMap Team”, in Bollier et Helfrich (dir.), Patterns of Commoning, op. cit., p. 214-217. https://patternsofcommoning.org/commoning-in-times-of-disaster-the-humanitarian-openstreetmap-team/
- Ostrom, Governing the Commons, op. cit., p. 93.
- J. Stephen Lansing, Perfect Order: Recognizing Complexity in Bali, Princeton University Press, 2006.
- Ibid.
- La différence entre la règle de la pluralité (majorité relative) et la règle de la majorité est que, dans le premier cas, l’option qui remporte le plus de votes gagne même si elle n’a pas franchi le seuil des 50 % (équivalent à la majorité lorsqu’il y a au moins trois choix).
- Voir l’entrée Wikipédia “Consensus Decision Making” : https://en.wikipedia.org/wiki/Consensus_ decision-making. Voir aussi Ian Hughes, “Quaker Decision Making”, février 2011. https://epoq.fandom. com/wiki/Quaker_Decision_Making
- Richard Bartlett et Marco Deseriis, “Loomio and the Problem of Deliberation”, openDemocracy, 2 décembre 2016. https://www.opendemocracy.net/en/digitaliberties/loomio-and-problem-ofdeliberation/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Consensus_decision-making
- James Priest, 9 mars 2015. jamespriest.org/sociocracy-consensus-decision-making-whats-thedifference
- Ted J. Rau et Jerry Koch-Gonzalez, Many Voices, One Song: Shared Power with Sociocracy, Sociocracy for All, 2018. https://sociocracyforall.org
- Pour plus de détails sur la sociocratie, voir l’entrée Wikipédia : https://en.wikipedia.org/wiki/Sociocracy
- https://www.sk-prinzip.eu
- https://patternsofcommoning.org/we-are-one-big-conversation-commoning-in-venezuela/
- Ibid.
- https://cell.com/trends/ecology-evolution/fulltext/S0169-5347(16)30043-X/html
- Entrée Wikipédia “Heterarchy”. https://en.wikipedia.org/wiki/Heterarchy
- Nicolas Kristof, “The Bankers and the Revolutionaries”, New York Times, 1er octobre 2011. https:// www.nytimes.com/2011/10/02/opinion/sunday/kristof-the-bankers-and-the-revolutionaries.html
- https://en.wikipedia.org/wiki/Heterarchy
- Ostrom, Governing the Commons, op. cit., p. 95.
- Michael Cox, Gwen Arnold, et Sergio Villamayor Tomás, “A Review of Design Principles of Community-Based Natural Resource Management”, Ecology & Society, vol. 14, n° 4, décembre 2010, p. 38. https://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss4/art38/. Voir aussi F. Cleaver, “Moral Ecological Rationality, Institutions and the Management of Common Property Resources”, Development and Change, vol. 31, n° 2, mars 2000, p. 374.
- Ostrom, Governing the Commons, op. cit., p. 86.
- Étienne Le Roy, “How I Have Been Conducting Research on the Commons for Thirty Years Without Knowing It”, in Bollier et Helfrich (dir.), Patterns of Commoning, op. cit., p. 277-296. https:// patternsofcommoning.org/how-i-have-been-conducting-research-on-the-commons-for-thirtyyears-without-knowing-it/
- Franciscus W. M. Vera, Grazing Ecology and Forest History, Centre for Agriculture and Biosciences International, 2000, p. 386.
- Boyd v. United States, 116 U.S. 616, 630 (1886).
- Selon l’Encyclopedia Britannica, le MST a mené en 2014 plus de 2 500 occupations de terres avec environ 370 000 familles et a obtenu des droits de propriété sur presque 7,5 millions hectares de terres du fait de son action directe.
- Ce principe, élaboré au xixe siècle, est entré dans la doctrine catholique avec l’encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII. Charles C. Geisler et Gail Daneker (dir.), Property and Values: Alternatives to Public and Private Ownership, Island Press, 2000, p. 31.
- International Co-operative Alliance, “World Co-operative Monitor”. https://monitor.coop
- Benjamin Mako Hill, “Problems and Strategies in Financing Voluntary Free Software Projects”, 10 juin 2005. https://mako.cc/writing/funding_volunteers/funding_volunteers.html
- Hill cite les recherches de Bernard Enjolra de l’Institute for Social Research d’Oslo, Norvège, qui a étudié le rôle et la nature du travail bénévole dans les organisations sportives norvégiennes après l’introduction de l’argent pour mener certaines tâches comptables et organisationnelles. La conséquence a été que les bénévoles ont été moins nombreux et ont moins travaillé. Bernard Enjolra, “Does the Commercialization of Voluntary Organizations ‘Crowd Out’ Voluntary Work?”, Annals of Public and Cooperative Economics, vol. 73, n° 3, 2002, p. 375-398.
- Simon Sarazin, “Separate Commons and Commerce to Make It Work for the Commons”. http:// discourse.transformap.co/t/separate-commons-and-commerce-to-make-it-work-for-thecommons/625. Voir aussi http://encommuns.com
- wiki.guerrillamediacollective.org/index.php/Commons-Oriented_Open_Cooperative_Governance_ Model_V_2.0
- La lettre de démission de Karlitschek est disponible ici : https://karlitschek.de/2016/06/nextcloud/. Voir aussi Steven J. Vaughan-Nichols, “OwnCloud Founder Resigns from His Cloud Company”, ZDNet, 28 avril 2016. https://www.zdnet.com/article/owncloud-founder-resigns-from-cloud-company/
- Goteo.org. Voir aussi Enric Senabre Hidalgo, “Goteo: Crowdfunding to Build NewCommons”, in Bollier et Helfrich (dir.), Patterns of Commoning, op. cit. https://patternsofcommoning.org/goteocrowdfunding-to-build-new-commons/
- La liste des monnaies de Sobiecki est disponible ici : https://www.quora.com/How-manycomplementary-currency-systems-exist-worldwide. L’une des listes les plus importantes de ce type est celle du Complementary Currency Resource Center avec sa cartographie en ligne : https:// complementarycurrency.org/cc-world-map/
- La proposition a été formulée par Philippe Aigrain : http://paigrain.debatpublic.net/docs/internet_ creation_1-3.pdf. Voir aussi Peter Barnes, Capitalism 3.0: A Guide to Reclaiming the Commons, BerrettKohler, 2006.
NOTES DU CHAPITRE 6
- https://en.wikipedia.org/wiki/Eating_your_own_dog_food
- Donald E. Knuth, “The Errors of TeX”, Software: Practice and Experience, vol. 19, n° 7, juillet 1989, p. 622.
- https://www.openprosthetics.org
- Thomas Berry, Evening Thoughts: Reflecting on Earth as a Sacred Community, Counterpoint, 2015, p. 17.
- http://cedifa.de/wp-content/uploads/2013/08/04-FabLabs.pdf, page 14.
- https://www.repaircafe.org/en/about/. Voir la carte : https://www.repaircafe.org/en/visit/
- Neera Singh, “The affective labor of growing forests and the becoming of environmental subjects: Rethinking environmentality in Odisha, India”, Geoforum, vol. 47, juin 2013, p. 189-198. https://www. sciencedirect.com/science/article/pii/S0016718513000134?via%3Dihub et https://www.academia. edu/3106203/The_affective_labor_of_growing_forests_and_the_becoming_of_environmental_ subjects_Rethinking_environmentality_in_Odisha_India
- L’excellente collection d’essais de Silvia Federici, Re-Enchanting the World: Feminism and the Politics of the Commons, PM Press, 2019, le montre de manière éclatante.
- https://www.deutschlandfunkkultur.de/feministische-oekonomie-unbezahlte-arbeit-ist-milliarden-100. html
- Voir, par exemple, https://www.feministeconomics.net
- Samuel Bowles passe en revue nombre de ces études dans son livre The Moral Economy: Why Good Incentives Are No Substitute for Good Citizens, Yale University Press, 2016.
- Richard M. Titmuss, The Gift Relationship: From Human Blood to Social Policy, Pantheon, 1971.
- https://wiki.opensourceecology.org/wiki/LifeTrac
- Rishab Aiyer Ghosh, “Cooking pot markets: An economic model for the trade in free goods and services on the Internet”, First Monday, vol. 3, n° 3, 2 mars 1998. https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/issue/view/90
- Lewis Hyde, Common as Air: Revolution, Art, and Ownership, Farrar, Straus and Giroux, 2010, p. 43.
- Entretien avec Rainer Kippe de SSM, 20 août 2017.
- Ibid. Voir aussi le site de SSM : http://ssm-koeln.org
- Fred Pearce, “Common Ground: Securing land rights and safeguarding the earth”, Land Rights Now, International Land Coalition, Oxfam International, Rights and Resources Initiative, 2016. https:// policy-practice.oxfam.org/resources/common-ground-securing-land-rights-and-safeguardingthe-earth-600459/. Le rapport conclut : “Up to 2.5 billion people depend on Indigenous and community lands, which make up over 50 percent of the land on the planet; they legally own just one-fifth. The remaining five billion hectares remain unprotected and vulnerable to land grabs from more powerful entities like governments and corporations. There is growing evidence of the vital role played by full legal ownership of land by Indigenous peoples and local communities in preserving cultural diversity and in combating poverty and hunger, political instability and climate change.”
- Cité dans John T. Edge, “The Hidden Radicalism of Southern Food”, New York Times, 6 mai 2017. https://www.nytimes.com/2017/05/06/opinion/sunday/the-hidden-radicalism-of-southern-food.html
- Le nom complet de Cecosesola est Central Cooperativa de Servicios Sociales del Estado Lara (www. cecosesola.org). Voir Silke Helfrich, “We Are One Big Conversation: Commoning in Venezuela”, in David Bollier et Silke Helfrich (dir.), Patterns of Commoning, Levellers Press, 2015, p. 258-264. https:// patternsofcommoning.org/we-are-one-big-conversation-commoning-in-venezuela/
- Ibid., p. 262.
- Ivan Illich, Tools for Conviviality, Harper & Row, 1973, p. 23.
- Ibid., p. 23.
- Andrea Vetter suggère des critères pour des outils conviviaux dans “The Matrix of Convivial Technologies: Assessing technologies for degrowth”, Journal of Cleaner Production, vol. 197, part. 2, septembre 2018, p. 1778-1786. http://konvivialetechnologien.blogsport.de/images/Vetter_JcP2017_MatrixConvivialTechnology.pdf
- Un réseau implique des participants/noeuds individuels engagés dans des transactions épisodiques sans connexions sociales continues, tandis que les membres d’une fédération partagent des buts et des engagements.
- Eric von Hippel, Democratizing Innovation, MIT Press, 2005. https://web.mit.edu/evhippel/www/ books/DI/DemocInn.pdf
- James K. Boyce, Peter Rosset et Elizabeth A. Stanton, “Land Reform and Sustainable Development”, in James K. Boyce et al., Reclaiming Nature: Environmental Justice and Ecological Restoration, Anthem Press, 2007, p. 140.
- On parle aussi d’« innovation informelle ». Voir Peter Drahos et Pat Mooney, Indigenous Peoples’ Innovation: Intellectual Property Pathways to Development, Australian National University Press, 2012. https://www.jstor.org/stable/j.ctt24hfgx. Voir aussi “Farmers’ Rights”, Rural Advancement Foundation International newsletter, mai-juin 1989. https://etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/ files/publication/555/01/raficom17farmersrights.pdf
- Entrée Wikipédia “Jugaad” : https://en.wikipedia.org/wiki/Jugaad
- https://archive.foodfirst.org/publication/campesino-a-campesino-voices-from-latin-americasfarmer-to-farmer-movement-for-sustainable-agriculture/
- https://masipag.org
- https://www.opensourceecology.org
- https://openspim.org. Voir aussi Jacques Paysan, “OpenSPIM: A High-Tech Commons for Research and Education”, in Bollier et Helfrich (dir.), Patterns of Commoning, op. cit., p. 170-175. https:// patternsofcommoning.org/openspim-a-high-tech-commons-for-research-and-education/
- https://www.scoutbots.com, aussi connu sous le nom de « Protei ».
- Wolfgang Sachs, The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power, Zed Books, 2e éd., 2009, p.122.
- Michael Bauwens, “The Emergence of Open Design and Open Manufacturing”, We_Magazine, décembre 2011. https://snuproject.wordpress.com/2011/12/17/the-emergence-of-open-design-andopen-manufacturing-we_magazine/. Voir aussi Vasilis Kostakis et al., “Design global, manufacture local: Exploring the contours of an emerging productive model”, Futures, vol. 73, 2015, p. 126-135 ; l’entrée du wiki de la P2P Foundation, “Design Global, Manufacture Local”. https://wiki.p2pfoundation. net/Design_Global,_Manufacture_Local
- Céline Piques et Xavier Rizos, “Peer to Peer and the Commons: A Matter, Energy, and Thermodynamic Perspective”, P2P Foundation, octobre 2017. https://commonstransition.org/wp-content/ uploads/2017/10/Report-P2P-Thermodynamics-VOL_1-web_2.0.pdf
NOTES DE L’INTRODUCTION DE LA PARTIE III
- Correspondance avec Dina Hasted, 2 décembre 2018.
- Sharing Cities: Activating the Urban Commons, Tides Center/Shareable, 2018. https://www. shareable.net/sharing-cities/
NOTES DU CHAPITRE 7
- Eduardo Moisés Penalver et Sonia K. Katyal, Property Outlaws: How Squatters, Pirates, and Protesters Improve the Law of Ownership, Yale University Press, 2010.
- E. P. Thompson, Customs in Common: Studies in Traditional Popular Culture, New Press, 1993, p. 162.
- C. B. Macpherson, Property, Mainstream and Critical Positions, University of Toronto, 1978, p. 199200.
- Ces thèmes sont étudiés par les spécialistes de l’économie institutionnelle.
- C’est Wesley N. Hohfeld qui est le plus souvent reconnu comme étant celui qui a fait passer le concept de propriété des relations personnes/objects (Blackstone) aux relations entre personnes (relations sociales). Voir Wesley N. Hohfeld, “Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning”, The Yale Law Journal, vol. 23, n° 1, novembre 1913, p. 16-59 ; “Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning”, The Yale Law Journal, vol. 26, n° 8, juin 1917, p. 710-770.
- Margaret Radin, Reinterpreting Property, University of Chicago Press, p. 35. Dès lors que les droits de propriété se focalisent sur le droit d’aliénation dans le cadre d’un ordre de marché libéral, ils privilégient une certaine conception de la personne dotée d’une liberté absolue dans les relations de marché.
- C. B. Macpherson, The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke, Clarendon Press, 1962, p. 3.
- https://understandingsociety.blogspot.com/2011/08/possessive-individualism.html. Ibid., p. 3.
- Ibid., p. 3.
- William Blackstone, “Of Property, in General”, in Commentaries on the Laws of England in Four Books (1753), éd. par George Sharswood, J. B. Lippincott Co, Philadelphie, rééd., 1893, vol. I, liv. II, chap 1. https://oll.libertyfund.org/title/sharswood-commentaries-on-the-laws-of-england-in-fourbooks-vol-1
- Gregory Alexander, Commodity & Propriety. Competing Visions of Property in American Legal Thought, 1776-1970, University of Chicago Press, 1997, p. 321.
- C’est la traduction usuelle, mais cela peut aussi bien être rendu par « servir le bien commun ».
- John Locke, Second Treatise of Government, éd. par C. B. Macpherson, Hackett Publishing, 1980, p. 19.
- Il existe une littérature académique considérable sur la clause lockéenne, qui a son origine dans le livre du philosophe Robert Nozick Anarchy, State and Utopia, Harper & Row, 1974, p. 178. Voir aussi l’entrée Wikipédia “Lockean proviso” : https://en.wikipedia.org/wiki/Lockean_proviso
- Étienne Le Roy, “How I Have Been Conducting Research on the Commons for Thirty Years Without Knowing It”, in David Bollier et Silke Helfrich (dir.), Patterns of Commoning, Levellers Press, 2015, p. 277296. https://patternsofcommoning.org/how-i-have-been-conducting-research-on-the-commons-forthirty-years-without-knowing-it/
- La notion de droit vernaculaire est développée dans Burns H. Weston et David Bollier, Green Governance: Ecologial Survival, Human Rights and the Law of the Commons, Cambridge University Press, 2013, p. 104-112.
- Le rôle fondateur de Hohfeld pour envisager la propriété comme une relation sociale est expliqué dans Syed Talha et Anna Di Robilant, “The Fundamental Building Blocks of Social Relations Regarding Resources: Hohfeld in Europe and Beyond”, 27 mars 2018. https://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=3149768. Les interprétations non physicalistes du concept de propriété remontent néanmoins à la seconde moitié du xixe siècle. Voir Alexander, Commodity & Propriety, op. cit., p. 322, note 41.
- Joseph Singer, “The Legal Rights Debate in Analytical Jurisprudence from Bentham to Hohfeld”, Wisconsin Law Review, vol. 1982, n° 6, 1982, p. 987.
- Alexander, Commodity & Propriety, op. cit., p. 323.
- La propriété d’entreprise est souvent confondue avec la propriété individuelle, de sorte que les différences importantes entre les deux sont rendues invisibles. Les gens sont conduits à envisager de manière erronée la propriété d’entreprise comme équivalente à la propriété personnelle.
- Ce propos est tiré de Lewis Hyde, Common as Air: Revolution, Art, and Ownership, Farrar, Straus and Giroux, 2010, p. 169-173.
- Cité dans E. P. Thompson, Customs in Common, op. cit., p. 167.
- On trouve un examen fascinant de ces questions dans Joseph L. Sax, Playing Darts with a Rembrandt: Public and Private Rights in Cultural Treasures, University of Michigan Press, 1999.
- Hartmut Zückert, “The Commons—A Historical Concept of Property Rights”, in David Bollier et Silke Helfrich (dir.), The Wealth of the Commons, Levellers Press, 2012, p. 129. http://wealthofthecommons.org/essay/commons-–-historical-concept-property-rights
- On compte plus de 1 500 communs forestiers ou de pâturage rien que dans les Carpates roumaines. Monica Vasile, “Formalizing commons, registering rights: The making of the forest and pasture commons in the Romanian Carpathians from the 19th Century to Post-Socialism”, International Journal of the Commons, vol. 12, n° 1, avril 2018, p. 170-201. https://www.thecommonsjournal.org/articles/10.18352/ ijc.805/. Voir aussi “The Role of Memory and Identity in the Obştea Forest Commons of Romania”, in Bollier and Helfrich (dir.), Patterns of Commoning, op. cit., p. 65-70. https://patternsofcommoning. org/the-role-of-memory-and-identity-in-the-obstea-forest-commons-of-romania/
- https://oak-schwyz.ch
- Trent Schroyer, Beyond Western Economics: Remembering Other Economic Cultures, Routledge, 2009, p. 69.
- Oliver Wendell Holmes, Jr., The Common Law (1881). http://1215.org/lawnotes/work-in-progress/ holmes/index.html
- Ibid.
- L’un des examens les plus complets du droit vernaculaire est une anthologie qui montre comment le droit non écrit et informel s’est épanoui dans une diversité de contextes au cours de l’histoire : Alison Dundes Rentln et Alan Dundes (dir.), Folk Law: Essays in the Theory and Practice of Lex Non Scripta, University of Wisconsin Press, 1994.
- Carol Rose, “Comedy of the Commons: Custom, Commerce, and Inherently Public Property”, in Property and Persuasion: Essays on the History, Theory, and Rhetoric of Ownership, Westview Press, 1994, p. 134.
- Graham v. Walker (1905), 62 Atlantic Reporter, at 99.
- Rose, Property and Persuasion, op. cit., p. 123-124.
- https://www.landrightsnow.org/ et http://pbs.twimg.com/media/DZXa7iCX4AAkgQI.jpg
- Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions of Collective Action, Cambridge University Press, 1990, p. 90.
- Pierre Dardot et Christian Laval, Commun. Essai sur la révolution au xxie siècle, La Découverte, 2015, p. 583.
- Karl Polanyi, The Great Transformation, Beacon Press, 1944, p. 132 et 252.
- Entretien télévisé de CBS avec Salk, “See It Now” (12 avril 1955), cité dans Jon Cohen, Shots in the Dark: The Wayward Search for an AIDS Vaccine, W. W. Norton, 2001.
- https://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/places-to-go/central-north-island/places/taupotrout-fishery/
- “By the law of nature these things are common to mankind—the air, running water, the sea, and consequently the shores of the sea.”
- Inst. 2, 2 ap. Digest. 1, 8, 1 : Summa itaque rerum divisio in duos articulos diducitur: nam aliae sunt divini juris, aliae humani (« Ainsi la plus haute division des choses est réduite à deux articles : certaines relèvent du droit divin, certaines du droit humain. »).
- Voir la liste complète des sites du patrimoine mondial de l’Unesco : https://en.wikipedia.org/wiki/World_Heritage_Site
- L’usufruit est un terme de droit civil désignant le droit de récolter les bénéfices (renouvelables) d’une ressource comme une plante ou une forêt tant que la ressource sous-jacente elle-même ne s’en trouve pas affectée.
- Theodore Steinberg, Slide Mountain: Or, the Folly of Owning Nature, University of California Press, 1995.
- http://ejil.org/pdfs/16/1/289.pdf
- En allemand, Sache/Gegenstand, Streitfall, Angelegenheit.
- Yan Thomas, « La valeur des choses. Le droit romain hors la religion », Annales, vol. 57, n° 6, 2002, p. 1449 et 1454. Res correspond mieux à la signification du grec ta pragmata.
- Le terme « ressource » tel qu’il est communément utilisé aujourd’hui, y compris dans la littérature académique sur les communs, dont nos propres contributions, reflète une conception réifiée de la res, alors que les deux termes sont étymologiquement séparés : « ressource » était utilisé au xviie siècle pour signifier un « moyen de satisfaire un besoin ou de combler une lacune », issu du terme « source » et du latin resurgere, « ressurgir ».
- Silke Helfrich, “Common Goods Don’t Simply Exist—They Are Created”, in Bollier et Helfrich (dir.), The Wealth of the Commons, op. cit., p. 61-67. http://wealthofthecommons.org/essay/commongoods-don’t-simply-exist-–-they-are-created
- Ibid., p. 64 ; Saki Bailey, “The Architecture of Legal Institutions”, in Ugo Mattei et J. Haskell (dir.), Research Handbook on Political Economy and Law, Edward Elgar Publishing, 2015, p. 481-495.
NOTES DU CHAPITRE 8
- Pour plus de détails sur les heures de travail, voir le manuel des membres : https://www.foodcoop.com/manual/
- Site de la Park Slope Food Coop : https://www.foodcoop.com/
- Manuel des membres de la Park Slope Food Coop, p. 28.
- Cité dans Max Falkowitz, “Birth of the Kale”, Grub Street, 19 avril 2018. https://www.grubstreet. com/2018/04/history-of-the-park-slope-food-coop.html
- Cf. Karl Marx, Manuscrits de 1844, 1er manuscrit, « Le travail aliéné », où Marx nomme quatre aspects de l’aliénation (ou réification) des travailleurs comme conséquences du travail aliéné : aliénation des produits de leur propre travail ; de leur propre énergie physique et mentale (une auto-aliénation) ; de leur « être générique » et nature spirituelle ; et de leur propre corps. https://www.marxists.org/ archive/marx/works/1844/manuscripts/labour.htm
- La lecture d’Erich Fromm est instructive en ce qui concerne l’autoréflexion et la nature de la propriété, notamment son livre To Have or to Be? The Nature of the Psyche, Harper & Row, 1976.
- Une idée promue par le futuriste Stewart Brand et la Long Now Foundation, établie pour « promouvoir la pensée et la responsabilité à long terme dans la perspective des prochaines 10 000 années ». https:// longnow.org
- Thomas Berry, Evening Thoughts: Reflecting on Earth as a Sacred Community, éd. par Mary Evelyn Tucker, Counterpoint, 2015, p. 17.
- Sur Wikipédia, les contributions individuelles ne peuvent être retracées que dans l’histoire de l’article, non sur la page de l’entrée wiki proprement dite.
- Cette comparaison s’inspire des notes de Ward Cunningham sur l’idée de possession : http://own. fed.wiki/view/welcome-visitors.
- Un seul talon d’Achille : une grande entreprise pourrait « aspirer » tout le contenu d’un wiki fédéré et l’utiliser pour son propre profit, sans le partager, dès lors qu’elle garderait ce contenu derrière un pare-feu. Mais une fois qu’il est publié sur l’Internet et disponible pour une fédération de wikis fédérés, personne ne peut s’arroger de droits d’auteur sur un contenu de wiki. Si une entreprises gardait le contenu de quelqu’un d’autre derrière un pare-feu, le contenu serait légalement considéré comme privé et non comme republié, et n’enfreindrait donc pas la loi sur le droit d’auteur.
- Les droits de propriété sont régis par des systèmes de droit civil dans presque toute l’Amérique latine. Celui-ci a été conçu pour harmoniser le droit écrit (codifié) et non écrit (non codifié). Trois sources de droit devaient être prises en compte : le droit canonique (la propriété qui vient de Dieu), le droit espagnol (la propriété qui vient du roi, système dit « régalien » dont les présupposés fondamentaux sous-tendent la gestion de la propriété par les États-nations) et le droit indigène (la propriété qui appartient au monarque correspondant). Voir José Juan González, “Civil Law Treatment of the Subsurface in Latin American Countries”, in Donald N. Zillman et al. (dir.) The Law of Energy Underground: Understanding New Developments in Subsurface Production, Transmission and Storage, Oxford University Press, 2014, p. 59-74 ; José Guadalupe Zúñiga Alegría et Juan Antonio Castillo López, « Minería y propiedad del suelo y del subsuelo en México », Alegatos, n° 87, mai-août 2014.
- Aux États-Unis, l’idée de droits infinis à l’air dérivés de la propriété d’une parcelle de terre a été formellement rejetée par la Cour suprême en 1946 dans l’affaire “United States v. Causby, 328 U.S. 256”.
- Dans la version initiale du Code napoléonien, l’article 552 stipulait que la possession de la terre incluait la possession de tout ce qui est au-dessus et en dessous d’elle.
- William Blackstone, Commentaries on the Laws of England in Four Books [1753], éd. par George Sharswood, J. B. Lippincott Co, Philadelphie, rééd. 1893, vol. I, liv. II, chap. 2, p. 18. https://avalon.law. yale.edu/18th_century/blackstone_bk2ch2.asp
- Nous nous concentrons ici sur la relation entre le contrôle individuel d’un site et le droit collectif de faire usage de ce site et d’en tirer du contenu. Nous ne discutons pas de la possession du serveur à ce stade.
- Si les licences Creative Commons peuvent permettre ou restreindre certains types de réutilisation (par exemple, commerciale, dérivative sous une licence permettant une réutilisation ultérieure), les détenteurs de droits d’auteurs ne peuvent pas facilement différencier les utilisateurs dans l’attribution des permissions de réutilisation. C’est ce qu’essaie de faire la licence de production par les pairs, ou Peer Production License (PPL), un dérivé des licences CC qui autorise seulement d’autres commoneurs, des coopératives ou des associations sans but lucratif à partager et à réutiliser un contenu, et non les entités commerciales qui cherchent à faire des profits grâce au commun sans réciprocité explicite. Voir https://wiki.p2pfoundation.net/Peer_Production_License
- https://www.syndikat.org
- Stefan Rost, « Das Mietshäuser Syndikat », in Silke Helfrich et Heinrich-Böll-Stiftung (dir.), Commons. Für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat, transcript Verlag, 2012, p. 285-287. https://band1. dieweltdercommons.de/essays/stefan-rost-das-mietshauser-syndikat/. Version anglaise : https:// patternsofcommoning.org/uncategorized/taking-housing-into-our-own-hands/
- Entretien avec Jochen Schmidt, 15 mai 2018.
- Rost, « Das Mietshäuser Syndikat », art. cité, p. 285.
- Les idées juridiques essentielles ont été tirées de Matthias Neuling, « Rechtsformen für Alternative Betriebe », in Kritische Justiz (1986), p. 309-326. https://kj.nomos.de/fileadmin/kj/ doc/1986/19863Neuling_S_309.pdf
- Ibid.
- Entretien avec Jochen Schmidt, 15 mai 2018.
- Le seul cas où un immeuble associé au Mietshäuser Syndikat a été remis sur le marché n’était pas une liquidation, mais la conséquence d’un financement insuffisant pour achever les travaux. Pour de nombreuses raisons, ce projet de logement n’a jamais vu le jour.
- Pour plus de détails sur ces transferts de solidarité : https://www.syndikat.org/en/solidaritytransfer/
- Eric Raymond, The New Hacker’s Dictionary, MIT Press, 3e éd., 1996.
- Chad Perrin, “Hacker vs. Cracker”, TechRepublic, 17 avril 2009. https://www.techrepublic.com/ article/hacker-vs-cracker/
- Les logiciels libres et open source ont souvent supplanté des logiciels propriétaires, entraînant une démarchandisation de certains segments de marché, même s’ils ont aussi servi de base à de nouveaux types de logiciels et de services commerciaux.
- Trebor Scholz, “Platform Cooperativism: Challenging the Sharing Economy”, Rosa-LuxemburgStiftung, New York, janvier 2016. https://rosalux.nyc/wp-content/uploads/2020/11/RLS-NYC_ platformcoop.pdf. Voir aussi : Trebor Scholz et Nathan Schneider, Ours to Hack and Own, OR Books, 2017. https://www.orbooks.com/catalog/ours-to-hack-and-to-own/
- http://tkdl.res.in/tkdl/LangDefault/Common/Home.asp
- https://celdf.org
- Le Pr Philip H. Howard de l’université d’État du Michigan étudie la concentration de l’industrie semencière. Voir ses explications : https://philhoward.net/2018/12/31/global-seed-industry-changessince-2013/ et son tableau “Seed Industry Structure, 1996-2018”.
- Pat Mooney, “Blocking the Chain: Industrial Food Chain Concentration, Big Data Platforms, and Food Sovereignty Solutions”, ETC Group, octobre 2018. https://etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/ files/blockingthechain_english_web.pdf
- Les licences « film plastique » (shrinkwrap) et « un-clic » sont des contrats unilatéraux dont le droit estime que les usagers les ont acceptés dès lors qu’ils enlèvent le film plastique, ou shrinkwrap, autour d’une boîte contenant un logiciel ou cliquent pour accepter en ligne la license d’un logiciel.
- Johannes Kotschi et Klaus Rapf, “Liberating Seeds with an Open Source Seed License”, AGRECOL, juillet 2016. https://www.agrecol.de/files/OSS_Licence_AGRECOL_eng.pdf
- Jack Kloppenburg, “Re-purposing the master’s tools: The open source seed initiative and the struggle for seed sovereignty”, Journal of Peasant Studies, vol. 41, n° 6, 2014.
- La dénomination complète est Association for AgriCulture and Ecology in Africa, Asia, Latin America, and Eastern Europe.
- https://opensourceseeds.org/en
- https://osseeds.org
- Maywa Montenegro de Wit, “Beating the bounds: How does ‘open source’ become a seed commons?”, Journal of Peasant Studies, vol. 46, n° 3, 2017, p. 15.
- Jack Kloppenburg, “Enacting the New Commons: The Global Progress, Promise and Possibilities of Open Source Seed”, intervention à l’atelier de l’International Association for the Study of Commons, “Conceptualizing the New Commons: The Examples of Knowledge Commons & Seed and Variety Commons”, Oldenbourg, Allemagne, 6-8 juin 2018.
- Hiroyuki Kurokochi et al., ”Local-Level Genetic Diversity and Structure of Matsutake Mushroom (Tricholoma matsutake) Populations in Nagano Prefecture, Japan, Revealed by 15 Microsatellite Markers”, J. Fungi, vol. 3, n° 2, mai 2017, p. 23. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC5715919/
- Anna Lowenhaupt Tsing, The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins, Princeton University Press, 2015, p. 270.
- H. Saito et Gaku Mitsumata, “Reviving Lucrative Matsutake Mushroom Harvesting and Restoring the Commons in Contemporary Japan”, contribution présentée à ”Governing Shared Resources: Connecting Local Experience to Global Challenges”, 12e conférence bisannuelle de l’International Association for the Study of Commons, Cheltenham, Angleterre, 14-18 juillet 2008. https://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/ bitstream/handle/10535/1552/Saito_155501.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Tsing, Mushroom, op. cit., p. 3.
- Ibid., p. 14.
- Saito et Mitsumata, “Reviving Lucrative Matsutake Mushroom Harvesting”, art. cité, p. 5.
- Ibid., p. 14.
- De tels systèmes d’enchères existent aussi en Chine. L’anthropologue Anna Lowenhaupt Tsing relate que dans la province chinoise du Yunnan, dans les montagnes de la préfecture de Chuxiong, où le matsutake est le produit le plus précieux de la forêt, “money gained from the auction is distributed to each household and forms an important part of its cash income” (Tsing, Mushroom, op. cit., p. 268-269).
- Saito et Mitsumata, “Reviving Lucrative Matsutake Mushroom Harvesting”, art. cité.
- Tsing, Mushroom, op. cit., p. 271.
- Sur ce sujet, voir Ulrich Steinvorth, « Natürliche Eigentumsrechte, Gemeineigentum und geistiges Eigentum », Deutsche Zeitschrift für Philosophie, vol. 52, n° 5, octobre 2004, p. 717-738.
- Saito et Mitsumata, “Reviving Lucrative Matsutake Mushroom Harvesting”, art. cité.
- Tsing, Mushroom, op. cit., p. 16.
- Ibid., p. 8.
- Ibid., p. 10.
- Anatole France, Le Lys Rouge, 1894, chap. 7.
- Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, 2016.
NOTES DU CHAPITRE 9
- http://unoosa.org/pdf/gares/ARES_34_68E.pdf
- Il est aussi appliqué dans la Convention sur la diversité biologique (CDB).
- CNBC, “US Commerce Secretary Wilbur Ross Speaks with Joe Kernen and CNBC’s ‘Squawk Box’ Today”, 23 février 2018. https://www.cnbc.com/2018/02/22/cnbc-transcript-u-s-commerce-secretary-wilbur- ross-speaks-with-joe-kernen-on-cnbcs-squawk-box-today.html. Voir aussi Wilbur Ross, “The Moon Colony Will Be a Reality Sooner Than You Think”, New York Times, 24 mai 2018. https://www.nytimes. com/2018/05/24/opinion/that-moon-colony-will-be-a-reality-sooner-than-you-think.html
- Rich Hardy, “Trump, the Lunar Economy, and Who Owns the Moon”, New Atlas, 13 février 2017. https://newatlas.com/who-owns-moon-trump-lunar-economy/47897
- Prue Taylor, “Common Heritage of Mankind Principle”, in Klaus Bosselmann, Daniel S. Fogel et J. B. Ruhl (dir.), Berkshire Encyclopedia of Sustainability: The Law and Politics of Sustainability, Berkshire Publishing Group, 2010, p.64-69.
- En 2007, le gouvernement équatorien a proposé de renoncer à la moitié des revenus anticipés de l’exploitation de 20 % de ses réserves de pétrole, soit 3,6 milliards de dollars, si la communauté internationale accordait cette somme à l’Équateur pour l’aider à explorer des stratégies de développement sans énergies fossiles. Cette proposition se voulait une iniative pionnière de lutte contre le changement climatique parmi les pays « moins développés ». Juan Falconi Puig, “The World Failed Ecuador in its Yasuni Initiative”, The Guardian, 19 septembre 2013. https://www.theguardian. com/global-development/poverty-matters/2013/sep/19/world-failed-ecuador-yasuni-initiative
- Cité dans David Bollier, “State Power and Commoning: Transcending a Problematic Relationship”, rapport d’un atelier organisé par le Commons Strategies Group en partenariat avec la Fondation Heinrich-Böll, 2016. https://commonsstrategies.org/state-power-commoning-transcending-problematic-relationship/. Voir aussi Bob Jessop, State Power: A Strategic-Relational Approach, Polity, 2008, et The State: Past, Present, Future (Key Concepts), Polity 2015.
- L’identité nationale est, bien entendu, religieuse. Tout comme le gouvernement israélien invoque les doctrines du judaïsme pour justifier sa politique, le pouvoir d’État renforce les déclarations et l’influence des institutions religieuses et de la Halakha (le corpus collectif des lois religieuses juives dérivées de la Torah écrite et orale).
- https://www.swp-berlin.org/en/publication/israels-nation-state-law
- Hannah Arendt, « Nationalstaat und Demokratie », transcription d’une conversation à la radio avec le politologue Eugen Kogon à Cologne, Allemagne, 6 mars 1963. https://www.hannaharendt.net/index. php/han/article/view/94/154
- Ramon Roca, “Landline Networks and the Commons”, vidéo YouTube de l’atelier du Parlement européen sur les réseaux communautaires et la régulation des télécoms, 17 octobre 2017. https://www. youtube.com/watch?v=9Cu88NnigBU
- Geoff Mulgan, “Government With the People: The Outlines of a Relational State”, in Graeme Cooke et Rick Muir (dir.), The Relational State: How Recognising the Importance of Human Relationships Could Revolutionise the Role of the State, Institute for Public Policy Research, 2012.
- Cité dans Cooke et Muir, The Relational State, op. cit. https://www.ippr.org/files/images/media/ files/publication/2012/11/relational-state_Nov2012_9888.pdf (la courte remarque de Jovell est p. 61).
- Voir, par exemple, Ivan Illich, Medical Nemesis: The Expropriation of Health, Pantheon, 1976 ; Deschooling Society, Harper & Row, 1971 ; Tools for Conviviality, Harper & Row, 1973.
- Marc Stears, “The Case for a State that Supports Relationships, not a Relational State”, in Cooke and Muir, The Relational State, op. cit.
- Cité dans Peer to Peer Foundation, “Commons Transition Primer”, 2017. http://primer. commonstransition.org/archives/glossary/peak-hierarchy
- James C. Scott, Against the Grain: A Deep History of the Earliest States, Yale University Press, 2017), notamment p. 93-115, 150-182 et 232.
- Leviathan (1651) est un livre écrit par Thomas Hobbes durant la guerre civile anglaise. Hobbes théorise la structure de la société et du gouvernement légitime, défendant les notions de contrat social et de souverain absolu. Leviathan est considéré comme l’un des ouvrages les plus influents sur la théorie du contrat social.
- Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism: The Right for a Human Future at the New Frontier of Power, Public Affairs, 2019.
- James C. Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, Yale University Press, 1998, p. 81-82.
- Stears, “The Case for a State”, art. cité, p. 39.
- Voir, par exemple, Benjamin Barber, If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities, Yale University Press, 2014 ; et le TEDx Global Talk de Barber en 2013 : http://smart-csos.org/ images/Documents/Systemic-Activism-in-a-Polarised-World.pdf
- Murray Bookchin, “Libertarian Municipalism: An Overview ”, octobre 1991. http://dwardmac.pitzer. edu/Anarchist_Archives/bookchin/gp/perspectives24.html
- Kate Shea Baird, “A New International Municipalist Movement is on the Rise—From Small Victories to Global Alternatives”, openDemocracy, 7 juin 2017. https://www.opendemocracy.net/en/can-europemake-it/new-international-municipalist-movement-is-on-rise-from-small-vic/
- Le terme a été imaginé par le designer italien Ezio Manzini et il est longuement expliqué sur le site de la P2P Foundation : https://wiki.p2pfoundation.net/Small,_Local,_Open_and_Connected_As_Way_ of_the_Future
- Symbiosis Research Collective, “How Radical Municipalism Can Go Beyond the Local”, The Ecologist, 8 juin 2018. https://theecologist.org/2018/jun/08/how-radical-municipalism-can-go-beyond-local
- Ibid.
- https://walbei.wordpress.com/2015/06/15/was-bleibt-vier-jahre-nach-der-protestbewegung-15m-in-spanien/
- Nikolai Huke, « Politik der ersten Person. Chancen und Risiken am Beispiel der Bewegung 15-M in Spanien », Sozial.Geschichte Online / Heft 21 / 2017. https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00044168/10_Huke_Politik.pdf
- Cité dans David Bollier, “State Power and Commoning: Transcending a Problematic Relationship”, rapport d’un atelier organisé par le Commons Strategies Group en partenariat avec la Fondation Heinrich-Böll, 2016. https://commonsstrategies.org/state-power-commoning-transcendingproblematic-relationship/
- Simon Sutterlütti et Stefan Meretz, Kapitalismus aufheben. Eine Einladung, über Utopie und Transformation neu nachzudenken, Eine Veröffentlichung der Rosa-Luxemburg-Stiftung, VSA Verlag, 2018, p. 76.
- Ibid., p. 80.
- Joachim Hirsch, « Radikaler Reformismus », in Ulrich Brand, Bettina Lösch, Benjamin Opratko et Stefan Thimmel (dir.), ABC der Alternativen 2.0, VSA Verlag, 2012, p. 182-183.
- Ibid., p. 182-183.
- Bookchin, “Libertarian Municipalism”, art. cité, épigraphe d’ouverture.
- Fabian Scheidler, Das Ende der Megamaschine. Geschichten einer scheiternden Zivilisation, Promedia Verlag, 2015.
- J. K. Gibson-Graham, The End of Capitalism (As We Knew It): A Feminist Critique of Political Economy (1996), University of Minnesota Press, 2006, p. xvi.
- Hannah Arendt, The Human Condition, University of Chicago Press, 1958, p. 200.
- Bruno Latour, Down to Earth: Politics in the new Climate Regime, Polity, 2018.
- Pour un récit glaçant de cette histoire politique, voir Nancy MacLean, Democracy in Chains: A Deep History of the Radical Right’s Stealth Plan for America, Penguin, 2017.
- Jose Luis Vivero Pol, “Transition Towards a Food Commons Regime: Re-commoning Food to Crowdfeed the World”, in Guido Ruivenkamp et Andy Hilton (dir.), Perspectives on Commoning: Autonomist Principles and Practices, Zed Books, 2017. https://www.researchgate.net/publication/316877384_Transition_towards_a_Food_Commons_Regime_Re-commoning_Food_to_Crowd-feed_the_World
- Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions of Collective Action, Cambridge University Press, 1990, p. 90.
- James C. Scott a étudié les hautes terres de cinq nations du Sud-Est asiatique, connues sous le nom de Zomia (“the largest remaining region of the world whose peoples have not yet been fully incorporated into nation-states”), dans The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia, Yale University Press, 2009, p. ix.
- Scott, Against the Grain, op. cit., p. 219-256.
- David Graeber, The Utopia of Rules: On Technology, Stupidity, and the Secret Joys of Bureaucracy, Melville House, 2016.
- Les technologies de registres distribués consistent en de nombreuses variations du registre blockchain dont le Bitcoin a été le pionnier, mais qui se traduisent aujourd’hui par de multiples formes de contrôle social et politique sur les applications de cette technologie, comme les monnaies numériques. Parmi les exemples : Holochain, Ethereum et Fairchain (https://fair-coin.org/en/ fairchains). Voir chapitre 10.
- On pourrait penser que les banques de temps répliquent les valeurs du marché et l’idée d’échange réciproque « un donné pour un vendu », mais en pratique les gens utilisent leurs crédits moins comme des monnaies de transaction que comme un moyen d’aider leurs voisins dans le besoin et de construire un sentiment communautaire. Ils pratiquent une réciprocité accommodante.
- Jens Kimmel, Till Gentzsch et Sophie Bloemen, Urban Commons Shared Spaces, Commons Network, novembre 2018. https://commonsnetwork.org/wp-content/uploads/2018/11/SharedSpaces CommonsNetwork.pdf
- https://www.kening.frl/about-kening-fan-e-greide/
- Par exemple, de vieilles routes d’exploitation forestière ont été abandonnées, le bois a été récolté de manière plus écologiquement responsable, et une attention plus grande a été portée à l’habitat des poissons dans les cours d’eau. David Bollier, “New Film Documentary, ‘Seeing the Forest’”, 5 mai 2015. http://www.bollier.org/blog/new-film-documentary-“seeing-forest”
- David Bollier, “I Am the River, and the River is Me”, 29 juin 2017. http://www.bollier.org/blog/iam-river-and-river-me
- The Te Awa Tupua Act, signé en août 2014 : https://www.legislation.govt.nz/act/public/2017/0007/ latest/whole.html. Voir aussi David Bollier, “The Potato Park of Peru”, in David Bollier et Silke Helfrich (dir.), Patterns of Commoning, Levellers Press, 2015, p. 103-107. https://patternsofcommoning. org/the-potato-park-of-peru/
- Dans les infrastructures créées et gérées par des commoneurs, le caractère « ouvert » est moins significatif que la capacité des commoneurs à protéger et à entretenir leurs infrastructures (par exemple, systèmes Wi-Fi, collections d’information, systèmes de partage d’énergie) face à des entreprises qui cherchent à se les approprier, à des vandales ou à d’autres perturbateurs.
- US Department of Health and Human Services, National Institutes of Health Public Access Policy : https://publicaccess.nih.gov
- Open Commons Linz : https://opencommons.linz.at et https://www.cityofmediaarts.at/topic/open- commons_linz/
- Entrée Wikipédia “Freifunk” : https://en.wikipedia.org/wiki/Freifunk
- Ces droits ne sont pas seulement couverts par la Déclaration universelle des droits humains (art. 22 à 28), mais aussi par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ce dernier a été adopté en même temps que le Pacte relatif aux droits civils et politiques en 1966.
- Cette génération, même difficile à imposer, est extrêmement pertinente pour les communs puisqu’elle inclut des droits de groupes et collectifs, le droit à l’autodétermination et les droits à la communication.
- De manière intéressante, ces documents s’inscrivent dans la traduction juridique de la Magna Carta, où a été incorporée la charte de la forêt qui garantissait les droits d’usage des commoneurs.
NOTES DU CHAPITRE 10
- https://www.wikihouse.cc et https://medium.com/wikihouse-stories/wikihouse-design-principles47a49aec936d
- https://permacultureprinciples.com/principles/
- https://terredeliens.org
- https://www.kosmosjournal.org/article/people-sharing-resources-toward-a-new-multilateralismof-the-global-commons/
- https://blog.p2pfoundation.net/a-charter-for-how-to-build-effective-data-and-mappingcommons/2017/04/20
- globalcommonstrust.org/?page_id=20
- Isabel Carlisle, “Community Charters”, Stir Magazine, n° 9, printemps 2015, p. 21-23.
- Falkirk Community Charter : https://www.communitychartering.org/community-charters/
- Pour en savoir plus sur Barcelona en Comú, voir http://wiki.p2pfoundation.net/Barcelona_en_Comú. Pour le code d’éthique : https://barcelonaencomu.cat/sites/default/files/pdf/codi-etic-eng.pdf.
- Pour le plan d’urgence : https://barcelonaencomu.cat/sites/default/files/pla-xoc_eng.pdf 10. Ibid.
- Tim Wu, The Master Switch: The Rise and Fall of Information Empires, Knopf, 2010.
- Cité dans ibid.
- Primavera de Filippi, “Blockchain Technology Toward a Decentralized Governance of Digital Platforms?”, in Anna Grear et David Bollier, The Great Awakening, Punctum Books, 2020.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Mutual_credit
- Trent Lapinski, “WTF is Holochain: The Revolution Will Be Distributed”, HackerNoon, 10 mars 2017. https://hackernoon.com/wtf-is-holochain-35f9dd8e5908
- Entretien avec Eric Harris-Braun, 30 octobre 2018.
- http://metacurrency.org/about/
- Entretien avec Fernanda Ibarra, 30 novembre 2018.
- Deux organisations ont joué un rôle important pour documenter les échecs des contrats publicprivé : In the Public Interest (États-Unis, https://inthepublicinterest.org) et We Own It (RoyaumeUni, https://weownit.org.uk/privatisation-fails). En complément, voir le guide d’In the Public Interest, “Understanding and Evaluating Infrastructure Public-Private Partnerships” : https:// inthepublicinterest.org/guide-understanding-and-evaluating-infrastructure-public-privatepartnerships-p3s/
- Ces protocoles sont fondés sur des “field-experiments designed, analyzed and interpreted by LabGov in several Italian cities, together with 200+ global case studies and indepth investigations run in more than 100 cities from different geopolitical contexts”. Voir http://labgov.city/co-cityprotocol/
- Michel Bauwens et Yurek Onzia, « Commons Transitie Plan voor de stad Gent », juin 2017. https:// blog.p2pfoundation.net/wp-content/uploads/Commons-transitieplan.pdf
- Soma K. P. et Richa Audichya, “Our Way of Knowing: Women Protect Common Forest Rights in Rajasthan”, in David Bollier et Silke Helfrich (dir.), Patterns of Commoning, Levellers Press, 2015, p. 77-82. https://patternsofcommoning.org/our-ways-of-knowing-women-protect-common-forestrights-in-rajasthan/
- Site de DNDi : https://dndi.org
- https://dndi.org/diseases-projects
- https://dndi.org/about-dndi/business-model
- “$1 for 1 Life”, documentaire de Frédéric Laffont, 2010. https://www.youtube.com/watch?v=aSU4yDFwt8
NOTES DE L’ANNEXE A
- Pour une présentation détaillée incluant une justification ontologique, on se reportera à Silke Helfrich, « Lebensform Commons : Eine musterbasierte und ontologisch begründete Bestimmung », thèse pour le diplôme de master, université Cusanus, Institute for Economy, 2018.
- Christopher Alexander, The Nature of Order, vol. I : The Phenomenon of Life, Routledge, 2002.
- Voir en particulier Helmut Leitner, “Working with Patterns—An Introduction”, in David Bollier et Silke Helfrich (dir.), Patterns of Commoning, Levellers Press, 2015, p. 15-25. https://patternsofcommoning. org/working-with-patterns-an-introduction.
- En d’autres termes, notre méthode doit surmonter l’« individualisme méthodologique », comme cela est expliqué au chapitre 2.
- Michael Polanyi, The Tacit Dimension [1966], University of Chicago Press, 2009.
- Un pattern de commoning qui fonctionne dans un tel contexte, par exemple, pourrait devenir un « antipattern » dans un contexte économique capitaliste. En d’autres termes, un pattern qui fonctionne dans un certain contexte ne fonctionnera pas nécessairement dans des contextes très différents.
- Dans le diagramme qui présente le processus d’élucidation (voir p. 363), j’appelle le moment de verbalisation « préhension », d’après Alfred North Whitehead.
- Les questions qui déviaient de cette règle, comme « Avez-vous des rituels ? », ont immédiatement été formulées de manière plus précise, comme « Quels rituels avez-vous ? Décrivez-les ».
- Les patterns spécifiques sont plus concrets que les patterns génériques, mais ils sont incorporés dans les patterns génériques. Un pattern peut être à la fois générique et spécifique. La série de mots suivante illustre l’argument : feuille → branchette → branche → arbre. Une branchette est spécifique par rapport à la branche, mais générique par rapport à la feuille. C’est la même chose pour les patterns.
- Sur la « préhension » et le « sentiment » comme concepts épistémologiques, dans la lignée d’Alfred North Whitehead et de Christopher Alexander, voir la thèse de master de Silke Helfrich, note 1.
- Christopher Alexander, Sara Ishikawa, Murray Silverstein, Max Jacobson, Ingrid Fiksfahl-King, et Shlomo Angel, A Pattern Language. Towns, Buildings, Construction, Oxford University Press, 1977, p. xiv.
- Selon Ivan Illich, la convivialité est la liberté individuelle consciente de son interdépendance.
- Ivan Illich, Tools for Conviviality, Harper and Row, 1973 ; Andrea Vetter, “The matrix of convivial technology: Assessing technologies for degrowth”, Journal of Cleaner Production, vol. 197, n° 2, octobre 2018, p. 1778-1786. https://www.researchgate.net/publication/314271426_The_Matrix_of_Convivial_Technology_-_Assessing_technologies_for_degrowth
- Ce pattern se situe en un sens à un niveau d’abstraction supérieur aux autres parce qu’il les synthétise en tant que mode de production. Cf. Chris Giotitsas et Jose Ramos, A New Model of Production for a New Economy: Two Cases of Agricultural Communities, Source Network / New Economics Foundation, 2017.
